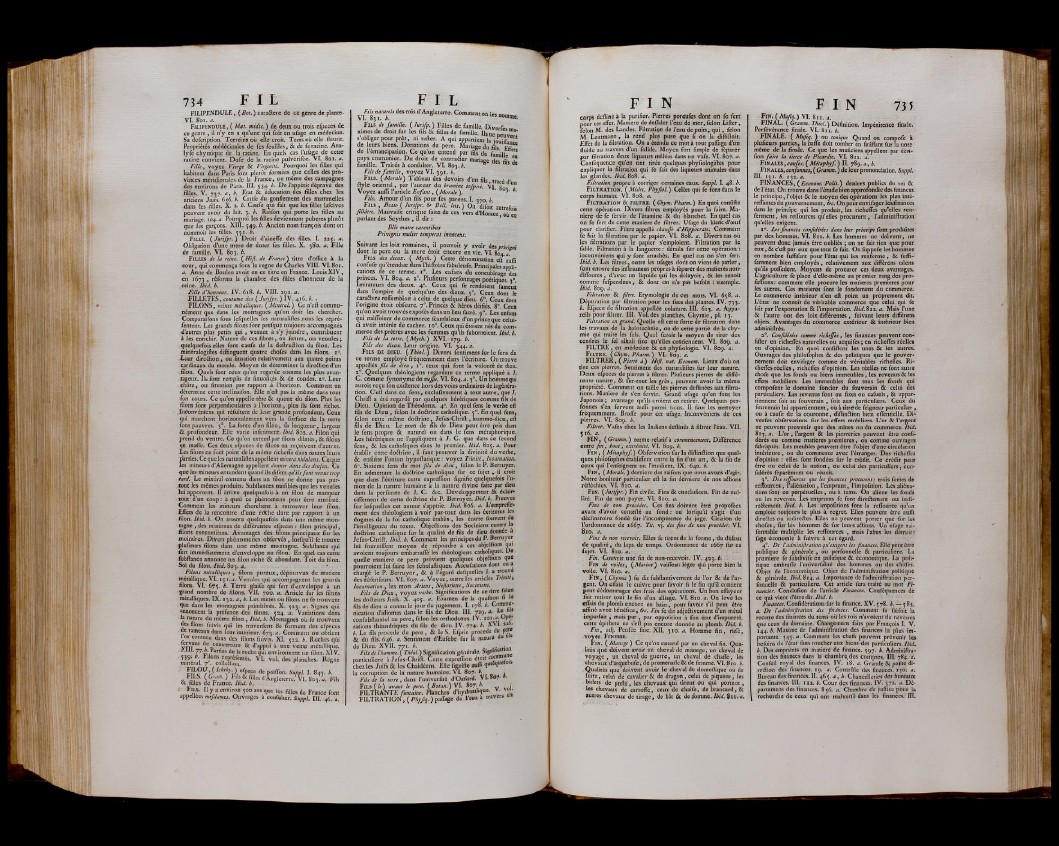
734 F I L F I L
FILIPENDULE, { B o t .) caraûere de ce genre de plante.
.VI. 801. /x. . .
F iu p ln d u le , { Ma t. mcdic. ) de deux ou trois cfpcccs de
ce genre, il n’y en a qu’une qui ioit en ufàge en médecine.
Sa defeription. Terreins où elle croit. Teins où elle fleurit.
Propriétés médicinales de fes feuilles, & de fa racine. Ana-
ly fe chymiquc de la racine. En quels cn s l’ufage de cette
racinê convient. Dofc de la racine pulvérifée. V l. 801. a.
F ille , v o y e z Vierge & Virginité. Pourquoi les filles qui
habitent dans Paris font plutôt formées que celles des provinces
méridionales de la France, ou même des campagnes
des environs de Paris. III. 534- Us. De l’appétit dépravé des
Elles. V. 737. a , b. Etat & éducation des Elles chez les
anciens Juifs. 6$6. b. Caufe du gonflement des mammelles
dans les Elles. A. 2. b. Caufe qui fait que les Elles lafeives
peuvent avoir du lait. 3. b. Raifon qui porte les Elles au
mariage. 104. 0 Pourquoi les Elles deviennent puberes plutôt
que les garçons. XIII. 349. b. Ancien nom françois dont on
nommoit les Elles, 3 31. b.
F i l l e . ( Jurifpr. ) Droit d’aineffe des Elles. I. 22 c. a.
Obligation d’une.mere de doter fes Elles. X. 380. a. Fille
de famille. V I. 803.. b.
FlLLES de la reine. { H iß . de France) titre d’ofHce à la
cour, qui commença fous le regne de Charles VIII. V I .801.
a. Anne de Boulcn avoit eu ce titre en France. Louis X IV ,
en 1673 , réforma la çhambre des Elles d’honneur de la
reine, ibid. b.
F ille d ’honneur. IV . 618. b. VIII. 291. a.
F ILLETES, coutume des ( Jurifpr.)^ IV . 416. b. .
FILONS, veines métalliques. ( Minéral. ) Ce n’eft communément'
que dans les montagnes qu’on doit les chercher.
Comparaifons fous lefquelles les naturalises nous les repré-
fentent. Les grands Elons font prefquc toujours accompagnés
d’autres plus petits q u i, venant à s’y joindre, contribuent
i les enrichir. Nature de ces fibres, ou fentes, ou venules ;
. quelquefois elles font caufe de la deilruélion du Elon. Les
minéralogifles distinguent quatre chofes dans les Elons. i°.
.Leur dircétion , ou fuuation relativement aux quatre points
cardinaux du monde. Moyen de déterminer la direélion d’un
• filon. Quels font ceux qu’on regarde comme les plus avan-
■ tageux. Ils font remplis de finuofités, & de coudes. a°. Leur
■ chûtc, ou Etuation par rapport à l’horizon. Comment on
détermine cette inclinaifon. Elle n’eft pas la même dans tout
fon cours. Ce qu’on appelle tête & queue du Elon. Plus les
Elons font perpendiculaires à l’horizon, plus ils font riches.
.Inconvéniens qui réfuitciu de leur grande profondeur. Ceux
qui marchent horizontalement vers la furfàce de la terre
font pauvres. '3°. La forte d’un Elon, fa longueur, largeur
& profondeur. Elle Varie infiniment. Ibid. 802. a. Filon qui
prend du ventfc. Ce qu’on entend par filons dilatés, & filons
en maffe. Ces deux efpeces de filons en reçoivent d’autres.
Les filons ne font point de la même richcffe dans foutes leurs
ÎParties. Ce que les naturalises appellent minera nidulans. C e que
es mineurs d’Allemagne appellent donner dans des drufen. Ce
que les mineurs entendent quand ils difent qu’ils font venus trop
tard. Le minéral contenu aans un Elon ne donne pas partout
les mêmes produits. SubSances nuifibles que les venules
lui apportent. 11 arrive quelquefois à un Elon de manquer
■tout d’un coup: à quoi ce phénoiriene peut être attribué.
Comment les mineurs cherchent à retrouver leur Elon.
Effets de la rencontre d’une rdbhé dure par rapport i un
Elon. Ibid. b. On trouve quelquefois dans ’ une même montagne
, des minéraux de différentes efpeces : filon principal,
Elons conconlifans. Avantages dés filons;principaux fu r ie s
moindres. Divers phénomènes obfervés,. lorfqu’il fc trouve
plufieurs Elons dans une même montagne. Stibftancë qui :
fert immédiatement d’enveloppe au Elon. En quel cas cette
fubftance annonce un Elon riche & abondant. To it du filon.
Sol du Elon. Ibid. 803. a. *.
Filons métalliques , Elons poreux, dépourvus de matière
métallique. V I. 13 t .a . Venulcaqui accompagnent les grands !
Elons. VI. 673. b. Terre glaife qui fert d’enveloppe à un
grand nombre de EUwis. v i l . 700. a. Article fur les filons :
métalliques. IX. i 3 2. a , b. Les mines ou Elons ne fe trouvent
que dans les montagnes primitives. X. 523. a . Signes qui
annoncent la préfence des Elons. 324. a. Variations dans !
a ° iiUrc m^mc » Ibid. b. Montagnes où fe trouvent :
des filons Suivis qui lés traverfent- &• forment des cipeccs
ue rameaux dans leur intérieur. 673.«, Comment on obtient
or contenu dans des filons fuivis. XI. 322. b. Rochésqùi
■vm*nt l _C0livertl>re & d’appui à une veine métallique.
77 r 'i dc larOchcqui environnent un filon. X IV.
minéral Vpl* d*S P,anchcs' Rcßne
’J “ W , *§’* !* * Çoiffon. Suppl. I. 843. 4.
H ® L ? «"«d'Anglcu.-rrc. V l. 803 «. Fils
& filles de France. Ibid. b. ° 3
11 II 500 ans11'"' H de France font
appelées mtfdamu. Ouvrages i confulwr. Suppl. III.
VIf '8 T f d“ r° iS d An^ etcrre' Comment on les
V il s de famille. U u r lfp .) Filles de famille. Diverfes™
aimes de droit fur les dis & dlles de famille. Ils ne neu
s’obliger pour prêt, ni «fier. A qui appartient la i o u S !
de leurs biens. Donations du pere. Mariage du dis Eff
de l’émancipation. C e qu’on entend par du de famille
pays coutumier. D u droit de contraâer mariaec H., a . ?
famille. Traités à confulter. V I. 803.4. 8 S f l l dl
F ils de famille, v o y e z V I. 391. b.
F il s . (Mo ra le ) Tableau des devoirs d’un dis, tracé d’un
ftyle oriental, par l’auteur du bramine infpiré VI ft«, l
V o y e z aufii l’article E n fa n t , {Morale ). F
Fils . Amour d’un fils pour fes parens. I. 370. b.
F u s , B eau-(Jur ifpr . & B ell, lett .) On difoit autrefois
fillatre. Mauvaife critique faite de ces vers d’Horaco où en
parlant des Scythes , il dit :
Illîc matre carentibus
Privignis mulier temperat innocent.
Suivant les loix romaines, il pouvoit y avoir des privitmi
dont le perc ou la mere étoit encore en vie. VI. 804. a.
F i l s des dieux. { Myth. ) Cette dénomination eft aiifli
confufe qu’étendue dans l’hiftoire fabuleufe. Principales applications
de ce terme. i° . Les enfans du concubinage des
princes. V I. 804. a. %°. Plufieurs perfonnages poétiques. 30.
Imitateurs des dieux. 40. Ceux qui fe rendoient fameux
dans l’empire de quelqu’un des dieux. 30. Ceux dont le
caraftere reffembloit à celui de quelque dieu. 6°. Ceux dont
l’origine étoit obfcure. 70. Princes 8c héros déifiés. 8°. Ceux
qu’on avoit trouvés expofés dans un lieu Sacré. 90. Les enfâns
qui naiffoient du commerce fcandaleux d’un prince que celui-
ci avoit intérêt de cacher. io°. Ceux qui étoient nés du commerce
des prêtres avec les femmes qu ils fubornoient. Ibid. b.
F i ls de la terre. {M y th .) X V I .-179. b.
F ils des dieux. Leur origine. V L 244. a.
F i l s d e d ie u . ( Théol.•) Divers ientimens fur le fens de
ce terme employé fréquemment dans l’écriture. On trouve
appellés f ils de d ieu , i ° . ceux qui font la volonté de dieu.
20. Quelques théologiens regardent ce terme appliqué à J.
C . comme Synonyme de mejfie. V I ;804. a. 30. Un homme qui
auroit reçu fon exiftence hors des voies ordinaires de la génération.
C e ft dans.ee fens, exclufivement à tout autre, que J.
Chrift a été regardé par quelques hérétiques comme nls de
Dieu. Opinion de Théodotus. 40. En quel fens le verbe eff
fils de D ie u , félon la doélrine catholique. 50. En quel fens,
félon cette'même doélrine, Jefus-Chrift, homme-dieu, eft
fils de Dieu. Le noifi de fils de Dieu peut être pris dans
le fens propre 8c naturel ou dans le Sens métaphorique.
Les hérétiques ne l’appliquent à J. C. que dans ce fécond
fens, 8c les catholiques dans le premier. Ibid. 803. a. Pour
établir cette doélrine, il faut prouver la divinité du verbe,
8c enfuite l’union hypoflatique : voyez Trinité, Incarnation.
6°. Sixième fens du mot fils de dieu , félon le P. Berruyer.
En admettant la doélrine catholique, fur ce fu je t , il croit
que dans l’écriture cette expréffron Egnifie quelquefois l’union
de la nature humaine a la nature divine faite par dieu
dans la perfonne de J. G. 8cc. Développement Ôc éclair*
cillement de cette doélrine du P. Berruyer. Ibid. b. Preuves
fur lefquelles cet auteur s’appuie, lbid. %06. a. L’empreffe»
ment des théologiens à voir par-tout dans les écritures les
dogmes de la foi catholique établis, les écarte fouvent ai
l’intelligence du texte. Objeélions des Sociniens contre la
doélrine catholique fur la qualité de fils de dieu donnée à
Jefus-Chrift. ibid. b. Comment les principes du P. Berruyer
lui foiirnifTçnt moyen de répondre à ces objeélions qui
avoient toujours embarraffé' les théologiens catholiques. De
quelle manière ce pere prévient quelques objeélions que
pourraient lui faire les fcholaftiques. Accufations dont on a
charg’é le P. Berruyer, 8c à l’égard defquellés il a trouve
des défenfeurs. V I. 807. a. V o y e z , outre les articles Trinité i
Incarnation, les mots Ariens, Ncfloriens, Sociniens.
F ils de D ie u , v o y e z verbe. Significations de ce titre félon
les doéleurs Juifs. X. 405. a. Examen de la «ueftfoH « p
fils de dieu a connu le jour du jugement. I. 178.be Lommu-
nicarion d’idiomes dans le fils de Dieu. III. 729. a. Le nis
confubftantiel au pere, félon les orthodoxes. IV.
rations théandriques du fils de dieu. IV. 774. b. XVI. onob.
Le fils procédé du pere, 8c le S. Efprit procède du pw
8c dû fils. 646. a. Sentiment d’Eufebe fur la naturé du
de Dieu. XVII. 771 . b. Jd^ à n a
F ils de Ihomme. ( Théol.) Significatioh générale.
particulière à Jefus-Chrift. Cette expreffion étoit cort
chez les Juift 8c les Chaldécns. Elle Egnifie aufii qualq
la corruption de la nature humaine, v l. 807. b. .
F ils de la terre, dans l’univerfué d’Oxford. VI*
F i l S ( l e ) avant le pere. {B o ta n .) VI. So% b . :
F ILTR AN TE fontaine. Planches d’hydrauhqoe. v . vo •
F IL T R A T IO N , ( Phyftq.) paflage de l’éau à travers
F I N F I N
corps deftiné à la purifier. Pierres poreufes dont on fe fert
pour cet effet. Manière de defialer l’eau de mer, félon Lifter,
félon M. des Landes. Filtration de l’eau depuits, q u i, félon
M. Lcutmann, la rend plus pure que fi on la diftilloir.
E ffet de la filtration. On a étendu ce mot à tout pafiàge d’un
fluide au travers d’un folide. Moyen fort fimple de léparer
par filtration deux liqueurs mêlées dans un vafe. VI. 807. a.
Confêquence qu’en ont tirée quelques phyfiologiftes pour
expliquer la fibration qui fc fait des liqueurs animales dans
les glandes. Ibid. 808. a.
Filtration propre à corriger certaines eaux. Suppl. I. 48. b.
F il t r a t io n . (Médec. Phyfiol.) Celles qui fe font dans le
coras humain. VI. 808. a.
F il t r a t io n 8c f il t r e . {Chym. Phatm.) En quoi confifte
cette opération. Divers filtres employés pour la faire. Maniéré
de fe fervir de l’étamine 8c du blanchet. En quel cas
on fe fert de cette maniéré de filtrer. Ufage du blanc d’oeuf
pour clarifier. Filtre appelle chauffe d'Hippocrate. Comment
fe fait la filtration par le papier. VI. 808. a. Divers cas où
les filtrations par le papier s’emploient. Filtration par le
fable. Filtration à la languette : détails fur cette opération :
inconvéniens qui y font attachés; En quel cas on s’en fert.
Ibid. b. Les filtres. outre les ufages dont on vient de parler,
font encore des inuruinens propres à féparer des matierés non-
aiffoutes, d’avec un liquide qui les délayoit, 8c les tenoit
comme fufpcndues, 8c dont on n’a pas befoin : exemple.
Ibid. 809. à.
Filtration 8c filtre. Etymologie de ceS mots. VI. 638. a.
D épuration par filtration pour les fucs deS plantes. IV . 733.
b. Efpece de filtration appcllée cola tu re. IIL 613. a. Appareils
pour filtrer. III. Vol. des planèhés. Chymie, pl. 13.
Filtration en grand. Quelle eft cettè forte de filtration dans
les travaux de la halotechnie, ou de cette partie de la chymie
qui traite les fels. Quel ferait le moyen de tirer des
cendres le fel alkali Exe qu’elles contiennent. VI. 809. a.
F ILTR É , en médecine 8c ert phyfiologic. VI. 809. a.
F il tr e . {Chvtn. Pharm.) VI. 809; a.
FILTRER, ( P'ierrt à ) Hifi. nat. Eeonom. Lieux d’où on
tire ces pierres. Sentiment des naturalises fur leur nature.
Deux efpeces de piérres à filtrer. Plufieurs pierres de différente
nature, 8c fur-tout les g rés, peuvent avoir la même
propriété. Comment on taille lés pierres deftinées aux filtrations.
Maniéré de s’en fervir. Grand ufage qu’en font les
Japonois t avantage qu’ils croient en retirer. Quelques per-
fonnes s’en fervent aufii parmi faous. Il faut les nettoyer
fréquemment. Brofle pour cet ufage. Inconvénicrts de ces
pierres. V I. 809. b.
Filtrer. Va fes chez les Indiens deftinés à filtrer l’eau. VII.
5x6. a.
F IN , ( Gramm. ) terme relatif à commencement. Différence
entre f in , bout, extrémité. VI. 809. b.
F in , ( Métaphyf. ) Obfervation fur la diftinélion que quelques
philofophes établiffent entre la En d’un art, 8c la En de
ceux qui l’cnfeignent ou l’étudient. IX. 640. b.
F in , {Morale. ) dernière des raifonsque nous avonS d’agir.
Notre bonheur particulier eft la En dérnicre de nos aélions
réfléchies. VI. 810. a.
F in . {Jurifpr.) Fin civile. Fins 8c conduirons. Fin de nullité.
Fin de non payér. VI. 810. a.
Fins de non procéder. Ces fins doivent être propôfées
avant d'avoir contefté au fond : ou ibrfqu’il s’agit d’un
déclinatoire fondé fur l’incompétence du juge. Citation de
l’ordonnance de 1667. Ttâ vj. des fins de non procéder. VI.
810. a.
Fins 4e non recevoir. Elles fe tirent de la forme, du défaut
de qualité, du laps, de temps. Ordonnance de 1667 fur ce
fujet. VI. 810. a.
Fin. Couvrir une.fin de non-rcceVoir. IV . 423. b.
F in de voiUst {M a r in e ) vaiffeau léger qui porte bien la
voile. VI. 810. a.
F in , { fh ym ie ) fe dit fubftantivemcnt de l’or 8c de rangent.
On elfaie le cuivre pour favoir fi le fin qu’il contient
peut dédommager des frais des opérations. Un bon effayeur
fait retirer xout le fin d’un alliage. VI. 810. a. On leve les
eflais du plomb encore en bain, pour favoir s’il peut être
affiné avec bénéfice j 6>c. Fin fe dit adjeélivement d’un métal
imparfait, mais pur, par oppofition à fon état d’impureté,
cette épithetc ne s’eft. pas encore donnée au plomb. Ibid. b.
F in , adj. Penfce fine. XII. 310. a. Homme E n , rufé,
vo yez F inesse;
F in . {Manege) Ce qu’on entend par un cheval En. Qualités
qué doivent avoir un cheval de manege, un cheval de
voyage , un cheval de guerre, un cheval dé chafle, lés
chevaux d’irqüebufe, de promenade Sc'de femme. VI. 810. b.
. Qualités que doivent avoir le cheval de domeftique 011 de
fuite, celui de cavalier 8c de dragon, celui de piqueur, les
bidets de porte, les chevaux qui tirent Ou qui portent,
les chevaux de carroiTç, ceux de chaife, de brancard, 8c
autres chevaux de tirage, de bât 8c de fomme. Ibid. $ 1 1 , a.
F in . ( Mufiq. ) VI. 811.
FINAL. {Gramm. Théol.) Définition. Impénitence finale.
Perfévérance finale. V L 811. b.
FINALE. ( Mufiq. ) ou tonique Quand on compofc à
plufieurs parties, la baffe doit tomber en finiffant fur la note
même de la finale. C e que les muficiens appellent par déri-
Eon faire la tierce de Picardie. V I. 81 x. a.
F in a le s , caufes. { Métaphyf. ) II. 789.a , b .
F inales, confonnes, {Gramm. ) de leur prononciation. SuppL
III. 131. b. 132.4*.
FINANCES, {Econom. P o lit A deniers publics du roi 8c
de l’état. On trouve dans l’étude bien approfondie des finances
le principe, l’objet 8c le moyen des opérations les plus intè-
reffantes du gouvernement, 6>c. On peut envifager le&Enanccs
dans le principe qui les produit, les richeffes qu’elles renferment,
les reffources qu’elles procurent, l’adminiftration
qu’elles exigent.
1°. Les finances confidérées dans leur principe font produites
par des hommes. VI. S u . b . Les hommes ne doivent, ne
peuvent donc jamais être oubliés ; on ne fait rien que pour
eux, 8c c’cft par eux que tout fe fait. On fuppofe les hommes
en nombre luffifant pour l’état qui les renferme, 8c fuffi-
famment bien employés, relativement aux différens talens
qu’ils poffedent. Moyens de procurer ces deux avantages.
L’agriculture fe place d’elle-meme au premier rang des pro-
feluons: comment elle procure les matières premières pour
les autres. Ces matières font le fondement du commerce.
Le commerce intérieur n’en eft point un proprement dit.
L’état ne connoit de véritable commerce que celui qui fe
fait par l’exportation 8c l’importation. Ibid. 812. a. Mais l’une
8c l’autre ont des loix différentes, fuivant leurs différens
objets. Avantages du commerce extérieur 8c intérieur bien
adminiftrés.
2°. Confidérées comme richeffes, les finances peuvent confifte
r en richeffes naturelles ou acquifes ; en richeffes réelles
ou d’opinion. En quoi confident les unes 8c les autres.
Ouvrages des philofophes 8c des politiques que le gouvernement
doit envifager comme de véritables richeffes. Richeffes
réelles, richeffes d’opinion. Les réelles ne font autre
chofe que les fonds ou biens immeubles, les revenus 8c les
effets mobiliers. Les immeubles font tous les fonds qui
compofent le domaine foncier du fouVerain & celui dei
particuliers. Les revenus font ou fixes ou cafuels, 8c appartiennent
foit au fouverain , foit aux particuliers. Ceux du
fouverain lui appartiennent, ou à titre de feigneur particulier,
ou à caufe de la couronne, diftinélion bien effentielle. Di-
verfes obfervations fur les effets mobiliers. L’or 8c l’argent
ne peuvent provenir que des mines ou du commerce. Ibid.
813.4*. L’o r , l’argent 8c les pierreries peuvent être confi-
dérés ou comme matières premières, ou comme ouvrages
fabriqués. Les meubles peuvent être l’objet d’une circulation
intérieure, ou du commerce avec l’étranger. Des richeffes
d’opinion : elles font fondées fur le crédit. Ce crédit peut
être ou celui de la nation, ou celui des particuliers, con-
fidérés féparément ou réunis.
3°. De s reffources que les finances procurent: trois fortes de
reffources, l’aliénation, l’emprunt, l’impofition. Les aliénations
font ou perpétuelles, ou h tems. On aliéné les fonds
ou les revenus. Les emprunts fe font direélement ou indi-
rcélcmcnt. Ibid. b. Les impofitions font la reffource qu’on
emploie toujours le plus à regret. Elles peuvent être aufii
direéles ou indireéles. Elles ne peuvent porter que fur les
chofes, fur lés hommes 8c fur leurs aétions. Un ufage rai-
fonnable multiplie les reffources , mais l’abus les détruit :
fage économie à fuivre à cet égard.
4°. D e Vadminifiration qu’exigent les finances. Elle peut étré
publique 8c générale , ou perfonnelle 8c particulière. La
première fe fubdivife en politique 8c économique. La politique
embraffe l'univerfalité des hommes ou dés chofes.
Objet de l’économique. Objet de l’adminiftratron politique
8c générale. Ibid. 814. a. Importance de l’adminiftratron perfonnelle
8c particulière. Cet article fera traité au mot Financier.
Conclufion de l’article Finances. Conféquences de
ce qui vient d’étre dit. Ibid. b .
Finances. Confidérations fur la finance. X V . 378. b. — 382.
a. D e l ’ad/hinifiration des fihdnces. Comment fe faifoit la
recette des finances du tems où les rois n’avoient de révenus
que ceux du domaine. Chàngemens faits par François I. V .
144. b. Maxime de l’adminiitration des finances la plus importante.
345. <». Comment les chefs peuvent prévenir les
befoins de l’état fans toucher aux biens des particuliers. Ibid.
b. Des emprunts en thatiéré de finance. 397. b. Adminifiration
des finances dans la chambrè^dcs comptes. III. 784. à.
Confeil royal des finances. IV. 18. a. Grande 8c petite di-
reélion des finances. 19. a. Contrôle des finances. 130: a.
Bureau des finances. II. 463. a , b. Chancelleries des bureaux
des finances. III. 112. b. Cour des finances. IV. 372. a. Dé-
parteiticns des finances. 836. 4t. Chambre de jumee pour la
| recherche de ceux qui ont malverfé dans les finances. HI.