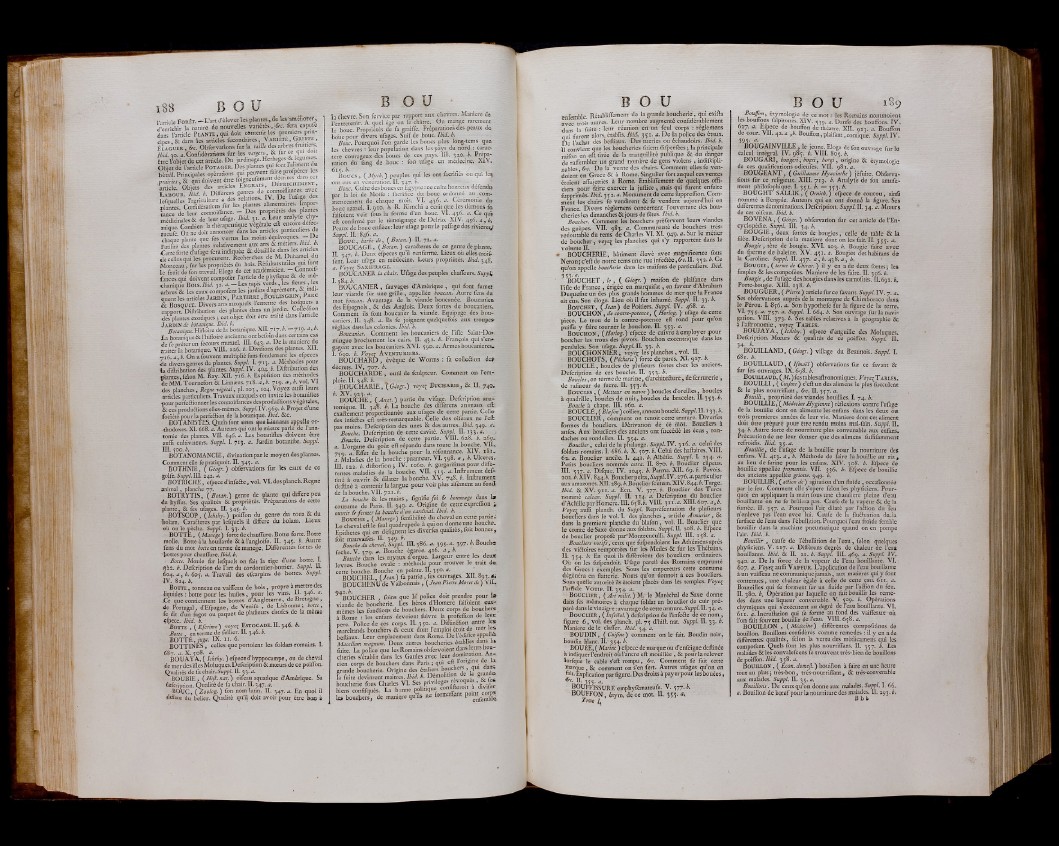
188 B O U B O
l’article F o u i r .- L ’art cl’ékver les plantes,N M £ N jM |
d’enrichir la nature de nouvelles variétés-, j&c. fera expoie
dans l’article P l a n t e , qui doit contenir les premiers principes,
& dans les articles fecondaires. V a r i é t é , G r e f f e ,
É la g u e r 1 6*c. Obfervations fut- la taille des arbres fruitiers.
tbid. %o. a. Gonfidèratiôns fur les vtrgcrs, & fur ce qui doit
Être l objet de cet article. Du ia rd in a g e .H e r ta g e s & cgumes^
Objet de l'article P o ta g e r . Des plantes qtu font 1 aliment du
bétail. Principales opérations qui peuvent
tintiri«, & qui doivent être ^gnenfement^crne s jan s jct
article. Objets des gicles ’connoiffanccs avec
lefqudîes l’agriculture a des relations. IV. De Mage des
nhntes Conîidérations fur les plantes alimentaires, Importance
de leur connoiffance. - Des propriétés des plantes
médicinales & de leur ufage. Ibii. 31. a. Leur analyle cliy-
mique. Combien la thérapeutique végétale eft encore defec-
tueufe On ne doit annoncer dans les articles particuliers de
chaque plante que fes vertus les moins équivoques. - ,Ue
l’utilité des plantes relativement aux arts 6c meners. Ibid. b.
Cette forte (fulage fera indiquée & détaillée dans les articles
«le celles qui les procurent. Recherches de M. Duhamel du
Monceau , fur l à propriétés du bois. Réfultats Indes qui font
le fruit de fon travail. Eloge de cet académicien. - Connoil-
fances qui doivent compoler l’article de phyfique Ce de mé-
chanique Bois.lbii. 3a. n .-L e s tapis verds, les fleurs ,les
arbres & les eaux compofent les jardins d agrément, Siindiquent
les articles J a rd in , P a r t e r r e ,B o u l in g r in , P a r c
& B o squ et. Divers arts auxquels 1 entente des bgfquets a
rapport. Diflrihution des plantes dans un jardin. Coftefton
d « plantes exotiques ; cet objet doit etre traité dans 1 article
JARDIN de botanique. Ibid. b.
Botanique. Hiftoire de la botanique. Xll. 717. b.— jlc).a,b.
La botanique & l’hiftoire ancienne ontbefoin dans certains cas
de fe prêter un fecours mutuel. III. 643. a. De la maniéré de
traiter la botanique. VIII. a26. b. Divifions des plantes. Xll.
716. a.b. On alouvent multiplié fans fondement les efpeces
■de divers genres de plantes. Suppl. I. 713. a. Méthodes pour
la diftribution des plantes. Suppl. IV. 404. b. Diftribution deS
plantes, félon M. Ray. XII. 716. b. Expùfition des méthodes
de MM. Tôurnefort & Linnæus. 718. a% b. 719. a , b. voL VI
des planches, Regne végétal, pl. 103 , 104. Voyez aufli leurs
articles particuliers. Travaux auxquels on invite les botaniftes
pour perfeftionner les connoiffances desprodaétions végétales,
& ces produirions eUes-mèmes. Suppl. IV. 969. b. Projet d’une
fociéte pour laperfeition de la botanique. Ibid. &c.
BOTANISTES. Quels font ceux que Linnæus appelle orthodoxes.
XI. 668. a. Auteurs qui ont le mieux parlé de l’ana-
tomie des plantes. VII. 646. a. Les botaniftes doivent être
aufli cultivateurs. Suppl. I. 713. a. Jardin botanifte. Suppl.
III. <¡00. b. ' ,
BOTANOMANCIE, divination par le moyen des plantes.
Comment elle fe pratiquoit. H. 345. a.
BOTHNIE, ( Géogr. ) obfervations fur les eaux de ce
golfe. Suppl. III. 242. a.
BOTRICHE, efpece d’infede, vol. VI. des planch. Regne
animal, planche 77.
BOTRYTIS, ( Bot an.) genre de plante qui différé peu
du byflus. Ses qualités & propriétés. Préparations de cette
plante, & fes ufages. II. 343. b.
BOTSCOP, {Ichthy. ) poiflon du genre du toua&du
Bolam. Caraderes par lefquels il différé du bolam. Lieux
où on le pèche. Suppl. I. 33. b.
BOTTE, (Manege) forte dechauflùre. Botte forte.Botte
molle. Botte à la houflarde & à l’angloife. II. 343. b. Autre
'fens du mot botte en terme demanege. Différentes fortes de
bottes pour chauflùre. Ibid. b.
■ Botte. Moule fur lefquels on fait la tige d’une botte. I.
<3^2. b. Defcription de l’art du cordonnier-bottier. Suppl. II.
604. a, b. 603. a. Travail des efearpins de bottes. Suppl.
IV. 814. b. I 1
Bo tte, tonneau ou vaiffeau de bois, propre à mettre des
liquides : botte pour les huiles, pour les vins. u. 346. a.
Ce que contiennent les bottes d Angleterre, de Bretagne,
de Portugal, d’Efpagne, de Venife , de Lisbonne; botte,
fe dit d’un fegot oupaquet de plufieurs choies de la même
efpece. Ibid. b. \ _ _ . .
la dhevre. Son fervice par rapport aux chèvres. Manière de
l’entretenir. A quel âge on le châtre. On mange rarement
le bouc. Propriétés de fa graifte. Préparations des peaux de-
bouc pour divers ufages. Suif de bouc. Ibid. b.
Bouc. Pourquoi l’on garde les boucs plus long-tems que,
les chevres *• leur population dans les pays du nord : caractère
BOTTE , ( Efcrime) voyez ESTOCADE. II. 346. b.
Botte , en terme de fellier. H. 346. b.
BOTTÉ, juge. IX. 11. 6. .
BOTTINES, celles que portoient les foldats romains. I.
687. a. X. 308. a.
BOUAYA, ( Ichthy. ) efpece d’hyppocampe, ou de cheval
de mer des ifles Moluques. Defcription & moeurs de ce poiflon.
.Qualités de fa chair.Suppl. H. 33. a.
BOUBIE, ( Hift.nat.) oifeau aquatique d’Amérique. Sa
defcription. Qualité de fa chair. 11.347. a.
•BOUC, 1 Zoolog. ) fon nom latin. II. 347. a. En quoi il 1
différé du belier. Qualité qu’il doit avoir pour être bon à
courageux des boucs de ces pays. III. 320. b. Préparation
du fang de bouc : fort ufage en médecine. XIV.
B ou c s , ( Myth. ) peuples qui les ont facrifiés ou qui lè||
ont eus en vénération; II. 347. b. ' * m/• 1
Bouc. Culte des boucs en Egypte : ce culte honteux défendu*
par la loi de Moïfe : facrifke du bouc ordonné au commencement
de chaque mois. VI. 436. a. Cérémonie du-
bouc azazel. I. 9x0- é» R- Kimchi a écrit que les démons fe,
fàifoient voir fous la forme d’un bouc. VI. 4j6.-a. Ce qui
eft confirmé par le témoignage de Delrio. XIV. 436. a , b1
Peaux de bouc enflées : leur ufage pour le paflage des rivières^
Suppl. II. 846. a.
BO U C , barbe de, ( Botan.) IL 72. a.
BOUCAGE, (Botan.) carafteres de ce genre de plante»
II. 347. b. Deux efpeces qu’il renferme. Lieux où elles croié
fent. Leur ufage en médecine. Leurs propriétés. Ibid. 348,
a. Voyez Sa x ifrag e. .
BOUCANER la chair. Ufage des peuples chafleurs. Suppl»
I .384.é.
BOUCANIER , fauvages d’Amérique , qui font fumet
leur viande fur une grille, appellée boucan» Autre fens du
mot boucan. Avantage de la viande boucanée. Boucanies
des Efpagnôls, & des Anglois. Deux fortes de boucaniers.
Comment ils font boucaner la viande. Equipage des boucaniers.
II. 348. a. Us fe joignent quelquefois aux troupe»
réglées dans les colonies. Ibid. b.
Boucanier. Comment les boucaniers .de l’ille Saint-Do*
mingue brochettent les cuirs. II. 43a* bm François, qui s’en?
gagent avec les boucaniers. XVI. 390.4. Armes boucanieres»
1. 690. b. r om A venturiers..
BOUCHARD, évêque de Worms : fa collection de»
décrets. IV, 707. b.
BOUCHARDE, outil de fculpteur. Comment on l’em.r
ploie. II. 348. b.
. BOUCHARIE, | Géogr. ) voyez Bucharie , & II. 740.
h. XV. 923. a. . . . . . . .
BOUCHE, | Anat. ) partie du vifage. Defcription anatomique.
IL 348. b. La bouche des diftérens animaux, eft
exactement proportionnée aux ufages de cette partie. Celle
des infeéteseft très-remarquable. Celle des oifeaux ne l’eft
pas moins. Defcription des unes & des autres. Ibid. 349. a.
Bouche. Defcription de cette cavité. Suppl. II. 133. a.
Bouche. Defcription de cette partie. VIII. 628. b. 269.,
a. L’organe du goût eft répandu dans toute la bouche. VIL.
739. a. Effet de la bouche pour la réfonnance. XIV. 181..
a. Maladies de la bouche : puanteur. VI. 398. a , b. Ulcérés*
III. 122. b. diftorfion; IV. 1060. b. gargarifmes pour diffé- .
rentes maladies de la bouche. VII. 313. a. Infiniment def-
tiné à ouvrir & dilater la bouche. XV. 748. b. Inftrument
deftiné à contenir la langue pour voir plus aifément au fond
de la bouche. VII. 721. b.
La bouche & les mains , fignifie foi & hommage dans 1»
coutume de Paris. II. | f § £ Origine de cette expreflion *
ouvrir b fermer la bouche d’un cardinal. Ibid. b. ■
B o u c h e ( Manège) fenfibilité du cheval en cette partie.!
Le cheval eft le feul quadrupède à qui on donne une bouche.
Epithetes qui en défignent les diverfes qualités, foxt bonnes ,
foit mauvaifes. II. 349. b-
Bouche du cheval. Suppl. m. 386. a. x93. a. 397- | Bouch«
feche. V . 379- *• Bouche, égarée. 416. a , b. I
Bouche dans les tuyaux dTorgue. Largeur entre les deux
levres. Bouche ovale : méthode pour trouver le trait de.
cette bouche. Bouche en pointe. II. 3 30. a. •
BOUCHEL, (Jean) fa patrie, fes ouvrages. XII. 893.4,'
BOUCHENU de Valboimais, ( Jean Pierre Moret de) VU.
94BOUCHER , foins que la* police doit prendre pour I»
viande de boucherie. Les héros d’Homerè fàifoient eux-,
mêmes les fondions de bouchers. Deux corps de bouchers |
à Rome : les enfans devoient fuivre la profeflion de leur
pere. Police de ces corps. II. 330. a. Diftinftion entre les,
marchands bouchers & ceux dont l’emploi étoit de tuer les
beftiaux. Leur emplacement dans Rome. De l’édifice appelle
Macellum magnum. Deux autres boucheries établies dans 1»
fuite. La police que les Romains obfervoient dans leurs boucheries
s’établit dans les Gaules avec le u r dojmnation. An-,
cien corps de bouchers dans Paris ; qui eft 1 origine a
grande boucherie. Origine des étaliers bouchers, q
la fuite devinrent maîtres. Ibid. b. Démobtion‘ .
boucherie fous Charles VI. Ses privilèges r^ ^
biens confifqués. La bonne politique
t o bouebets, * jnaniçte q«*1« fc r! " r f e^. P eni-enj,i<i
B O U B O U 189
êRÎemble. Rétabliflement !fl| Il grande boudierie, qui eüiftâ
avec trois autres. Leur nombre augmenté confidérablement
dans la fuitè : leur réunion ert un feul corps : régleniens
qui furent alors, établis. Ibid. 331. a. De la police des étaux.
De l’achat des beftiaux. 'Des tuèries ou échaudoirs. Ibid. h
U convient que les boucheries foient difperfées ; la principale
raifon en eft tirée de la tranquillité publique & du danger
de raflembler un grand nombre de gens violens , indifcipli-
nables, 6*c. De la vente des chairs. Comment elles fe ven-
doient en Grece & à Rome. Singulier fort auquel ces ventes
étoient aflùjetties à Rome. Etamiflement de quelques officiers
pour faire exercer la juftice, mais qui furent enfuite
fupprimés. Ibid. 332 .a. Monument de cette îupprefllon. Comment
les chairs fe vendirent & fe vendent aujourd’hui en
France. Divers réglemens concernant l’ouverture des boucheries
les dimanches & jours de fêtes. Ibid. b.
Boucher. Comment les bouchers prèfervent leurs viandes
des guêpes. VII. 983. a. Communauté de bouchers très-
redoutable du tems de Charles V I. XI. 949. a. Sur le métier
de boucher, voyez les planches qui s’y rapportent dans le
volume-II.
• BOUCHERIE, bâtiment élevé avec magnificence fous
Néron ; c’eft de notre tems une rue infeélée, bc. II. 3 3 2. b. Ce
qu’on appelle boucherie dans les maifons de particuliers. Ibid.
^ BOUCHET, le , ( Géogr. ) maifon. de plaifance dans
Tille de France , érigée en marquifat, en faveur d’Abraham
Duquefne un des plus grands hommes de mer que la France
ait eus. Son éloge. Lieu où il fut inhumé. Suppl. II. 33 .b.
B o u ch e t , (Jean) de Poitiers. SuppL IV. 468. a.
BOUCHON, de contre-potencet ( Horlog. ) ufage de cette
piece. Le trou de la contre-potence eft rond pour qu’on
puifle y faire tourner le bouchon. II. 333. a.
BOUCHON, (Horlog.) efpece de cuivre à employer pour
boucher les trous des pivots. Bouchon excentrique dans les
pendules; Son ufage. SuppL II. 33. b.
BOUCHONNIËR, voyez les planches, vol. II.
- BOUCHOTS, (Pêcherie) forte de parcs. XI. 027. b.
BOUCLE, boucles de plufieurs fortes chez les anciens»
Defcription de ces boucles. II. 333. A.
Boucles, en terme de marine, d’architeéture, deferrurene,
de raflneur de fucre. II. 333. b.
B oucles , ( Metteur en ouvre ) boucles d’oreilles, boucles
à quadrille, boucles de nuit, boucles de bracelet. II.333. b.
Boucle à chape. III. j6o. a.
BOUCLÉ, (Blafon) collier,anneau bouclé. Suppl. II. 133. b.
BOUCLIER, comment on tenoit cette armure. Diverfes
formes de boucliers. Dérivation de ce mot. Boucliers à
anfes. Aux boucliers des anciens ont fucçédè les écus, ron-
daches ou rondelles. II. 334.a .
Bouclier, celui de la pnalange. Suppl. IV. 316. a. celui des
foldats romains. I. 686. b. X. 307. b. Celui des haftaires.’VIII.
62. a. Bouclier ancile» I. 441. b. Albéfie. Suppl. L 234. a.
Petits boucliers nommés cetra. II. 870. b. Bouclier clipeus.
III. 337. a. Difquc. IV. 1043. b. Parma. XII. 69. b. Pavois.
202. b. XIV. 844. b. Bouclier pelta, Suppl. IV. 276. a. particulier
aux amazones. XU. 289. ¿.Bouclier fcutum.XlV. 844.b. Targe.
Ibid. & XV. 911. a. Ecu. V. 377. b. Boucher des Turcs
nommé calean. Suppl. II. 114. a. Defcription du bouclier
d’Achille par Homere.m. 6 3 8 .Vin. 311. a. Xffi. 607. a, b.
Voyez aufli planch. du Suppl. Repréfeptation de plufieurs
boucliers dans le vol. I. des planches , article Armurier, &
dans la première planche du blafon, vol. ÏÏ. Bouclier que
le comte de Saxe donne aux foldats. Suppl. H. 208. b. Efpece
de bouclier propofé par°Montecuculli. Suppl. m. 138. a.
Boucliers votifs, ceux que fufpendoient les Athéniens après
des viéloires remportées fur les Medes & fur les Thébains.
II. 334. b: En quoi ils différoient des boucliers ordinaires.
Où on les fuipendoit. Ufage pareil des Romains emprunté
des Grecs : exemples. Sous les empereurs cette coutume
dégénéra en flatterie. Noms qu’on donnoit à ces boucliers.
Sous quelle autorité ils étoient placés dans les temples. Viyez
l’arflcle V otif. II. 334. a.
B o u c l ier , (Art milit.) M. le Maréchal de Saxe donne
dans fes mémoires à chaque foldat un bouclier de cuir préparé
dans le vinaigre ¡avantage de cette armure. SupoLH. 34. a.
B ouclier , ( Infeftol. ) defcription de l’infefte ae ce nom,
figure 6 , vol. des planch. pl. 73 d’hift. nat. Suppl. IL 33 .b.
Maniéré de le dafler. Ibid. 34. a.
BOUDIN, ( Cuifine) comment on le fait. Boudin noir,
boudin blanc. II. 334. b.
BOUÉE, ( Marine ^ efpece de marque ou d’enfeigne deftinée
, à indiquer l’endroit ou l’ancre eft mouillée, & pour la relever
lorfque le cable s’eft rompu, . &c. Comment fe fait cette
marque, & comment on s’en fert. Autres ufages qu’on en
ftùt. Explication par figure. Des droits à payer pour les bouées,
BOÙWfssURE emphyfémateufe. V. 577. b.
BOUFFON, étyni, de ce mot. IX. 355. a.
Tome
Bouffon, étymologie de ce mot : les Romains rtônlrnôient
les bouffons falpitones. XIV. 539. Danfe des bouffons. IV»
627. 4. Efpece de bouffon de théâtre. XII. 913. Bouffon
de cour. VII. 42.a ,b. Bouffon, plaifant, comique. SupplIV.
BOUGAINVILLE , le jeune. Eloge de fon ouvraee fur le
calcul intégral. IV. 983. b. VIII. 803. b.
BOUGART, bougeri, bogri, borgi, origine & étymologie
de ces qualifications odieufes. VII. 981. a.
BOUGEANT, ( Guillaume Hyacinthe ) jéfuite. Obferva-
rions fur ce religieux.. XIH. 713. b. Analyfe de fon amufe-
ment philofbphique. I. 331. b. — 3 <x. b.
BOUGHT SALLIK, ( Omith. ) efpece de coucou, ainfï
nommé à Bengale. Auteurs qui en ont donné la figure. Ses
différentes dénominations. Defcription. Suppl. II. 34. a. Moeurs
de cet oifeau. Ibid. b.
BOVENA, ( Géogr. ) obfervation fur cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. III. 34. b.
BOUGIE, deux fortes de bougies, Celle de table & la
filée. Defcription de la maniéré dont on les fait. II. 333. a.
Bougie, tête de bougie. XVI. 203. b. Bougie faite avec
du fperme de baleine. AV. 431.4. Bougies deshabitans de
la Caroline. Suppl. 11.437. a»b. 438.4, b.
B o u g i e , ( terme de Chirur. ) il y en a de deux fortes; les
fimples & les compofées. Maniéré de les faire. II. 35 6. b.
Bougie y de l’ufage des bougies dans les carnofités. H. 691. b.
Porte-bougie. XIII. 138. b.
BOUGUER, ( Pierre ) article fur ce favant. Suppl. IV. 7. 4»
Ses obfervations auprès de la montagne de Chimboraco dans,
le Pérou. I. 836. 4. Son hypothefe fur la figure de la terre.
VI. 733. 4; 7Ç7. 4. Suppl. t 664. b. Son ouvrage fur la navigation.
VIII. 373. b. Ses tables relatives à la géographie &
à l’aftronomie, voyez T a b l e s .
BOUJAYA, (Ichthy.) efpece d’artguille des Moluques»
Defcription. Moeurs oc qualités de ce poiflon. Suppl II»
34. b.
BOUILLAND, ( Géogr. ) village du Beaunois. Suppl I.
681. b.
BOUILLAUD, ( Ifmael ) obfervations fur ce favant &
fur fes ouvrages. IX. 698. b.
B o u il l a u d , (M.) fes tablesaftronomiques. Voyez T a b l e s »
BOUILLI, ( Cuifine ) c’eft un des alimens le plus fucculent
& le plus nourriflant, &c. II. 337. 4.
Bouilli, propriété des viandes bouillies. I. 74. b.
BOUILLIE, (MédecineHygtenne ) réflexions contre l’ufage
de la bouillie dont on alimente les enfans dans les deux ou
trois premières années de leur vie. Maniéré dont cet aliment
doit être préparé pour être rendu moins mal-fain. Suppl. IL
34. b. Autre forte de nourriture plus convenable aux enfans.
Précaution de ne leur donner que des alimens fuffifammenr
refroidis. Ibid. 3 3.4.
Bouillie, de l’ufàge de la bouillie pour la nourriture des
enfans. VI. 413. a , b. Méthode de Faire la bouillie au riz*
au lieu de farine pour les enfans. XIV. 308. b. Efpece de
bouillie appellée fromentée. VII. 336. b. Efpece de bouillie
des ariciens appellée griotte. 949. b.
BOUILLIR, ( aflion de ) agitation d’un fluide, occafionnée
par le feu. Comment elle s’opère félon les phyficiens. Pourquoi
en appliquant la main fous une chaudière pleine d’eau
bouillante on ne fe brûlera pas. Caufe de là vapeur & de la
fumée. II. 337. 4. Pourquoi Pair dilaté par Taélion du îeu
n’enleve pas l’eau avec lui. Caufe de la fluftuation de-la
furfàce de l’eau dans l’ébullition. Pourquoi l’eau froide femble
bouillir dans la machine pneumatique quand on en pompe
l’air. Ibid. b.
Bouillir y caufe de l’ébullition de l’eau, félon quelques
phyficiens. V. 217. a. Différens degrés de chaleur ae l’eau
bouillante. Ibid. & II. 21. b. Suppl. III. 469. 4. Suppl. IV.
940. 4. De la force de la vapeur de l’eau bouillante. V I ..
607. 4. Voyez aufli V a p e u r . L’application de l’eau bouillante
à un vaifleau ne communique jamais, aux matières qui y font
contenues, une chaleur égale à celle de cette eau. 6x1. 4.
Bouteilles qui fé forment fur un fluide par l’aétion du feu.
II. 380. b. Opération par laquelle on fait bouillir les reme-
des dans une liqueur convenable. V. 309. b. Opérations
chymiques qui s’exécutent au degré de l’eau bouillante. VI.
611. 4. Incruftation qui fe forme au fond des vaiffeaux où
l’on fait fôuvent bouillir de l’eau. VIII. 638. a.
BOUILLON , (Médecine) différentes compofitions de
bouillon. Bouillons confidérés comme remedes : il y en a de
différentes qualités, félon la vertu des médicamens qui les
compofent. Quels font les plus nourrifians. II. 357. b. Les
malades & les convalefcens fe trouvent très-bien de bouillons
de poiflon. Ibid. 358. a.
B o u il l o n , ( Écon. domeft.) bouillon à faire en une heure
tout au plus ; très-bon, très-nourriflant, & très-convenable
aux malades. Suppl. IL 35.4.
Bouillons. De ceux qu’on donne aux nvdades. Suppl. I. 66.
4. Bouillon de boeuf pour la nourriture des malades. 11. 293. b.
B b b