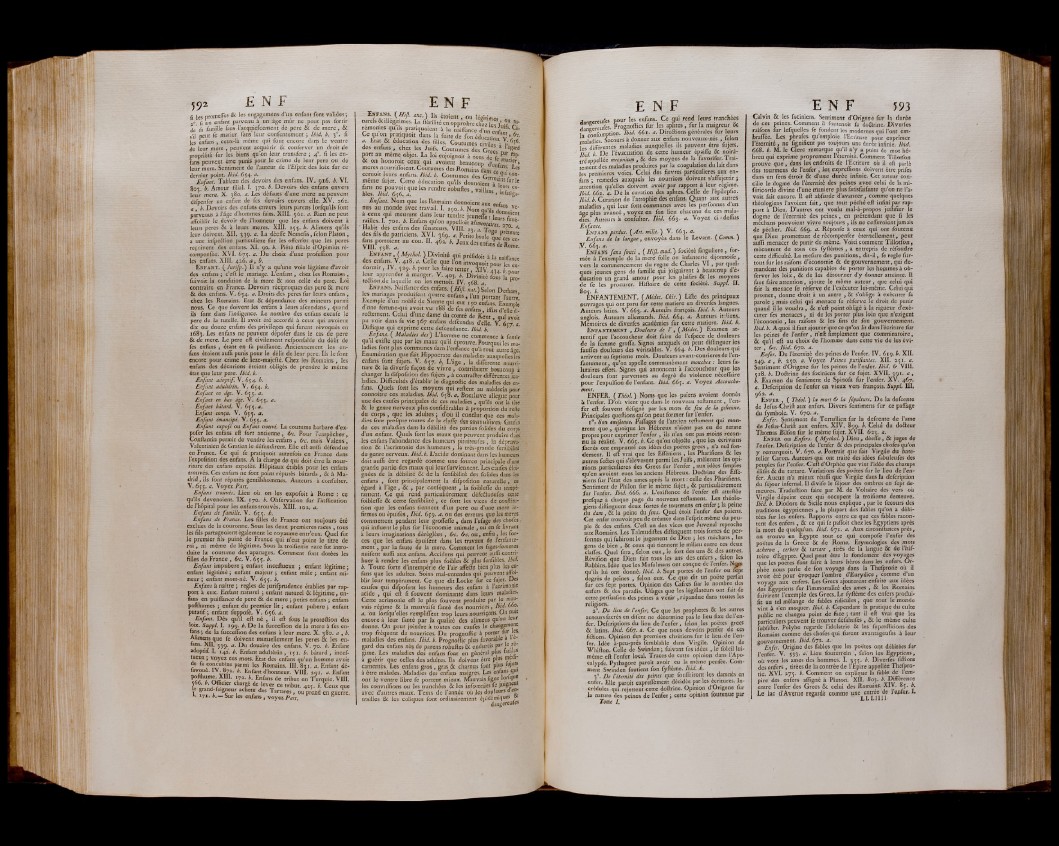
392 £ N F
fi ics promettes Se les engageméns d’un enfant font valides ;
2°. fi un enfant parvenu à un âge mûr ne peut pas fortir
de fa famille fans i’acquiefccmenr de pere Se de mcrc, 8c
s'il peut te marier fans leur confcntcmcnt ; Ibid. b. 30. fi
les enfans, ceux-là même qui font encore dans le ventre
de leur mere , peuvent acquérir Se confervcr un droit de
propriété fur les biens qu'on leur transféré ; 40. fi les en-
fans peuvent être punis pour le crime de leur pere ou de
leur mere. Sentiment de l’auteur de l’Efprit des loix fur ce
dernier point. Ibid. 634. a.
Enfant. Tableau des devoirs des enfans. IV. 016. b. VI.
803. b. Amour filial. I. 370. b. Devoirs des ennuis envers
leur mere. X. 3So. a. Les défauts d’une mcrc ne peuvent
difpcnfcr un enfant de fes devoirs envers elle. XV. 262;
a , b. Devoirs des enfans envers leurs parens lorfqu’ils font
parvenus à l’âge d’hommes faits. XIII. 561. a. Rien ne peut
affoiblir le devoir de l’honneur que les enfans doivent à
leurs peres Se à leurs mères. XIII. 255. b. Alimens qu’ils
leur doivent. XII. 339. a. La décile Nemefis, félon Platon,
a une infpeôion particulière fur les offenfes que les peres
reçoivent des enfans. XI. 90. b. Piété filiale d’Opimius ré-
compenfée. XVI. 673. a. Du choix d’une profefiion pour
les enfans. XIII. 426. a , b.
E n f a n t . ( Jurifv.") Il n’y a qu’une voie légitime d’avoir
des enfans ; c’eft le mariage. L enfant, chez les Romains,
fuivoit la condition de la mere & non celle du pere. Loi
contraire en France. Devoirs réciproques des pere Se mcrc
8c des enfans. V. 634. a. Droits des peres fur feurs enfans,
chez les Romains. Etat Se dépendance des mineurs parmi
nous. Ce que doivent les enfans à leurs afeendans , quand
ils font dans l’indigence. Le nombre des enfans exeufe le
pere de la tutelle. Il avoit été accordé à ceux qui avoient
dix ou douze enfans des privilèges qui furent révoqués en
1683. Les enfans ne peuvent depofer dans le cas de pere
Se de mere. Le pere eft civilement refponfable du délit de
fes enfans , étant en fa puifiânee. Anciennement les enfans
étoient auifi punis pour le délit de leur pere. Us le font
encore pour crime de lezc-majcfté, Chez les Romains, les
enfans des décurions étoient obligés de prendre le même
état que leur pere. Ibid. b.
Enfant adoptif. V. 634. b.
Enfant adultérin. V. 634. b.
Enfant en âge. V. 635. a.
Enfant en bas au. V. 633. a.
Enfant bâtard. V. 633. a.
Enfant conçu. V. 633. a.
Enfant émancipé. V, 03 3. a.
Enfant expofé ou Enfant trouvé. La coutume barbare d’ex-
pofer les enfans eft fort ancienne, 6>c. Pour l’empêcher,
Conftantin permit de vendre les enfans, &c. mais Valons,
Valentinien & Graticn le défendirent. Elle eft auifi défendue
en France. Ce qui te pratiquoit autrefois en France dans
l’expofition des enfans. A la charge de qui doit être la nourriture
des enfans expotes. Hôpitaux établis pour les enfans
trouvés. Ces enfans ne font point réputés bâtards, Se à Madrid,
Us font réputés gentilshommes. Auteurs à confultcr.
V. 633. a. "Voyez Part.
Enfans trouvés. Lieu où on les expofoit à Rome : ce
u’ils devenoient. IX. 170. b. Obfervation fur l’inftitution
c l’hôpital pour les enfans trouvés. XIII. 102. a.
Enfans de famille. V. 653. b.
Enfans de France. Les fuies de France ont toujours été
exclues de la couronne. Sous les deux premières races, tous
les fils partageoient également le royaume entr’eux. Quel fut
le premier fils puine de France qui n’eut point le titre de
roi, ni même de légitime. Sous la troificme race fut introduite
la coutume des apanages. Comment font dotées les
filles de France , bc. V. 633. b.
Enfant impubère ; enfant inceftueux j enfant légitime ;
enfant légitimé ; enfant majeur ; enfant mâle 5 enfant mineur
; enfant mort-né. V. 633. b.
Enfans à naître ; réglés de jurifprudencc établies par rapport
à eux. Enfant naturel ; enfant naturel Se légitime, en-
fans en puiffancc de pere & de mere j petits enfans j enfans
pofthumes ; enfant du premier lit ; enfant pubere ; enfant
putatif ; enfant fuppofé. V. 636. a.
Enfant. Dés qu’il eft né , il eft fous la protection des
I°ix. Suppl. I. 199. b. De la fucceifion de la mcrc à fes cn-
fàns ; de la fucceifion des enfans à leur mere. X. 280. a , b.
Alimens que te doivent mutuellement les peres Se les en-
a *’ 319'. a' douaire des enfans. V. 70. b. Enfant
adopuf. I. 142. b. Enfant adultérin, 131. b. bâtard, inceftueux
; voyez ces mots. Etat des enfans qu’un homme avoit
de fa concubine parmi les Romains. III. 831 .a. Enfant désavoué.
IV .872.. b. Enfant d’honneur. VIII. 201. a. Enfant
pofthume. XIII.
k66. b. Officier
le grand-feigneu
L i7 i. é.— Sur
, — u n « » u t in uu i en 1 urquic.
chargé de lever ce tribut. 423. b. Geu;
ir acheté des Tartares, ou prend en gu
les enfans, voyez Part.
E N F
réntomes qu.ls pramraokn, 1 la n M g d C c V f i '? - ? ’
Cequorlp«K|uq.t dan» la fui,c de fon ¿durai! V V Î
a. t u t & ¿ducat,on des filles. Cou,urnes civil« V O T j
des enfans , chez les Juifs. Coutumes des Gree. Ëfëtà
port au même objet. La loi enjoignoit à tous de f, P « S
& on honoroit ceux qui avoient beaucoup d'™r ' f *
meres nourrifibient. Coutumes des Romains dan/,. ' U '
ccrnoit leurs enfans. Ibid. b. Coutumes des Gcrm
même fujet. Cette éducation qu’ils donnons», 1 rlc
fans ne pouvoir que les rendre robuftes , vaillant 7
blcs. Ibid. 6^6. a. ».inans, uthhgv.
Enfant. Nom que les Romains donnolem aux l ü
nus au monde avec travail. I. 190. b. Nom auils H *
à ceux qui meurent dans leur tendre jeunefle • u Ï Ï T 6?*
rallte. I. 7o, b. Enfans qu’on appelloi
Habit des enfans des fénatcurs. VIII. i i a Tnn*. 1
des fils dcpatriciens. XVI. ¡ » g
v n i p5r,8 . 'T 1 co“ ' 4 | a g S n
E n f a n t , ( Mythol. ) Divinité qui prélldoit i 1 Sm „
des enfans. V. 418. a. Celle que Ion invoniioit pour les endormir,
IV. f 10. ¿.pour les faire terrer, XIV.4,4 b
eur apprend« b manger. V. 403. b. Divinité fous Sffi
tecuon/lc; laquelle on les mettoit. IV. <68. a.
E n f a n s . Naiffance des enfans. (¡ ¡ ¡ g nat. j Selon DcrhamS
les mariages prodmfent quatre enfans, l’u„ portant l’autre
Exemple d un noble de Sienne qui eut 130 enfans. Exemple
d une fcmmc.qtii avoit vu 188 de tes enfans, iftùs d’elledi-
rcacmenr. Celui d une dame du comté de Kent, oui avoit
pu voir dans fa vie 367 enfans deiccndus d’elle. V. 6<7 a
Diftique qui exprime cette dcfcendancc. Ibid. b.
Enfans. ( Maladies des ) L’homme ne commence à fentir
quil extftc que parles maux qu’il éprouve. Pourquoi les maladies
font plus communes dans l’enfance qu’à tout autre âge.
Enumération que fait Hippocratc des maladies auxquelles les
enfans font fujets.V. 6 57. b. L’âge , la différente nourriture
Se la diverfe façon de vivre, contribuent beaucoup à
changer la difpofition des fujets , à contrafter différentes maladies.
Difficultés d’établir le diagnoftiç des maladies des en-
fans. Quels font les moyens qui reftent au médecin pour
connoîtrc ces maladies. Ibid. 658. a. Boeihave allégué pour
une des caufes principales de ces maladies , qu’ils ont la tête
& le genre nerveux plus confidérables à proportion du refte
du corps, que les adultes j d’où il conclut que ces maladies
font prefque toutes de la claffc des convulfivcs. Caufes
de ces maladies dans la débilité des parties folides du corps
d’un enfant. Quels font les maux que peuvent produire dais;
les enfans l’abondance des humeurs pituiteufes, la dépravation
& l’acrimonie des humeurs, la très-grande fcnfibilité
du genre nerveux. Ibid. b. L’acide dominant dans les humeurs
doit auifi être regardé comme une fource principale d’une
grande partie des maux qui lcurfurviennent. Les caufes éloignées
de la débilité Se de la fcnfibilité des folides dans les
enfans , font principalement la difpofition naturelle, eu
égard à l’âge, Se , par conféquent, la foibleffe du tempérament.
Ce qui rend particulièrement défcéhicnfcs cette
foibleftc 8c cette fenfibilité, ce font les vices de cotiftitu*
tion que les enfans tiennent d’un pere ou d’une tnere infirmes
oit épuifés, Ibid. <>39, a. ou des erreurs que les meres
commettent pendant leur groffeffe , dans l’ufagc des chofcs <
qui influent le plus fur l’économie animale, ou en te livrant
à leurs imaginations déréglées , bc. bc. ou, enfin, les forces
que les enfans épuifent dans les travaux de l’enfantement
, par la faute de la mere. Comment les fages-femmes
nuifent auifi aux enfans. Accidens qui peuvent auffi contribuer
à rendre les enfans plus foibles & plus fcnfibles. Ibid.
b. Toute forte d’intempérie de l’air affeae bien plus les enfans
que les adultes. Soins mal-entendus qui peuvent affot-
blir leur tempérament. Ce que dit Locke fur ce fujet. Des
caufes qui difpofent les humeurs des enfans à l’acrimonie
acide , qui eft fi fouvent dominante dans leurs maladies.
Cette acrimonie eft le plus fouvent produite par le mauvais
régime 8c la mauvaife famé des nourrices, Ibid. 660.
a. 'ou lorfqu’elles rcmpliffent trop leurs nourriçons. On nuit
encore à leur fanté par la qualité des alimens qu’on leur
donne. On peut joindre à toutes ces caufes le changement
trop fréquent de nourrices. Du prognoftic à porter ter les
maladies des enfans. Ibid. b. Prognoftic plus favorable a 1 e-
gard des enfans né? de parens robuftes Se endurcis par 1e
gime. Les maladies des enfans font en général plus iac‘‘,c^
a guérir que celles des adultes. Ils doivent être plus metu"
camentés. Les enfans gros, gras 8c charnus font plus
à être malades. Maladies des enfays maigres. Les ênfaus fl*1
ont le ventre libre te portent mieux. Mauvais ûgnçfQtW,
les convulfions ou les tranchées $c les infamnics fc .
avec d’autres maux, Tems de l’année où les douleurs u e -
trailles Se les coliques font ordinairement épidédmaniqgeureesufes
E N F
fans. Ce qui rend leurs tranchées
fur les aphtes, fur la maigreur 8c
1. a. Direélions générales fur leurs
:r aux enfans nouveaux-nés , félon
Range,eufe» P“ r fe lF "
d a n g c r e n f c s .P r o g n o f t ,c S
la cbnfornnlron- 7M. 66
maladies. Secours à donm
i’crdifférentcs maladies auxquelles ils peuvent être fujets.
Ibid b. De l’évacuation de cette humeur épaiffe 8c noirâtre'
appelléc méconium, 8c des moyens de la favorifer. Traitement
des maladies produites par la coagulation du lait dans
les premières voie?. Celui des fièvres particulières aux enfans
j remedes auxquels les nourrices doivent s’aflùjettir ;
attention qu’elles doivent avoir par rapport à leur régime.
Ibid. 662. a. De la curation des aphtes. Celle de l’épilcpftc.
Ibid. b. Curation de l’atrophie des enfans. Quant aux autres
maladies, qui leur font communes avec les perfonnes d’un
âge plus avancé, voyez en fon lieu chacune de ces maladies.
Auteurs à confultcr. Ibid. 663. a. "Voyez ci-dcffus
Enfance.
E n f a n s perdus. ( Art. milit. ) V. 663, a.
Enfans ae la langue, envoyés dans le Levant. ( Comm. )
y . 663. a.
E n f a n s fans fouci, (Hifl.mod.) fociété fingulicre, formée
à l’exemple de la mere" folle ou infanterie dijonnoife,
vers le commencement du regue de Cliarles V I , par quel- • 3ucs jeunes gens de famille qui joignirent à beaucoup dé-
ucation un grand amour pour les plaifirs 8c les moyens
de fc les procurer. Hiftoire de cette fociété. Suppl. II.
803. b. ....... . ..
ENFANTEMENT. ( Médec. Chir. ) Lifte des principaux
ouvrages qui ont paru fur cette matière en diveries langues.
Auteurs latins. V. 663. a. Auteurs françois. Ibid. b. Auteurs
anglais. Auteurs allemands. Ibid. 664. a. Auteurs itrliens.
Mémoires de diverfes académies fur cette maticre. Ibid. b.
E n f a n t e m e n t , Douleurs de V, ( Médec. ) Examen attentif
que l’accoucheur doit faire de l’efpece de douleurs
de la femme groffc. Signes auxquels on peut diftinguer les
fauftcs douleurs des véritables. V. 664. b. Des douleurs <jui
arrivent au fepticme mois. Douleurs avant-couricres de l’cn-
fantement, qu’on appelle,communément mouches : leurs fa-
lutaircs effets. Signes qui annoncent à l’accoucheur que les
douleurs font parvenues au degré de violence néccffàire
pour l’expulfion de l’enfant. Ibid. 663. a. Voyez Accouchement.
ENFER. ( Théol. ) Noms que les païens avoient donnés
à l’enfer. D’où vient que dans le nouveau teftament, l’cn-
fer eft fouvent défigné par les mots de feu de la gehenne.
Principales queftions qu’on peut former fur l’enfer.
i°. Son txiflence. Paffagcs de l’ancien teftament qui montrent
que, quoique les Hébreux n’aient pas eu de terme
propre pour exprimer l’enfer , ils n’en ont pas moins reconnu
la réalité. V. 663. b. Ce qu’ou obje&c , que les écrivains
facrés ont emprunté ces idées des poètes grecs, n’a nul fondement.
Il eft vrai que les Effénicns, les Pharifiens Se les
autres fcêlcs qui s’élevèrent parmi les Juifs, mêlèrent les opinions
particulières des Grecs fur l’enfer , aux idées fimples
qu’en avoient eues les anciens Hébreux. Doftrinc des Effé-
siens fur l’état des ames après la mort : celle des Pharifiens.
Sentiment de Philon fur le même fujet, Se particulièrement
fur l’cnfcr. Ibid. 666. a. L’exiftcncc de l’enfer eft atteftée
prefque à chaque page du nouveau teftament. Les théologiens
diftinguent deux fortes de tourmens en enfer ; la peine
du dam, Se la peine du fens. Quel étoit l’cnfcr des oaïens.
Cet enfer trouvoit peu de créance dans l’efprit même du peuple
8e des enfans. C’eft un des vices que Juvenal reproche
aux Romains. Les Talmudiftcs diftinguent trois fortes de perfonnes
qui fubiront le jugement de Dieu ; les méchans, les
gens de bien , 8c ceux qui tiennent le milieu entre ces deux
elaffes. Quel fera, félon eux, le fort des uns 8e des autres.
Révifion que Dieu fait tous les ans des enfere , félon les
Rabbins. Idée que les Mufulmans ont conçue de l’enfer. Nom
qu’ils lui ont donné. Ibid. b. Sept portes de l’enfer ou fept
degrés de peines , félon eux. Ce que dit un poète perfan
fur ces fept portes. Opinion des Cafres (ut le nombre des
enfers Se des paradis. Ufages que les légiflateurs ont fait de
cette perfuafion des peines à venir , répandue dans toutes les
religions.
2°. Du lieu de l ’enfer. Ce que les prophètes & les autres
auteurs facrés en difent ne détermine pas le lieu fixe de l’enfer.
Descriptions du lieu de l’enfer, fclon les poètes grecs
8e latins. Ibid. 667. a. Ce que nous devons penfer de ces
fixions. Opinion des premiers chrétiens fur le licu.de l’enfer.
Idée a-pcu*prés femblablc dans Virgile. Opinion de
Whifton. Celle de Swindcn; fuivant fes idées , le foleil lui-
méme eft l’enfer local. Traces de cette opinion dans l’Apo-
calypfe. Pytbagorc paroît avoir eu la môme penfée. Comment
Swinden foutient fon fyftêmc. Ibid. b.
3°. De l’éternité des peines que fouffriront les damnés en
enfer. Elle paroit expreffément décidée par les écritures. Incrédules
qui rejettent cette doôrinc. Opinion d’Origene fur
la nature des peines de l’enfer ; cette opinion foutenue par
Tome I,
E N F 593
Calvin 8c les focinicns. Sentiment d’Origene fur la durée
de ces peines. Comment il foutenoit fa doûrinc. Diverfes
raifons fur lefqucllcs fe fondent les modernes qui l’ont cm-
brafTée. Les phrafes qu’emploie l’Ecriture pour exprimer
l’éternité , ne fignifient pas toujours une durée infinie. Ibid.
668. b. M. le Clerc remarque qu’il n’v a point de mot hébreu
qui exprime proprement l'éternité. Comment Tillotfbn
prouve que, dans les endroits de l’Ecriture où il eft parlé
des tourmens de l’enfer, les, expreffions doivent être prifes
dans un fens étroit 8c d’une durée infinie. Cet auteur concilie
le dogme de l’éternité des peines avec celui de la mi-
féricordc divine d’une maniéré plus fatisfaifante qu’on ne l’a-
voit fait encore. Il eft abfurdc d'avancer, comme quelques
théologiens l’avoient fait, que tout péché eft infini par rapport
à Dieu. D’autres ont voulu mal-à-propos juftifier le
dogme de l’éternité des peines , en prétendant que fi les
mcchans pouvoient vivre toujours , ils ne cefTcroient jamais
de pécher. Ibid. 66g. d. Réponfe à ceux qui ont foutenu
que Dieu promettant de récompcnfer éternellement, peut
auifi menacer de punir de même. Voici comment Tillotfon,
mécontent de tous ces fyftêmcs, a entrepris de réfoudre
cette difficulté. La mcfurc des punitions, dit-il, fe réglé fur-
tout fur les raifons d’économie Se de gouvernement, qui demandent
des punitions capables de porter les hommes à ob-
ferver les loix, 8c de les détourner d’y donner atteinte. Il
faut faire attention, ajoute le même auteur, que celui qui
fait la menace fc réferve de l’exécuter lui-méme. Celui qui
promet, donne droit à un autre , & s’oblige à exécuter fa
parole ; mais celui qui menace fc réferve le droit de punir
quand il le voudra, & n’eft point obligé à la rigueur d’exécuter
fes menaces, ni de les porter plus loin que n’exigent
l’économie , les raifons 8e les fins de fon gouvernement.
Ibid. b. A quoi il faut ajouter que ce qu’on lit dans l’écriture fur
les peines de l’enfer , n’eft amplement que comminatoire,
& qu’il eft au choix de l’homme dans cette vie de les éviter
, 6>c. Ibid. 6rjo. a.
Enfer. De l’éternité des peines de l’enfer. IV. 619. b. XII.
249. a , b. 250. a. Voyez Peines purifiantes. XIL 231. a.
Sentiment d’Origene fur les peines de l’enfer. Ibid. & VIIL
318. b. Doârinc des focinicns fur ce fujet. XVIL 391. a ,
b. Examen du tentiment de Spinofa fur l’enfer. XV. 467.
a. Defcription de l’enfer en vieux vers françois. Suppl. 11L
962. a.
Enfer , ( Théol. ) la mort & la fépulture. De la defeente
de Jefus-Chrift aux çnfers. Divers fentimens fur ce pafiàge
du iymbolc. V. 670. a.
Enfer. Sentiment de Terrullien fur la defeente de l’ame
de Jefus-Chrift aux enfers. XIV. 809. b. Celui du doâeur
Thomas Biifon fur le même fujer. XVII. 623. a.
E n f e r ou Enfers. ( Mythol. ) Dieu, déeffe, Se juges de
l’enfer. Defcription de l’enfer & des principales choies qu’on
y remarquoit. V. 670. a. Portrait que fait Virgile du bate-
tclicr Caron. Auteurs qui ont traité des idées fabuleufes des
peuples fur l’cnfcr. C'eft d’Orphée que vint l’idée des champs
éliics 8c du tartarc. Variations des poètes fur le lieu de l’enfer.
Aucun n’a mieux réufli que Vireile dans la defcription
du féjour infernal. Il divife le féjour des ombres en fept demeures.
Traduftion faite par M. de Voltaire des vers où
Virgile dépeint ceux qui occupent la troificme demeure. Îbiê. b. Diodore de Sicile nous explique, par le fecours des
traditions égyptiennes , la plupart des fables qu’on a débitées
fur les enfers. Rapports entre ce que ces fables racontent
des enfers , 8c ce qui fc paffoit chez les Egyptiens après
la mort de quelqu’un, fbid. 071. a. Aux circonftances prés,
on trouve en Egypte tout ce qui compote l’enfer des
poètes de la Grece 8c de Rome. Etymologies des mots
acheron , cerbere Se tartare , tirés de la langue 8c de l’hif-
toirc d’Egypte. Quel peut être le fondement des voyages
que les poètes font faire à leurs héros dans les enfers. Orphée
nous parle de fon voyage dans la Thefproiie où il
avoit été pour évoquer l’ombre d’Eurydice, comme d’un
voyage aux enfers. Les Grecs ajoutèrent enfuite aux idées
des Egyptiens fur l’immortalité des ames , 8c les Romains
fuivirent l’exemple des Grecs. Le fyftêmc des enfers produi-
fit un tel mélange de fables ridicules, que tout le monde
vint à s’en moquer. Ibid. b. Cependant la pratique du culte
public ne changea point de face ; tant il eft vrai que les
particuliers peuvent te trouver défabufés , Se le même culte
fubfiftcr. Polybe regarde l'idolâtrie Se les fuperftitions des
Romains comme des chofes qui furent avantageufes à leur
gouvernement. Ibid. 672. a.
Enfer. Origine des fables que les poètes ont débitées fur
l’enfer. V. 333. a. Lieu fouterrein , félon les Egyptiens,
où vont les ames des hommes. I. 233. b. Diverfes fiftions
des enfers , tirées de la contrée de lEpire appelléc Thefpro-
tié. XVI. 273. b. Comment on explique la fable de 1 empire
des enfers affigné à Pluton. XII. 803. é. Différence
entre l’cnfcr des Grecs 8c celui des Romains. XIV. 83. b.
Le lac d’Ayçrne regardé comme une cnc^ Cj ^