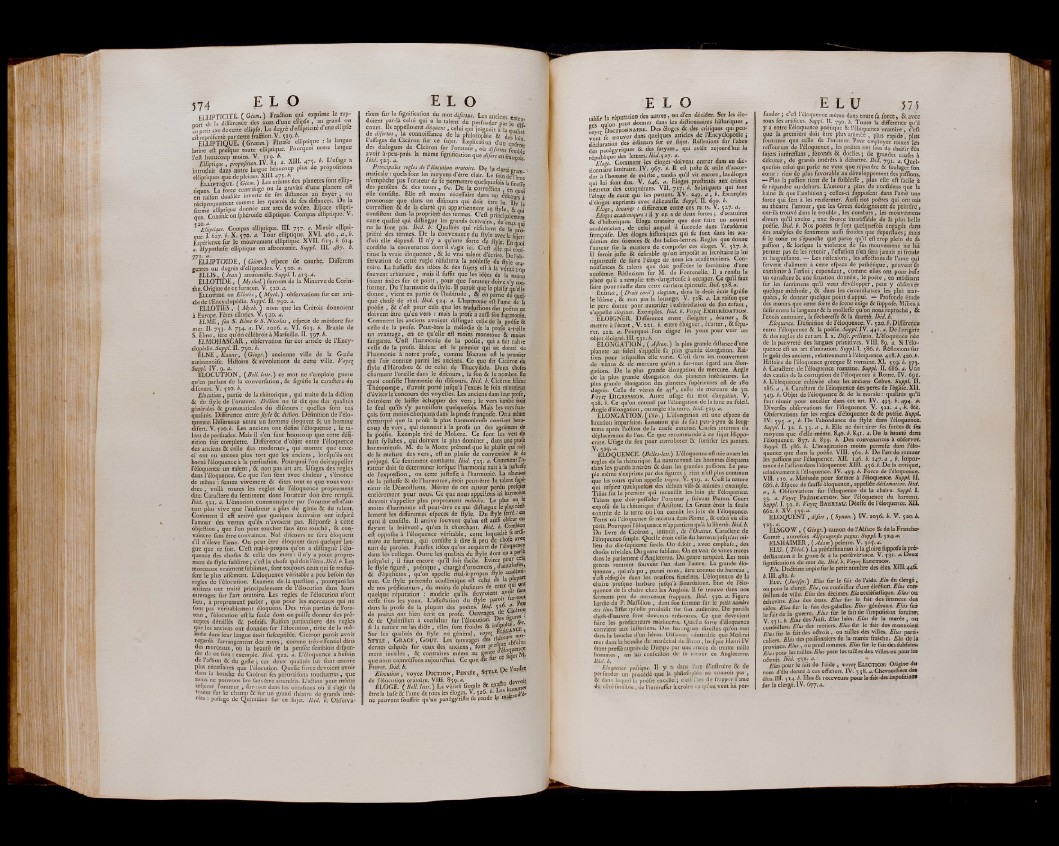
574 E L O E L O
Fî IÎPTÎCITÉ. ( Géom. ) Fraûion qui exprime le rapport
de la différence des axes d’une cllipfe m g | & g
au petit axe de cette ellipfe. Le degré d ellipticité d une ellipfc
cftrcpréfenté par cette fraftion. V. 519. b.
ELLIPTIQUE. (Gramm.) Phrafe elliptique : la langue
latine eft pjefque toute elliptique. Pourquoi notre langue
l’cft beaucoup moins. V. <19. *• _
Elliptique, propofition. IV. 84. a. XIII. 475- • . J
introduit dan? notre langue beaucoup plus de propolmons
Cl“é S ü b 1 i^ o ^ t ô s des punctesfont elliptiques.
La fo r c e centrifuge ou la gravité dune plancte eft
' en raifon doublée inverfo de les dtftances au fo y c r ,o u
réciproquement comme les quarrés de fus dtftances. De la
forme elliptique donnée aux arcs de voûte. Efoace clltptt-
que. Conoïdc ou fphéroïde elliptique. Compas elliptique. V.
**Elliptique. Compas elliptique. III. 757. a. Miroir elliptique.
\.6%7. b. X. 370. a. Tour elliptique. XVI. 460 , a, b.
Expérience fur le mouvement elliptique. XVII. 613. b. 614.
a. Hypothefe elliptique en aftronomie. Suppl. III. 487. b.
77*. a'
ELLIPTOIDE, ( Géom.) efoece de courbe. Différons
genres ou degrés d’clliptoidcs. V. 320. a.
ELLIS, (Jean') anatomifte. Suppl. 1. 412. a.
ELLOTIDE, ( Mythol.) furnom de la Minerve de Corin-
the. Origine de ce furnom. V. 520. a.
E l l o t id e ou Ellotès, ( Myth. ) obfprvations fur cet article
de l’Encyclopédie. Suppl. II. 790. a.
ELLOTÎES , ( Myth. ) nom que les Crétois donnoient
à Europe. Fêtes èllorics. V. çzp. a.
ELME, feu S. Elme b S. 'Nicolas, efpcce de météore fur
mer. II. 753. b. 734. a. IV. 1016. a. VI. 613. b. Branle de
S. Elme, tète qu’rincélébroitàMarfcillc. II. 397.b.
ELMOHASCAR , obfervation fur cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. II. 700. b.
ÉLNE y Eauncy ( Géogr.) ancienne ville de la Gaule
oarbonnoife. Hiftoire & révolutions de cette ville. Voye^
Supol. IV. 0. a.
ÉLOCUTION, (Bell.leur.) ce mot ne s’emploie guere
qu'en parlant de la convcrfation, & lignifie le caraétere du
difeours. V. 520. b.
Elocution, partie de la rhétorique, qui traite de la diâion
& du ilylè de l’orateur. Diilion ne fe dit que des qualités
générales & grammaticales du difeours : quelles foht ces
qualités. Différence entre ftyle 8c diilion. Définition de l’éloquence.
Différence entre un homme éloquent & un homme
aifert. V. 320.*. Les anciens ont défini l’éloquence , le talent
de perfuader. Mais il s’en faut beaucoup que cette définition
foit complcttc. Différence d’objet entre l’éloquence
des anciens & celle des modernes, qui montre que ceux-
ci ont eu encore plus tort que les anciens, lorfqu’ils ont
borné l’éloquence à la perfuafion. Pourquoi l’on doitappellcr
l’éloquence un talent, & non pas un art. Ufagcs des règles
dans l’éloquence. Ce que l’on fent àvcc chaleur , s’énonce
de même : fentez vivement 8c dites tout ce que vous voudrez
, voilà toutes les règles de l’éloquence proprement
dite. Caraftcre du fentiment dont l’orateür doit être rempli.
Ibid. 521. a. L’émotion communiquée par l’orateur eft d’autant
plus vive que l’auditeur a plus de génie 8c de talent.
Comment il eft arrivé que quelques écrivains ont infpiré
l’amour des vertus qu’ils n’avoient pas. Réponfe à cette
objeâion, que l’on peut toucher fans être touché, & convaincre
fans être convaincu. Nul difeours ne fera éloquent
s’il n’éleve l’amc. On peut être éloquent dans quelque langue
que ce foit. C’eft mal-à-propos qu’on a diftingué l’éloquence
des chofes & celle des mots : il 11’y a point proprement
de ftyle fublime ; c’eft la chofe qui doit l’ctre. Ibid. b. Les
morceaux vraiment fublimes, font toujours ceux qui fc tradui-
fent le plus aifément. L’éloquence véritable a peu befoin des
réglés de l’élocution. Examen de la queftion , pourquoi les
anciens ont traité principalement de l’élocution dans leurs
ouvrages fur l’art oratoire. Les réglés de l’élocution n’ont
lieu, à proprement parler , que pour les morceaux qui nç
font pas véritablement éloquens. Des trois parties de l’orateur
, l'élocution eft la feule dont on puiffe donner des préceptes
détaillés 8c pofitifs. Raifon particulière des règles
que les anciens ont données fur l’élocution, tirée de la mélodie
dont leur langue étoit fufceptiblc. Cicéron parolt avoir
regardé l’arrangement des mots, comme très-cffenticl dans
des morceaux, où la beauté de la penféc fembloit difpen-
ler de ce foin : exemple. Ibid. 522. a. L’éloquence a befoin
de l’aftion 8c du gefte ; ces deux qualités lui font encore
plus néceffaires que l’élocution. Quelle force dévoient avoir
dans la bouche de Cicéron fes péroraifons touchantes, que
nous ne pouvons lire fans être attendris. L’aélion peut mômç
mfpircr 1 orateur , fur-tout dans les occafions où il s’agit de
traiter fur le champ & fur un grand théâtre de grands inté-
rcts : paflàgc ¿fc Quintilicri fur ce fùjct. Ibid. U. Obferva-
1,0ns fur la lignification du mot diferus. Les anciens
do,tnt par-là celui qu, a le talent de perfuader par le S ’
cours. Ils appelloicnt ê lw um , celui qui jo ign it à la a j I
de J i j im i , la connoilfance de la ph'üo'foWie & a ¿ u-
Faffaj.es * * ExpHcânon d W c , &
des dialogues de Cicéron fur l'orateur, où Ji/mus ¿mil
avoir à-peu-près la même lignification que difm en franco!;
ibid. 323. a. ' • ■ • ' .
Principales regles de l’élocution oratoire. Dp 1* clarté ara »
maticalç : qucls iont les moyens d’étre clair. Lé foin deT^
n’empêche pas l’orateur de fe permettre quelquefois la É$ñ§
des penfées 8c des tours , &c. D e la correftion , en aunî
elle confifte. Elle eft moins néceffaire dans' ün djfcours i
prononcer que dans un difeours qui doit être lu, De 1
corrcétion oc de la clarté qui appartiennent aji ftÿie-
confident dans la propriété des termes. Oeft principalement
cette qualité qui diftingué les grands é c r iv e s , de ceux qui
ne le font pas. Ibid. b. Qualités qui réfultent de la propriété
des termes. D e la convenance du llyle avec le fujet-
d’où elle dépend. Il h’ÿ a qu’une forte dp ftylç. En quoi
confifte la convenance dont il s’agit ici.’ G ’cft ejjç nU¡
titue la vraie éloquence , 8c le vrai talent d’écrire. De l’ob-
fervation de cette regle'réfultcra la nobleffe du ftyle oratoire.
La baffeffe des idées 8c des fujets eft à la vérité trop
fouvent arbitraire , mais il fuffit que íes idées; de la nation
foient fixées fur ce point pour que l'orateur doive s'y con.
former. De l'harmonie du ftyle. Il paroît que le plaifjr qu’elle
donne, vient en partie de l’habitude , & en partie dé quelque
chofe de réel. Ibid. 3 24. a. L'harmonie eft l’ame de la
poéfie , 8c c’cft pour cela que les traduirions des poetes ne
doivent être qu’en vers : mais la profe a aulfi fon hgpnome;
Comment les anciens a voient diftingué celle de la ppéftp &
celle de la profe. Peut-être la mélodie dp la prqfe q-t-çlle
un avantage, en ce qu’elle eft moins monotone 8c moins
fatigante. C ’eft l’harmonie de la poéfie, qui a fait naître
celle de la profe. Balzac eft le premier qui ait donné de
fharmonie a notre profe, comme Ifocrate eft le premier
qui l’-ait connue parmi les anciens. Ce quç dit Cicéron du
ftyle d’Hérodotc 8c de celui de Thucydide; Deqx chofes
charment l’oreille dans le difeours, le fon 8c le npmbre. En
Îuoi confifte l’harmonie du difeours. Ibid. b. Cicéron blâme
’héopompe, d’avoir porté jufqu’à l’excès le foin minuqeux
d’éviter le'concours des voyelles. Les anciens dans leur profe,
évitoient de laiffer échapper des vers ; le vers ï^mbe étoit
le feul qu’ils s’y pcrmmeht quelquefois. Mqis les vers frait
cois font moins choquaqs dans là profe frqnçoifc. On a même
Remarqué que la prôfe la plus harnionieufe contient beaucoup
de v e r s , qui dçnnent à la profe un des aerémens de
la poéfie. ¿temple tiré de Moliere. Ce fçnt les vers de
huit fyllabcs, qui doivent le plus dominer, dans une profe
harmoniçufe. M. de la Motte prétend que le plaifir qui najf
de la mefure des v e r s , eft un plaifir de convention & de
préjugé. C e fentiment combattu. Ibid. 323. a. Comment l’orateur
doit fc déterminer lorique l'harmonie nuit à la juftcffç
de l’expreflion , ou çette juiteffe, à l’harmonie. La réunion
de la jufteffe 8c de l’harmonie, étoit peut-être lq talent lupé;
rieur de Démofthene. Mérite de cet auteur perdu prefque
entièrement pour nous. Ce que nous appelions içi harmonie
devroit s’appéller plus proprement mélodie, plus ou le
moins d’harmonie eft peut-être ce qui diftingué le plus r*er
lement les différentes efpeces de ftyle. Du ftyle ferré '■ en
quoi il confifte. Il arrive fouvent qu’on eft aulfi oMc11^0^
fuyant la brièveté, qu’en la chercnant. Ibid. b. Conjbtc®
cit oppofée à l’éloquence véritable, cette loquaçi,té fi ordinaire
au barreau, qui confifte à dire fi peu ce chofe, aveq
tant de paroles. Faiiffes idéçs qu’on acquiert de l’éloqueiKe
dans les collèges. Outre les qualités du ftyle dont op a parjft
jufqu’i c i , il faut encore qu’il foit façilc. Evitez pour cela
le ftyle figuré , poétiqyc , chargé d’ornemens > d’antyhm«s%
8c d'épithetes , qu’on appelle mal-à-propos ftyle aca. 3ne. <Jc ftyle prétendu académique eft cçlqi ce la plUP.
fe nos prédicateurs, du moins de plufieurs ce ceuif qui b
quelque réputation : modele qu ils, deyroient avoir .
cfeffe fous les yeux. L’affcélation du ijyle p^roit *ur'p¿ :
dans la profe de la plupart des poetes. Ibiq. 5* • JÎ ¿r¿a
de poëtes ont bien écrit en profo. Ouvrages, de :
8c de Quîntilien à, confultcr fur l’élocution. Des- ng ’
fi la natürc ne les, difte, elles font fcoitles 6c
Sur les qualités du ftyle en général, vove{ m0?
S t y l e , G r â c e , G o v t . Les 'ouvrages des rh<? ^ ajjf0lù-
dernes calqués fur cqyjx des. anciens, fpgt Erc ?>¿|0qucnqe
ment inutiles., 8c contraires même au genre c 4 ^
que nous connoi^Tons aujoyrdliui. Ce que, ait fur c"
rrerct. Ibid. b. * « De l’ordre
Elocution t voyez D i c t i o n , P e n s é e , 1
de l’élocution oratoire. VIU. 839.«, Hevroit
ÉLOGE. I Bell, ¿tir.) La vérité fimple f c
être la bafe 8c l’amc de tous les éloges. V. ça6.
ne peuvent fouffrir qu’un panégyrifte fe rende Ip . .W
E L O
ubllr la réputation Mi autres, ou d’eu M ü ia . Sur Ica élo-
•es cu’on peut donner dans les diaïonnaircs hiftonqucs ,
Lvrr D i c t i o n n a i r e Des éloges 8c des critique» qui peuvent
fc trouver dans quelques articles de 1 Encyclopédie ;
déclaration des éditeurs fur ce fujet. Réflexions fur labus
des panégyriques 8c des fatyres, qui avilit aujourd’hui la
république des lettres. /*«/, ç 27. a.
Eloge. Comment les éloges doivent entrer dans un dic-
tionmure littéraire. IV. 967. b. Il eft jufte 8c utile d’accorder
à l’homme de mérite, tandis qu’il vit encore, les éloges
qui lui font dus. V. 646. a. Eloges proftitués aux crimes
heureux des conquérans. VIL 717. b. Sobriquets qui font
l’éloge de ceux qui les portent. XV. 249. 4 , b. Exemples
d’éloges exprimés avec délicateffe. Suppl. II. 690. b.
Eloge t louange : différence entre ces mots. V. 327. a.
Eloges académiques : if y en a de deux fortes i d’oratoires
8c d’hiftoriques. Eloge oratoire que doit faire un nouvel
académicien, de celui auquel il fucccde dans l’académie
françoife. Des éloges hiftoriques qui fe font dans les académies
des fciences 8c des bellcs-lettrcs. Réglés que donne
l’auteur fur la maniéré de compofer ces éloges. V. 3 ^7.
Il feroit jufte & defirable qu’on impofàt au fecrétaire la loi
rigoureufe de faire l’éloge de tous les académiciens. Con-
noiffances 8c talens que doit pofféder le fccrétaire d’une
académie. Réflexions fur M. de Fontenclle. Il a rendu la
place qu’il a remplie três-dangoreufe à occuper. Ce qu il faut
faire pour réuflir dans cette carrière épineufe. Ibid. 328.4.
É L O G E , ( Droit çivil) elogiumt dans le droit écrit fignifie
le blâme , 8c non pas la louange. V. 328. a. La raifon que
le pere donne pour autorifer 1 exhérédation de fon enfant,
s’appelle elogium. Exemples. Ibid. b. Voyt{ E x h é r é d a t io n .
ELOIGNER. Différence entre éloigner , écarter, 8c
mettre à l’écart ,-V. 221. b. entre éloigner, écarter , 8c fépa-
rer. 222. a. Pourquoi l’on cligne les yeux pour voir un
objet éloigné. III. 3 31. *.
ÉLONGATION, ( Aftron. ) la plus grande diftance d’une
planète au folcil s’appelle fa plus grande élongation. Rai-
fons pour lcfquelles elle varie. C’eft dans les mouvemens
de venus & de mercure qu’on a fur-tout égard aux élongations.
De la plus grande élongation de mercure. Angle
de la plus grande élongation des planètes inférieures. La
plus grande élongation ces planètes fupérieurcs eft de 180
degrés. Celle de vénus de 45*, celle de mercure de 30.
Voyez D i g r e s s io n . Autre ufage du mot élongation. V.
328. b. Ce qu’on entend par l’élongation de la lune au foleil.
Angle d’élongation, ou angle à la terre. Ibid. 3 29. a.
ELONGATION. ( Chir. ) L’élongation elt une efpcce de
luxation imparfaite. Luxation qui le fait peu-à-peu 8c long-
tems après l’aâion de la caufe externe. Caufes internes du
déplacement de l’os. Ce que recommande à ce fuiet Hippo-
crate. Ufage du feu pour corroborer 8c fortifier les parties.
,v. 329.4.
ELOQUENCE. (Belles-Utt.) L’éloquence eft née avant les
réglés de la rhétorique. La nature rend les hommes éloquens
dans les grands intérêts 8c dans les grandes pallions. Le peuple
même s’exprime par des figures ; rien n’eft plus commun
que les tours qu’on appelle tropes.. V. 529. a. C’eft la nature
qui infoire quelquefois des débuts vifs oc animés ; exemple.
Tifias fut le premier qui recueillit les loix jdè l’éloquence.
Talens que doit-pofféder l’orateur , fuivant Platon. Court
expofé de la rhétorique d’Ariftote. La Grèce étoit la feule
contrée de la terre où l’on connût les loix de l’éloquence.
Tcm9 où l’éloquence fe montra dans Rjomc , 8c celui où elle
périt. Pourquoi l’éloquence n’appartient qaà la liberté. Ibid. b.
Du livre cfe Cicéron , intitulé de l’Orateur. Caraâere de
l’éloquence fimple. Quelle étoit celle du barreau jufqu’au milieu
du dix-fepticme ficcle. On difoit, avec emphafe, des
chofes triviales. Du genre fublime. On en voit de vives traces
dans le parlement d'Angleterre. Du genre tempéré. Les trois
genres rentrent fouvent l’un dans Uautre. La grande éloquence
, qui n’a pu , parmi nous, être connue du barreau ,
5 eft réfugiée dans les oraifons funèbres. L’éloquence de la
chaire prcfque barbare jufqii’ài Bourdaloue. Etat de l’élo-
Siucncc de la chaire chez les Anglois. 11 fe trouve dans nos
crmons peu de morceaux frappans. Ibid. 330. a. Figure
hardie du P. Maflillon-, dans fon fermon fur. le petit-nombre
des élus. Effet qu’elle produifit fur fon auditoire. De pareils
chcfs-d’oeuvrc font devenus très-rares. Ce que devroient
faire les prédicateurs médiocres. Quelle forte d’éloquence
convient aux hiftoriens. Dos harangues, dircélos qu’on met
dans la bouche d’un héros. Djfcours admirable qucMefcrai
met dans la bouche du maréchal de*Biron, lorfcjuc Henri IV
étant preffé auprès de Dieppe par une armée de trente mille
hommes , on lui coofeilloit de fe retirer en Angleterre.
Ibidi b. •
Eloquence poétique. Il y a dans1 l'art1 d’inftruirc- 8c de
perfuader un procédé que la philofophw ne- connoîr pas ,
8c dans lequel la poéfie excelle j c’cft i’art de frapper 1 ame
du côté fenfible, de l'intéreffer à,croire ce qu’oa veut lui per-
E L U 575
fuader ; c’eft l’éloquence même dans toute fa force, 8cavec
tous fes artifices. Suppl. H. 79o. b. Toute la différence qu’il
y a entre 1 éloquence poétique & l’éloquence oratoire , c’eft
que la première doit être plus animée , plus rapide plus
foutenue que celle de l’orateur. Pour employer foutes ltfs
reffources de l'éloquence, les poëtes ont foin de choifir dés
fujets inréreffans , féconds 8c dociles j de grandes caufes à
difeuter, de grands intérêts à débattre. Ibid. 791. a. Quelquefois
celui qui parle ne veut que répandre & foulagcr fou.
coeur : rien de plus favorable au développement des pallions.
— Plus la paflion rient de la foibleffe , plus elle eft facile à
fe répandre au-dehors. L’amour a plus de confidcns que ta
haine 8c que l'ambition ; celles-ci nippofent dans l’àme une
force qui fort à les renfermer. Aufii nos poé'tes qui ont mis
au théâtre l’amour. que les Grecs dédaigtioient de pèindrc,
ont-ils trouvé dans le trouble , les combats, les moùVémens
divers qu’il excite , une fource intariffable de la plus belle
poéfie. Ibid. b. Nos poëtes fe font quelquefois engagés dans
des analyfes de fenrimens aufii froides que fupernues ; mais
fi le coeur ne s'épanche que parce qu’il eft trop plein de fa
paflion , 8c lorfque la violence de fes mouvemens ne lui
permet pas de les retenir, i’cffufion n’en fera jamais ni froide
ni languiffante. — Les réflexions, les affeftions de l’ame qui
fervent d’aliment à cette efpcce de pathétique, peuvent fo
combiner à l’infini ; cependant, comme elles ont pour bafe
un caraétcrc 8c une fituation donnée, lé poëte , en méditant
fur les fenrimens qu’il veut développer, peut ÿ obfcrvcfr
quelque méthode, 8c dans les circonftanccs les plus mar-
Suées, fc donner quelque point d’appui. —■ Profonde étude
es moeurs que cette forte de fçene exige 8c fuppofe. Mflicü à
faifir entre la langueur 8c la molleffe qu’on nous reproché , 8c
l’excès contraire, la féchereffe 8c la dureté. Ibid. b.
Eloquence. Définition de l’éloquence. V. 5 20. b. Différence
entre l’éloquence 8c la poéfie. Suppl. IV. 441. a. De l’origine
8c des règles de cet art. I. x. Difc. prélitjiin. L’éloqu'ence née
de la pauvreté des langues primitives. VIII. 89. a. Si l’éloquence
eft un art d’imitation. Suppl. I. 386. b. Réflexions fur
le goût des anciens, relativement à l’éloquence. 418. b. 420. b.
Hiftoire de l’éloquence grecque & romaine. XI. «39: b. 373.
b. Cara&cre de l’éloquence romaine. Suppl. II. 686. a. Une
des caufes de la corruption de l’éloquence à Rome, IV. 69/.
b. L’éloquence cultivée chez les anciens Celtes. Suppl, II.
286.4 , b. Caraélere de l’éloquence des petes de l’égliie. XII.
349. b. Objet de l’éloquence 8c de la morale: qualités qu’il
faut réunir pour exceller dans cet art. IV. 493. b. 404. A
Divcrfes obfervations fur Téloquence. V. 321. 4, b. 8cè.
Obfcrvations fur les règles d’éloquence 8c de poéfie. Suppl.
IV. 39e. a y b. De l’abondance du ftyle dans l’éloquence.
Suppl. t. 32. b. 33. a , b. Elle ne doit tirer fes forées 8c fes
moyens que d’elle-mème. 840. *.841. 4. De la beauté dans
l’éloquence. 837. b. 8.39. b. Des convenances à obforver.
Suppl. i l 386. b. L’imagination moins permifo dans l’éloquence
que dans la poéfie. VIII. 362. b. De l’art de remuer
les pariions par l’éloquence. XII. 146. b. 147.4 , b. Importance
de l’aaion dans l’éloquence. XIII. 436.*. De la critique,
relativement à l’éloquence. IV. 493. b. Force de l’éloquence.
VIL 110. 4. Méthode pour former à l’éloquence. Suppl. H.
686. b. Efpcce de fauffe éloquence, appellée déclamation. Ibid.
4 , b. Obfervations fur Moquerie« de la chaire. Suppl. I.
33. 4. Voye{ P r é d i c a t io n . Sur l’éloquence du barreau.
Suppl. I. 32. b. Voye{ B a r r e a u 1. Déeffe de l’éloquence. X1L
662. b. XV. 3 5m 4.
ELOQUENT, difert, ( Synon.) W. 103& b. V. 320;*.
51| l s g o w , ( Géogr.) canton dc l’Alface 8c-de la Franche*
Comté , autrefois Aifgaugcnfis pagus. Suppl. L 3241*.
ELSHAIMER, (Adam) peintre; V. 313.4.
ELU. ( Thcol. ) La prédeffiriation à la.gloire fuppofe la prée
deftination à la grâce 8c à la- perfévéfance. V. 331. a. Deux
lignifications du mot élu. Ibid. b. Voyer ELECTION.
Elu. Doârine impie fur le petit nombre des élus. XIII. 44k,
* E lv * 2(Jurifpr.) Elus fur le fait de l’aide. Elu du clergé,
ou pour le clergé. Elu, ou confeillcr d’une éleftion. Elus con»
foillcrs de ville. Elus des décimes. Elu eccléfiaftique. Elus’ou
échevins; Elus des états. Élus fur le fait desi finances de*
aides. Elus fur le- fait des gabelles. Elus- généraux. Elus fiiê
le fait de la guerre. Elus for le fait de l’impofition foraines
V. m 1. b. Elus des Jùift. Elus laïcs. Elus de la marée,. ou
confeillers. Elus des métiers. Elus (vu le fait des monnbiefc
Elus (ut le fait des oôrois, ou tailles des villes. Elus parti*
culiers. Elus ces poiffonniers de lai marée fraîche; Elu de-la
province. Elus, ou prndhommes. Elus (vu le fait des fubfidris»
Elus pont les tailles. Elus pour les tailles des villes'ou pour les
oétrois. Ibid* 33 asa. • _ . , ,
Elus pour le fait de laide , voyeç E lectioni Origine du
nom d’elu donné à ces officiers. IV. 3 38.4. Chevauchées des
élus. III. 314. b. Elus 8c receveurs; pour lefait^des impolitipa»
fur le clergé. IV. 677,4.