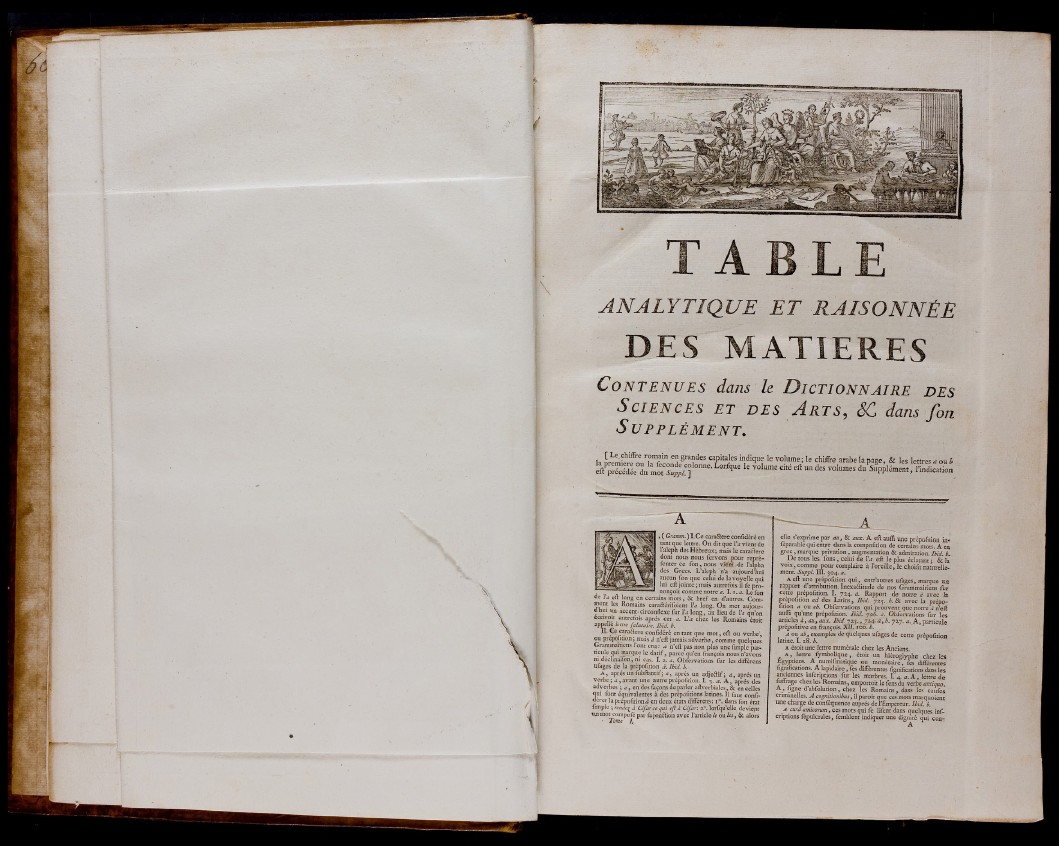
I
V
TABLE
ANALYTIQUE E
DES MATIERES
C o n t e n u e s dans le D i c t io n n a ir e d e s
S c i e n c e s e t d e s A r t s , SC dans fo n
S u p p l é m e n t .
la p r em Î r e ^ V rW o n L Sra?deS “ Plt*lesiSSIIe v0? T e; le arabe la Pag*> & les lettres * ou b
^ le voIume “ té eft ua d- volumes dA îp p lém en t, l’indication
~ K ~
, ( Gramm.)l.Ce caraôereconfidéré en
tant que lettre. On dit que Va vient de
l’alepn des Hébreux; mais le cara&ere
dont nous nous Servons pour représenter
ce Son, nous vïëm .-de l’alpha
des Grecs. L’aleph n’a aujourd’hui
aucun ion que celui de la voyelle qui
lui eft jointe ; mais autrefois il fe pro-
, nonçoit comme notre a. 1.1 . a. Le fon
de 1 a eft long en certains mots, & bref en d’autres. Comment
les Romains cara&érifoient Va long. On met aujour-
uhui un accent-circonflexe fur Va long, au lieu de IV qu’on
écnvoit autrefois après cet a. Va chez les Romains étoit
appellé lettré falu taire. Ibid. b.
x J5^raftere confidéré en tant que mot, eft ou verbe’,
ou prépoiition; mais à n’eft jamais adverbe, comme quelques
Grammamens 1 ont cru : a n’eft pas non plus une Ample particule
qui marque le datif, parce qu’en françois nous n’avons
ni déclinaifon, ni cas. I. 2. a. Observations fur les différens
ufages de la prépoiition à. Ibid. b.
A , après un fubftantif; a , après un adje&if ; a, après un
verbe; a , avant une autre prépofition. I. 3. a. A , après des
adverbes ; a, en des façons de parler adverbiales, & en celles
qui font équivalentes à des prépofidons latines. Il faut confi-
oérer la prépofition à en deux états différens: i°. dans ion état
Simple ; rendeç à Cifarce qui eft à Céfarro.0. lorfqu’elle deviept
tvn mot compofé par fa jonftion avec l’article le ou Us, & alors
• Tome
H
elle s’exprime par au, & aux. A eft auffi une prépofition inséparable
qui entre dans la compofition de certains mots. A en
grec, marque privation, augmentation & admiration. Ibid. b.
De tous les Sons, celui de Va eft. le plus éclatant ; & la
voix, commepour complaire à l’oreille, le choifit naturelle-
. ment. Suppl. IIl. 304. a.
a eft une prépofition qui, éntr’autres ufages, marque un
rapport d’attribution. Inexactitude de nos Grammairiens fur
cette prépoiition. I. 724. a. Rapport de notre à avec la
prépofition ad des Latins, Ibid. 725- b. & avec la prépo-
fition a ou ab. Obfervations qui prouvent que notre à n’eft
aufli qu’une prépofition. Ibid. 726. a. Obfervations fur les
articles à, au, aux. Ibid. 723.^24. a, b. 727. a .A , particule
prépofitive en françois. XII. 100. b.
a ou ab, exemples de quelques ufages de cette prépofition
latine. I. 28. b.
A étoit une lettre numérale chez les Anciens.
A , lettre fymbolique, étoit un hiéroglyphe chez les
Egyptiens. A numifmatique ou monétaire, les différentes
fignificanons. A lapidaire, Ses différentes Significations dans les
anciennes inferiptions Tur les marbres. I. 4. a .A , lettre de
uiffrage chez les Romains, emportoitle Sens du verbe antiquo.
A., figne-d’abfoludon, chez les Romains, dans les cauies
criminelles. A cognitionibus, il paroît que ces mots marquoient
une charge de conféquence auprès de l’Empereur. Ibid. b.
a curâ amicorum, ces mots qui fe lifent dans quelques inf-
cripdons Sépulcrales, Semblent indiquer une dignité qui conr