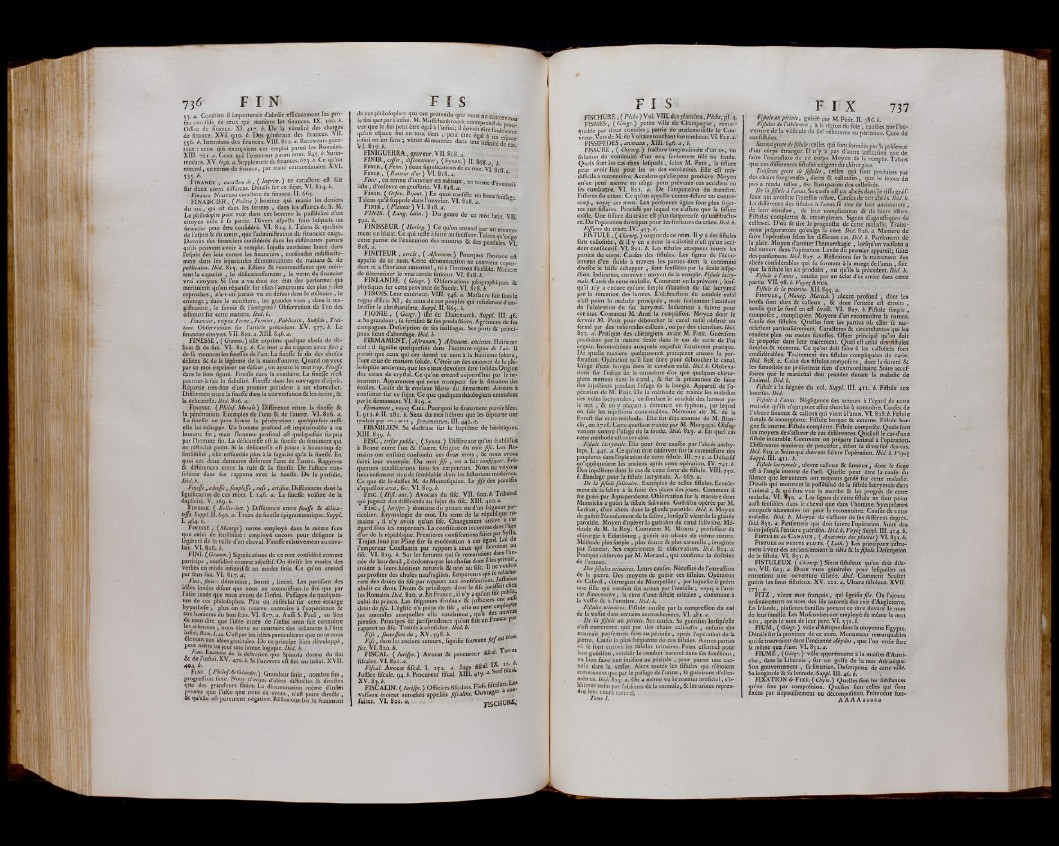
7 3 6 F I N
53. a. Combien il importcroit d’abolir efficacement les profils
cxccffifs de ceux qui manient les finances. IX. 100. b.
Office de finance. XI. 417. b. D e la vénalité des charges
de finance. XVI. 910. b. Des généraux des finances. V il.
35 6. b, Intendans des finances. "VIII. 812. a. Receveurs généraux
: ceux qui exerçoient cet emploi parmi les Romains.
XIII. 701. a. Ceux qui l’exercent parmi nous. 845. é.Surin-
tendans. XV , 690. a. Supplément de finances. 673. é. Ce qu pn
entend, en terme de finance, j>ar traité extraordinaire. AVI.
^ F inance , carafon * . Um fr im .) ce carailere eft fait
fur deux corps différens. Deuils fur ce fuier. VI. 814. b.
Finance. Nouveau caraélere de finance. II. 66ç.
FINANCIER, ( Pol'ttïq. ) homme qui manie les deniers
du ro i, qui eft dans les fermes , dans les affaires de S. A l
Le philofoplte peut voir dans cet homme la poffibilité d’un
citoyen utile à fa patrie. Divers afpcéts fous lefquels un
financier peut être confidéré. VI. 814. b. Talens & qualités
de l’effirit & d u coeur, que l’adminiftration du financier exige.
Devoirs des financiers confidérés dans les différentes parties
qu’ils peuvent avoir à remplir. Injufte anathéroe lance dans
lefprit des loix contre les financiers I confondus indiftinéle-
ment dans les injurieufes dénominations de traitant 8c de
publicains. lbid. 815. a. Eftime 8c reconnoiffance que méritent
la capacité , le défintéreffement, la vertu du financier
vrai citoyen. Si l’on a vu dans cet état des perfonnes qui
méritoient qu’on répandit fur elles l’amertume des plus juftes
reproches, n*a-t-on jamais vu en défaut dans le militaire, le
courage ; dans le miniftere, les grandes vues ; dans la ma-
eiftrature, le favoir 6c l’intégrité? Obfervation de l’un des
editeurs'fur cette matière. lbia. b.
. Financier t voyez Ferme, Fermier, Publicain, Subftde | Traitant.
Obfervarions fur l’article précédent. X V . 577. b. Le
financier citoyen. V II. 820. a. X lli. 846. a.
FINESSE, ( Gramm. ) elle exprime quelque chofc de délicat
& de fini V L 815. b. Ce mot a du rapport avec finir ;
de-là viennent les fineffes de l’art. La fineffe fc dit des chofes
déliées & de la légéreté de la main-d’oeuvre. Quand on veut
par ce mot exprimer un défaut, on ajoute le mot trop. Fineffe
dans le fens figuré. Fineffe dans la conduite. La fineffe n’eft
pas tour-à-fait la fubtUité. Fineffe dans les ouvrages d’efprit.
Répartie très-fine d’un premier préfident à un chancelier.
Différence entre la fineffe dans la converfation & les écrits, &
la délicateffe. lbid. 816. a.
Finesse. ( Philof. Morale ) Différence entre la fineffe &
la pénétration. Exemples de l’une 8c de l’autre. V I .8 16 . a.
La fineffe ne peut fuivre la pénétradon: quelquefois auffi,
elle lui échappe. Un homme profond eft impénétrable à un
homme fin ; mais l’homme profond eft quelquefois furpris
par l’homme fin. La délicatefie eft la finefte du fentiment qui
ne réfléchit point. Si la délicateffe eft jointe à beaucoup de
fenfibilité > elle refferable plus à la fagacité qu’à la fineffe. En
quoi ces deux dernieres différent l’une de l’autre. Rapports
oc différences entre la rufe 8c la fineffe. D e l’aftuce con-
fidérée dans fes rapports avec la fineffe. D e la perfidie.
I b id .b ,.
Fineffe , adreffe, foupleffe, rufe, artifice. Différences dans la
fignification de ces mots. I. 146. a. La fineffe voifine de la
duplicité. V . 169. /*.
F inesse. ( Bellts-lett. ) Différence entre fineffe 8c délicateffe,
Suppl. 11.690. a. Traits de fineffe épigrammatique. Suppl.
I. 464. b,
F inesse , (Manège) terme employé dans le même fens
que,celui de fenfibilité : employé encore pour défigner la
légéreté de la taille d’un cheval. Fineffe relativement au cavalier.
VI. 816. b.
FINI. ( Gramm,) Significations de ce mot confidéré comme
participe , confidéré comme adjeélif. On divife les modes des
verbes en mode infinitif & en modes finis. Ce qu’on entend
par fens fini. VI. 817, a.
F in i, fin ie : déterminé, borné , limité. Les partifans des
idées innées difent que nous ne connoiffons le fini que pdr
l’idée innée que nous avons de l’infini. Paffagcs de quelques-
uns de ces philofophes. Plus on réfléchit fur cette étrange
hypothefe ■, plus on la trouve contraire à l’expérience oc
aux lumières au bon fens. VI. 817. a. Auffi S. Paul » au lieu
.de nous dire que l’idée innée de l’infini nous fait connoitre
les créatures, nous éleve au contraire des créatures à l’être
mnm. Rom. 1.?q. C ’eftpar les idées particulières que nous nous
élevons aux idées générales. D e ce principe bien développé,
petit naître un jour une bonne logique, lbid. b.
a i v - c •m£ri ,4e la définition que Spinofa donne du fini
& de 1 infini. X V. 470. b. Si l’univers eft fini ou infini. XVII.
*404' ».
Fini. ( P h ilo f bGlomltr .) Grandeur finie, nombre fini,
progreffion finie. Nous n’avons d’idées diftinûes 8c direéles
que des grandeurs finies. La dénomination môme d’infini
prouve que 1 idée que nous en avons, n’eft point direûe ,
Ce quelle eft purement négative. Réflexions fur le fentiment
VI. 817. b.
FINIGU
F I S
de ces plnlofoplies qui ont prétendu que nous ne cm,«.,-
le fini que par iíntmi. M. Muffchenbrocck entreprend de n.«™
ver que le fini peut être égal à l'infini; il devoir dire féiiK „
qu'un efpacc finí eni tout .feus , peut être égal à „ „ S
infimcn un fens ; vérité démontrée dans une infinité de c a
jU ER R A , graveur. VII. 868. a.
F IN IR , ceffer , discontinuer, ( Synon. ) II. 868. a b
F in ir , {Peint. ) deux fignificationsde ce mot V ï ’ a.'e
F in i r , (Batteur d’or) \ l . 8 i 8. a. • X .a. ;
F in ir , en terme d’ouvrier en métaux, en terme l l l B i I
lifte, d’orfevre en grofferic. V I. 818. ip éventa,t
Fini». lO r f iv . ■Bijou| E u quoi confifte un beaufinifliee
I alens qu il luppofe dans l ouvner. VI. 818. a.
F in ir , ( Planeur) \ I. 8i8.<*.
F IN IS . ( Long, latin. ) Du genre de ce mot latin. VII
59** "•
FINISSEUR. ( Horlog ) Ce qu'on entend par un mouvement
en blanc. Ce qui relie à faire au finiffeur. Talens ou'exiee
cette partie de l’exécution des montres & des pendules. VI
8x8. a.
FINITEUR , cercle, ( ABrontm.) Pourquoi lTioriion eft
appellé de ce nom. Cette dénomination ne convient cependant
ni à Thorizon rationnel, ni à l’horizon fenfible. Maniere
de déterminer le vrai cercle finiteur. VI. 8x8. b.
FINLANDE. ( Géogr. ) Obfervarions géographiques &
phyfiques fur cette province de Suede. VI. 8x8. A.
FINOIS. Leur extérieur. VIII. 346. a. Maffacre fait fous le
regne d’Eric X I , de ccux.de ces peuples qui rcfuferentd’cm-
braffer le chriftianifme. Suppl. II. 865. b.
FIONIE , ( Géogr.) ifle de Danemarck. Suppl. III. 46.
a.Sa grandeur, fa fertilité & fes produirions. Agrémens de fes
campagnes. Defcription de fes bailliages. Ses ports & principaux
lieux d’abordage, lbid. b.
_ FIRMAMENT. ( Ajlronom. ) Afironom. ancienne. Huitième
c ie l: il fignifie quelquefois dans l’écriture -région de F air. Il
paroît que ceux qui ont donné ce nom à la huitième fphere,
l’ont crue de matière folide. C ’étoit un des axiomes de la phi-
lofophie ancienne, que les cieux devoient être folides.Origine
des cieux de cryftal. C e qu’on entend aujourd’hui par le firmament.
Apparences qui nous trompent fur la firuation des
étoiles. Caufe de la couleur bleue au firmament. Auteurs à
confulter fur ce fuiet. Ce que quelques théologiens entendent
par le firmament. V l. 819 .a .
Firmament, voyc{ C iel. Pourquoi le firmament paroît bleu.
I. 912. b. II. 281. b. Sens du mot hébreu que les feptante ont
traduit par mp.uua , firmarnentum. 111.44a. a.
FIRMILIEN. Sa doétrine fur le baptême de hérétiques.
XIII. 829. b.
F IS C , tréforpublic, (S y n o n .) Différence qu’on étabüffoit
à Rome entre l’un & l’autre. Origine du mot fife. Les Romains
ont enfuite confondu ces deux mots , 8c nous avons
fuivi leur exemple. D u mot f i f e , on a fait confifquer. Fréquentes
confifcations fous les empereurs. Nous ne voyons
heureufement rien de femblable dans les hiftoriens modernes.
Ce que dit là-deffus M. de Montefquicu. Le fife des pontifes
s’appelloit arcat & c . V I. 819. b.
F isc. ( H ifl. a nc.) Avocats du fife. VII. 600. b. Tribunal
quijugeoit des différends au fujet du fife. XIII. 410. a.
F i s c , ( Jurifpr. ) domaine du prince ou d’un feigneur particulier.
Etymologie du mot. Du tems de la république romaine
, il n’y avoit qu’un fife. Changement arrivé à cet
les e
éput
,____ ^ P3t - __ — — _______ - . . . „
l’empereur Conftantin par rapport à ceux qui dévoient au
fife. V I. 819. b. Sur les femmes q u ife remarioient dans 1 année
de leur deuil, il ordonna que les chofcs dont il lespnvoit,
iroient à leurs héritiers naturels 8c non au fife. Il *je vouloit
pas profiter des chofes naufràgiées. Empereurs qui ‘eTrei^c.
rent des droits du fife par rapport aux confifcations. Juiunicn
abolit ce droit. Droits 8c pnvileges dont le fife jouiffoit c e
les RomainKlbid. 820. a. En France, il n’y a qu’un nfc pumi^
celui du prince. Les feigneurs féodaux 8c jufticiers ont a
droit de fife. L ’égiifc n’a point de fife , elle ne peut cmpmy
les amendes auxquelles elle condamne, qu à des °cuv
pieufes. Principes de jurifprudcnce qu’on fuit en France p
rapport au fife. Traités ipport nie.1 raites aà ccoonmfuulitteerr.. ltbtni d. b.
F ife , fucccffion d u , X V . 598. b.
FF jiJfec y, ddaannss líeess anciens auteurs, fignii
fice. V.I. 82O. b. . tT-rr**
FISCAL. (Ju r ifp r .) Avocat & procureur fifca*#
fifcales. VI.8ai.<*.
Fife al. Avocat fifbal. I. 152. a. Juge û C a l ‘ r ç.ç.jr
Juftice fifcale. 94. b. Procureur fifcal. XIII. 419* a‘
F1SCA L1N. {Jurifpr.) Officiers fifcalins. Fiefs
vaffaux étoieut autrefois appellés fifeatint. Ouvrag .
fultcr, ,VI. 821. a, . . p isG H U ^ ’
F I S F I X 7 3 7
FISCHURÊ, ( Pèche) Vol. V III. des planches, Pèche, pï. 4.
F I S M E S , (G éo g r .) petite ville de Champagne, remarquable
par deux conciles ; patrie de madcmoildle le Couvreur,
vers de M. de Voltairetouchantfonrombcau.VI.821.«.
FISSIPEDES, animaux, XIII. 646. a -, b.
FISSURE, ( Chirurg. ) fraâure longitudinale d’un os, ou
folution de continuité d’un os », feulement fêlé ou fendu.
Quels font les cas dans lefquels , félon M. Petit, la fiffure
peut avoir lieu pour les os des extrémités. Elle eft rrés-
' difficile à rcconnoitTe. Accidens qu’elle peut produire. Moyen
qu’on peut mettre en ufage pour prévenir ces accidens bu
les combattre. VI. 821. a. De l’amputation du membre.
Fiffures du crâne. Ce qu’on appelle contre-fiffure ou contrecoup
, voyeç ces mots. Les perfonnes âgées font plus finettes
aux fiffures. Procédé par lequel on s^ffure que la fiflure
exifte. Une fiffure du crâne eft plus dangereufe qu'tinÿfraéhi-
re. De l’opération du trépan pour les franures du crâne.lbid, h
Fiffures du crâne. IV. 433. d.
FISTULE, ( Chirurg. ) origine de ce nom. Il y a des fiftules
fans callofités , & il y en a dont la callofité n eft qu’un accident
confécutif. VI. 82x. b. Les fiftules attaquent toutes les
parties du corps. Caufes des fiftules. Les fignes de l’écoulement
d’un fluide- à travers les parties dont la continuité
divifée le laiffe échapper , font fenfibles par la feule infpc-
élion. Indication, curative : moyen de la remplir. Fiflule lacrymale.
Caufe de cette maladie. Comment on la prévient, lorf-
qu’il n'y a encore qu’une fimple dilatation du fac lacrymal
par la rétention des larmes. L’obftruéhon du conduit nafal
n’eft point la maladie principale, niais feulement l’accident
de l’ulcération du fac lacrymal. Indication à fuivre pour
cet état. Comment M. A ne f la rempliffoit. Moyen dont fe
fervoit M. Petit pour déboucher le canal nafal obftrué ou
fermé par des tubercules calleux, ou par des cicatrices, lbid.
822. a. Pratique des chirurgiens avant M. Petit. Guérifons
produites par la nature feule dans le cas de carie de l’os
unguitt Inconvénicns auxquels expofoit l’ancienne pratique.
De quelle maniéré quelques-unS pratiquent encore la perforation.
Opération qu’il faut faire pour déboucher le canal.
Ufage d’une bougie dans le conduit nafal. lbid. b. Obfervarions
fur l’ufage ue la cannelure d’or que quelques chirurgiens
mettent dans le canal, 8c fur la précaution de faire
des ¡njeélions pendant l’ufagc de la bougie. Appareil de l’opération
de M. Petit. D e la méthode de traiter les maladies
des voies .lacrymales, en fondant le conduit des larmes par
le nez , & en y plaçant à demeure un fyphon, par lequel
on fait les injeétions convenables. Mémoire de M. de la
Foreft fur cette méthode. Elle fut déjà connue de M. Bian-
chi,en i7i6.Ccttequeftion traitée par M. Morgagni. Obfe(-
vations contre l’ufage de la fonde, lbid» 823. a. En quel cas
cette méthode eft rccevable.
Fiflule lacrymale. Elle peut être caufée par l’abcès anchy-
lops. I. 441. a. Ce qu’on doit obferver fur la commiffure des
paupières dans l’opération de cette fiftule. III. 712. a. Défenfif
Îu’appliquoient les anciens après cette opération. IV. 741. b.
)es injeétions dans le cas de cette forte de fiftule. VIII. 750.
b. Bandage pour la fiftule lacrymale. X. 667. a.
De la fiflule falivaire. Exemples de telles fiftules. Ecoulement
de la falive à la fuite des plaies des joues. Comment il
fut guéri par Aquapendente. Obfervation fur la manière dont
Munnicks a! guéri la fiftule falivaire. Guérifon opérée par M.
Ledran, d’un abcès dans la glande parotide, lbid. b. Moyen
de guérir l’écoulement de la falive, lorfqu’il vient de la glande
parotide. Moyen d’opérer la guérilon du canal falivaire. Méthode
de M. le Roy. Comment M. Monro , profeffeur de
chirurgie à Edimbourg , guérit un ulccre de même nature.
Méthode plus fimple , plus douce 8c plus naturelle, imaginée
Îiar l’auteur. Scs expériences & obfervarions. lbid. 824. a.
’rauque obfervéc par M. Morand, qui confirme la doétrinc
de l’auteur.
De s fiflules urinaires. Leurs caufcs. Néceffité de l’extraétion
de la pierre. Des moyens de guérir ces fiftules. Opération
de C abrol, chirurgien de Montpellier , par laquelle il guérit
une fille qui rendoit fes mines par l’ombilic; voye% à l’article
Boutonnière, la cure d’une fiftule urinaire , commune à
la veffie 8c à l’urethre. lbid.'b.
Fiflules urinaires. Fiftule caufée par la compreffion du col
de la veffie dans certains accouchcmens. VI. 481. a.
D e la fiflule au périnée. Scs caufes. Sa guérifon lorfqu’elle
n’eft entretenue que nar des chairs calleufcs , enfuite des
mauvais panfeinens laits au périnée, après l’opération de la
pierre. Caufe la plus fréquente de ces nftules. Autres parties
où fe font encore les fiftules urinaires. Point effcntiel pour
leur guérifon, rétablir le conduit naturel dans fes fondions,
ou bien faire une incifion au périnée , pour porter une can-
nulc dans la veffie. Alors toutes les fiftules qui n’étoient
entretenues que par le paffage de l’u rine, fe guériront d’elles-
mêmes. lbid. 82.5. a. Ou a môme vu le conduit artificiel, s’oblitérer
enfin par l’abfencè de la cannule , 8c les urines reprendre
leur cours naturel.
■Fiflule au périnée t guérît* par M. Petit. II. 386. b.
Fiflules de l abdomen , à la région du foie, caufées par l’oi^
verrure de la véficule du fiel adhérente au péritoine. Cure dé
ces fiftules.
„ Second genre defiftule : celles qui font fohnéès par la préfence
d un corps étranger. I! n 'y “a pas d’autre indication que de
faire l’cxtradion de ce cofps. Moyen de la remplir. Talens
que ces différentes fiftules exigent du chirurgien.
Troifieme genre de fiflules , celles qui font produites par
des chairs fongueufes, dures & calleufcs, que le féjour du
pus a rendu telles, b c . Extirpation des callofités.
D e la fiflule à Tanus.Sn cauie eft un abcès dans le tiffu graif-
feux mii avoifine l’inteftiri reftum. Caufes de cet abcès, lbid. b.
La différence des fiftules à.l’anus.ïe rire de Jcur ancienneté,
de leur étendue, de leur complication & de leurs iffucs.
Fiftules complcttcs 8c incomplettes. Signes diagnoftiqiics de
celles-ci. D ’où fe rire le prognoftic de cette maladie. Traitement
préparatoire qu’exige la cure. lbid. 826. à. Maniéré de
faire 1 opération félon les différens cas. lbid. b. Panfement dé
la plaie. Moyen d’arrêter l’hémorrhagie , lorfqu’un Vaiffeâu a
été ouvert dans l’opération. Levée du premier appareil ; fuite
despanfemens. lbid. 827. a. Réflexions fur le traitement des
abcès confidérables qui fe forment à la marge de l’anus , foit
que la fiftule les ait produits, ou qu’ils la précèdent .lb id. b.
Fiflule à l'a n u s , caufée par un éclat d’os arrêté dans cette
parne. VII. 78. b. Poye^rA nus,
Fiflule de la poitrine. XII. 893. à.
F is tu e e , (Maneg, Marich. ) ulccre profond , dont les
borHs font durs 8c calleux , 8c dont l’entrée eft étroite ,
tandis que le fond en eft évafé. VI. 827. b. Fiftule fimple ,
compofée, compliquée. Moyens d’Cn reconnoitrc la nature^
Caufe des fiftules. Quelles font les parties où elles fe ma-
nifeftent particulièrement. Caraâeres 8c circonftahces qui les
rendent plus ou moins funeftes. Objet prit!ripai qu’on doit
fe propofer dans leur traitement. Quel eft celui dcs*fiftules
fimples 8c récentes. Ce qu’on doit faire fi les callofités font
confidérables. Traitement des fiftules compliquées de carie;
lbid. 828. a. Celui des fiftules coiripofécs, dont la dureté &
les finuofités ne préfentent rien d’extraordinaire: Soins acccf1
foires que le maréchal doit prendre durant la maladie de
Yanimal. .lbid. b.
Fiflule à la faignée du col. Suppl. III. 41 1 . b. Fiftule aux
bourfes. lbid.
Fiflule à l ’anus. Négligence des àutcurs à l’égard de cette
maladie qu’ils n’ont point affez cherché à connoître. Caufes de
l’ulcere finueux & calleux qui vient à l’anus. V I . 828. b. Fiftule
fimple 8c incomplette. Fiftule borgne & externe. Fiftule borgne
& interne. Fiftule complctte. Fiftule compofée. Quels font
les moyens de s’affurer de ces différences. Q uel eft le cas d’une
fiftule incurable. Comment on prépare l’animal à l’opération.
Différentes maniérés de procéder, félon la diverfité des cas.
lbid. 829. a. Soins qui doivent fuivre l’opération. lbid. b. Voye{
Suppl. III. 411. b.
Fiflule lacrymale, ulccre calleux & finueux, dont le fiegâ
eft à l’angle interne de l’oeil. Quelle peut être la caufe au
filencc que les* auteurs ont toujours gardé fur cette maladie-.
Détails qui montrent la poffinilité de la fiftule lacrymale dans
l’animal, 8c qui font voir la marche & les progrès de cette
maladie. VI. «36. a. Les fignes de cette fiftule ne font point
auffi fenfibles oans, le cheval que dans l’homme. Symptômes
auxquels néanmoins on peut la reconnoître. Caufes de cette
maladie, lbid. b. Moyen de s’affurer de fes différens degrés.
lbid. 831. a. Panfement qui doit fuivre l’opération. Suitfe des
foins jufqu’à l’entière guérifon. lbid. b. Voyc{ Suppl. III. 414. b.
Fistules ou C a n a u x , (Anatomie des plantes) VI. 831 .b.
Fistule ou petite flûte. (L u th .) Les principaux inrtru-
mens à vent des anciens étoient la tibia 8c la fiflule. Defcription
de la fiftule. VI. 831. b.
FISTULEUX. ( Chirurg: ) Sinus fiftuleux qu’on doit dilater.
VII. 603. a. Deux vues générales pour lefquelles on
entretient une ouverture dilatée, lbid. Comment Scultet
guérit les finus fiftuleux. X V . 221. a. Ulcere fiftuleux. XVII.
37l i r z , vieux mot françois, qui fignifie fils. On l’ajoute
ordinairement au nom des fils naturels des rois d’Angleterre.
En Irlande, plufieurs familles portent ce titre devant le nom
de leur famille. Les Mofcovites ont employé de même le mot
witSy après le nom deleurpere. VI. 531 .b.
FIUM, (Géogr.) ville d’Afriqueaansla moyenhe Ëgybte,
Détails fur la province de ce nom. Monumens remarquables
qui fe trouvoient dans l’ancienne Abydos, que l’on croit être
la même que Fium. V I. 822. a.
FIUME, (Géogr.) ville appartenante à la maifon d’Autriche
, dans la Liburme , fur un golfe de la mer Adriatique.
Son gouvernement, fa fituation, Defcription de Cette ville.
Sa longitude 8c fa latitude. Suppl. III. 46. b,
FIXATION fi* F ix é. ( Chym.) Quelles font les fubftance»
u’on fixe par compoftrion. Quelles font celles qui font
xêes par dépouillement ou dêcompofition. Prétendue fixa-
A A A A a a a a a