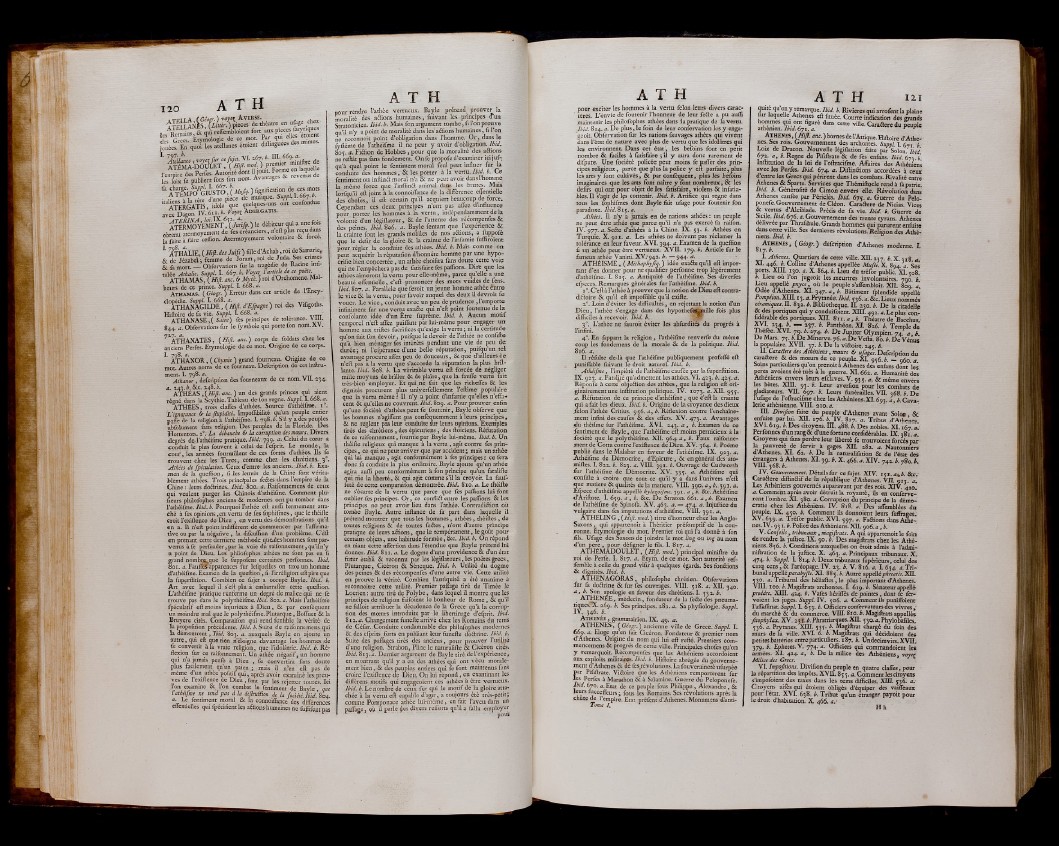
no A T H
h m É Ê Ê m Ê ^ È Ê Ê & en S p i J
les loix le publient fous fon nom. Avantages
f l A T S l P O WG iü S T O ', ( Ï Ï & ) lignification f e # S Ç g
-, v J ï i k tête d’une pieee de mufique. Sttppi1.667.i.
ATERGATIS, idole que quelques-uns ont confondue
avec Dagon. IV.611 .1/ « A d e r g a t is .
j t f r IMA. loi. IX. 6<î' a' s c .
ATERMOIEMENT, | j g p l e débitettr qm a une f i«
obtenu atermoyement de fes créancters, n eft plus reçu dm;
la fuite à faite ceffion. Atermoyement volontaire 8c forcé.
1 ï f HAL1E, ( Util. des Juifs ) fille d’Acliab, rot de Samarte,
& de Jèiabel ; femme de Joram, roi de Juda. Ses crimes
& fa mort — Obfervadons fur la tragédie de Racine intitulée
Athall'. Suffi. I. 667. é. Vom H j de se foet,
ATHAMAS, ( Hifi. une. «■ Myde ) roi d Orchomene. Malda”
s cet ” “ 1* de rEncy‘
C’ 1 tH À n Ï (SLD E , ( Htjl. i'Efpugnt') roi des Vifigôtfts.
Hiftoire de fa vie. Suffi. 1. 688. à. ■
ATHANASE,( Saint) fes principes de tolérance. VU1.
844. a. Obfervadons fur le fymbole qui porte fon nom.XV.
7 ^ T H A N A T E S , (HiJI. ntic.) corps de foldats chez les
anciens Perfes. Etymologie de ce mot. Origine de ce corps.
1 A TH A N O R , ( Chymu ) grand fourneau. Origine de ce
mot. Autres noms de ce fourneau. Defcripdon de cetmftru-
ment. I. 798. a.
Athanor , defeription des fourneaux de ce nom. VU. 134.
a. 243. b. 8tc. 248. A.
ATHÉAS >{Hifi. anc. ) un des grands princes qui aient
régné dans la Scÿthie. Tableau de-Ion regne. Suppl. L 668. a.
ATHÉES, trois claffes d’athées. Source d’athêifme. i°.
L’ignorance & la ftupidité. Impoflibilité qu’un peuple entier
paffe de la religion à l’athéifme. L 798. b. S’il y a des peuples
abfolument fans religion. Des peuplés de la Floride. Des
Hottentots. 2°. La débauché & la corruption des maurs. Divers
degrés de-l’athéifme pratique. Ibid,.799. a. Celui du coeur a
conduit le plus fouvent à celui de l’efprit. Le monde, la
cour , les armées fourmillent de ces fortes d’athées. Ils fe
trouvent chez les Turcs, comme chez les chrétiens. 30.
Athées de Spéculation. Ceux d’entre les anciens. Ibid. b. Examen
de la queftion, fi les lettrés de la Chine font véritablement
athées. Trois principales feâes.dans l’empire de la
Chine : leurs doétrines. Ibid. 800. a. Raifonnemens de ceux
qui veulent purger les Chinois d’athéifme. Comment plusieurs
philofophes anciens & modernes ont pu tomber dans
l’athéifine. Ibid. b. Pourquoi l’athée eft aulîi fermement attaché
à fes opinions,en vertu de fes fpphifmçs , que le théiile
croit l’exiftence de Dieu , en vertu des démonstrations qu’il
en a. Il n’eft point indifférent de .commencer par l’affirmative
ou par la négative , la difeuffion d’un problème. C’êft
en prenant cette derniere méthode que.des hommes font parvenus
àfe perfuader, par la voie du raifonnement, qu’il n’y
a point de Dieu. Les philofophes athées ne font pas en ii
grand nombra.que le fuppofent certaines perfonnes. Ibid.
001. a. FaufféTapparences fur lefquelles on taxe un homme
d’athéifme. Examen de la queffion, fi l’irréligion eft pire que
la fuperftition. Combien ce fujet a occupé Bayle. Ibid. b.
Art avec lequel il s’eft plu à embarrafler cette queftion.
L’athéifme pratique renferme un degré de malice qui ne fe
trouve pas dans le polythéifme. Ibid. 802. a. Mais l’athéifme
fpéculatif eft moins injurieux à Dieu, & par conféquent
un moindre mal que le polythéifme. Plutarque, Boflùet & la
Bruyere cités. Comparaifon qui rend fenfible la vérité de
la propofition précédente. Ibid. b. Suite. de r'aifonnemens qui
la démontrent, Ibid. 803. a. auxquels Bayle en ajoute, un
autre, qui eft que rien n’éloigne. davantage les hommes .de
fe convertir à la vraie religion, que l’idolâtrie. Ibid. b. Réflexion
fur ce raifonnement. Un \ athée négatif, un homme
qui n a jamais penfé à Dieu , fe convertira fans doute
plus facilement qu’un païen,; mais il n’en eft pas de
même d un athée pofitif qui, après avoir examiné les, preuves
de lexiftence de Dieu,finit par les rejetter toutes. Ici
Ion examine & Ion combat le fentiment de Bayle, que
l athèifme ne tend pas à la deftruélion de la fociété.ibid. 804.
a. Le fentiment moral & la connoiffance des différences
effentielles qui fpécifientles avions humaines ne fuffifent pas
A T H
pour rendre l’athée vertueux. Bayle prétend prouver la
moralité des avions humaines, fuivant les principes d’un
Stratonicien. Ibid. b. Mais fon argument topibe, fi l’on prouve
qu’il n’y a point de moralité dans les1 a&ions humaines, fi l’on
ne reconnoît point d’obligation dans l’homme. O r , dans le
fyftème de l’athéifme il ne peut y avoir d’obligation. Ibid.
80$. a. Fiftion de Hobbes , pour que la moralité des aftions
ne reftât pas fans fondement. On fe propofe d’examiner ici juf-
qu’à quel point le fentiment moral feul peut influer fur la
conduite des hommes, & les porter à la vertu. Ibid. b. Ce
fentiment ou inftinél moral n’a oc ne peut avoir dans l’homme
la même force que l’inftinft animal dans les brutes. Mais
lorfqu’il eft joint à la connoiffance de la différence eijentielle
des chofes., il eft certain qu’il acquiert beaucoup de force.
Cependant ces deux .principes n’ont pas aflez d’influence
pour porter les hommes h la vertu, indépendamment de la
volonté d’un légiflateur, & de l’attente des récompenfes &
des peines. Ibid. 806. a. Bayle fentant que l’expérience &
la crainte font les grands mobiles de nos aétions, a fuppofé
que le defir de la gloire & la crainte de l’infamie fuffiroient
pour régler la conduite des athées. Ibid. b. Mais comme on
peut acquérir la réputation d’honnête homme par une hypo-
crifie bien concertée, un athée choifira fans doute cette voie
qui ne l’empêchera pas de fatisfaire fes paillons. Dire que les
athées aimeront la vertu pour elle-même, parce qu elle a une
beauté eflentielle, c’eft prononcer des mots vuides de fens.
Ibid. 807. a. Parallèle que feroit un jeune homme athée êntre
le vice & la vertu, pour favoir auquel des deux il devroit fe
vouer. Le vice, conduit avec un peu de prudence, l’emporte
infiniment fur une vertu exaéle qui n’eft point foutenue de la
confolante idée d’un Être fuprême. Ibid. b. Aucun motif
temporel n’eft aflez puiflânt par lui-même pour engager un
homme aux triftes facrifices qu’exige la vertu ; ni la certitude
qu’on fait fon devoir, puifque le devoir de l’athée ne confifte
qu’à bien ménager fes intérêts pendant une vie de peu de
durée; ni l’efpèrance d’une belle réputation, puifqu’un tel
avantage procure aflez peu de douceurs, & que d’ailleurs ce
n’eft pas à la vertu que s’accorde la réputation la plus brillante.
Ibid. 808. b. La véritable vertu eft forcée de négliger
mille moyens de briller & de plaire, que hufaufle vertu lait
très-bien employer. Et qui ne fait que les richefles & les
dignités procurent plus uniyerfellement l’eftime populaire
que la vertu même i II n’y a point d’infamie qu’elles n’effacent
& qu’elles ne couvrent. Ibid. 809. a. Pour prouver enfin
qu’une fociété d’athées peut fe foutenir, Baylê obferve que
les hommes n’agiflent pas conféquemment à leurs principes,
& ne règlent pas leur conduite lur leurs opinions. Exemples
tirés des chrétiens, des épicuriens, des ftoïciens. Réfutation
de ce raifonnement, fournie par Bayle lui-même. Ibid.b. Un
théifte religieux qui manque à la vertu, agit contre fes principes
, ce qui ne peut arriver que par accident ; mais un athée
qui lui manque, agit conformément à fes principes : ce fera
donc fa conduite la plus ordinaire. Bayle ajoute qu’un athée
agira aufii peu conformément à fon principe qu’un fatalifte
qui nie la liberté, & qui agit comme s’il la croyoit. La faufile
té de cette comparaifon démontrée. Ibid. 810. a. Le théifte
ne s’écarte de la vertu que parce que fes pallions lui font
oublier fes principes. Or, ce confliâ entre les pallions 8c les
principes ne peut avoir lieu dans l’atliée. Contradiction où
tombe Bayle. Autre inltance de fa part dans laquelle il
prétend montrer que tous les hommes, athées, théiftes, de
toutes religions & de toutes feétes, n’ont d’autre principe
pratique de leurs aétions, que le tempérament, le goût pour
certains objets, une habitude formée, &c. Ibid. b. On répond
en niant cette aflertion dans l’étendue que Bayle prétend lui
donner. Ibid. 811. a. Le dogme d’une providence 8c d’un état
futur établi & reconnu par les légiflatcurs, les poetes grecs,
Plutarque, Cicéron 8c aéneque. Ibid. b. Utilité du dogme
des peines & des récompenfes d’une autre vie. Cette utilité
en prouve la vérité. Combien l’antiquité a été unanime à
reconnoitre cette utilité. Premier pauage tiré de Timée le
Locrien : autre tiré de Polybe, dans lequel il montre que le?
principes de religion faifoient le bonheur de Rome, 8c qu’il
ne falloit attribuer la décadence, de la Grece qu’à la corruption
des moeurs introduite par le libertinage d’efprit. Ibid.
812. a. Changement funefte arrivé chez les Romains du rems
de Céfàr. .Conduite condamnable des philofophes modernes
& des efprits forts en publiant leur funefte doétrine. Ibid. b..
Suite des paffages tirés des anciens, pour prouver l'utilité
d’une religion. Strabon, Pline le naturalifte oc Cicéron cités.
Ibid. 813.a. Dernier argument de Bayle tiré de l’expérience,
en montrant qu’il y a eu. des athées qui ont vécu moralement
bien y 8c des peuples entiers qui le font maintenus fans
croire i ’exiftence de Dieu. On lui répond, en examinant les
différens motifs qui engageoient ces athées à être vertueux.
Ibid. b. Le nombre de ceux fur qui le motif de la gloire attachée
à la vertu eft capable d’agir, a toujours été très-petit ;
comme Poniponàce athée lui-mênie, en fait l’aveu dans un
paflage, où il parle |ês divers reflbrts qu’il a fallu employer
A T H A T H 121
pour exciter les hommes à la vertu félon leurs divers carac-
teres. L’énvie de foutenir l ’honneur de leur fefte à pu auffi
maintenir les philofophes athées dans la pratique de la vertu.
Ibid. 814 .a. De plus, le foin de leur confervation les y enga-
"geoit. Obfervation fur les nations fauvages athées qui vivent
dans l’état de nature avec plus de vertu que les idolâtres qui
les environnent. Dans cet état', les befoins font en petit
nombre & faciles à fatisfaire ; il y aura donc rarement de
difpute. Une fociété policée peut moins fe paffer des principes
religieux, parce que plus la police y eft parfaite, plus
les arts y font cultivés, & par conféquent, plus les befoins
imaginaires que les arts font naître y font nombreux, & les
defirs qui ont pour objet de les fatisfaire, violens & infatia-
bles. Il s’agit de lçs contenir. Ibid. b. Artifice qui regne dans
tous les (ophifmes dont Bayle fait ufage pour foutenir fon
paradoxe. Ibid.815.a.
Athées. Il n’y a jamais eu de nations athées : un peuple
ne peut être athée que parce qu’il n’a pas exercé fa raifon.
IV. 977. a. Se&e d’athées à la Chine. IX. 53. b. Athées en
Turquie. X. 911. a. Les athées ne doivent pas réclamer la
tolérance en Îeur faveur. XVI. 394. a. Examen de la queftion
fi un athée peut être vertueux. XVII. 179. b. Article fur le
fameux athée Vanini. XV.*942. b. — 944. a.
ATHÉISME, ( Méthaphyjiq. ) idée exa&e qu’il eft important
d’en donner pour ne qualifier perfonne trop légèrement
d’athéifme. I. 81;. a. Antiquité de l’athéifine. Ses cliver fes
efpeces. Remarques générales fur l’athéiime. Ibid. b.
I °. C’eft à l’athée à prouver que la notion de Dieu eft contra-
di&oire & qu’il eft impoflible qu’il exifte.
20. Loin aéviter les difficultés, en rejettant la notion d’un
Dieu, l’athée s’engage dans des hypotheij|ÉmiUe fois plus
difficiles à recevoir. Ibid. b.
30. L’athée ne fauroit éviter les abfurdites du progrès à
l ’infini.
40. En fappant la religion, l’athéifine renverfe du même
coup les fondemens de la morale 8c de la politique. Ibid.
816. *.
II réfulte de-là que l’athéifme publiquement profeffé eft
puniflable fuivant le droit naturel. Ibid. b.
Athèifme , l’impiété de l’athéifme caufêe par la fuperftition.
IX. 923. a. Fatalité qu’admettent les athées. VI. 423. b. 425. a.
Réponfe à cette obteétion des athées, que la religion eft originairement
une inftitution politique. IV. 1073. XII. 955.
a. Réfutation de ce principe d’athéifme, que c’eft la crainte
qui a fait les dieux. Ibid. b. Origine de la croyance des dieux
.félon l’athée Critius. 956. <z, b. Réflexion contre l’enchaînement
infini des caufes 8c des effets. XV. 473. a. Avantages
du théifme fur l’athéifme. XVI. 243. a , b. Examen de ce
fentiment de Bayle, que l’athéifine eft moins pernicieux à la
fociété que le polythéifme. XII. 964. a, b. Faux raifonnement
de Cotta contre l’exifteuce de Dieu. XV. 364. b. Poëme
publié dans le Malabar en faveur de lathéifme. IX. 923. a.
Athèifme de Démocrite, d’EpicUre, & en général des ato-
miftes. I. 822. b. 823. a. VIII. 391. b. Ouvrage de Cudworrh
fur l’athéifine de Démocrite. XV. 335. a. Athèifme qui |
confifte à croire que tout ce qu’il y a dans l’univers n’eft
que matière & qualités delà matière. VIII. 390. <*, b..391. a.
Efpece d’athéifme appellé hyloroijme. 391. a , b. &c. Athèifme
d’Àriftote. I. 659. a , b. 8cc. De Straton. 661. a ,b. Examen
de l’athéifme de Spinofa. XV. 463. a. — 474. a. Injuftice du
vulgaire dans fes imputations d’athèifme. VIII.’ 391. a.
ATHELING, (Mft. mod.) titre d’honneur chez'les Anglo-
Saxons, qui appartenoit à l’héritier préfomptif de la couronne.
Étymologie du mot. Premier roi qui l’a donné à fon
fils. Ufage des Saxons de joindre le mot ling ou ing au nom
d’un pere, pour défigner le fils. I. 817. a.
ATHÉMADOULET, {Lfifi. mod. ) principal miniftre du
roi de- Perfe. I. 817. a. Étym. de ce mot. Son autorité ref-
femble à celle du grand vifir à quelques égards. Ses fondions
8c dignités. Ibid. b.
ATHENAGORAS, philofophe chrétien. Obfervations
fur fa do&rine & fur fes ouvrages. VIII. 518. a. XII. 340.
a * a ’ ^on ®P°l°g*e en faveur des chrétiens. I. 532. b.
ATHENÉE, médecin, fondateur de la fede des pneuma-
tiquesHX. 269. b. Ses principes. 282. a. Sa phyfiologie. Suppl.
IV. 346. b.
AthenÉE , grammairien. IX. 49. a.
ATHENES, ( Géogr. ) ancienne ville de Grece. Suppl. I.
669. a. Eloge qu’en fait Cicéron. Fondateur & premier nom
d’Athenes. Origine du nom qui lui eft refté. Premiers com-
mencemens & progrès de cette ville. Principales chofes qu’on
y remarquoit. Récompenfes que les Athéniens accordoient
aux exploits militaires. Ibid. b. Hiftoire abrégée du gouvernement
a’Athènes 8c dé fes/évolutions. La fouveraineté ufurpée
par Pififtrate. Vidoire que les Athéniens remportèrent fur
les Perfes à Marathon 8c à Salamine. Guerre du Peloponefe.
Ibid. 670. a. Etat de ce peuple fous Philippe, Alexandre, &
l e - fucceffeurs ; fous les Romains. Ses révolutions après la
chutç de l’empire. Etat prèfent d’Athenes. Monumens d»’anti- {
Tome I. r I
i ciiutuee. tourte indication des grands
* “ H C a r a b e du p^ple
ATHENES, (Hijl. anc. ) bornes del’Atnquc. Hiftoire d’Athe-
nés. Ses rois. Gouvernement des archontes. Suppl. 1. 671 b
Loix de Dracon. Nouvelle légiflation fiùte par Solôn ! Ibid
672. a y b. Regne de Pififtrate & de fes enfans. Ibid. 673.il
Inftitution de la loi de l’oftracifme. Affaires des Athéniens
avec les Perfes. Ibid. 674. a. Diftindions accordées à ceux
d’entre les Grecs qui périrent dans les combats. Rivalité entre
Athènes & Sparte. Services que ThémiftQcle rend à fa patrie.
Ibid. b. Génerofité de Cimon envers elle. Révolution dar^
Athènes caufée par Périclès. Ibid. 675. a. Guerre du Peloponefe.
Gouvernement deCléon. Caradere de Nicias. Vices
& vertus d’Alcibiade. Précis de fa vie. Ibid. b. Guerre de
^1$ 'a" G°uvernement des trente tyrans. Athènes
délivrée par Thrafibule. Grands hommes qui parurent enfuite
dans cette ville. Ses demieres révolutions. Religion des Athéniens.
Ibid. b. -
A th ène s , {Géogr.) defeription d’Athenes moderne. I.
8ï7. b.
I. Athènes. Quartiers de cette ville. XII. 237. b. X. 318. a.
XL 446. b. Colline d’Athenes appellée Muféc. X. 894. a. Ses
ports. XHI. 130. a. X. 864. b. Lieu du tréfor public. XI. 308.
b. Lieu où l’on jugeoit les meurtres involontaires. 790 b
Deu appellé pnyce, où le peuple s’affembloit. XII. 800. a l
Odée d’Athenes. XI. 347. a , b. Bâtiment fplendide appellé
Pompéion.XIII. 13. a. Prytanée. Ibid. 536. a. 8cc.Lieux nommés
céramiques. IL 832. b. Bibliothèque. H. 230. b. De la citadelle
& des portiques qui y conduifoient. XHI. 492. a. L e plus con-
fidérable des portiques. XII. 8 1 1 .* , b. Théâtre de Bacchus.:
Ï S a ?37- b' Panthéon. XI. 826. b. Temple de
Théfée. XVL 79. b.,274. b. De Jupiter Olympien. 74. a , b.
De Mars. 73. b. De Minerve. 76. a .D e Vefta. 80. b. De Vénus
la populaire. XVII. 37. b. De la vidoire. 245. b.
U.Carailere des Athéniens, meeurs 6* ufages. Defeription du
caradere & des moeurs de ce peuple. XI. 936. b. —- 960 a
Soins particuliers qu’on prenoit à Athènes des enfans dont les
peres avoient été tués à la guerre. XI. 662. «. Humanité des
Athéniens envers leurs efclaves. V . 933. a. & même envers
les bêtes. XHI. 93. b. Leur averfion pour les combats de
gladiateurs. VII. 697. b: Leurs funérailles. V IL 368. b. De
l’ufage de l’oftraciime chez les Athéniens.XI. 6o-i.a,b Cavalerie
athénienne. VIH. 210 .*. '
n i. Divifion faite du peuple d’Athenes avant Solo*, &
Mfuite par lui. XH. 176. b. IV. 817. a. Tribus d’Athenes.
XVI. 619. b. Des citoyens. III. 488. b. Des nobles. XI. 167.0*
Perfonnes d’un rang& d’une fortune confidérables. IX. 381. a.
Citoyens qui fans perdre leur liberté fe trouvoient forcés par
la pauvreté de fervir à gages. XH. 282. Nautonniers
d Athènes. XI. 02. b. De la naturalifation & de l’état des
Rangera i Athènes. XI. 39. i . X. 466. a. X IV. 74Z. S. 780. i .
VIII. 368. é..
IV. Gouvernement. Détails fur ce fujet. XIV. xei.o+b. & c.-
Caradere diftindif de la république d’Athenes. VJL913. a.
Les Athémens gouvernés auparavant par des rois. XTV. 420*
a. Comment après avoir détruit la royauté, ils en conferve-
rent l’ombre. A l . 380. a. Corruption du principe de la démocratie
chez les Athéniens. IV. 818. *. Des affemblées du
peuple. IX 4jo. b. Comment ils donnoient leurs fuflrages.
X V . 6 p . a. Tréfor public. XVI. 397. a. Fadions dans Athènes.
IV. 931. b. Police des Athéniens. XH. 906. a, b.
V. Confeils, tribunaux, magiftrats. A qui appartenoit le foin
de rendre la juftice.lX. 90. b. Des magiftrats chez les Athéniens.
836. b. Conditions auxquelles on étoit admis à l’admi-
niftration de la juftice. X. 463. a. Principaux tribunaux. X.
474- b. Suppl. I. 814. b. Deux tribunaux iupérieurs, celui des
cinq cens, & l’aréopage. IV. 23. b. V. 816. a. L 634. a. Tribunal
appelléparabyjle. XI. 883. b. Autre appelléphreatis. XIL
330. a. Tribunal des héliaftes, le plus important d’Athenes.
v r a . zoo. b. Magiftrats archontes. 1. 619. b. Sénateur appellé
proèdre. XIII. 424. b. Vafes hériffés de pointes, dont ie ier-
voient les juges. Suppl. IV. 306. a. Comment ils punifloient
l’aflaflinat.Suppl. I. 653: b. Officiers conièrvateursdes vivres,
du marché 8c du commerce. VUI. 8x0. b. Magiftrats appellés
•Jitophylax. XV. 23 Ï. b. Phrarriaroues. XII. 3 30. a. Phylobafiles.
336. a. Prytanes. XHI. 333. b. Magiftrat chargé du foin des
murs de la ville. XVI. o. b. Magiftrats qui décidoient des
petites batteries entre particuliers. 187. b. Undecimvirs. XVII.
379. b. Ephetes. V. 774. a. Officiers qui commandoient les
armées. XI. 424. a, b. De la milice des Athéniens, voye^
Milice des Grecs.
V I .Importions. Divifiondupeupleen quatre claffes, pour
la répartition des impôts. XVII. 833. n. Comment les citoyens
s’impofoient des taxes dans les tems difficiles. XHI. 33 6. a.
Citoyens aifés qui étoient obligés d’équiper des vaiffeaux
pour l’état. XVL 638. b. Tribut qu’un étranger p?yoit pour
le droit d’habitation. X. 466. a.'
Hh