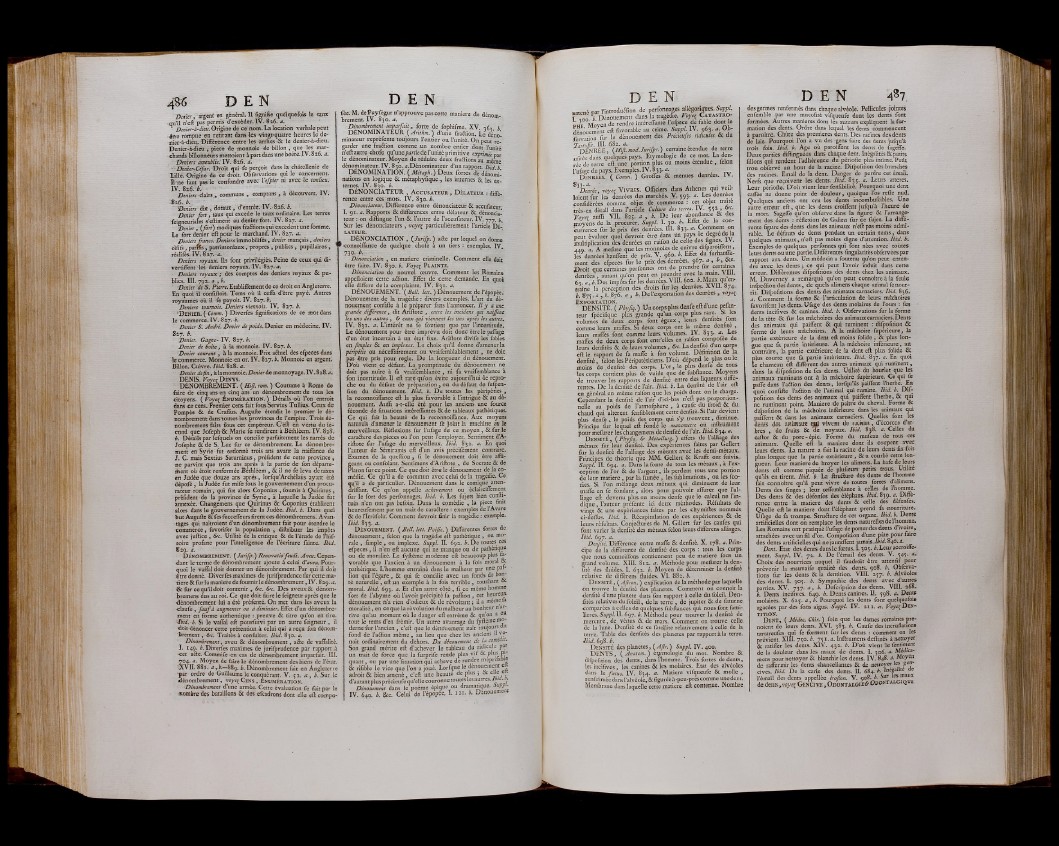
à U D E N D E N
jJe/t ter, argent en général. 11 fignifie quelquefois le taux
qu’il n’eft pas permis d’excéder. IV. 826. «.
Denier-à-dieu. Origine de ce nom. La location verbale peut
être rompue en retirant dans les vingt-quatre heures le de-
nier-à-dieu. -Différence entre les arrhes & le denier-à-dieu.
Denier-à-dieupiece de -monnoie de billon , que les marchands
billonneurs mettoient à part dans une boète.JV.826. «.
Deniers ameublis.' IV. 826. a. a
■ Denier-Ufar. Droit qui -fe perçoit dans la châtellenie de
Lille. Origine de ce droit. Obiervations qui le concernent.
B'ne faut pas le confondre avec Vefpier ni avec le tonlieu.
IV. 8 a6.X , -T, f-rr
Deniers-clairs , communs -, comptans, a découvert. IV.
S26. b.
' Deniers dix , dofeuX, d’entrée. IV. 826. é.
Denier fort, taux qui excede le taux ordinaire. Les terres
feigneuriales s’eftiment au denier fort. IV. 827. a.
■Denier, (fort) modiques fractions qui excédent une fomme.
Le fort denier eft pour le marchand. IV. 827. a.
Deniers francs. Deniers immobilifés, denier mançais, deniers
oîfifs, parms, patrimoniaux, propres, publics, pupillaires ,
réaliffe. IV:827.-rf.
Deniers royaux. Ils font privilégiés. Peine de ceux qui di-
vertiffent-les deniers royaux. IV. 827. a.
■ Deniers royaux ; des comptes des deniers royaux & publics.
III. 792. a , b.
' -Denier de S. Pierre. EtablifTement de ce droit en Angleterre.
En quoi il cbnfiftoit. Tems où il ceffa d’être payé. Autres
royaumes où il fe payoit. IV. 827. b.
Deniers tournois. Deniers viennois. IV. 827. b.
-‘D en ie r . (Comm. ) Diverfes lignifications de ce mot dans
le commerce. IV. 817. b.
Denier S. André. Denier de poids. Denier en médecine. IV.
827. b.
Denier. Gagne- IV. 827. b.
Denier de boîte , à la monnoie. IV. 827. b.
Denier courant, à la monnoie. Prix aâuel des efpeces dans
le commerce. Monnoie en or. IV. 827. b. Monnoie en argent.
Billon. Cuivre. lbid. 828. a.
Denier défit, k la monnoie. Pmier de monnoyage.IV.828.tf.
DENIS. Voyez Dénys.
DÉNOMBREMENT. ( Hifi. rom. ) Coutume à Rome de
faire de cinq ans en cinq ans un dénombrement de tous les
citoyens. ( Voye^ É n um é ra tion . ) Détails où l’on entroit
dans ce cens. Premier cens fait fous Servius Tullius. Ceux de
Pompée & de Craffus. Augufte étendit le premier le dénombrement
danstoutes les provinces de l’empire. Trois dé-
nombremens faits fous cet empereur. C eft en vertu du fécond
que Jofeph 8c.Marie fe rendirent à Bethléem. IV. 828.
b. Détails par lefquels on concilie parfaitement les narrés de
Jofephe 8c de S. Luc fur ce dénombrement. Le dénombrement
en Syrie fut ordonné trois ans avant la haiffance de
J. C. mais Sextius Saturninus, préfident de cette province,
ne parvint que trois ans après à la partie de fon département
où étoit renfermée Bethléem , oc il ne fe leva de taxes
en Judée que douze ans après, lorfqu’Archélaüs ayant été
dépofé, la Judée fut mife fous le gouvernement d’un procurateur,
romain , qui fut alors Coponius, fournis à Quirinus,
préfident-de la province de Syrie, à laquelle la Judée fut
annexée. Changemens que Quirinus 8c Coponius établirent
alors dans le-gouvernement de la Judée, lbid. b. Dans quel
but Augufte & fes fucceffeurs firent ces dénombremens. Avantages
qui naîtroient d’un dénombrement fait pour étendre le
commerce, favorifer la population , diftribuer les impôts
avec juftice , &c. Utilité de la critique 8c de l’étude de 1 histoire
profane pour l’intelligence de l’écriture fainte. lbid.
€29. a.
Dénombrement. (Jurifp.) Renovatio'feudl. Aveu. Cependant
le terme de dénombrement ajoute à celui d'aveu. Pourquoi
le vaffal doit donner un dénombrement. Par qui il doit
'être donné. Diverfes maximes de iurifprudence fur cette matière
8c fur la maniéré de fournir le dénombrement, IV. 829. a.
& fur ce qu’il doit contenir , &c. &c. Des aveux 8c dénombremens
dus au roi.-Ce que doit faire le feigneur après que le
dénombrement lui a été préfenté. On met dans les aveux la
-claufe , faufà augmenter ou à diminuer. Effet d’un dénombrement
en forme authentique : .preuve 8c titre qu’on en tire.
'lbid. b. Si le vaffal eft pourfuivi par un autre feigneur , il
doit-dènoncer cette prétention à celui qui a reçu fon dénombrement
, &c. Traités à confulter. lbid. 830. a.
Dénombrement, aveu 8c dénombrement, aâe de vaffalité.
I. 149. b. Diverfes maximes de jurifprudence par rapport à
-cet aâe. Commife en cas de dénombrement imparfait. III.
704. a. Moyen de faire le dénombrement des biens de l’état.
-XVII. 881. a , 889. b. Dénombrement fait en Angleterre
•par ordre de Guillaume le conquérant. V. 52. a 9 b. Sur le
dénombrement, voye^ Cens , Enuméra tion .
•Dénombrement d une armée. Cette évaluation fe fait par le
«ombre des bataillons 8c des efcadrons dont elle eft compofée.
M-dePuyfégur n’approuve pas cette maniéré de dénombrement.
IV. 830. a.
Dénombrement imparfaitforte de fophifme. XV 265 u
DÉNOMINATEUR ( Arïthm. ) d’une fraâion. Le déno^
minateur repréfente toujours l’entier ou l’unité. On peut regarder
une fraâion comme .un nombre entier dont l’unité
n’eft autre chofe qu’une 'partie de l’unité primitive exprimée par
le dénominateur. Moyen de réduire deux fraâions au même
dénominateur. IV. 830. a.Dénominateur d’un rapport ïbid h
DÉNOMINATION. ( Métaph.) Deux fortes de dénoiiiï
nations en logique 8c métaphyfique, les internes 8c les externes.
IV. 830. b.
DÉNONCIATEUR , A c c u s a t e u r , D é la t e u r : diffé-;
rence entre ces mots. IV. 830. b.
Dénonciateur. Différence entre dénonciateur 8c accufateur;
L 91. a. Rapports 8c différences entre délateur 8c dénonciateur
: on dimngue l’un 8c l’autre de l’accufateur. IV. 777. b.
Sur les dénonciateurs , voye^ particulièrement l’article Dél
a t e u r .
DÉNONCIATION , ( Jurifp. ) aâe par lequel on donne
1 connoiffancc de quelque choie à un tiers : exemples. IV.
73°- }>' . . . _
Dénonciation , en matière criminelle. Comment elle doit
être faite. IV. 830. b. Voye{ P la in t e .
Dénonciation de nouvel oeuvre. Comment les Romains
appelloient cette aétion. Effet de cette demande. En quoi
elle différé de la complainte. IV. 831. a.
DÉNOUEMENT. ( Bell. lett. ) Dénouement de l’épopée.'
Dénouement de la tragédie : divers exemples. L’art du dénouement
confiffe à le préparer fans l’annoncer. Il y aune
grande différence , dit Ariftote , entre les incidens qui naiffent
Us uns des autres , & ceux qui viennent les uns après Us autres.
IV. 831. a. L’intérêt ne fe foutient que par l’incertitude.
Le dénouement pour être imprévu doit donc être le paffage
d’un état incertain à un état fixe. Ariffote divife les fables
en funples 8c en impUxes. Le choix qu’il donne d’amener la
péripétie ou néceffairement ou vraifemblablement , ne doit
pas être pris pour réglé. De la longueur du dénouement.
D’où vient ce défaut. La promptitude du dénouement ne
doit pas nuire à fa vraifemblance , ni fa vraifemblance à
fon incertitude. Il efl rare qu’on évite aujourd’hui -le reproche
ou du défaut de préparation, ou du défaut de fufpen-
fion du dénouement, lbid. b. De toutes les péripéties ,
la reconnoiffance efl la plus favorable à l’intrigue 8c au dénouement.
Auffi a-t-elle été pour les anciens une fource
féconde de fituations intéreffantes 8c de tableaux pathétiques.
Ce qui fait la beauté de la reconnoiffance. Aux moyens
naturels d’amener le dénouement fe joint la machine ou le
merveilleux. Réflexions fur l’ufage de ce moyen, 8c fur le
caraâere des pièces où l’on peut remployer. Sentiment d’A-
riilote fur -l’ufage du merveilleux, lbid. 832. a. En quoi
l’auteur de Sémiramis efl d’un avis précifément contraire.
Examen de la queflion, fi le dénouement doit être affligeant.
ou confolant. Sentimens d’Ariflote , de Socrate 8c de
Platon fur ce point. Ce que doit être le dénouement de la comédie.
Ce qu’il a de commun avec celui de la tragédie. Ce 3t)’il a de particulier. Dénouement dans le comique atten-
riffant. Ce qu’on appelle achèvement ou éclairciffement
fur le fort des perfonnages. lbid. b. Les fujets bien confti-
tués n’en ont pas befoin. Dans la comédie , la piece finit
heureufement par un trait de caraâere : exemples de l’Avare
8c de l’Irréfolü'. Comment devroit finir la tragédie : exemple.
lbid. 833.. 4*
Dénouement. ( Bell. lett. Poéfie. ) Différentes fortes de
dénouement, félon que la tragédie efl pathétique , ou morale
, fimple , ou implexe. Suppl. II. 692. b. De toutes^ ces
efpeces, il n’en eft aucune qui ne manque ou de pathétique
ou de moralité. Le iyftême moderne eft beaucoup plus favorable
que l’ancien à un dénouement à la fois moral oc
pathétique. L’homme entraîné dans le malheur par une paf-
lion qui l’égare, 8c qui fe concilie avec un fonds de bonté
naturelle, eft un exemple à la fois terrible, touchant oC
moral. lbid. 693. a. Et d’un autre côté , fi ce même homme
fort de l’abyrae où l’avoit précipité fa paffion, cet heureux
dénouement n’a rien d’odieux 8c de révoltant j il a même la
moralité, en ce que la révolution du malheur au bonheur n arrive
qu’au moment où le danger eft extrême 8c qu’on a eu
tout le tems d’en frémir. Un autre avantage du fyftême moderne
fur l’ancien ,'c ’eft que le dénduement naît toujours au
fond de l’aâion même, au lieu que chez les anciens il Vf"
noit ordinairement du dehors. Du dénouement de la comedie.
Son grand mérite eft d’achever le tableau du ridicule par
un trait de force que la furprife rende plus vif
quant, ou par une fituation qui achevé de rendre méprilaüie
& rifible le vice que l’on a joué. Lorfque le dénouement
adroit 8c bien amené, c’eft une beauté de plus ; 8c el e
d’autantplus précieufe qu’elle couronne toutes les autres. 1 • •
Dénouement dans le poème épique ou drainanaue. ^ -
IV. 640. b. 8cc. Celui de l’épopée, I. 121. b. Dénouement
D E N D E N 4*7.
„ „ i ™ l'introduiUon de perfonnages allégorwiieS. Suppl.
I ,00 b- Dénouement dans htragetl.e. Voyez C a t a s t r o -
. Moyen de rendre intéreflante l'efpece de fable dont le
* .A £,.....1.1/1 01» rrimp .Çwnn/.dénouement eft favorable au crime. Suppl. IIVV. f9i6n3i.. au. UObb--
fervation fur le dénouement des Precieufes ridicules 8c du
Tartuffe. III. Ô82. a. I '
DENRÉE, (Hifi.mod.Jurifpr.) certaine étendue de terre
ufitée dans quelques pays. Etymologie de ce mot. La denrée
de terre eft une portion plus ou moins étendue , lelon
l’ufage du pays. Exemples. IV. 833.«. , . . .
Denrées. ( Comm. ) Groffes 8c menues denrées. IV.
^ Denrée, voyez V iv r e s . Officiers dans Athènes qui veil-
loient fur les denrées des marchés. V. 593. a. Les denrées
confédérées comme objet de. commerce : cet objet traite
très-en détail dans l’article Culture des terres. IV. 352 , o*c.
'Voyez auffi v i l . 823. a y b. De leur abondance 8c des
moyens de la procurer. Suppl. I. 30. b. Effet de la concurrence
fur le prix des denrées. III. 833. a. Comment on
peut évaluer quel devroit être dans un pays^le degré de la
multiplication des'denrées en raifon de celle des lignes. IV.
449. a. A mefure que les monnoies de cuivre difparoiffent,
£ denrées hauflent de prix. V. 960. b. Effet.du furhauffe-
ment des efpeces fur le prix des denrées. 967. a , ,
Droit que certaines perfonnes ont de prendre fur certaines
denrées , autant qu’on peut en prendre avec a mam. VU1.
63. a., b. Des impôts fur les denrées. VIII. 602. b. Maux qu entraîne
la perception des droits fur les denrées. XV11. 0 7 4 .
b. 873. a y b. 876. a y b. De l’exportauon des denrées , voye^
E x p o r ta t io n . , ^ -
DENSITÉ. ( Phyfiq.) Uncorpsplus denfeeftdune pelan-
teur fpécifique puis grande qu’un corps plus rare. Si les
volumes de deux corps font égaux , leurs denfites lont
comme leurs maffes. Si deux corps ont la même deniitè ,
leurs maffes font comme leurs volumes. IV. 833. a. Les
maffes de deux corps font entr’elles en raifon compoièe ae
leurs denfités 8c de leurs volumes, 6>c. La denmé d un corps
eft le rapport de fa maffe à fon volume. Définition de la
denfité, félon les Péripatéticiens. D ’où dépend le plus ou le
moins d e . denfité des corps. L’or, le plus denfe de tous
les corps contient plus de vuide que de fubftance. Moyens
de trouver les rapports de denfité entre des liqueurs .di“ é“
rentes. De la. denfité de l’air. lbid. b. La denfité de lair eft
en général en même raifon que les poids dont on le charge.
Cependant la denfité de l’air d’ici-bas n’eft pas proportionnelle
au poids de l’atmofphere , à caufe du froid 8c du
chaud qui altèrent fenfiblement cette denfité. Si l’air devient
plus denfe , le poids des corps qui s’y trouvent, diminue.
Principe fur lequel eft fondé le manomètre^ ou infiniment
pour mefurer les changemens de denfité de l’air. lbid. 834. a.
D en s ité , ( Phyfiq. Ce Métallurg.) efiets de l’alliage des
métaux fur leur denfité. Des expériences faites par Gellert
fur la denfité de l’alliage des métaux avec les demi-métaux.
Principes de théorie que MM. Gellert 8c Krafft ont fuivis.
Suppl. II. 604. a. Dans la fonte de tous les métaux, à l’exception
de l’or 8c de l’argent, ils perdent tous une portion
de leur matière, par la fumée , les fublimations , ou les feo-
ries. Si l’on mélange deux métaux qui diminuent de leur
maffe en fe fondant, alors pour pouvoir affurer que l’alliage
eft devenu plus ou moins denfe que le calcul ne l’indique,
l’auteur préfente ici deux métnodes. Réfultats de
vingt 8c une expériences faites par les chymiftes nommés,
ci-deffus. lbid. b. Récapitulation de ces expériences 8c de
leurs réfultats. Conjeâures de M. Gillert fur les caufes qui
font varier la denfité des métaux félon leurs différens alliages.
lbid. 697. a. . .
Denfité. Différence entre maffe 8c denfité. X. 178. «.Principe
de la différence de denfité des corps : tous les corps
que nous connoiffons contiennent peu de matière fous un,
grand volume. XIII. 812. a. Méthode pour mefurer la den-
fité des fluides. I. 632. b. Moyen de déterminer la denfitc
relative de différens fluides. VI. 882. b.
D en s ité , ( Aftron. ) explication de la méthode par laquelle
on trouve la denfité des planetes. Comment on connoît lr
denfité d’une planète dans fon rapport à celle du foleil. Den-
fités relatives du foleil, de la terre , de jupiter 8c de faturne
comparées à celles de quelques fubftanccs qui nous font familières.
Suppl. II. 697. b. Méthode pour trouver la denfité de
mercure, de vénus 8c de mars. Comment on trouve celle
de la lune. Denfité de ce farellite relativement à celle de la
terre. Table des denfités des planetes par rapport à la terre.
lbid. 698. b.
Den s ité des planetes, (Afir.) Suppl. IV. 400.
DENTS, | Anatom. ) étymologie du mot. Nombre
difpofition des dents, dans l’homme. Trois fortes de dents,
les incifives, les canines 8c les molaires. Etat des alvéoles
dans le foetus. IV. 834. a. Matière vifqueufe 8c molle ,
renfef mée dans l’alvéole, 8c figurée à-peu-prescomme une dent.
Membrane dans laquelle cette matière eu contenue. Nombre
des germes renfermés dans chaque alvéole^ Pellicules jointes
enfemble par une mucofité vifqueufe dont les dents font
formées. Autres maniérés dont les auteurs expliquent la formation
des dents. Ordre dans lequel les dents commencent
paroîtré. Chûte des premieres dents. Des racines des dents
Je lait. Pourquoi l’on a vu des gens faire des dents jufqu’à
trois fois. lbid. b. Age où paroiffent les dents de lageffe.
Deux parties diftinguées dans chaque dent. Inégalités 8c petits
filions qui rendent l’adhérence du périofte plus intime. Petit
trou obfervé au bout de la racine. Difpofition des branches
des racines. Email de la dent. Danger de perdre cet émaiL
Nerfs que reçoivenc les dents. lbid. 835. a. Leurs arteres.
Leur périofte. D’où vient leur fenfibilité. Pourquoi une dent
caffée ne donne point de douleur, quoique l’os refte nud.
Quelques anciens ont cru les dçnts incombuftibles. Une
autre erreur eft, que les dents croiffent jufqu’à l’iieure de
la mort. Sageffe qu’on obferve dans la figure 8c l’arrangement
des dents : réflexion de Galien fur ce fujet. La différente
figure des dents dans les animaux n’eft pas moins admirable.
Le défauts de dents pendant un certain tems, dans
quelques animaux, n’eft pas moins digne d’attention. lbid. b.
Exemples de quelques perfonnes qui font nées avec toutes
leurs dents ou une partie. Différentes Angularités obfervées par
rapport aux dents. Un médecin a foutenu qu’on peut entendre
avec les dents ; ce qui peut l’avoir induit dans cette
erreur. Différentes difpofîtions des dents chez les animaux.
M. Duverney a remarqué qu’on peut connoître à la feule
infpeâion des dents , de quels alimens chaque animal fe nourrit.
Difpofitions des dents des animaux carnaciers/ lbid. 836.
a. Comment la forme 8c l’articulation de leurs mâchoires
favorifent les dents. Ufage' des dents molaires de l’ours : fes
dents incifives 8c canines, lbid. b. Obfervations fur la forme
de la tête 8c fur les mâchoires des animaux carnaciers. Dents
des animaux qui paiffent 8c qui ruminent ; difpofition 8c
forme de leurs mâchoires. A la mâchoire fupérieure, la
partie extérieure de la dent eft moins folide, oc plus longue
que fa partie intérieure. A la mâchoire inférieure, au
contraire, la partie extérieure de la dent eft plus folide 8c
plus courte que fà partiè intérieure. Ibid. 837. J. En quoi
le chameau eft différent des autres animaux qui ruminent,
dans la difpofition de fes dents. Utilité du bourlet que les
animaux ruminans ont à la mâchoire fupérieure. Ce qui fe
paffe dans l’aâion des dents, lorfqu’ils paiffent l’herbe. En
quoi confifte l’aâion de l’animal qui rumine. lbid. b. Difpofition
des dents des animaux qui paiffent l’herbe, 8c qui
ne ruminent point. Maniéré de paître du cheval. Forme ©c
difpofition de la mâchoire inférieure dans les animaux qui
paiffent 8c dans les animaux carnaciers. Quelles font les
dents des animaux qui vivent de racines, d’écorces d’arbres
, de fruits 6c de noyaux. lbid. 838. a. Celles du
caftor 8c du porc-épic. Forme du muieau de tous ces
animaux. Quelle eft la maniéré dont ils coupent avec
leurs dents. La nature a fait la racine de leurs dents fix fois
plus longue que la partie extérieure, 8c a courbé cette longueur.
Leur maniéré de broyer les alimens. La bafe de leurs
dents eft comme piquée de plufieurs petits trous. Utilité
qu’ils en tirent, lbid. b La ftruâure des dents de l’homme
fait connoître qu’il peut vivre de toutes fortes d alimens.
Dents des finges ; leur reffemblance à celles de 1 homme.
Des dents 8c des défenfes des éléphans. lbid. 839. «. Différence
entre la matière des dents 8c celle des défenfes.
Quelle eft la maniéré dont l’éléphant prend fa -nourriture.
Ufage de fa trompe. Struâure de cet organe. lbid. b. Dents
artificielles dont on remplace les dents naturelles de l’homme.
Les Romains ont pratiqué l’ufage de porter des dents d ivoire,
attachées avec un fil d’or. Compofition d’une pâte pour faire
des dents artificielles qui ne jauniffent jamais.lbid. 840.«.
Dent. Etat des dents dansle foetus. 1.303. ¿.Leur accroiffe-
ment. Suppl. IV. 72. b. De l’émail des dents. V. 345- a"
Choix des nourrices auquel il faudrait être attentif pour
prévenir la mauvaife qualité des -dents. 908. b. Obfervations
fur les dents 8c la dentition. VIII. 237. b. Alvéoles
des dents. L 303. b. Sympathie ¡des dents avec d’autres
parties. XV. 737. « , b. Defcription des dents. VIIL 268.
b. Dents incifives. 649. b. Dents canines. II. 398. «. Dents
molaires. X. 623. «, b. Pourquoi les dents font quelquefois
agacées par des fons aigus. Suppl. IV. 211. ai. Voye^ Dent
i t io n .
D e n t , ( Médec. Chir.) foin que les dames romaines pre-
noient d■ e ' 'l eurs d:eennttss.. XXVVIT.É 3È8m3. gb . C~a u8fe W desM incruftations
tartareufes qui fe forment fur les dents : comment on les
prévient. XIII. 730. b. 731. «. Inftrumens deftinés à nettoyer
8c ratifier les dents. XIV. 432. b. D’où vient le fentiment
de la douleur dans les maux de dents. I. 306. a. Mèdica-
raens ponr nettoyer 8c blanchir les dents. IV. 848. «. Moyen
de raffermir les dents chancellantes 8c de nettoyer les eerr-
cives. lbid. De la carie des dents. IL 684. ê. Inégalité de
l’émail des dents appellée érofion. V. 908. b. Sur les maux
de dents, voyei G e n c i v e , O d o n t a l g i e & O d o n t a l g i q u e