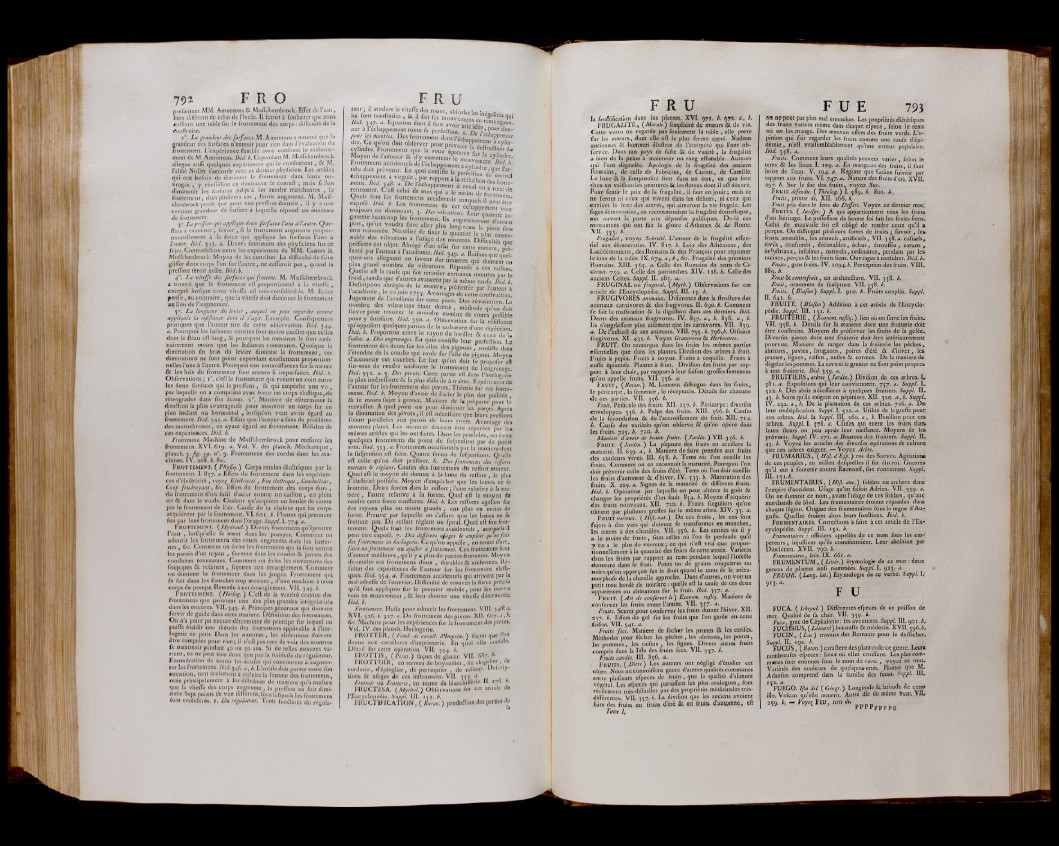
f f i F R O
préfentent MM. Amontons 8c Muffchembrock, Effet de l’eau,
nien différent de celui de l'huile. 11 fcroit à fouhaitcr que nous
enflions une table Air le frottement des corps : difficulté de la
éonftnùre, . .
a”. L a grandeur desfurfaces. M . Amontons a montré que la
grandeur des furfaces n’cntroit pour rien dans l’évaluation du
frottement. I.’expérience femble avoir confirmé le rationne*
ment de M. Amontons. Ibid. b, Cependant M. Muffchembrock
allégué auffi quelques expériences qui le combattent, 8c M,
l ’abbé Nollet s'accorde avec ce dernier pliyficien, Les ardues
qui ont befoin de diminuer le frottement dans leurs ouvrages
-, y réuffiffcnt en diminuant le cornait ; mais A l'on
diminiioit les furfaces jufqu’k les rendre tranchantes , le
frottement , dan* pluficurs cas , feroit augmenté. M. Muff-
chenbrock penfe que pour une nreffion donnée , il y a une
certaine grandeur de iurface â laquelle répond un minimum
de frottement.
5®, /</ prtjjian qui applique deux furfaces l'une à l'autre. Quc-
Aîo/t h examiner ; fa voir, ft le frottement augmente proportionnellement
li la force qui applique les lurfaces l'une à
fautre. Ibid. 343. a. Divers fentimens des pliyAciens fur ce
Auet. Contradiiiion entre les expériences de MM. Camus &
Muffchenhrock. Moyen de les concilier. La difficulté de faire
gljffcr deux corps l'un fur l’autre, ne cefferoit p a s , quand la
prefiion feroit nulle, Ibid. b.
4", L a vlttjfc des furfaces qui frottent. M, Muffchembrock
a trouvé que le frottement eA proportionnel k la v ite ffe,
excepté lorfque cette viteffe eA trés-confidérable, M. Eulcr
p en fe , au contraire, que la viteffe doit diminuer le frottement
an lieu de l’augmenter.
30. L a longueur du levier , auquel on peut regarder comme
appliquée la rififlance dont i l s'agit. Exemple. Con fèq u en cc s
pratiques que l'auteur tire de cette obfervation. Ibid. 344.
a. Pourquoi les balances courtes font moins exaétes que celles
dont le fléau eA long, 8c pourquoi les romaines le font ordinairement
moins que les balances communes. Quoique la
diminution du bras du levier diminue le frottement, ces
diminutions ne font point cependant exactement proportionnelles
l’une h l’autre. Pourquoi nos connoiffances lur la nature
& les loix du frottement font en co re A imparfaites. Ibid. b.
Obfcrvations ; x". c ’eA le frottement qui retient un coin entre
les deux furfaces qui le preffent, 6c qui empêche une v is ,
par laquelle on a comprimé avec force un corps élaAique,de
rétrograder dans fon écrou, a". Maniéré de déterminer la
direétion la plus avantageufe pour mouvoir un corps fur un
plan incliné ou horizontal , lorfqu'on veut avoir égard au
frottement. Ibid. 345. a. Effais que l'auteur a faits du problème
des tautochrones | en ayant égard au frottement. Réfultat de
c e t expériences. Ibid. b.
Frottement. Machine de Muffchembrock pour mefurer les
frottem ent. XV I. 6 19 . a. Vol. V . des planch. Méclianique,
planch. 3. fig. n°. 3. Frottement des cordes dans les machines.
I v . 208, b. 6/c.
F rottement. ( P h y fiq .) Corps rendus éleilrlqucs par le
frottement. I. 857. a. Effets du frottement dans les expériences
d'éleéiricité, voy<{ E leflr iciti , Feu ¿le tir ¡que, Condu(leurt
Coup foudroyant, C e . Effets du frottement des corps durs ,
du frottement d'un fufil d’acier contre un ca illou , en plein
air 8t dans le vuide. Chaleur qu'acquiert un boulet de canon
par le frottement de l’air. Cauie de la chaleur que les corps
acquièrent par le frottement. V I. 601. b. Plantes qui prennent
feu par leur frottement dans l’orage. Suppl. 1. 774, a.
F rottement. ( Hydraul. ) Divers frottemens qu'éprouve
l'eau , lorfqu'elle fe meut dans les pompes. Comment on
adoucit les frottemens des roues engrenées dans les lanternes
, C e . Comment on évite les frottemens qui fe font contre
les parois d’un tuyau , fur tout dans les coudes 8c jarrets des
conduites tournantes. Comment on évite les ouvertures des
foupapes 8c robinets, fujerres aux étranglcmcns. Comment
on diminue le frottement dans les jauges. Frottement qui
fe fait dans les fourches trop menues, d’une machine k trois
corps de pompe. Remede k cet étranglement. V il, 345. b.
F rottement. ( Horlog, ) C'eA de la variété connue des
frottemens que provient une des plus grandes irrégularités
dans les montres, VII, 343, b. Principes généraux qui doivent
fervir de guide dans cette matière. Définition des frottemens.
O n n’a point pu encore déterminer de principe fur lequel on
puiffe établir une théorie des frottemens applicable a l'horlogerie
en petit. Dans les montres, les altérations doivent
être comptées pour rien; il n'eA pas rare de voir des montres
fe maintenir pendant 40 ou 30 ans. Si de telles montres varient
, ce ne peut être donc que par la foiblcffe du régulateur.
Enumération de toutes les saules qui concourent k augmenter
les frottemens. Ibid, 346.a , b, L'artiAedoit porter toute fon
attention, non feulement k réduire la femme des frottemens,
mais principalement k les dlArilmcr de maniéré qu’a mefure
que la viteffe des corps augmente, la prcffion en foit diminuée,
Sept points de vue différcns.fous lefquels les frottement
font confiuérés, 1. D u régulateur. Trois fondions du régula-
F R U
Ibid. 347. a. Equation dont il faut avoir u n c l l? tems 6Hat,x‘
ner à l’échappement toute fa perfection 2 D e l ) Çotlr don~
pour les montres. Des frottemens dans v lcC ,/ . “ ""PP'mcnt
dre. Ce qu’on doit obfervcr pour prévenir
cylindre, Frottement que la roue éprouva ^ f ru^‘?n du
Moyen de l'adoucir 8c d’y entretenir le m,! cylindre.
expofé. M d . b. Le» frotte,ne,,« de . J /* T ic1mI P.®%re
toujoiir» c i diminuant. D u v i b r a , . l ï S ™ 1
gmente beaucoup le* frottemens. II, attementero,, ,
p lu ,, qu'on voudra faire aller plus IdnlTem la S i ?
être remtm,ée, Nôcciîirôde fixer la quamuô la plEi conv’ü
naltle de, vdtra.tom à I tlfage de, montre,. Difee, Ité" mm
prilcme ce, objet. Ahrégi dPun eJTal fnr cette matiërë, S
fenrt par 1 auteur .11 académie. Ibid. 34p. Râlions que qïel-
ques-u", allèguent en faveur de, ¿ou tre, qui domtem11
* «Sratlon». Riponfc à ce, raifon,.
Quelle eA la eau/l qui fait retarder certaines montres par le
fro'd tand.s que d autres avancent par la même caufc. Ibid. b.
V “ i1 8' . e I "M ™ “ > préfentée par l’auteur à
Hcadtmle . l e aoiuin ,7 ,5 . Avantage, de cetteconfttuflioifc
Jugement de I académie lur cette piece. De» révolution,. Le
nombre de, vibration, étant donné , méthode qu’on doit
fmvre pour trouver le moindre nombre de roue» poffible
pour y fatKfaire. !b,d. 350. Obfervation fur la réfiltance
quoppofetit quelque»parue, de la eadmure d’une répétition.
Ibid. b. Proportion entre le rayon du barillet & ceux de la
folie . t . Dct m m u p r . En quoi confilte leur perfettion. Le
frottement de» dents fur le» aile» de» pignon» , eonlille dan,
1 étendue de la courlte qui roule fur l’aile du pignon. Moyen
daccourcir ce» courbe». Le but qu’on doit le propofer clt
fur-tout de rendre uniforme le troinm.nl de l ’engrenage.
Ibid. 3(J. a. y D u p i n u . dette partie cil dans l'horlogerie
la plu, intéreuante & la plu» difficile b traiter. Expérience, do
l’auteur fur les frottemens des pivots. Théorie fur ces frotte-
mens. Ibid. b. Moyen d’avoir de l’acier le plus dur poffible ,
8c le moins fujet à grener. Manière de le préparer pour le
travailler. A quel point on peut diminuer les pivots. Après
U diminution des pivots, il eA néceffaire que leur* préfixons
foient parallèles aux parois de leurs trous, Avantage des
montre» plates. Les montres doivent être réparées par les
mêmes artlAcs qui les ont faites. Dans les pendules, on évite
quelques frottemens du point de fufnenfion par de petits
arcs. Ibid. 333. a. Frottemens occafionnés par la manière dont
la fufpenfton eA faite. Quatre fortes de lufpenfions. Quelle
cA celle qu’on doit préférer. 6. Des frottemens des refont
moteurs 6/ réglons. Cauiés des frottemens dn reffort moteur.
Qu el eA le moyen de donner k la lame du reffort, le plus
délaAicitépoAible. Moyen d’empôclier que les lames ne fe
frottent. Deux forces dans le refiort j l’une relative è la matière
, l’autre relative k la forme. Quel eA le moyen de
rendre cette force conAantc. Ibid. b. Les refforts agiAans fur
des rayons plus ou moins grands, ont plus ou moins de
force. Preuve par laquelle on s’affure que les lames ne fe
frottent pas. Du reffort réglant ou fpirai. Quel eA fon frottement.
Quels fout les frottemens accidentels, auxquels il
peut être expofé, 7. De s dijfférens ufages & emplois qu on fait
des frottemens en horlogerie. C e qu’on appelle, en ternie d’art,
faire un frottement ou ajufler à frottement. Ces frottemens font
d’autant meilleurs, qu'il y a plus de parties frottantes. Moyen
de rendre ces frottemens doux , durables 8c uniformes. Réfultat
des expériences de l’auteur fur les frottemens élaAi-
ques. Ibid. 3 34, a. Frottemens accidentels qui arrivent par la
mal-adreffe de l'ouvrier. Difficulté de trouver la force précife
qu'il faut, appliquer fur le premier mobile, pour les mettre
tous en mouvement, 8c leur donner une viteffe déterminée*
Ibiidd,. bb>,
Frottement. Huile pour adoucir les frottemens. VIII. 34®*l1,
XVI, 326. b. 327. a. Du frottement des pivots. XII. 667. »/, b.
Ce. Machine pour les expériences fur le frottement desjuvots.
Vol. IV. des planch. Horlogerie.
F R O T T E R , l Fond. de earafl, dVrnprim, ) façon que l'on
donne aux caracteres d'imprimerie. En quoi elle eoiilme.
Détail fur cette opération. VII, 334. b,
F R O T T IS , (P e in t .) façon de glacer. VII. 6 8 7 - ,
F R O T T O IR , en termes de boyaudicr, de cliupcner, rtc
corderie, d’épinglier, de perruquier. de relieur. Deicrip-
tions 8c ufages de ces inArumens. VIL 333. u.
Frottoir ou Frotte r ie, en terme de blanchinerie, 11. y jo . b.
FRUCTESA. ( Mythol. ) Obfcrvations far cet article de
l’Encyclopédie. Suppl. III. 131. b. .
FRU CTÍFIC A T ÍO N , ( Botan. ) production des parues rte
F R U F U E 793
la fruflificallon dans les plantes. XVI. 971. b. 972. a , b.
FRUGALITÉ., (Mo ra le ) Ampiicité de moeurs 8c de vie.
Cette vertu ne regarde pas feulement la table, elle porte
fur les mteurs, dont elle eA le plus ferme appui. Nations
anciennes 8c hommes UJiiAres de l’antiquité qui l’ont ob-
fervée. Dans nps pays de faAe 8c de vanité , la frugalité
a bien de la peine k maintenir un rang eAimable. Auteurs
qui l’ont dégradée. Apologie de la frugalité des anciens
Romains, de celle de Fabricius, de Curius, de Camille.
Le luxe 8c la fomptuofité font dans un état, ce que font
dans un vaiffcait les peintures 8c les Aattics dont il eA décoré.
Pour fentir le prix de la frugalité, il faut en jouir ; mais ce
ne feront ni ceux qui vivent dans les délices, ni ceux qui
envient le luxe des autres, qui aimeront la vie frugale. Les
fages démocraties, en recommandant la frugalité domcAique,
ont ouvert la porte aux dépenfes publiques. Dc-là ces
monumens qui ont fait la gloire d’Athcncs 8c de Rome.
,VII. 333. b.
Frugalité, voyez Sobriété. L’amour de la frugalité effen-
tiel aux démocraties. IV. 817. b. Loix des Athéniens, des
Lacédémoniens, des Romains 8c des François pour réprimer
le luxe de la table. IX. 674. » , b , C e . Frugalité des premiers
Romains. XUI. 363. a. Celle des Romains du tems de Ci-
céron. 739. a. Celle des patriarches. XIV . 126. b. Celle des
anciens Celtes. Suppl. II. 283. a.
FRUGINAL.ou frueural. (M y th .) Obfcrvations fur cet
article de i’Encyclppédic, Suppl. III. 13. b.
FRUGIVORES animaux. Différence dans la Aruélure des
animaux carnivores 8c des frugivores. II. 690. b. Comment
fe fait la maAication 8c la digeAion dans ces derniers. Ibid.
Dents des. animaux frugivores. IV. 837. a , b. 838. a , b.
Ils s’ctigrkiffent plus alternent que les carnivores, v i l . 839.
a. De luiAinét de ces animaux. VIII. 793. b. 706.J>. Oifeaux
friieivores. XI. 433, b. Voyez Granivores 6c Herbivores,
FRUIT. On remarque dans les fruits les mêmes parties
effcntielles que dans les plantes. Divifion des arbres à fruit.
Fruits & pépin. Fruits à noyau. Fruits à coquille. Fruits k
coffc épineufe. Plantes à fruit. Divifion des fruits par rapport
à leur chair, par rapport à leur faifon: greffes icmcnccs
qu’on appelle fruits. VII. 336. a.
Fruit , (B o ta n .) M. Linnæus diAingue dans les fruits,
le péricarpe, la fcmence, le réceptacle. Détails fur chacune
de ces parties. VII. 336. b.
Fruit. Pédicule des fruits. XII. 237. b. Péricarpe: diverfes
enveloppes. 336. b. Pulpe des fruits. XIII. 360.fi. Caufcs
de la fécondation 8c de l’accroiffement du fruit. XII. 7x4.
fi. Caufc des variétés qu’on obferve 8c qu’on opère dans
les fruits. 713. fi. 720. b.
Maniéré d ’avoir de beaux fruits. ( Jardin. ) V IL 3 36. fi.
F ruit. ( Jardin. ) La piquure des fruits en accéléré la
maturité. 11. 639. » , fi. Maniéré de faire prendre aux fruits
des couleurs vives. III. 638. fi. Tems où l’on cueille les
fruits. Comment on en reconnoît la maturité. Pourquoi l’on
doit prévenir celle des fruits d’été. Tems où l’on doit cueillir
les fruits d’automne 8c d’hiver. IV . 332. fi. Maturation des
fruits. X. 209. ». Signes de la maturité de différons fruits.
Ibid. fi. Opération par laquelle on peut altérer le goût 8c
changer les propriétés d’un fmiit. 834. fi. Moyen d’acquérir
des fruits nouveaux. XII. 720. fi. Fruits finguliers qu’on
obtient par pluficurs greffes fur le même arbre. XIV. 33. a.
F ru it verreux. ( Htfl. nat. ) De ces fruits , les uns font
fujets k des vers qui doivent fe transformer en mouches,
les autres k des chenilles. VU. 336. fi. Les années où il y
a le moins de fruits, font celles où l’on fe perfuade quil
y en a le plus de verreux; ce qui n’eft vrai que proportionnellement
à la quantité des fruits de cette année. Variétés
dans les fruits par rapport au tems pendant lequel l’infcéte
demeure dans le fruit. Petits tas de grains rougeâtres ou
noirs qu’on apperçoit fur le fruit quanti le tems de la méta-
morphofe de la chenille approche. Dans d’autres, on voit un
petit trou bordé de noirâtre : quelle cA la caufc de ces deux
apparences ou altérations fur le fruit. Ibid. 337 , a.
F ruit. ( A r t de conferver le ) Econom. rujliq. Manière de
conferver les fruits toute l’année. VII. 3 <7. ».
Fruits. Secret pour conferver les fruits durant l’hiver. XII.
237. fi. Effets du gel fur les fruits que l’on garde en cette
faifon. V II. 341. ».
Fruits fecs. Maniéré de fécher les prunes 8c les cernes.
Méthodes pour fécher les pêches , les abricots, les poires,
les pommes, les raifins . les figues. Divers autres fruits
compris dans la lifie des fruits fecs. VII. 3 37. fi.
Fruits candis. III. 836. ».
F ruits. (D i c t e ) Les auteurs ont négligé d étudier cet
objet. Nous ne connoiffons guère d’autres qualités communes
entre pluficurs cfpeccs de fruits, que la qualité d’aliment
végétal. Les efpcces qui paroiffent les plus analogues, font
réellement três-diAi»««* P«»' dcs propriétés médicinales très-
différentes. V il. 337. fi. La divifion que les anciens avoicnt
faite des fruits en fruits d’été 8c en fruit» d’autwnnc, cft
Tome /,
on n e peut pas plus mal entendue. Les propriétés diététiques
des fruits varient même dans chaque efpecc, félon le tems
ob on les mange. De, mauvais effet, des fruiu verds. L’o pinion
qui fait regarder le, fruits comme une caufc d’fpi-
d im ie , n’ert vraifemblablcmcnt qu’une erreur populaire.
Ibid. 3 38. a.
Fruits. Comment leurs qualités peuvent varier, félon le
tems 8c les lieux. I. 109. ». En mangeant des fruits, il faut
boire de l’eau. V . 104. a. Régime que Galien fui voit par
rapport aux fruits. VJ. 74yt a. Nature des fruiu d’été. XVII.
297. fi. Sur le fuc des fruits, v o y e z Suc.
F r u i t défendu. ( Théolog.) I. 389. fi. S o i. fi..
Fruits t peintre de. XII. 206. fi.
Fruit pris dans le fens de Dcjfcrt. ’Voyez, c e dernier mot:
F ru i t s . ( Jur ifpr .) A qui appartiennent tous les fruiu
d’un héritage. Le poffcffeur de bonne foi fait les fruits fiens.
Celui de mauvaife foi cA obligé de rendre ceux qu’il a
perçus. On difiingue pluficurs fortes de fruits ; favoir , les
fruits, ameublis, les annuels, artificiels, VII. 338.a. cafitcls,
civils , confumés, déclinables, échus, étrouffés, extans ,
induAriaux, infolitcs, naturels, ordinaires, pendans parles
racines, perçus 8c les fruits fiens. Ouvrages k confuiter. Ibid. b .
F ruits, gros fruiu. IV. 1094. fi. Perception des fruiu. VIII.
889. fi.
Fruit 6c contrefruit, en architecture. VIL 338. b.
Fru itt ornement de fculpture. V IL 338. fi.
Fruits. (B la fo n ) Suppl. I. 910. fi. Fruits couplés. Suppl.
II. 641. fi.
FRUITÉ. (B la fo n ) Addition k c e t article de l’Encyclopédie.
Suppl. III. 131 .fi.
FRUITERIE, (Econom. rujliq. ) lieu où on ferre les fruits.’
VII. 338. fi. Détails fur la maniéré dont une fruiterie doit
être construite. Moyens de préferver les fruits de la gelée.
Diverfes pièces dont une fruiterie doit être intérieurement
pourvue. Maniéré de ranger dans la fruiterie les pêches,
abricots, pavies, brugnons, poires d’été 8c d’h ive r , les
prunes, figues, raifins, nèfles 8c cormes. De la manière da
dégeler les pommes. La cave ni le grenier ne font point propres
à une fruiterie. Ibid. 339. a.
FRUITIKRS, arbres ( Jardin. ) Divifion de ces arbres. I.'
381. a. Expofitions qui leur conviennent. 737. a. Suppl. 1.
322. fi. Des abris néccffaircs à quelques fruitiers. Suppl. II.
43. fi. Soins qu’ils exigent en pépinière. XII. 320. a ,b . Suppl.
l v . 292. <x, fi. De la plantation de ces arbres. 726. a. D e
leur multiplication. Suppl. I. 322. a. Utilité de la greffe pour,
ces arbres. Ibid. 8c Suppl. 111. 260. a , fi. Bouillon pour ces
arbres. Suppl. I. 378. ». Caufcs qui tuent les fruits dans
leurs ffeurs ou peu après leur naiffance. Moyens de les
prévonir. Suppl. l v . 271. a. Boutons des fruitiers. Suppl. II.
43. fi. V o y e z les articles des diverfes. opérations de culture
que ces arbres exigent. — V o y e z Arbre.
FRUMARIUS, (H iJ l.d ’E fp . ) roi des Sucvcs. Agitation»
de ces peuples, au milieu desquelles il fut élu roi. Guerres
qu'il eut à Soutenir contre Raimond,fon concurrent. Suppl.
n i . 131.fi.
FRUMENTAIRES, (H ifl.a n c .) Soldats ou archers dans
l’empire d’occident. USagc qu’en faiSoit Adrien. VII. 339. a.
O11 ne donnoit ce nom, avant l’uSagc de ces Soldats, qu’aux
marchands de bled. Les frumentaires étoient répandus dans
chaque légion. Origine des frumentaires fous le regne d’Au-
guffe. Quelles étoient alors leurs fondions. Ibid. fi.
Frum en ta ire s . Corrections à faire k cet article de l’En-i
cyclopédie. Suppl. III. 15».fi.
Frumentaires : officiers appellés de ce nom fous les empereurs
; injuAices qu’ils comnîettoient. Leur abolition par
Dioctétien. XVII. 790. fi.
Frumentaires. loix. IX. 661. ».
FRUMKNTUM, (L itté r .) étymologie de ce mot: deux
genres de plantes ainfi nommées. Suppl. I. 9x3. a.
FR U O R . (Lang. la t . ) Etymologie ue ce verbe. Suppl. I.'
913.».
F U
FUCA. ( Ichtyol. ) Différentes cfpeccs de ce poiffon de
mer. Qualité de fa chair. VII. 339. fi.
Fuca, grec de Céphalonic : Ses aventures. Suppl. III. 90x. fi;
FUCHSIUS,(Zw»4/'</)botaniAe 8c médecin. XVlI.396.fi;
FU CIN , ( Lac ) travaux des Romains pour le deffcchcr;
Suppl. II. X92. fi. ' , J
FU CUS, (B ota n.) caraClere des plantes de ce genre. Leurs
nombreufes efpcces : lieux où elles croiffent. Les plus commîmes
font connues fous le nom de varec, v o y e z ce mot.
Variétés des couleurs de quelques-unes. Plante* que M.
Adanfon comprend dans la famille des fucus. Suppl. III,
’ ’ fUEG O . IJla d<l ( Gtoer. ) Longiiudi & latitude de cctw
iflo. Volcan qu’elle nourrit. Autre Me du môme nom. VII,
15.9. b. — Voyt\ F e u , terre d.,
P P P P p p p p f i