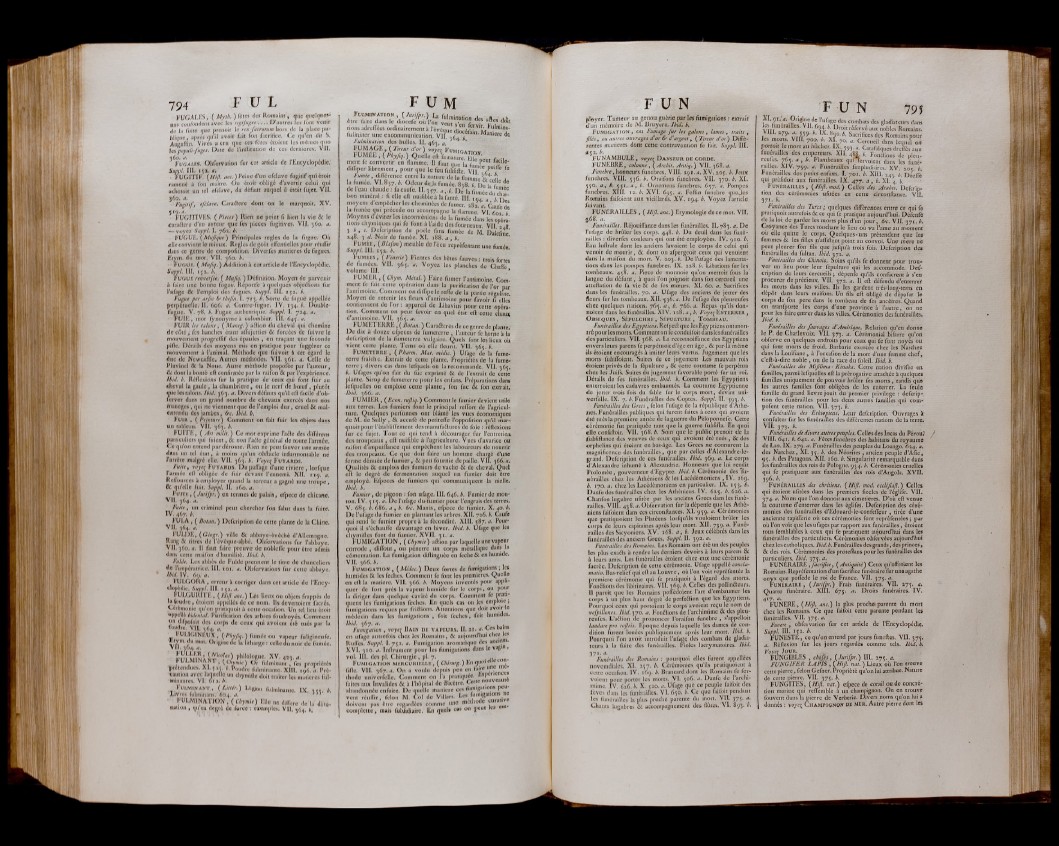
7 94 F U L F U M
IIV Q A ïJ tô ) ( Myzh, ) fête« de« Reniait» , q ue quelque**
un« confondent avec le« regi/ugts . . . . D'autre« le» font venir
de la fuite que pre/iolf Je /ex fterorum \tor* de la place pu-
¡,11(1110, apre« filili avoir fait fou Sacrifice. Ce qu'en dir S.
Aimirfii/J. Vives a cru que ces fête* étoient les même* quota
» pupilli-Juges, Date de rinlliiution do ces dernières. V il.
^ FudALM. Obfòrvation Air cet article de l'Encyclopédie.
Sitptil. lit# 154* c* ‘ ' t t ,
FUGITIF, ( Hi fi. ii/ic.) Veine d'un eiclavo fugitif qui croit
ramené ¿1 fou maître. On étoit obligé d'avenir celui qui
Ncbetoit un tel efclavc, du défaut auquel il étoit Aijct. VII.
$ 60. th . J
Fu gitif, (fiihm, Caraélcro dont ou le ma rq noi t. XV .
^ {JG ITiVE S. ( Piece») Rien ne peint A bien la vie 6c le
earaélere d’un auteur que ics pièces fugitives. VU. 360. a.
— voyez. Siippl. 1. j 6 î . l>.
FUGUE, ( Mufique ) Principales règles do la fugue. Oii
•Ile convient le mieux. Règles de goût cffcnticllcs pour réuiTir
dans ce genre de compofuion. Diverfe» manières de fugues.
Eiym, du mot. V II, ado. b.
Fuîiuk, ( Mtifiq. ) Addition h c e t article d< l'Encyclopédie.
Suppl, III. 151. b,,
P v o v k retiverjée, ( Miifìii. ) Définition. Moyen de parvenir
& faire une bonne fugue. Ileponfe b quelques objection» fur
l'ufage 6c l'emploi des fugues. Suppl. Ili, 131. b.
Puant per arfm 6* ihefi/i.i, 713, b, Sorte de fugué appelléc
perpétuelle. Il, 606. ih Corìtrc-Aiguc'. IV, 134. b. Double-
fugue, V. 78. b, Fugue authentique. Suppl, 1. 724, a.
■ rU IE , mot fynonynw b colombier. Ili, 643. a,
PU Ut l a talons, (A laneg.) a filon du cheval qui chemine
do côté, fes hanches étant amijctties 6c forcées de Aiivre le
mouvement progrefAf des épaules, en traçant uno fecondo
piAc. Détails des moyens mis en pratique pour fuggérer ce
mouvement b l'animal, Méthode que iuivoit fa cet égard le
duc de NcwcaAle. Autres méthodes. VU, 361. a. Celle do
Pluvinel fk lu Noue. Autre méthode propofée par l'gutour,
tit dont la bonté cA confirmée par la railbn 6c par l’expérience.
Jbiil. b, Réflexion» fur la pratique do ceux qui font fuir au
cheval la gaule. la chambriere, ou le nerf do boeuf, plutôt
que les talons, Ibld. 363. a, Divers défauts qu'il cA facile d'ob*
ferver dans un grand nombre do chevaux exercés dans nos
manèges , qui ne viennent que do l'emploi dur, cruel 6c malentendu
des jambes, b e , Ibid, b.
F u i r , (P eintu re ) Comment on fait fuir les objets dans
un tableau, VU, 363. b.
FU IT E , ( Art mïlh, ) Ce mot exprime l'aile des différons
particulier.« qui fuient. 6c non l’uéle général do toute l'armée.
C e qu'on entend pur déroute. Mien ne peut Amvor une armée
dans un tel état. b moins qu'un obAaclc InAirmontable ne
l’arréte malgré elle. VU. 361. b. Foye^ F u y a rd s .
F ulte, voyer F uy ard» . Du puffngo d’uno riviere, lorfque
1 armée efl obligée do fuir devant l'ennemi. XII. n o , a,
Hciïourccs A employer quand la terreur a gagné une trotine.
6c qu’elle fuit. Suppl. 11. 160. a,
*/i? u,Tk' ®n *®r,r,B# palais# efpece de chicane.
VII, 364. a,
^ F u it e , un criminel peut chercher fon falut dans la fuite.
IV. 467, b,
»#.# ’ ( F o tan .) Dofcrlpilon do cette plante de la Chine.
VII, 164, a.
FULDK, (GJ ogr .) ville 6c abbaye-évêché d'Allemagne.
Rang Ht dires deTéyôquo-abbé. Onfervations fur l'abbaye.
VII, 360. a, Il faut faire preuve de nobloffe pour être admis
dans cette tnnilbn d'humilité. Ibid, b,
Pulde, Les abbés de Fulde prennent le titre de chanceliers
de l'Impératrice. 111. to i. u, Obfòrvation» fur cette abbaye.
lbhl, IV. 69, a. 7
FUI,COR A , erreur h corriger dans cet article de l'Encyclopédie.
S unni, lit, t«a, u,
FULGUIUTE, ( l h j l itne,) Les lieux ou objets frappés do
la.foudre# étolent appellés de ce nom, Ils devanoicm facrés.
Cérémonie qu'on pratlquolt h cette occafion. Un tel Hou étoit
eppeilé Indentai. Purification des arbres foudroyés, Comment
OU dlijtoi'üi] des corps do ceux qui avolent été tués par la
fouId rl eH, IV. iiwt ,jo a,'&..!r i ï u,
* 1
•E1
V
FULIGINEUX. (¡Phyjlq, ) fumée ou vapeur fullglncufe.
Litym, üu mot. Origine do la litharge 1 celle du noir de fumée.
F i 1.164,t 10 4 .d,
I f •Í u K l l e S r í ,
S B S Í philologue. XV
FULM u lm INAN in j T, (Cnymle)........
O r fulmini
fes propriété!
XÍ11.196.d.Préfulmlnaitt,
r — ----- i- i* - » uuure tuimmamo. AHI. 100. d, l'rocnntlon
uvee liffltielìo un «liyittlfto dui, thflter lo. mnilorci. (ut-
mlnantee. VI, 0(2. b,
PULMINANT, ( l l l l l r . ) Union follili,,,,,,0. IX, a . . , 4.
L ivrea Ailminans. 604. a, m
• l'U LM IN A TIO N , ( Chyml,) Ella no d lff.n do U dii«-
iiation 1 quou degré de forco : onemplos. v i i , 3^4. b.
FULMIWATION , ( Jurifpr. ) La __
éttrree ilaitiittee ddaannss llee ddiiooccccffee oohh TToonn vveenu## r v w
lions adrcíTécs ordinairement ¡t Tévéqtic í I í / j c a S 'L !
íuJ/níncr une excommunication. Vit, l Maniere de
Pulmbidtion des bulles, U. 4 6 1 . a *
Oi 1 iva a 1/ / 'i*;....... i, \ * 1. F UM A G E . ( Tireur d'or) voyer Fumi r
FUM É E , (P hy jiq . ) Quelle cflVa nafure £ £ V r -,
ment fc convertir en flamme. Il faut que la f i l l i S
diir,|icr librcnicnt, pour iji» le fini fubfiftc. V I ? .
tu r n t ,, dilKrcnce cmrc la naturo do la filmimi. ai ,
la fumee. VI. 837. 4. Odeur deja liimie. 838. 4 IJ c lî f i , ' *“
île l'eau cluuidc ; iaeaufe. II. 3 ,7 . .1 ,4 ; n i 1.
bon minéral 1 fi elle efl mdfibleji Infanti. I li um " 1 1 ? ’
moyen, d’ompicllcr le . cheminée» de (inner. aSa. é. é a ii& .u
la fumée qui précède ou ;ieeom|lnmic la flamme. VI 'ô o i ù
Moyen» d éviter le» ¡nconvéïdon» de la fumée dan» lcsonér.1
non» eliyimque» util fo font 4 l'aide de» fourneau». VII aaS
3 4 , e. »cferi|iiion du |ioéle finis fumée de M. Daicfme'
24B. 3 d. Noir de fumée. XI. tBB. a , b,
l ’OMÎir, (M u jo n ) meuble de l’écu re|iréfcniani une fumée
Suppl, III, 132. b,
h imi èuri, ( t 'i r li r it ) I'Ieiiic» de» béle» fauve»; irol» forte»
de fumée». VII. 3.6:3; iff Voye» le» idanehc» de CliafTo
volume Ili. *
EUMEK ,(C h ym . M ita i.) Faire fumer l’iuillinoiiic. Comment
fc fait celle opération dai» la purification de l'or par
l'antimoine. Comment on dillipc le reffe de ia pardo réanime
Moyeu do reienlr le» fleuri d'antimoine pour favoir fi elle»’
comiciiiicnr do l'or ; appareil de Libaviii» pour celte opér».
lion, Comment on peut favoir en quel élai efl celte cliiiiw
d'iimimoiiic. VII. 36(0 <i.
FUME FERRE, ( ßotan, ) Carnllcrcs do ce genre de plante.'
De dix ft douze cfpcces de fumeterre. Fauteur fobprnc h la
dcfcrlption de la fumeterre vulgaire. Quels font les lieux où
vient cette plante. Tcms oh elle fleurit. VII. 363. b.
FuMinmuu , (Pliurin. Mut, mèdie, j Ufügc de la fume-
terre fratchc. Extrait do cette plante. Propriétés de la fumeterre
: divers cas dans lefqucls on la recommande. VU. 363.
b. Ufagos qu'on fair du fuc exprimé 6c do l'extrait do cette
plante. Sirop de fumeterre pour les enfans, Préparations dans
icfqucllos 011 emploie cette plante, fon Aie ot fon extrait.
îbtd, 366. d,
FUM IE R , (Econ. rufliij.) Comment le fumier devient utile
aux terres. Les fumiers font le principal reflbrt de l'agriculture.
Quelques perfonnes ont blâmé les vues économique«
de M. de S u lly , 6c uecufé de pctitofTe l'oppofttion qu'il marquait
pour l’établiflemem des manufallurcs de foie : réflexions
fur ce fujet. Tout ce qui tend h décourager fur l'entretien
dos troupeaux, cil nuiflblc h l'agriculture. Vues d’avarice ou
raifon d impuifiuuce qui empêchent tes laboureurs do nourrir
des troupeaux. Ce que doit faire un homme chargé d’une
forme dénuée de fumier, Scpou fournie de paille. VII. 3 66, a.
Qualités 6c emplois des fumiers de vache o£ do cheval. Quel
efl le degré de fermentation auquel un fumier doit être
employé. Efpecos de fumiers qui communiquent la nielle.
/bld, b,
Pumier, do pigeon : fon ufago. III. 646. b, Fumier de mouton.
IV. 313. d, De l'ufage du-fumier pour l’engrais des terres.
V , 6B3.1. 680. //, b, frc. Manls, efpece de fumici'. X. 40. b.
De l'ufage du fumier en plantant les arbres. XII. 726. b, Caule
qui remilo fumier propre à la fécondité. XIII. 387. d, Pourquoi
il s'échauflb davantage en hiver. Ibid. b, Ufagc que les
cltymiAcs font du fumier. XVII, 31, //,
FUM IG A T IO N , ( C/ivmie) aélioii par laquelle uno vapeur
corrod e, diAbltt. ou pénètre un corps métallique dans la
cémentation. Lu lumigution dillinguée en fòche 6c en humide.
VU. 3ÖÖ. b.
F um ig a t io n , (M J d e c .) Deux fortes do fumigation# ; les
Immldes 6c les feches. Comment Ce font les premiere#. Quello
on cil la matlero. VII, 366, b. Moyens inventât) pour appliquer
do fort prés la vapeur humide fur le corps, ou pour
lu diriger dans quelque cavité du corps. Comment fo PrBt'~
ciucili: les fumigations feches. En quels cas on les emploie ;
fumigations reçues par frlllions. Attentions que doit avoir 10
médecin dans les fumigations, foit feches, foit humides.
Ibld, 3 671 a, . . .
Pumigdthn , voyer IJain dk VAPEURS. II. 21. <t. Ce8 Dams
en ufago autrefois chez le# Romains, 6c aujourd'hui chez les
KuAei. Suppl, I. 732. d, Fumigation aromatique des ancien»*
XVI. 110.1/. InArumcnt pour les fumigations dons le v«g »
vol. l f l. des pl. Chirurgie, pl. 7. ..„a,,,,.
F um ig a tio n mkrcuriulls, ( Chirurg, ) En qm>* ,
flflô. VU. 367. d. O n il voulu depuis peu en luire < '
diodo unlvericllo. Comment on Tu pratiquée. »P .
ftlw» mix li,vallile. & 4 l'hôplial ilo Blcòirc. C i;;* npuvaau«
iibiiiidbtiiiâo cnliilid, l) c qiiollc maniera ce» ruitrlg I
vom réuflîr, félon M. ¿01 fie Villon. B S S H I
doivent niw dire leauriléo» comme une méiliodo imaov
compiono, mal» fbbutiiairo, En quel* ea* on peut
F U N
jployer. Tumeur au genou guérie par les fumigations : extrait
«l’un mémoire de M. Bruyère. Ibtd. b.
F umigatio n , ou fumage fu r les galons , lames, traits,
fil/ s , ou autres ouvrages d ’or & d’argent, ( Tireur d'or ) Différentes
manières dont cette contravention fc fait. Suppl, III.
i2'5?<. b,
FU NAMBULE, voyer D ansf.uk de corde.
FUNEBRE, colonne, i Archit. A n t iq .) V il, 368. a.
fúnebret honneurs fúnebres. VIII, 291. a, XV . 203. b. Jeux
fúnebres. VIII. 336. b. Oraifons fúnebres. VII, 370. b. XI.
330. a , b. 331. a , b. Ornemeos funèbres. 637. a. Pompes
fúnebres. XIII. 12. b, XVI. 603. </. FeAin funèbre quejes
Romains faifoient aux vieillards, X V . 194. b. Voyez i article
fui v-ant.
FUNÉRAILLES, ( //¡fi. une. ) Etymologie de ce mot. VII.
$68. a.
Funérailles, Réjouiffancc dans les funérailles. I I .783. a. De
l'ufage de briller les corps. 448. b. Du deuil dans les funérailles
: diverfes couleurs qui ont été employées. IV. 910. b.
Eau luAralc dont les anciens lavoient le corps de celui qui
venoit de mourir, 6c dont on afpergeoit ceux qui venoient
dans la maifon du mort. V. 203. b. De l’ufage des lamentations
dans les pompes fúnebres. IX. 228. b. Libations fur les
tombeaux. 438. a. Pièce de monnoic qu’on mertoit fous la
langue du défunt, h quoi l’on joignoit dans fou cercueil une
attcAation de fa vie 6c de les moeurs. XI. 60. a. Sacrifices
dans les funérailles. 70. a. Ufagc des anciens de jetter des
/leurs fur les tombeaux. XII. 336. a. De l’ufage des plcurcufcs
chez quelques nations. 763. a , b. 766. a. Repas qu'ils don-
noient dans les funérailles. XIV. 12e. a t b. l'oye^ E n t lu r lk ,
.OllSFQUFS , SÜJ'ULCHKE, SÉPULTURE , TOMDEAU.
funérailles des Egyptiens, Rcfpcél que les Egyptiens ont mon*
tré pour les morts. Comment on fccondtiifoituanslcsfunéraillcs
des particuliers, VII. 368. w» La rcconnoiffance des Egyptiens
envers leurs parons fc perpétuoit d'âge en Age, & par-lé même
ils étoient encouragés il imiter leurs vertus. Jugement que les
morts Aibiffoicnt. Suites de ce jugement Les mauvais rois
êtoient privés de la féuulturc > 6c cette coutume fc perpétua
chez les Juifs. Suites du jugement favorable porté fur un roi.
Détails de fes funérailles. Ibid. b. Comment les Egyptiens
enterroient les cadavres embaumés. La coutume Egyptienne
de jetter trois fois du fable fur le corps mort, devint uni-
.vcrfellc. IX. 7. b. Funérailles des Coptes. Suppl. II. 303. b.
funérailles des Grecs, félon l’ufage de la république u’Athènes.
Funérailles publiques qui furent fuites é ceux qui avoient
été tués la première année de la guerre du Péloponnefc. Cette
cérémonie fut pratiquée tant que lu guerre fubfiAa. En quoi
elle conAAoit. V i l . 368. b. Soin que le public prenoit de la
rfubflAancc des veuves de ceux qui avoient été tués, 6c des
orphelins qui étoient en bas-âge. Les Grecs ne connurent la
magnificence des funérailles, que par celles d’Alcxandrc-le-
grand. Dcfcription de ces finie rai lies. Ibid. 369. //. Le corps
d'Alexandre Inhumé é Alexandrie. Honneurs que lui rendit
Pioloméc, gouverneur d’Egypte. Ibid, ¿. Cérémonie des'funérailles
chez les Athéniens oc les Lacédémonicns, IV. 169.
L 170. a, chez les Lacédémonicns en particulier. IX. 133. b,
Danfc des funérailles clic/, les Athéniens. IV. 613. b ,6 i6 .a ,
Chunfon lugubre ufitéc pur les anciens Grecs duns les funérailles.
VIII. 4ÿ8; 4. Obfcrvution Air la dépenfe que les Athéniens
faifoient dans ces circonAanccs. XI. 939. a. Cérémonies
que prutiquoient les Platécns lorfqu’ils vouloient briller les
corps de fours capitaines après leur mort. XII. 719. <j. Funérailles
des Sicyomcns. XV. 168. a , b. Jeux célébrés dans les
Funérailles des anciens Grecs. Suppl, II. 39a. <1.
funérailles des Romains. Les Romains ont été un des peuples
les plus cxnéts ¿I rendre les derniers devoirs à leurs parens 6c
¿1 leurs amis. Les funérailles étoient chez eux une cérémonie
fucréc. Dcfcription de cette cérémonie. Ufagc appcllé conclu-
ttiiitio. Bas-relief qui cil au Louvre, oh l’on voit repréfentée la
première cérémonie qui fc pratiquoit à l’égard des morts.
Fonélions des libitinaires. VII. 269. b. Celles des pollinéleurs.
11 paroit que les Romains poffédoient l’art d'ombaumer les
corps à un plus haut degré de perfeélion que les Egyptiens.
Pourquoi ceux qui portoicnt le corps avoient reçu le nom de
vefpillonts. Ibid. 370. a, Fonélions ue l'archimimc 8c des plcurcufcs.
L'aéllon de prononcer l'ornifon funèbre, s'appclloit
laudare pro rofiris. Epoque depuis laquelle les dames île condition
furent louées publiquement après leur mort. Ibid. b.
Pourquoi l'on »voit introduit l'ufiigq dès combats de gladiateurs
à lu fuite des funérailles. Fioles lacrymatoircs. Ibid.
371. a.
funérailles des Romains : pourquoi elles furent appcllées
novcmdialcs. XI. 237. b. Cérémonies qu’ils pratiquolcnt fi
cette occafion. IV. 169. b. Brancard dont les Romains fc Içr-
voient pour porter les morts. VI. 306. <1. Danfc de larclii-
inimc. IV. 626. b. X. 320../. Ufagc que ce peuple faifoit des
lèves dans les funérailles. VI. 650. b. Ce que faifoit pendant
les funérailles lu plus proéhc parente du mort. V il. 373. a,
Chants lugubres 6c accompagnement des flûtes. V I. 893. 0,
F U N 795
XI.ox.'îî, Or iginc d,
- * «a.igc ucs comoats ücs gladiateurs «ans
les ninérailles. Vil,
VIII. ayp. a I
«. i y ü1Jro‘l r^ crv“ allx »oblcs Romains.
les morts. VIII, 70
, v ? ° ' b- Sacrifices des Romains pour
a* 1 , v 7°- “■ Cercueil dans lequel ori
portait le mort au b
lûclicr. DG «93'. ,a- Catafalques dreffés aux
funérailles des emp
icrciirs. XII. 48g. b. Fonélions de plcu,-
reufes. 763. a , b.
rlambeaux quiTcrvoicnt dans les funé-
railles. A lV . 799. c
t. ru/iéraiJJes Ampludiaircs. XV. 203. %
Funérailles des péri
ts enfans. I. 701. b. XIII. m .
qui préfidoit aux Ainérailles. IX. 477. a , b. Xl7 4. b;
, Funérailles, ( ffifi. rnod, ) Celles des Arabes. Dcfcrip-
tion des cérémonies uAtécs en cette circonflancc. VIL
37t. b.
funérailles des Turcs } quelques différences entre c e qui fe
pratiquoit autrefois 6c ce qui fc pratique aujourd’hui. Défcnfe
de la loi de garder les morts plus d’un iour, 6*c. VII. 371. b.
Croyance des Turcs touchant le lieu ou va l’amc au moment
ou elle quitte le corps. Quelques-uns prétendent que les
femmes 6c les Ailes n affilient point au convoi. Une merc ne
peut pleurer (on Aïs que jufqu’à trois fois. Dcfcription des
funérailles du fultan. Ibid, 372. a.
funérailles des Chinois. Soins qu’ils fc donnent pour trouver
un lieu pour leur fépulture qui les accommode. D e s cription
de leurs cercueils ; dépente qu’ils confacrent à s’en
procurer de précieux. VII. 372. a. U cft défendu d’cmerrei
les morts dans les villes. Ils les gardent très-long-tems en
dépôt dans leurs maifons. Un Als eft obligé de depofer le
corps de fou pere dans le tombeau de fes ancêtres. Quand
on tranfportc les corps d’une province à l’autre, on ne
peut les faire entrer dans les villes. Cérémonies des funérailles»
Ibid. b.
Funérailles des fauvages d ’Amérique. Relation qu’en donne
le P. de Charlevoix. VII. 373. a. Cérémonial bifarrc qu’oïl
obfervc en quelques endroits pour ceux qui fe font noyés ou
qui font morts de froid. Barbarie exercée chez les Natchcz
dans la Louifianc, à l'occafion de la mort d’une femme ch ef,
c’cft-à-dirc noble, ou de la race du folcil. Ibid. b.
Funérailles des Mifilima- Kinaks. Cette nation diviféc eu
familles, parmi lcfquclles efl ia prérogative attachée à quelques
familles uniquement de pouvoir brûler fes morts, tandis que
les autres familles font obligées de les enterrer. La feule
famille du grand lièvre jouit du premier privilège : deferip-,
tion des funérailles pour les deux autres familles qui com-l
pofent cette nation. V il. 373, b.
funérailles des Ethiopiens. Leur defeription. Ouvrages h
confultcr fur les funérailles des différentes nations de la terre#
VII. 3y3» b.
Funérailles de divers autrespeuples. Celles des Incas du Pérou# /
VIII. 641. b. 642. a. Fétcs funèbres des habitans du royaume
de Lao. IX. 279. a. Funérailles des peuples du Loango. 6 24. a.
des Natchcz, A l. 33. b. des Néorires, ancien peuple d’A f le ,
03. b. des Pntagons. XII. x6o. b. Singularité remarquable dans
les funérailles des rois de Pologne. 93 4. b. Cérémonies cruelles
qui fe pratiquent aux funérailles des rois d’Angola. XVII»
396. b.
F unérailles des chrétiens» ( ffifl. mod, eccléfiafl. ) Celles
qui étoient ufltées dans les premiers ficelés de l’cglife. V II.
374. a. Noms que l’on donnoit aux cimetières. D ’oh efl venue
la coutume d'enterrer dans les églifes. Dcfcription des cérémonies
des funérailles d’Edouaru-lc-confeffcur , tirée d’une
ancienne tapiffcric oh ces cérémonies font rcpféfcntécs ; par
oh l’on voit que les ufagès par rapport aux funérailles, étoient
tous fcmblablcs h ceux qui fe pratiquent aujourd'hui dans les
funérailles des particuliers. Cérémonies obfcrvécs aujourd'hui
chez les catholiques. Ibid.b. Funérailles des grands, des princes,
6c des rois. Cérémonies des proteflans pour les funérailles des
particuliers. Ibid. 373. a.
FUNÉRAIRE, facrifict, (Antiqu ité) Ceux qu'offroient les
Romains. Rcpréfentation d’un facrihcc funéraire fur unoagathe
onyx que poffede le roi de France. VII. 373. a,
F u n é r a i r e , (Juri/br.) Frais funéraires. VII. 273. <x»
Quarte funéraire. XIII. 673, a, Droits funéraires. IV .
4 1 7 . <t.
FUNERE, (H ifli une.) la plus proche parente du more
chez les Romains. Ce que faifoit cette parente pendant les
funérailles. VII. 373. a.
Funere , obfcrvntion fur cet article de l'Encyclopédie.
Suppl. III. i?a. b.
FUNESTE, ce qu'on entend par jours funefles. VII. 373.
a. Réflexion fur les jours regardés comme tels. Ibid. b,
Foyer Jour.
FUNGIBLES , chofes , ( Jurifpr. ) III. 273. a.
F U N G IP E R L A P I S , (U ifi. nat. ) Lieux oh l’on trouve
cette pierre, félon Gcfncr. Propriété qu'on lui attribue. Nature
de cette pierre. VII. 373. b.
FUNGITES, (H ift , nat.) efpece de corail ou do concrétion
marine qui rcffcmblc h un champignon. On en trouve
(buvent dans la pierre de Vcrbcrie. Divers noms qu’on lui a
donnés i vo yq C hampignon de mer. Autre pierre dont les