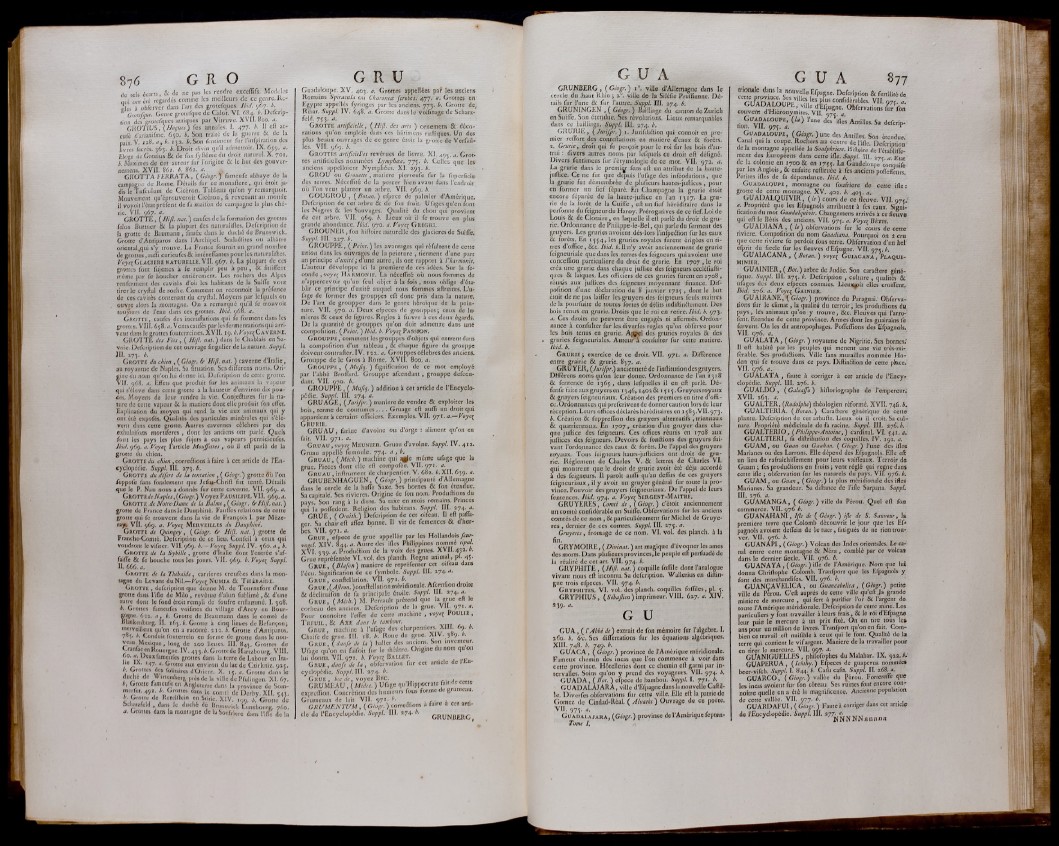
8 7 6 G R O
de ic i. écarts, & de ne [«« les rendre eK c ffift. Modelés
oui ont été regardés comme les meilleurs de ce genre. Règles
h obfcrv cr dans l’art des grotcfqueig Ibid. 96-7. b.
Grotefque. Genre grotefque de Calot, V I. <584. A. Dcfcrip-
tion des grorefijues antiques par Vitruve. X V II. 800, //.
¿ROTI US, ( Hugues ) Tes annales. 1« 4 7 7 - b. 11 ac"
eufé d'arianifinc. 630. b. Son traité de la guerre 8c de la
paix. V, 128. a , b. 13a. ¿.Son fcntimenr furl’ÎMpiratidJJ çlcs
livres Ihcrbs, 363. b, Droit divin qu’il admettoit, IX. 659, n.
Eloge deGrotius 8c de Ton ïyftéme du droit naturel. X. 701.
b. Maximes de cet auteur fur l’origine 8c le but des gouver-
nemens. X V II. 8 6 t. b. 862. a. 'ÿ L
GROTTA I E R R A T A , ( Géogr. ) fameufe abbaye de la
campagne de Rome. Détails fur ce monaftere, qui étoit jadis
le Tuftulum de Cicéron. Tableau qu’on y rcmarquoit.
Mouvement qu’éprouveroit Cicéron, fi revenant au monde
il voyoit l’état préfent de fa mailbn de campagne la plus chérie.
VII. 267» n.
GROTTE, (H i f l. na t.) caufcs de la formation des grottes
félon Buttncr oc la plupart des naiuraliftes. Dcfcription de
la grotte de Baumann, fitnéc dans le duché de Brunswick.
Çro tte d’Anftparos dans l’Archipel. Stalaélites ou albâtre
oricntal^jui s’y trouve. La France fournit un grand nombre
de grottes,auifi curicufesék iméreffanres pour les naturaliftes.
FoyrçGLACiERENATURELLE. V IL 967. h. La plupart de ces
grottes font fujettes à fe remplir peu à peu , 8c finiftent
même par fe boucher entièrement. Les rochers des Alpes
renferment des cavités d’ob les habitans de la Suiffe vont
tirer le cryftal de roche. Comment on reconnoît laoréfence
de ces cavités contenant du cryftal. Moyens par lefquels on
ouvre alors la montagne. On a remarqué uu’il fe trouvoit
toujours de l’eau dans ces grottes, Ibid. 960, a.
G r o t t e , caufcs des incruftations qui fe forment dans les
grottes. V III, 658, a. Ventscanféspar lesfetmentationsqui arrivent
dans le grottes fouterreines. X V II. 19, b. VoyezCaverne.
GROTTE des F é e s , ( Hifl. nat. ) dans le Chablais en Savoie.
Defcription de cet ouvrage fingulier de la nature, Suppl.
III, 273, b.
G r o t t e du chien , ( Géogr, <5* Hi(l. nat. ) caverne d’Italie ,
au royaume de Naples. Sa fituation. Scs differens noms. Origine
du nom qu’on lui donne ici. Defcription de cette grotte.
V II, né8. a. Effets que produit fur les animaux la vapeur
qui s’élève dans cette grotte a la hauteur d’environ dix pouces.
M oyens de leur rendre la vie, Conjectures fur la nature
de cette vapeur 8c la maniéré dont elle produit fè h effet.
Explication du moyen qui rend la vie aux animaux qui y
ont été expofés. Qualités des particules minérales qui s’élèvent
dans cette grotte. Autres cavernes célébrés par des
exhalaifons mortifères, dont les anciens ont parle. Quels
font les pays les plus fujets à ces vapeurs pernicieufes.
Ibid. 960, a, Voye[ l’article Mouffettes , ou il eft parlé de la
grotte du chien.
G r o t t e du chien, corrections à faire h cet article de l’Encyclopédie
« Suppl. III. 273, b.
G r o t t e du dé/en de la tentation, f Géogr.) grotte dû l’on
iuppofe fans fondement que Jcfit#-Chrift fut tenté. DétaiR
que le P. Nau nous a donnés fur cette caverne, V II, 960. a.
GKQTTV.deNaples, (Géogr.) Voyez Pausilipe. V II. 009.0.
G r o t t e .de Notre-Dame de la tialme, ( Géogr. & H ijl. nat. )
grotte de France dans le Dauphiné, Faunes relations de cette
grotte qui fe trouvent dans la vie de François I, par Méze-
ray, VIL 969, a. Voyeç MERVEILLES du Dauphiné.
G r o t t e de Quingey, (Géogr, 8* Hifl. n a t . ) grotte de
Franche-Comté. Defcription de ce lieu. Confeil à ceux qui
voudront le vifiter. V IL 969. b. - Voye{ Suppl, IV. 560. a , b.
G r o t t e de la Sy b ille , grotte d’Italie dont l’entrée s’af-
faiffe 8c fe bouche tous les jours. V IL 969. b. Voyez Suppl.
II. 666. a.
G r o t t e de la Thébaïde, carrières creufées dans la montagne
du Levant duNil,—Fey^NuMtA 8c T u ¿11 aide.
G r o t t e , defcription que donne M. de Tournefort d’une
grotte dans l’ifte de Milo, revêtue d’alun fublimé, 8c d’une
autre dont le fond étoit rempli de foufre enflammé. I. 308.
b. Grottes fameufes voifines du village d’Arcy en Bourgogne.
622. a . b. Grotte de Bcaumann dans le comté de
»lankeiiburg. II, 163. b. Grotte à cinq lieues dcBefançon;
merveilleux qu’on en a raconté, 212. b. Grotte d’Antiparos.
7®5' b, Conduit fouterrein en forme de grotte dans le nouveau
Mexique, long de 200 lieues. III, 843. Grottes de
v.ranfacenRouergue,IV, 433,¿.Grottede Hambourg. V III.
v rv fameufes grottes dans la terre de Labour en Ira-
, /"* a. Grotte aux environ du lac de Czirkniz. 923. I folhaires d’Oiient. X. 15. a. Grotte dans le
duché de Wirtemberg prés de la ville Je Pfulingen. XI. 67.
¿f Grotte fameufe en Angleterre dans la province de Soin»
merfer. 49** b . G x o m «Tans |c comté de Derby. X II. 543.
RGrouadcRiielrtcm en Siiric. X IV . >99. b. Gfoite dc
pcneizfcld .aeni le duché de Bnm.vritk E,mebourg. 760.
1- ™»S I» montagne de la Soufifer« dan» l'ifle de la
G R U
Guadalonpe. X V . 403. a. Grottes appeiiées paf les anciens
Romains Spiracula ou Charoneat ferobes. 477. a. Grottes en
Egypte appel lés fyrioges par les anciens. 773. b. Grotte de,
Rinar. Suppl. IV . 048. a. Grotte dans le voifinage de Scharz»
feld, 753. a.
G r o t t e artificielle, f Hifl. des arts ) ornemens 8c décorations
qu’on emploie dans ces bâtimens rtiftiqûes, Un des
plus beaux ouvrages de ce genre étoit lu grotte de Verfail-
Ics. V II, 969. b.
G r o t t e s artificielles r evê tue s de lierre. X I. 490, a. Grottes
artificielles nommées Lymphaa. 773, b. Celles que les
anciens appelloienr Nympnées. XL 293. b.
GROU ou G 'ou et te , matière pierreufe fur la fiiperficie
des terres. Néceftité de la percer bien avant dans l'endroit
où l'on veut planter un arbre. V IL 969. b.
GOUGROU , ( B o ta n .) efpece de palmier d’Amérique.
Defcription de cet arbre oc de fon fruit. Ufagesqu’en four,
les Negres 8c les Sauvages. Qualité du chou qui provient
de cet arbre. V II, 969. b. Lieux où il fe trouve en plus
grande abondance, Ibid. 970. a. Voyez G r i g r i .
GROUNER, fon hiftoirc naturelle des glacières de SuifTe.
Suppl. I I I 227. b.
GROUPPE, (P e in t ,) les avantages qui réfuirent de cette
union dans les ouvrages de la peinture , tiennent d’une part
an principe d'unité ; dune autre, ils ont rapport à Vharmonie.
L'auteur développe ici la première de ces idées. Sur la féconde
iVoyc{ H a rm o n ie . La néceftité où nous fommes de
ii'appercevoir qu’un fcul objet & la fois, nous oblige d'établir
ce principe d’unité auquel nous fommes aftremts. L’u-
fiige de former des grouppe* eft donc pris dans la nature.
De l’art de groupper dans le genre héroïque de la peinture.
V IL 970. a. Deux efpcces de groiippes; ceux Je lumières
8c ceux de figures. Réglés à Cuivre a ces deux égards.
De la quantité de grouppes qu’on doit admettre dans une
compofition. (Peint. ) Ibid. b. Voyc{ P a s s io n .
G r o u p p e , comment lesgrouopes d’objets qui entrent dans
la compofition d’un tableau, oc chaque figure du grouppe
doiventcontrafter.lv. 122. a. Grouppes célébrés des anciens.
Grouppe de le Gros à Rome. X V II. 800. a.
G r o u p p e , ( Mufiq. ) ftgnification de ce mot employé
par l'abbé Bronard. Grouppe afeendant, grouppe defeen-
dant. V II. 970. b.
GROUPPE, | Mufiq. ) addition à cet article de l'Encyclopédie.
Suppl. III. 274, a.
CRU AGE, ( Jurifpr. ) maniéré de vendre 8c exploiter les
bois, terme de coutumes. . . . Gruage eft aufti un droit qui
appartient à certains officiers. Exemples. V II. 971. a.— Voye^
G r u r i e .
G R U A U , farine d’avoine ou d’orge : aliment qu’on en
fait. V II. 971. a. |
G R U A ü jwm M e u n ie r . Gruau d’avoine. Suppl. IV . 412.
Gruau appelle femoule. 774. a , b.
G r u a u , ( Méch, ) machine qui ag|e même ufage que la
grue. Pièces dont elle eft compofée. V II. 971. a.
G r u a u , infiniment de charpentier. V. 682. b. X II. 639. a.
GRUBENHAGUEN, ( Géogr. ) principauté d’Allemagne
dans le cercle de la bafie Saxe. Ses bornes 8c fon étendue.
Sa capitaltf. Ses rivières. Origine de fou nom. Productions du
pays. Son rang à la dierc. Sa taxe en mois romains. Princes
qui ïa pofledenr. Religion des habitans. Suopl. III. 274. *.
GRUE , ( Omith.) Dcfcription de cet oiseau. Il eft piina-
ger. Sa chair eft aflez bonne. Il vit de femences 8c d’herbes.
V II, 971. a.
G r u e , efpece de grue appcllée par les Hollandois feur-
■ ¿44, a. Autre des ifles Philippines nommé tipul.
vogel. X IV .
voget,. . . » » v ------- - - - ». v i / i 1 L
X V I. 339.//. Pr/Production uliiéKon de la voix des grues. X Xww.V II. 432.¿¡¡à »L
.
Grue représentée V I, vol,vol. des planch. Regne animal, f
pl. 4 5 -
Ci ru e , ( B la fo n ) maniere tie repréfenter^ cet oifeau dans
l’écu.Significarlo T'
H jP H I I .maniéré J e r ep ré fen te r c e t oifeau
l’écu. Signification de ce fymbolc. Suppl. III. 274*J-
G r u e , conftellation. V ÎI. 971. ¿.
/ . n \ __ «t. il..,-. Air^nliAn 1
G
r u e , (Afiron, ) conftellation méridionale. Afcenfion droite
8c déclin
uéclinaifon de fa principale étoile. Suppl. III. 274- a-
G r u e , (M é c h .) M, Perrault prétend que la grue eft le
corbeau des anciens. Defcription de la grue. VIL 971 .a .
Pour connoitre l’effet de cette machine , voye{ P o u l ie ,
T r e u i l , 8c A x e dans le tambour.
G r u e , machine k l'ufage des charpentiers. X III. 69. b.
Chai fe de grue. III. 18. b. Roue de grue. X IV . 389. b.
G r u e , (d a n fe de la ) ballet des anciens. Son inventeur.
Ufage qu’on en faifoit fur le théâtre. Origine du nom quou
lui donna. V IL 971. b, Voye{ B a l l e t .
G r u e , danfe de l a , obfervation fur cet article de I encyclopédie,
Suppl. III. 274. b.
G r u e , bec de , v o y e z B e c . ¿ S E s , « »
GRUMEAU, ( mm ) UÜIRC qu'Hippocrate f»!l R « n e
exprefiion. Concrition des humeurs fou» forme de grumeau.
Grumeaux de lait V IL 971. b, ,
G n U M / ' .N T U M , ( Géogr. ) correfliona à faire a cet article
de l'Encyclopédie. Suppl. Ht. 17A- br GRUNBERG,
G U A
GRUNBERG, (G é o g r .) i ° . ville d’Allemagne dans le
cercle du .haut Rhin ; 2". ville de la Siléfie Prulficnnc. Détails
fur l’une 8c fur l’autre, Suppl. I II. 274, b.
GRUNINGEN , ( Géogr. ) Bailliage du canton de Zurich
en SuifTe. Son éreijdue. Scs révolutions. Lieux remarquables
dans ce bailliage, fiuppl. IIÍ, 274. ¿.
GRURIE t ( Jurijpr. ) 1. Jurifdiétion qui connoit en premier
reffort des conreftations en matière d’eaux 8c forêts.
2. Grurie, droit qui fe perçoit pour le roi fur les bois d’autrui
: divers autres noms par lefquels ce droit eft défigné.
Divers fentimens fur Tétyinologie de ce mot. V II. 972. a.
La grurie dans le premiqf fens eft un attribut de la naute-
iuftice. Ce ne fut que depuis l’ufage des inféodations, que
la grurie fut démembrée de plusieurs hautes-juftices, pour
en former un fief féparé. En Champagne la grurie étoit
encore féparéc de la baute-juftice en l’an 1317. La gru-
rie de la forêt de la Guifte , eft un fief héréditaire dans la
perfonne du feigneurdu Haroy. Prérogatives de ce fief. Loi de
Louis 8c de Clotaire, en laquelle il eft parlé du droit de grurie.
Ordonnance de Philippc-le-Bel, qui parle du ferment des
gruyers. Les gruriesavoient dés-lors rinfpeétion furies eaux
8c forêts. En 1354, les gruries royales furent érigées en titres
d’office, 8cc. Ibid. b. Il n’y avoit anciennement de grurie
feigneuriale que dans les terres des feigneurs quiavoient une
conceffion particulière du droit de grurie. En 1707, le roi
créa une grurie dans chaque juftice des feigneurs eccléfiafti-
ques 8c laïques. Les officiers de ces gruries furent en 1708,
réunis aux juftices des feigneurs moyennant finance. Dif-
pofition d'une déclaration du 8 janvier 1723, dont le but
étoit de ne pas laifTer les gruyers des feigneurs fculs maîtres
delà pourfuitc de toutes fortes de délits indiftinéteincnt. Des
bois tenus en grurie. Droits que le roi en retire. Ibid. b. 973.
a. Ces droits ne peuvent être engagés ni affermés. Ordonnance
à confultcr fur les diverfes regles qu’on obferve pour
les bois tenus en grurie. Appel des gruries royales 8c des
gruries feigncuriales. Auteur a confulter fur cette matière.
ibid. b.
G r u r i e ; exercice de ce droit, V II. 971. a. Différence
entre grairic 8c grurie. 837. a.
GRUVER, (Jurifpr.) ancienneté de i'infiitution des gruyers.
DlfTérens noms qu on leur donne. Ordonnance de l’an 1318
8c fentence de 1363, dans lesquelles il en eft parlé, L)é-
fenfe faite aux gruyers en 1346,14028c 1313. Gruyers royaux
8c gruyers feigneuriaux. Création des premiers en titre (Toffi-
Cc. Ordonnances qui preferivent de donner caution lors de leur
réception. Leurs offices déclarés héréditaires en 1383 .V IL 973.
b. Création 8c fuppreffion des gruyers alternatifs , triennaux
8c quatriennaux. En 1707, création d’un gruyer dans chaque
juftice des feigneurs. Ces offices réunis en 1708 aux
juftices des feigneurs. Devoirs 8c fonctions des gruyers fui-
vaut l’ordonnance des eaux 8c forêts. De l’appel des gruyers
royaux. Tous feigneurs hauts-jufticiers ont droit de grurie.
Règlement de Charles V. 8c lettres de Charles VI.
qui montrent que le droit de grurie avoit été déjà accordé
k des feigneurs. Il paroît auifi qu’au dcffiis de ces gruyers
feigneuriaux, il y avoit un gruyer général fur toute la province.
Pouvoir des gruyers feigneuriaux. De l’appel de leurs
fentcnccs. Ibid. 974. a. V o y e /o e r g e n t -M a i t r e .
GRUYERES, Comté d e , (Géogr.) c’étoit anciennement
un comté çonfidérable en SuifTe. Obfervations fur les anciens
comtés de ce nom, 8c particulièrement fur Michel de Gruyeres
, dernier de ces comtes. Suppl. III. 273. a.
Gruyeres, fromage de ce nom. V I. vol. des planch. à la
fin.
GRYMOIRE, ( Divinal. ) art magique d’évoquer les ames
des morts. Dans pluficurs provinces,le peuple eft perfuadé de
la réalité .de cet art. V IL 974. ¿.
GRYPHITE , (Hifl. nat. ) coquille foflile dont l’analogue
vivant nous eft inconnu. Sa dcfcription. Wallerius en diftin-
gue trois efpeces. V II. 974. b.
G r y p h i t e s . V I. vol. des planch. coquilles fondes, pl. 3.
GRYPHIUS , (Sébafiien ) imprimeur. V IIL 627. a. XIV.
239. a.
G U
G U A , ( l'Abbé d e) extrait de fon mémoire fur l’algcbre. I.
a fio. ¿. Ses differtations fur les équations algébriques.
X III. 748. b. 749. b.
G U A C A , f Géogr.) province de l’Ainérique méridionale.
Fameux chemin des incas que l’on commence à voir dans
cette province. Hôtelleries dont ce chemin eft garni par intervalles.
Soins qu’on y prend des voyageurs. V IL 974. ¿.
G U A D A , ( Bot. ) efpece de bambou. Suppl. I. 7 7 1 . ¿.
GUADALÀJARA, ville d’Efpagnc dans la nouvelle Caftil-
le. Diverfes obfervations fur cette ville. Elle eft la patrie de
Gomez de Cindad-Réal. ( Alvarès ) Ouvrage de ce poète.
V II. 973. a.
G u a d a l a j a r a , (Géogr.) province de l’Amérique fepten-
Tomc /,
G U A 877
(rionale dnns la nouvelle E/pagne. Dcfcription & fertilité de
‘ ‘ X S n 1“! 1“ çonfidérable», V II, 075. a.
jUADALOUPE, ville dEfpagne. Obfervations fur fon
c o u v en t d’Hicronymites.lWdct V II a j t i(a k;,An,iUci'Sa SIS G uadaloupe, (Géo er . ) une des Antilles. Son étendue.
Canal qui la coupe. Rochers au centre de Tille. Defcription
de la montagne appcllée la Soulphriere. Hiftoire de l’établifre-
ment des Européens dans c e t te tfle. Suppl. iU. %1, a_
de la colonie en 1700 8c en 1733. La Guadeloupe conquife
par les Anglois, 8c enfuite reftiruée à fes anciens poffefTcurs.
Petites ifles de fa dépendance. Ibid. b.
Guadalqupe, montagne ou foufriere d e cet te iflc:
grotte de cette montagne. XV . 402. b. 401. a.
G UAD ALQU IV IR, ( U ) cours de ce fleuve. V II. 973.'
a. Propriété que les Espagnols attribuent à fes eaux. Signification
du mot Guadalquivir. Changcmens arrivés à ce fleuve
qui eft le Bétis des anciens. V IL 97 3 - a. Voyez D é t i s .
GUADIANA , ( le ) obfervations fur le cours de cette
rivière. Compofition du nom Guadiana. Pourquoi on a cru
que cette rivière riviere fe perdoit fous terre. Obfervation d’u d’un *bel
‘
efprit du fiecle fur r les fleuves f
d’Efpagne. V IL 973. b.
GUAIACANA,AC AN A.
( Botan. ) voyez G u i a c a n a , PtA
MINIER.
GUAINIER, ( B o t.) arbre de Judée. Son caraétere générique.
Suppl. III. 273. b. Defcription , culture, qualités 8c
iifagcs des deux efpeces connues. Licuiqpm elles croiflent,
Ibid. 276. a. Voyeç Gainier.
GUA1RANE, *(Géogr.) province du Paraguai, Obfervations
fur le climat, la qualité du terroir ; les produétions du
pays, lès animaux qu’on y trouve, S ic . Fleuves qui Tarro-
fent. Etendue de cette province. Armes dont le s guairains fe
fervent. On les dit antropophages. PofTeffions des Efpagnols.
VIL 976. a.
GUALATA, (Géogr. ) royaume de Nigritic, Scs bornes.’
Il eft habité par les peuples qui mènent une vie três-mi-
férable. Ses produétions. Ville fans murailles nommée Ho-
den qui fe trouve dans ce pays. Diftinétion de cette pkicc.
V II. o 7 6. a.
G U A LA TA , faute h corriger à c e t article de l’Encyclopédie.
Suppl. 111, 276. b.
GUALDO , ( Galeaffo ) hiftoriographe de l'empereur«'
X V II. 2Ô3. a.
GUALTER, (Rodolphe) théologien réformé. X V II. 746. b.
GUALTERIA. (B o ta n .) Caraétere générique de cette
plante. Defcription de cet arbufte. Lieux où il croit. Sa culture.
Propriété médicinale de fa racine. Suppl. III. 276. b.
G U A L iE R IO , ( Philippe-Antoine, ) cardinal. V I. 34t. a.
G UAL TIERI, fa diftrioution des coquilles. IV. 192. a.
G U AM , ou Guan ou Gaahan. ( Géogr. ) l’une des ¡îles
Mariancs ou des Larrons. Elle dépend des Espagnols. Elle eft;
un lieu de rafraichiiTement pour leurs vaiffeaux. Terroir de
Guain : fes productions en fruits; vent réglé qui regne dans
tre ifle ; obfervation fur les naturels du pays. V It. 97 6. ¿.
G U AM , ou G u a n , ( Géogr.) la plus méridionale des ifles
Mariants. Sa grandeur. Sa diftance de l'ifle Sarpana. Suppl.
III. 276. a.
GUAMANGA, ( Géogr. ) ville du Pérou. Quel eft fon
commerce. V II. 9 76 b.
G UANAHANl, Ifle de ( Géogr. ) ifle de S . Sauveur, la
première terre que Colomb découvrit le jour que les Efi*
pagnols avoient deffein de le tuer, fatigués de ne rien trouver.
V IL 976. b.
GUANAPl, (G éo g r.) Volcan des Indes orientales. Le canal
entre cette montagne S i Néra | comblé par ce volcan
dans le dernier fiecle. V II. 976. b.
GUANAYA, ( Géogr. ) iflc de l’Amérique. Nom que lut
donna Cliriftophe Colomb. Tranfport que les Efpagnols y
font des marenandifes. V IL 976. b.
GUANÇAVELICA , ou .Guancabelica, ( Géogr. ) petit®
ville du Pérou. C’eft auprès de cette ville qu’eft Ja grando
minière de mercure , qui fert à purifier l’or 8c l’argent d»
toute l’Amérique méridionale. Defcription de cette mine. Les
particuliers y font travailler & leurs frais, 8c le roi d’Efpagne
leur paie le mercure à un prix fixé. On en tire tous les
ans pour un million de livres. Tranfport qu’on en fait. Combien
ce travail eft nuifiblc à ceux qui le font. Qualité de la
terre qui contient le v if argent. Manière de la travailler pour
en tirer le mercure. V IL 997. a.
GlfANIGUELLES, philofophes du Malabar. IX. 922. b.
GUAPERUA , ( Ichthy. ) Efpeces de guaperua nommée»
becr-vifcli. Suppl. I. 844. b. Cani cafa. Suppl. II. 268. a.
GUARCO, ( Géoer. ) vallée du fé ro u . Forierefle que
les incas avoient fur fon côteau Ses ruines font encore con-
noftre quelle en a été la magnificence. Ancienne population
de cette vallée. V II. 977. b. • ,
GUARDAFUI, (G é o e r .) Faute h corriger dans cet article
de TEucyclopèdic. Suppl. III. 277. ^
' 1 N N N N N n n n n n