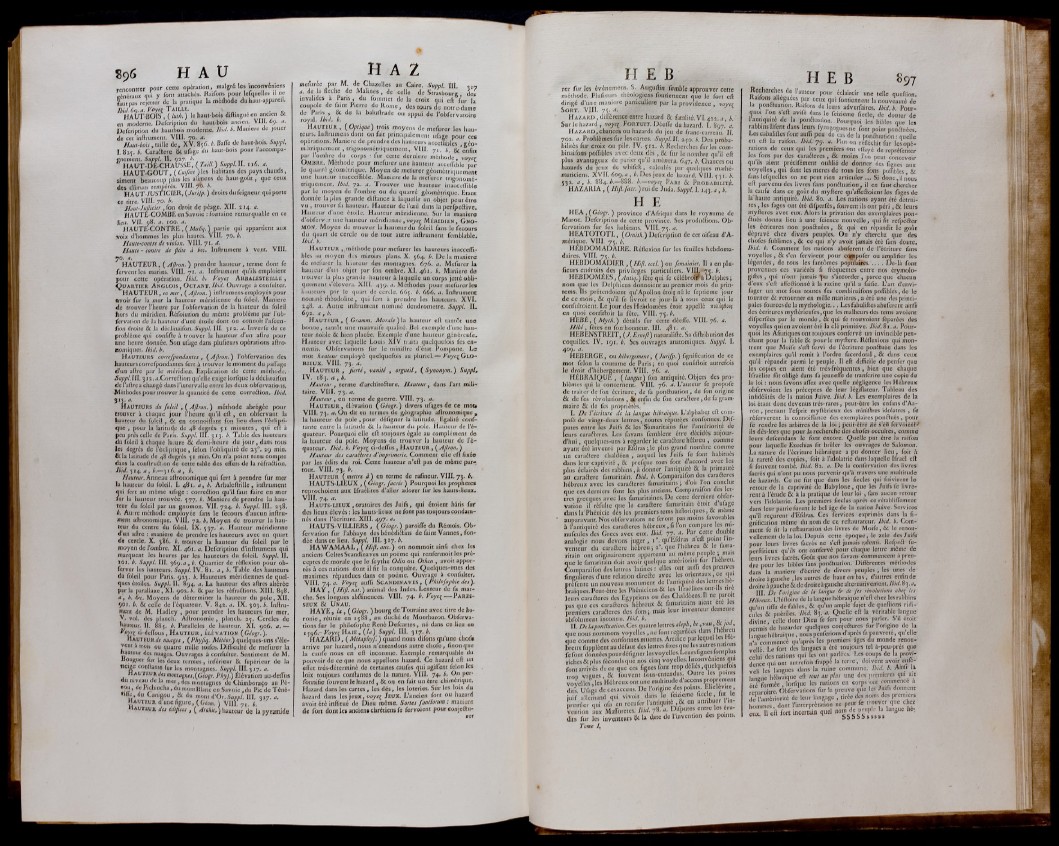
896 H A U
rencontrer pour cette opération, malgré les mcomréniens
eénéraux qui y font attachés. Raifon* pour lciquclles il ne
faut pas refetter de la pratique la méthode du haut-appareil.
V * l î i Taiu»*» . , , - . . «,
H A U T B O IS , (/////;.) le haut-bois diAinguécn ancien oc
en moderne, Defcription du hautbois ancien. VIII. 69. a.
Description du hautnoïs moderne. Ibid. b. Manière de jouer
de cet inArument, V I I I . n o . a . . „ .
Ha u t-bo is , taille d e , X V . f e b. Baffe de haut-bois. %/>/.
I. 825. b. Ca radere 8c ïifsge du haut-bois pour iaccompa-
S" h A U T ? f f £ c H , ( T a i l l . ) S u f f i . II. 1 1«. a.
H A U T -G O U T , ( Qui fine ) les habitans des pays chauds,
aiment beaucoup plus les alwens de haut-goût, que ceux
des climats tempérés. VIII. f o . b .
HAUT-JUSTICIER, ( Jurtjp. ) droits du feigneur qui porte
cp titre. VIII. 7 0 ./ .
Haui-Juflicicr, ion droit de péage. XII. 214. 4.
HAUTE-COM B E en Savoie : fontaine remarquable en ce
j/eu, VII. 98. 4. 100. a.
H A U T É -C O N T R E , (M u f îq . ) partie qui appartient aux
voix d’hommes les plus hautes. VIII. 70. b.
Haute-contre de violon. VIII. 7 1 . A
H a u te -con tre de flû te à bec. InArument à Vent. VIII.
70. a,
H A U T E U R , ( Aflron. ) prendre hauteur, terme dont fe
fe r v en t les marins. VIII. 7 1 . a. InArument qu’ils emploient
pour cette opération, tbid. b, Voycq A u b a l e s t r il l e ,
Q u a r t i e r A n g l o j s , O c t a n t . Ibid. Ouvrage à confulter.
H A U T E U R ,e n mer, ( A flron. ) inftrumensemployés pour
ftvoir fur la mer la hauteur méridienne du foleil. Maniéré
de trouver l’heure par l’obfervation de la hauteur du foleil
hors du méridien, Réfoiurion du même problème par l’ob-
fervation de la hauteur d’unê étoile dont on conna ît l’afcen-
fion droite 8c Ja déclinaifon. Suppl. III. 312. a. Inverfe de ce
problème qui confiAc à trouver la hauteur d’un allre pour
une heure donnée, Son ufage dans plufieurs opérations aftro»
«omiques, Ibid. b.
H a u t e u r s correfpondantes, ( Aflron. ) l’obfervation des
hauteurscorrefpondantes fert à trouver le moment du pafiage
d’un aftre par le méridien. Explication de cette mêthorle, -
Suppl, III. 312, d.Correélion qu’elle exige lorfque la déclinaifon
de l’aAre a changé dans l’intervalle entre les deux obfervations.
Méthodes pour trouver la quantité de cette correétion. Ibid,
3 *1; a
H a u t e u r s du f o l e i l , (A f lr o n , ) méthode abrégée pour
trouver à chaque jour l’heure qu’il e f t , en observant la
hauteur du fo le il, 8c en connoifiant fon lieu dans l’éclipti-
que , pour la lautud.c de 48 degrés 51 minutes, qui en h
peu près celle de Paris, Suppl. III. 313. b. T able des hauteurs
du foleil ii chaque heure oc demi-heure du jo u r , dans tous
les degrés de l’écliptique, félon l’obliquité de 23°. 29 min.
6c la latitude de 48 degrés 51 min. On n’a point tenu compte
dans la conAru&on de cette table des effets de la réfraélion.
Ibid, 314, a , b.— 3 16. a , b.
Hauteur. Anneau agronomique qui fert à prendre fur mer
la hauteur du foleil, I. 481. a , b. A rb aleflrille, infiniment
qui fert au même ufage : correélion qu’il faut faire en mer
fur la hauteur trouvée. 577, b. Maniéré de prendre la hauteur
du foleil par un gnomon. VII. 724. b. Suppl, III. 238.
b. Auire méthode employée fans le fecours d aucun inflrument
aflronomique. V U l. 72, b. M o yen de trouver la hauteur
du centre du foleil. IX. 537. a. Hauteur méridienne
d’un aflre : maniéré de prendre les hauteurs avec un quart
de cercle. X. 286. b. trouver la hauteur du foleil par le
m o y en de l’omnre, XI. 461. a. Description d’inArumens qui
marquent les heures par les hauteurs du foleil. Suppl. II.
ï o i . b. Suppl. III, 3 6 9 ,4 , b. Quartier de réflexion pour ob-
ferver les hauteurs, Suppl, IV . 81. a , b. Table des hauteurs
du foleil pour Paris. 923. b. Hauteurs méridiennes de quelques
étoiles, Suppl. 11. 894. a . La hauteur des aAres altérée
par la parallaxe, XI. 902. b, 6c par les réfraélions. XIII. 898.
a y b, Oc. Moyens de déterminer la hauteur du p ô le , XII,
901, b, 6c celle de l’équateur. V , 842. a. IX . 303. b. infiniment
de M, H a d le y , pour prendre les hauteurs fur mer.
V . vol, des nlanch. AAronomie, planch. 23. Cercles de
hauteur. II, «83. b. Parallèles de hauteur. XI. 906. a. —
% ci-deffous, H a u t e u r , é l é v a t io n (G éo g r .) .
Hauteur</r nuages, (P hy ftq . Météo rf) quelques-uns s’élèvent
à trois ou quatre mille toifes. Difficulté de mefurer la
nauteur ‘K 5 nu*Rc *» Ouvrages à confulter, Sentiment de M.
liouguer " ,r 1% deux termes, inférieur 6c fupéricur de la
neige confiante fur les montagnes. Suppl. III. 317. a.
H a u t e u r des montaenesAGeogr. P h y j ) Élévation au-defïus
ou niveau de la mer, des montagnes de Chimboraço au Pé-
»0115 de Pichincha, du mont Blanc en Savoie ,du Pic de Téné-
« f le .d u Camgou, 8c du montd 'Q h S u p p l, III. 3 17 . 4.
H a u t e u r d’une figure, (C lam . ) VIII, 7 t . b.
H a u t e u r dte édifices, ( A r ch it.) b u teu r de la pyramide
H A Z
m e fu rè e par M. de C lia zelle . au Caire, S u f f i . Ht,
a. de la fleclie de M a lin es , de celle de Strasbourg, des
invalides à Paris, du foinmec de la croix qui eft fur la
coupole de faim Pierre de R om e , des tours de noire-dame
de Paris< t 8c de la baluAradc ou appui de l’obfervatoire
royal, ¡b ld . b.
H a u t e u r , ( O it iq u i ) trois moyens de mefurer les liau-
reurs. Inllrumens dont 011 fait principalement ufage pour ces
opérations. Maniéré de prendre des bailleurs accefiibles g éo métriquement
, trigonométriquement, VIII, 7 / , ¡>i &*enjjn
par l’ombre du corps : fur cette derniere méthode, voyez
O m b r e . Méthode pour m e fu re r une hauteur acçcfiiblc par
le quarré géométrique. Moyen de mefurer géométriquement
une hauteur inaccefilble. Maniéré de la mefurer trigonométriquement,
ib id . 72. a. T ro u v e r une hauteur inacccffibl©
par le moyen de l’ombre ou du quarré géométrique. Etant
donnée la plus grande diAance à laquelle un objet peut être
vu , trouver fa hauteur. Hauteur de l’oeil dans la perfpeélive.
Hauteur d’une étoile. Hauteur méridienne. Sur la maniéré
d’o b fc rv .r une hauteur méridienne,v o y e z M é r id i e n , G n o m
o n . Moyen de tr o u v e r la hauteur du foleil fans le fecours
du quart de cercle ou de tout autre inArument fcmblable*
Ibid. b.
H a u t e u r , .méthode pour mefurer les hauteurs innccefii-
blet au moyen des miroirs plans. X, 364. b. D e la manière
de mefurer la hauteur des montagnes. 676. a, Mefurer la
hauteur d’un objet par fon ombre. XI. 461. b. Maniéré de
trouver la plus grande hauteur à laquelle un corps jetté obliquement
s’élèvera. X t ll . 439. a. Méthodes pou r mefurer les
hauteurs par le quart de cercle. 663, b. 6 6 6 . a. InArument
nommé théodolite, qui fert à prendre les hauteurs. X V I .
248. a. Autre inArument nommé deudroinctre. Suppl. II.
692. a , b.
H a u t e u r , ( Gramm. Morale ) la hauteur eR rainât une
bonne, tan tôt une mauvaife qualité, Bel exemple d’une hauteur
noble 8c bien placée. Exemple d’une hauteur généreufe.
Hauteur avec laquelle L o u is X IV traita q u e lq u e fo is fes ennemis.
Obfervations fur le miniAre d’é ta t Pompone. L e
mot hauteur employé quelquefois au pluriel.— Voy e^G l o r
i e u x , V l lL 73. a.
H a u t e u r , fie r t é , vanité , orgueil, ( Synony/n. ) Suppl»
IV . 183. a , b.
H a u teu r , te rm e d’a rch ite é lu re . H a u teu r , dans l’art milita
ire. V I I I . 73, a.
Hauteur y en te rm e d e g u e r re . V I I I , 73. a.
H a u t e u r , élévation ( Géogr, ) divers ufages de ce mot»
V I I I . 73, a. O u dit en termes de géographie aAronomique ,
la hauteur du p ô le , pour défigner la latitude. Egalité confiante
entre la latitud e 8c la hauteur du pôle. Hauteur de l’é-
quateur. Pourquoi elle eA toujours égale au complément de
la hauteur du pôle. Moyens de trouver la hauteur de l’ê -
quateur. Ibid. b. Voyc^ ci-deffus, H a u t e u r , ( Aflron. )
Hauteur des caraéleres d'imprimerie. Comment elle eu fixée
par les édits du roi. Ce tte nauteur n’eA pas de même partout.
V I I I . 7 3 . b.
H a u t e u r {mettre à ) en te rm e d e ra fin e u r .V I I I .73. b.
H A U T S -L IE U X , (G éo g r . facrée ) P ou rq u o i les p ro p h ète s
r ep ro c h o ie n t au x Ifra élite s d’a lle r ad o re r fu r le s hautSTlicux.
V I I I . 74. a.
H a u t s -l i e u X , oratoires des Juifs , qui étoient bâtis fur
des lieux élevés : les hauts-lieux ne font pas toujours condamnés
dans l’écriture. XIII. 497. a.
H A U T S -V IL L IE R S , ( Géogr. ) paroifie du Rémois. Ob-
fervation fur l’abbaye des bénédictins defaint Van n e s , fondée
dans ce lieu. Suppl, III. 317. b.
H A W A M A A L , ( H ifl. a n c .) on nommoit ainfi chez les
anciens Celtes Scandinaves un poème qui renfermoit les préceptes
de morale que le fcythe Odin ou Othen , avoir apportés
à ces nations dont il fit la conquête. Quelques-unes des
maximes répandues dans ce poème. Ouvrage à confulter,
V I I I . 74. a. Voy e[ suffi S c a n d i n a v e s , ( Philo,fophie d e s ).
H A Y , ( H ifl.n a t .) animal des Indes. Lenteur de fa marche.
Ses longues abflinences. V I I I . 74* é, Voy e[ — P a r e s s
e u x 8c U n a u .
H A Y E , l a , (Géogr. ) bourg de Tourainc avec titre de ba-
ro n ie , réunie en 138 8, au duché de Mombazon. Obfervations
fur le pbilofophe René Defca rtes, né dans ce lieu en
1396." Voyer H a i e , ( l a ) Suppl. III. 3 1 7 . b.
H A Z A R D , ( Mé/aphyfI) quand nous difons qu’une cliof«
arrive pa r hazard, nous n’entendons autre ch o fe , finonque
la caiife nous en eA inconnue. Exemple remarquable du
pouvoir de ce que nous appelions hazard. C e hazard eA un
eAet très-déterminé de certaines caufes qui agiffent félon les
loix toujours conAantcs de la nature. V l lL 74. b. O n per*
fonnifie fouvent le hazard, 8c on en fait un être chimérique.
Hazard dans les cartes, les d é s , les loteries. Sur les loix du
hazard dans les je u x , voye[ J e u x . L ’ancien fo r t ou hazard
avoit été inAitué de Dieu même. Sortes fanflorum : manière
de for» dont les anciens chrétiens fe Cervoient pour conjecturer
H E B
rer fur les événemens. S, AuguAin femble approuver c e t te
méthode, Plufieurs théologiens fou tien n en t que le fort eA
dirigé d’une maniéré particulière par la providence , voyez
S o r t . V J I1. 73. n.
H a z a r d , différence entre hazard 8c fatalité. V I. 4 1 2 .4 , b. '
Sur le hazard , voye{ F o r t u i t . DéeAe du hazard, I. 897, 4.
H a z a r d , chances ou hazards du jeu de franc-carreau, II.
702. 4. Problèmes fur les cartes, S u p p l.U . 230. b. Des probabilités
fur croix ou plie. IV . 312. li.Recherches furies com-
binaifons poffibles avec deux d é s , 8c fur le nombre qu’il eA
plus avantageux de parier qu’il amènera. 647. b. Chances ou
hazards du jeux de w h ifek , calculés par quelques mathématiciens.
X V I I . 60 9 .4 , b. Des jeux de hazard. VIII. 331. b.
332. 4 , b. 884. /».— 888. b,— voye{ P a r i 6c P r o b a b i l i t é ,
H A Z A R IA , ( H i f l, f ie r . ) roi de Juda. Suppl. 1, 143 .4 , b.
H E
H E A , (Géopr. ) province d’A frique dans le royaume de
Maroc. Defcription de cette province. Ses produélions. O b fervations
fur fes habitat». VIII. 73. a.
H E A T O T O T L , (O rn ith .) Defcription de cetoifeau d’A mérique.
V I I I 73, b.
H E BD OM A D A IR E . Réflexion fur les feuilles hebdomadaires.
V I I I . 73, b.
H E BD OM A D IE R , (H i f l. e c e l . ) o u femainier. Il a en plu»
ficurs endroits des privilèges particuliers. VIU.^73. b.
H E BD OM É E S , (A n i iq J fête qui fe célébroîPâ Delphes ;
nom que les Delphiens don 11 oient au premier mois du prin-
teins. Ils prétendoient au’Apollon étoit né le feptieme jour
de ce mois, 8c qu’il fe nvroit ce jour-là à tous ceux qui le
confultoient. Le jour des Hebdomées ¿toit appellê irthiçioof
e n quoi confiAoit la fête. VIII. 73. b.
H E B É , (M y i h . ) détails fur cette décile. V I I I . 76. a.
H é b é , fêtes en fon’honneur. III. 481. 4.
H E B EN STR E IT , ( / , E rne fl) naturaliAe. Sa diAribntion des
coquilles. IV . 191, b. Scs ouvrages anatomiques. Suppl. I.
409. 4.
H E B E R G E , ou hébergement, ( Ju r ifp .) lignification de ce
mot félon la coutume Je Paris j en quoi confiAoit autrefois
le droit d'hébergement. VIII. 76. a.
H É B R A ÏQ U E , ( la n g u e ) fon antiquité.Objets des problèmes
qui la concernent. V I I I . 76. a. L'auteur fe propofe
de traiter de fon écriture, de fa ponctuation, de fon origine
8c de fes révolutions , 8c enfin de fon caraélere, de fa grammaire
8c de fes propriétés.
I. D e l'écriture de la langue hébraïque. L ’alphabet eA coin-
pofé de vingt-deux lettres, toutes réputées confonnes. Disputes
entre lès Juifs 8c le s ’Samaritains fur l’antériorité de
leurs caraéleres, Les favans fcmblent être décidés aujourd'hui
, quelques-uns h regarder le caraétere hébreu , pomme
ayant été inventé par Eulras ; le plus grand nombre comme
lin caraélere chaldéen , auquel les Juifs fe font habitués
dans leur captivité , 6c prcfque tous font d’accord avec les
plus éclairés des rabbins, â donner l'antiquité 8c la primauté
au caraélere famaritain. Ibid, b. Comparai fon des caraéleres
hébreux avec les caraéleres famaritains j d'ou 1011 conclut
que ces derniers font les plus anciens. Comparai fon des lettres
grecques avec les famaritaincs. De cette derniere observation
il réfulte que le caraélere famaritain étoit d ufage
dans la’Phéuicic dés les premiers tems biAoriques, 8c même
auparavant. Nos obfervations ne feront nas moins favorables
à l'antiquité des caraéleres hébreux, fi l’on compare les mi-
nufcules des Grecs avec eux. Ibid. 7 7 . a. Par cette double
analogie nous devons ju g e r , i° . qu’Efdras neA point 1 Inventeur
du caraélere hébreu ; a0, que l’hébreu 8c le famaritain
ont originairement appartenu au même peuple ; mais
que le famaritain doit avoir quelque antériorité fur 1 hébreu.
Comparaiibn des lettres latines : elles ont aiiAi des preuves
finguiieres d'une relation direéle avec les orientaux, ce qui
préfente un nouveau monument de l'antiquité des lettres hébraïques.
Peut-être les Phéniciens 8c les Ifraehtes ont-ils tiré
leurs caraéleres des Egyptiens ou des Chaldécns.II ne paroit
pas que ces caraéleres hébreux 8c famaritains aient été les
premiers caraéleres des fonsi mais leur inventeur demeure
abfolument ipconnu. Ibid. b. a . ,
II. D e laponfluation. Ces quatre lettres altph, he ,v a u ,, et W ,
que nous nommons v o y e lle s , 11e font regardées dans 1 hébreu
que comme des confonnes muettes. Artifice par lequel les n e -
breux fuppléent au défaut des lettres fixes mie les autres nations
fe font données pour défigner lesvoyellcs. Leursfignesfontplus
riches8c plus féconds que nos cinq voyelles. Inconvén ens qui
font arrivés de ce que ces figues font trop déliés, quelquefois
troo vagues, 8c (buvent lous-entendus. Outre les points
v o v c lle s , les Hébreux ont une multitude d accent proprement
«lit«. Ufage tic cesacccns. D e l'origine dea point«. E lte liv ite ,
ju if allemand qui vivoit dans l e fememe ftec le , fu le
premier qui ofa en reeufer l'antlquiti en attribuer 1 Inten
tion aux Mafforetes. M
dits fur les inventeurs 8c la date de l'invention des points.
Tonte %
H E B 897
R e ch e rch a de 1 auteur pour éclaircir une telle queftion.
Kaifons alléguées par ceux qui foutiennent la nouveauté de
la ponétuation. Kaifons de lents adversaires. Ibid. b. Pourquoi
Ion sert avtfé dans le fememe ftecle, de douter de
I antiquité de la ponétuation. Pourquoi les bibles que les
rabbins Jtfcnt dans leurs fynagogues ne font point ponéitiées.
Les cababftcs font auffi peu de cas de la ponétuation : quelle
en ett la raifon. Ih d . 79. a . Pinson réfléchit fur lesopé-
rations de ceux qui les premiers ont eflayé de représenter
les fons par des caraéleres, 8c moins l’on peut concevoir
qu'ils aient précifément oublié de donner des lignes aux
v o y e lle s , oui font les meres de tous les fon» poffibles, 6c
fans lefquelles on ne peut rien a rticuler.... Si don c ,il nous
eA parvenu des livres fans ponétuation, il en faut chercher
la caufe dans ce goût du myAere qu’afleétoienr les faces de
la haute antiquité. Ibid, 80. a. Les nations ayant été détruire
» , les fage» ont été difpcrfé», fouvent ils ont p é r i , 8c leurs
myAercs avec eux. Alors la privation des exemplaire» ponctués
donna lieu à une fcience nouvelle, qui fit rcfpcéter
les écritures non ponétuées, 8c qui en répandit le goût
dépravé chez divers peuple». On n’y chercha que des
chofcs fublimes, 6c c e qui n’y avoit jamais été fan» doute.
Ibid. b, Comment les nations abuferent de l’écriture fans
v o y e lle s , 8c s’en fervirent pour cqpipofcr ou amplifier les
légendes, de tous les fantômes populaires De-là font
provenue» ces variétés fi fréquentes entre nos étymolo-
giA e s, qui n’ont jamais 3>u s’accorder, parce que chacun
d'eux s’efi afieétionné à la racine qu’il a laifie. L'art d’envi-
fager un mot fous toutes fes combinaifons poAibles, de le
tourner 8c retourner en mille maniérés, a été une des principales
fourccsdc la m ythologie.. . LesfabuliAes abuferent ainfi
des écritures myAérieufes,que les malheurs des tems avoient
difperfées par le monde, 8c qui fe trouvoient féparées des
voyelles qui en avoient été la clé primitive. Ibid. 8 t . a. Pourquoi
les Afiatiques ont toujours confervé un invincible penchant
pour la fable 8c pour le myAere. Réflexions qui montrent
que Moïfe s’eA tervi de récriture ponétuée dans les
exemplaires qu’il remit â l’ordre facerdotal, 8c dans ceux
qu'il répandit parmi le peuple. Il eA difficile de penfer que
les copies en aient été très-fréquentes, bien que chaque
Ifraèlite fût obligé dans fa jeuneAe de tranferire une copie de
la loi : nous favons a fiez avec quelle négligence les Hébreux
obfervoient les préceptes de leur légifiateur. Tableau des
infidélité» de la nation Juive. Ibid. b. Les exemplaires de la
loi étant donc devenus très-rares, peut-être les enfans d’Aa-
ron , prenant l’efprit myAérieux des minifires idolâtres , fe
réferverent la connoifiance des exemplaires ponélués, pour
fe rendre les arbitres de la loi ; peut-être ne s’en fervoientJ
ils dés-lors q u e pour lu recherche des ch o ie s o c cu lt e s , com m e
leur» defeendans le font en co re . Quelle pur être ja raifon
pour laquelle Ezcchias fit brûler les ouvrages de Salomon.
La nature de récriture hébraïque a pu donner lie u , foit h
l.i rareté des copies, foit & l’idolâtrie dans laquelle Ifraèl eA
fi fouvent tombe. Ibid. 82. a, D e la confervation des livres
facrés qui n’ont pu nous parvenir qu’à travers une multitude
de hazards. C e ne fut que dans les fiecles qui fuivirent le
retour de la captivité Je Babylone, que les Juifs fe livrèrent
à l’étude 8c à la pratique de leur loi , fans aucun retour
vers l’idolâtrie. Les premiers ficelas après ce rétablifieinent
dans leur patrie furent le bel âge de la nation Juive. Service«
qu’il reçurent d’Efdras. Ces fervices exprimés dans la fi-
gnification même du nom de ce rcAaurareur. Ibid. b. Comment
fe fit la reAauration des livres de Moïfe, 8c le renouvellement
de la loi. Depuis cette époque, le zele des Juifs
pour leurs livres facrés ne s’efi jamais ndenti. Refpeéè fu-
perAitieux qu’ils ont confervé pour chaque lettre même de
leurs livres iacrés. Goût que nos favans Commencent à prendre
pour les bibles fans ponétuation. Différentes méthodes
dans la manière d’écrire de divers peuple*, les unes de
droite âgauche ,1e» autres de haut en b a s, d’autres enfin de
droite à gauche 8c de droite à gauche alternativement./é/W. 83. a.
III. D e t origine de la langue & de f e s révolutions c h e f les
Hébreux. L’hlAoire de la langue hébraïque n’eA chez les rabbins
qu’un tiffu de fables, 6c qu’un ample fujet de quefiion* ridicules
8c puériles. Ibid. 83. a. Qu elle eA la véritable langue
divine, celle dont Dieu fe fert pour nous parler. S il étoit
nermis de bazarder quelque» conjectures fur l’origine de a
L ngue hébraïque, nous penferion» d’après fa pauvreté, qu elle
n’a commencé qu’après les premiers âges du monde renouv
e lé Le fort des langues a été toujours tel à-peu-près que
celui*des nations qui les ont parlée». Les coups de la providence
qui ont autrefois frappé la terre, doivent avoirenfé-
veli les langues dans la ruine commune. Ibid. b. AJnh Ja
l-ingiie hébraïque eA tout au plus une des premières qui ait
été formée, lorfque les nations en corps ont commencé à
reparoltre. Ôhfervations fur la preuve que les Jmfi* donnent
de l’antériorité de leur langage , tirée des noms des premiers
I ommes, dont l’interprétation ne peut fe trouver que chez
en™ U c i l fort incertain quel 6