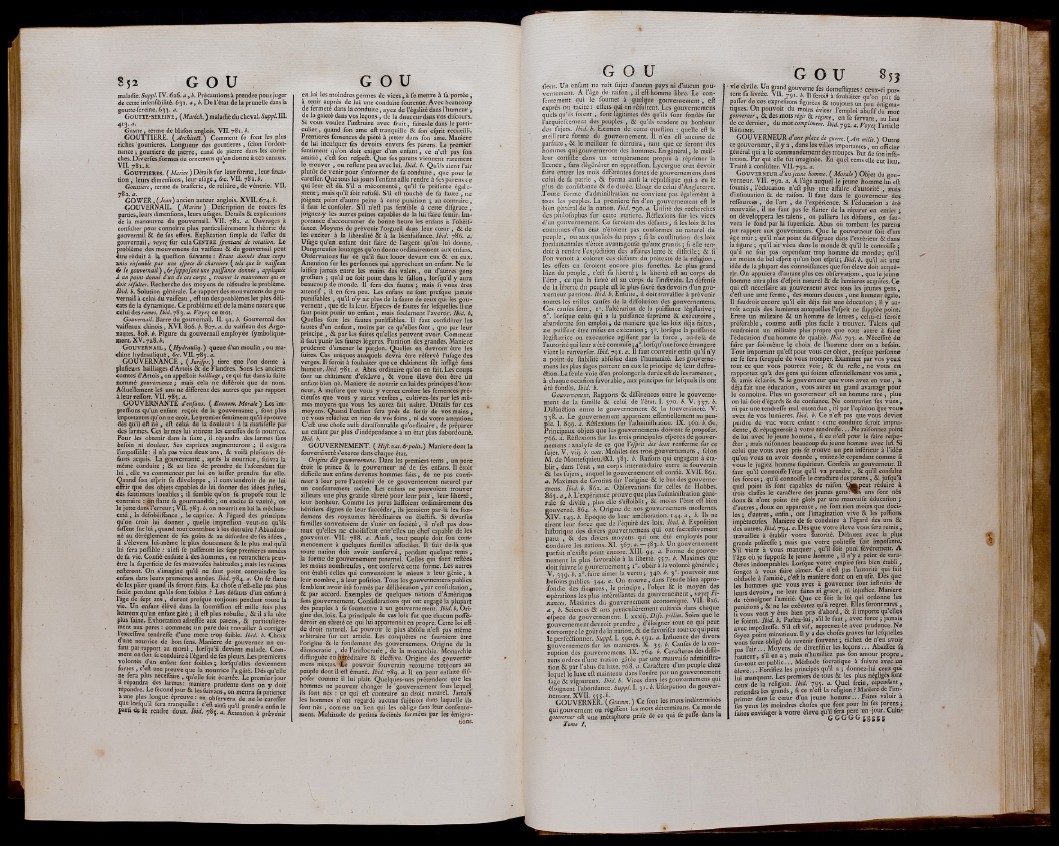
G O U G O U
maladie. Suppl. IV . 626. a , b. Précautions à prendre pour juger
de cette inienfibilité. 631. a , b. D e i ’état de la prunelle dans la
goutte-fereine. 633. a.
G o u t t e -se r e in e , (Maréeh. ) maladie du cheval. SuppLÏU.
4 X3‘ a-
Go u t te , terme de blafon anglois. V I I . 781 .b .
G O U T T IE R E . ( ArchitcÜ. ) Comment fe font les plus
riches ‘gouttières. Longueur des gouttières, félon l’ordonnance
; gouttière de pierre, canal de pierre dans les corniches.
Divcrfes.formes du ornemens qu’on donne à ces canaux.
V IL 781; fc
GOUTTIERES. ( Marine ) Détails fur leur form e, leur fitua-
tion , leurs dimenfions, leu ru fa g e, V I I . 781 .b .
Gouttière, terme de braderie, de re liu re ,d e vénerie. V I I .
782. a. \
G OW E R , (Jea n ) ancien auteur anglois. X V I I . 674. b.
G OUVERNA IL . ( Marine ) Defcription de toutes fes
parties, leurs dimeniions, leurs ufages. Détails & explications
de la manoeuvre du gouvernail. V II. 782. a. Ouvrages à
confulter pour connoître plus particulièrement la théorie du
gouvernail & de fes effets. Explication fimple de l’effet du
gouvernail, voye[ fur cela CENTRE fpontané de rotation. Le
problème des mouvemens du vaiffeau 8c du gouvernail peut
être réduit à la queftion fuivante : E ta nt donnés deux corps
vn is ehfemble pa r une efpece de charnière ( tels que le vaiffeau
& le gouvernail ) ,6* fuppofant une puiffance donnée , appliquée
à un point donné d'un de ces corps , trouver le mouvement qui en
doit réfulter. Recherche des moyens de réfoudre le problème.
Ibid. b. Solution générale. Le rapport des mouvemens du gouvernail
à celui du vaiffeau , eil un des problèmes les plus délicats
de la dynamique. C e problème eft de la même nature que
celui des rames. Ibid. 783. a. Voye{ ce mot.
Gouvernail. Barre du gouvernail. II. 9 1. b. Gouvernail des
Vaiffeaux chinois, X V I . 806. b. 807. a. du vaiffeau des A rgo nautes.
808. b. Figure du gouvernail employée iÿmbolique-
ment. X V . 728. b.
G o u v e r n a i l , (Hydrauliq. ) queue d’un m oulin, ou machine
hydrauliquè, & c .V U .783.a .
G O U V E R N A N C E , (Ju r i/p r .) titre que l’on donne à
plufieurs bailliages d’Artois 8c de Flandres. Sous les anciens
comtes d’A r tois , on appelloit bailliage, ce qui fut dans la fuite
nommé gouvernance ; mais cela ne différait que du nom.
A&uellement les uns ne différent des autres que par rapport
à leur reffort. V I I . 783. a.
G O U V E R N A N T E d'enfans. ( Econom. Morale ) Les im-
preflions qu’un enfant reçoit de la gouvernante , font plus
importantes qu’on ne croit. L e premier fentiment qu’il éprouve
dès qu’il eft né , eft celui de la douleur : il la manifefte par
des larmes. Ces larmes lui attirent les careffes de fa nourrice.
Pour les obtenir dans la fuite , il répandra des larmes fans
beioin ni douleur. Ses caprices augmenteront ; il exigera
l’impoflible : il n’a pat» vécu deux ans, 8c voilà plufieurs défauts
acquis. La gouvernante , après la nourrice, fuivra la
même conduite ; 8c au lieu de prendre de l ’afcendant fur
l u i , elle va commencer par lui en laiffer prendre fur elle.
Quand fon eiprit fe d é ve lopp e, il conviendrait de ne lui
offrir que des objets capables de lui donner des idées juftes,
des fentimens louables; il fernble qu’on fe propofe tout le
contraire : on flatte fa gourmandife ; on excite fa vanité, on
le jette dansl’erreur ; VU . 783. b. on nourrit en lui la méchanceté
, la défobéiffance , le caprice. A l’égard des principes
qu’on croit lui donner , quelle impreifron veut-on qu’ils
faffent fur lu i , quand tout contribue à les détruire ? Abandonné
au dérèglement de fes goûts 8c au défordre de fes id é e s ,
il s’é lèvera lui-même le plus doucement 8c le plus mal qu’il
lui fera poflible ; ainft fe pafferont les fept premières années
de fr vie. Confié enfuite à des hommes, on retranchera peut-
être la fuperficie de fes mauvaifes habitudes'; mais les racines
refteronr. O n s’imagine qu’il ne faut point contraindre les
enfans dans leurs premières années. Ibid. 784. a. On fe flatte
de les p lier quand ils feront faits. La chofe n’eft-ellepas plus
facile pendant qu’ils font foibles ? Les défauts d’un enfant à
l ’âge de fept ans , durent prefque toujours pendant toute la
vie. Un enfant élevé dans la loumiffron eft mille fois plus
heureux qu’un enfant gâté ; il eft plus robufte,’ 8c il a la tête
plus 'faine. Exhortation adreffée aux parens, 8c particulièrement
aux peres : comment un pere doit travailler à corriger
l ’exceffive tendreffe d’une mere trop foible. Ib id. b. Choix
d’une nourrice de bon fens. Maniéré de gouverner un enfant
par rapport au ipora l, lorfqu’il devient malade. Comment
on doit fe conduire à l’égard de fes pleurs. Les premières
volontés d’un enfant font foib le s; lorfqu’elles deviennent
fortes , c eft une preuve que la nourrice l’a. gâté. D è s qu’e lle
ne fera plus néceffaire , qu’elle foit écartée. Le premier jour
il répandra des larmes: maniéré prudente dont on y doit'
répondre. L e fécond jour 8c les fuivans • on mettra Ta patience
a une pins longue épreuve : on obfervera de ne le carefler
que lorfqn ,1 fera tranquille : c’eft ainf. qu’il prendra enfin le
f» r a d* fe rendre doux. U id . 7 8 5 . . . Attention à prévenir
en lui les moindres germes de v ic e s , à fe mettre à fa portée ,
à tenir auprès de lui une conduite foutenue.Avec beaucoup
de fermeté dans la conduite, ayez de l’égalité dans l’humeur ,
de la gaieté dans v os le çon s , de la douceurdans vos difeours.
Si vous voulez l’inftruire avec fru it , faites-le dans le particu
lie r , quand fon ame eft tranquille 8c fon efprit recueilli.
Premières femences de piété à jetter dans fon ame. Maniéré
de lui inculquer fes devoirs envers fes parens. Le premier
fentiment qu’on doit exiger d’un enfant, ce n’eft pas fon
amitié, c ’eft fon refpeâ. Q u e fes parens viennent rarement
le trouver , ou reftent peu avec lui. Ibid. b. Q u ’ils aient l’air
plutôt de venir pour s’informer de fa conduite, que pour le
carefler. Q u e tous les jours l’enfant aille rendre à fes parens ce
qui leur eft du. S’il a mécontenté, qu’il fe préfente également
; mais qu’il foit refùfé. S’il eft touché de fa frute g ne
joignez point d’autre peine à cette punition ; au contraire ,
il faut le confolèr. S’il n’eft pas fenfible à cette difgrace ,
joignez-y les autres peines capables de la lui faire fentir. Importance
d’accoutumer de bonne heure les enfans à l’obéif-
lance. Moyens de prévenir l’orgueil dans leur coeur , 8c de
les exciter à la libéralité 8c à la bienfaifance. Ibid. 786. a.
Ufage qu’un enfant doit faire de l’argent qu’on lui donne.
Dangereufes louanges qu’on donne ordinairement aux enfans.
Obfervations fur ce qu’il faut louer devant eux 8c en eux.
Attention fur les perfonnés qui approchent un enfant. Ne le
laiffez jamais entre les mains des v a le ts , ou d’autres gens
groifiers ; qu’il ne foit point dans le fa llon , lorfqu’il y aura
beaucoup de monde. I l fera des fautes ; mais fi vous êtes
attentif , il en fera peu. Les enfans ne font prefque jamais
puniflables , qu’il n’y ait plus de la faute de ceux qui les gouvernent
, que de la leur. Èfpeces de fautes fur lefquelles il ne
faut point punir un enfant, mais feulement l’avertir. Ibid. b<
Quelles font les fautes puniflables. Il faut confidérer les
fautes d’un enfant, moins par ce qu’elles fo n t , que par leur
principe , 8c par les fuites qu’elles peuvent avoir. Comment
il faut punir les fautes légères. Punition des grandes. Maniéré
prudente d’amener le pardon. Quelles en devront être les
fuites. Cas uniques auxquels devra être réfervé l’ufage des
verges. Il ferait à fo.uhaiter que ce châtiment fut infligé fans
humeur. Ibid. 781. a. Abus ordinaire qu’on en fait. Le s coups
font un châtiment d’e fc la v e , 8c votre élev e doit être un
enfant bien né. Maniéré de nourrir en lui des principes d’honneur.
A mefure que vous y verrez croître les femences pré-
cieufes que vous y aurez verfées , cultivez-les par les mêmes
moyens que Vous les aurez fait naître. Détails fur ces
moyens. Quand l’enfant fera près de fortir de vos mains ,
ne vous relâchez en rien de .vos foins , ni de votre attention.
C ’eft une chofe aufli déraifonnable qu’ordinaire, de préparer
un enfant par plus d’indépendance à un état plus fubordonné.
Ibid. b.
G OU V E RN EM EN T. ( H ijl. nat. & p o lit .) Maniéré dont la
fouveraineté s’exerce dans chaque état.
Origine dèï gouvernement. Dans les premiers tems , un pere
étoit le prince 8c le gouverneur né de fes enfans. Il étoir
difficile aux enfans devenus hommes faits, de ne pas continuer
à leur pere l’autorité de ce gouvernement naturel par
un confentement tacite. Les enfans ne pouvoient trouver
ailleurs une plus grande sûreté pour leur p a ix , leur liberté ,
leur bonheur. Comme les peres laiffoient ordinairement des
héritiers dignes de leur fuccéd er, ils jettoient par-là les fon-
demens des royaumes héréditaires ou éleâirs. Si diverfe9
familles convenoient de s’unir en foc ié té , il n’eft pas douteux
qu’elles ne choififfcnt entr’elles un ch e f capable de les
gouverner. VII.- 788. a. A in f i , tout peuple doit fon conv-
mencement à quelques familles affociées. I l fuit de-là que
toute nation doit avoir confervé , pendant quelque tems ,
la forme de gouvernement paternel. Celles qui font reftées
les moins nombreufes, ont confervé cette forme. Les autres
ont établi celles qui convenoient le mieux à leur génie, à
leur nombre, à leur pofition. T o u s les gouvernemens publics
femblent avoir été formés par délibération ,p a r confultation,
8c par accord. Exemples de quelques nations d’Amériqu»
fans gouvernement. Confédérations qui ont engagé la plupart
des peuples à fe foumettre à un gouvernement. Ibid. b. Origine
des.loix. La principale de ces loix fut que chacun poffé-
aeroit en sûreté ce qui lui appartenoit en propre. Cette loi eft
de droit naturel. L e pouvoir le plus âbfolu n’eft pas même
arbitraire fur cet article. Les conquêtes ne fauroient être
l’origine 8t le fondement des gouvernemens. Origine de la
démocratie , de l’ariftocratie , de la monarchie. Monarchie
diftinguée en héréditaire 8c éle&ive. Origine des gouvernemens
mixtes/'Ce pouvoir fouverain retourne toujours au
peuple dont il eft émané. Ibid. 789. a. I l en peut enfuite dif-
pofer comme il lui plaît. Quelques-uns prétendent que les
hommes ne peuvent changer le 'gouvernement fous lequel
ils font nés : ce qui eft contraire au droit naturel. Jamais
les hommes n’ont regardé aucune fujétion dans laquelle ils
font nés , comme un lien qui les oblige fans-leur confentement.
Multitude de petites fociétés formées par les émigrations.
G O U
tîons. Un enfant ne naît fujet d’aucun pays ni d’aucun gouvernement.
A l’âge de raifon , il eft homme libre. L e confentement
qui le foumet à quelque gouvernement, eft
exprès ou tacite : eftets qui en réfultent. Les gouvernemens
quels qu’ils foient , font légitimes dès qu’ils font fondés fur
l’acquiefcement des peuples , 8c qu’ils tendent au bonheur
des fttjets. Ibid. b. Examen de cette queftion : quelle eft la .
meilleure forme de gouvernement. Il n’en eft aucune de
parfaite, 8c le meilleur fe détruira, tant que ce feront des
hommes qui gouverneront des hommeà. En général, le meilleur
confifte dans un tempérament propre à réprimer la
licence , fans dégénérer en oppreflion. Lycurgue crut devoir
faire entrer les trois différentes fortes de gouvernemens dans
celui de fa patrie , 8c forma ainfi la république qui a éu le
plus de confiftance 8c de durée. Eloge de celui d’Angleterre.
.Toute forme d’adminiftration ne convient pas égalemènt à
tous les peuples. La première fin d’un gouvernement eft le
'bien général de la nation. Ibid. 790. a. Utilité des recherches
des philofophes fur cette matière. Réflexions fur les vices
d ’un gouvernement. C e feroient des défauts, fi les loLx 8c les
coutumes d’un état n’étoient pas conformes au naturel du
peuple , ou aux qualités du pays ; fi la conftitution des loix
fondamentales n’étoit avantageufe qu’aux grands ; fi elle ten-
doic à rendre l’expédition des affaires lente 8c difficile ; 8c fi
l’on venoit à colorer ces défauts du prétexte d e là religion ,
les effets en feroient encore plus funeftes. Le plus grand
bien du peuple , c’eft fa liberté ; la liberté eft au corps de
l ’é t a t , ce que la famé eft au corps de l’individu. La défenfe
d e la liberté du peuple eft le plus facré des devoirs d’un gouverneu
r patriote. Ibid. b. Enfuite, il doit travailler à prévenir
toutes les triftes caufes de la diflolution des gouvernemens.
C e s caufes fo n t , i° . l’altération de la puiffance légifiative ;
a ° . lorfque celui qui a la puiffance fuprême 8c exécutoire,
abandonne fon emploi, de maniéré que les loix déjà faites ,
ne puiffent être mifes en exécution; 30. lorfque la puiffance
légiflatrice ou exécutrice agiffent par la force , au-delà de
l ’autorité qui leur a été commife;4°. lorfqu’uneforce étrangère
v ien t le renverfer. Ibid. 79 1 . a. I l faut convenir enfin qu’il n’y
a point de Habilité abfolue dans l’humanité. Les gouvernemens
les plus fages portent en eux le principe de leur deftru-
étion. L a leule voie d’en prolonger la durée eft de les ramener,
à chaque occafion favorable, aux principes fur lefquels ils ont
¿ té fondés. Ibid. b.
Gouvernement^ Rapports 'S i différences entre le gouvernement
de la famille 8c celui de l’état. I. 370. b. V . 337. b.
D iftinôion entre le gouvernement 8c la fouveraineté. V .
338. a. L e gouvernement appartient effentiellement au peuple.
I. 899. a. Réflexions fur l’adminiftration. IX . 360. b. & c .
Principaux objets que les gouvernemens doivent fe propofer.
76 6. a . Réflexions fur les trois principales efpeces de gouvernemens
: analyfe de ce que Y efprit des lo ix renferme fur ce
fujet. V . viij. b\ note. Mobiles des trois gouvernemens , félon
M . de Montefqüieu.*XI. 383. b. Raifons qui engagent à établir
, dans l’é ta t , un corps intermédiaire entre le fouverain
• & les fuje ts, auquel le gouvernement eft confié. X V I I . 861.
a . Maximes de Grotius fur l’origine 8c le but des gouvernemens.
Ibid. b. 862. a. Obfervations fur celles de Hobbes.
863. a ,b . L’expérience prouve que plus l’adminiftration générale
fe divife , plus elle s’affoiblit, 8c moins l’état eft bien
gouverné. 864. b. Origine de nos gouvernemens modernes.
X IV . 143. b. Epoque de leur amélioration. 144. a , b. Us ne
tirent leur force que de l’équité des loix. Ibid. b. Expofition
hiftorique des divers gouvernemens qui ont fucceflivement
paru , 8c des divers moyens qui ont été employés pour
conduire les nations. X I. 367. a .— 383. b. Un gouvernement
parfait n’exifte point encore. XIII. 94- a% Forme de gouvernement
la plus favorable à la liberté. 357* Maximes que
doit fuivre le gouvernement ; i° . obéir à la volonté générale ;
V . 339. b. 20. faire aimer la vertu ; 340. b. 30. pourvoir aux
befoins publics. 344. a. O n t ro u v e , dans l’étude bien approfondie
des finances, le principe, l’objet 8c le moyen des
opérations les plus intéreffantes du gouvernement > -fr-
nances. Maximes du gouvernement économique. V II. 826.
a , b. Sciences 8c arts particulièrement cultivés dans chaque
efpece de gouvernement. I. xxxiij, D i f c . prélim. Soins que le
gouvernement devroit prendre , d’éloigner tout ce qui peut
. corrompre le goût de la nation, 8c de favorifer tout ce qui peut
l e perfe&ionner. Suppl. I. 590. b. «roi. a. Influence des divers
gouvernemens fur les maniérés. X . 35. b. Caufes de la corruption
des gouvernemens. IX . 7^4- b. Cara&eres des diffé-
rens ordres d’une nation gâtée par une mauvaifé adminiftra-
tion & par l’abus (lu luxe. 768. a. Ca raâere d’un peuple chez
leque l le luxe eft maintenu dans l’ordre par un gouvernement
fage 8c vigoureux. Ibid. b. Vices dans les gouvernemens qui
éloignent l’abondance. Suppl. I. 31. b. Ufurpation du gouyer-
àiement. X V II. 5 5 5 .^ , . ,
G O U V E RN E R . (G ram m .) C e font les mots indéterminés
qui gouvernent ou régiffent les mots déterminans. C e mot de
gouverner eft une métaphore prife de ce qui fe pafle dans la
Tome I ,
G O U 853
v ie civile. Un grand gouverne fes domelHques ! ceux-ci portent
fa hvrée. V i l . 7 9 ,. j . u feroit à foui’ iter .fln £
palier de ces expreffions figurées & toujours un peu énigmatiques.
O n pouvoir du moins éviter l’emploi abufif du mot
gouverner, & des mots rêSir & rigimc, en fe fervant, au lieu
de ce dernier, du m ot compliment. t t id .7 q i .a . V o y a l’article
REGIME p i
G O U V E R N E U R d'une p la c e de guerre. (A r t milit. ) Outre
ce gouverneur, il y a , dans les villes importantes, un officier
général qui a le commandement des troupes. But de fon infti-
tntion. Par qui elle fut imaginée. En quel tems elle eut lieu.
Traité à confulter. V IL 792. a.
G o u v e r n e u r d'un jeune homme. ( M o ra le ) Objet du gouverneur.
V I I . 792. a. A l’âge auquel le jeune homme lui eft
fournis, l’éducation n’eft plus une affaire d’autorité , mais
d’infinuation 8c de raifon. Il faut dans le gouverneur des
reffourcejs, de l’art , de l’expérience. Si l’éducation a été
mauvaifé, il ne faut pas fe flatter de la réparer en en t ie r ;
on développera les talens , on palliera les défauts, on fau-
vera le fond par la fuperficie. Abus où tombent les parens
par rapport aux gouverneurs. Q u e le gouverneur foit d’un
âge mûr ; qu’il n’ait point de difgrace dans l’extérieur 8c dans
la figure ; qu’il a it'vécu dans le monde 8c qu’il le connoiffe ;
qu’il ne foit pas cependant trop homme du monde; qu’il
ait moins de bel efprit qu’un bon efprit; Ibid. b. qu’il ait une
idée de la plupart des connoiffances que fon éleve doit acquérir.
O n appuiera d’autant plus ces obfervations, que le jeun e
homme aura plus d’efprit naturel 8c de lumières acquifes. C e
qui eft néceflaire au gouverneur avec tous les jeunes gens ,
c’eft une ame fe rm e , des moeurs douces , une humeur égale.
Il faudrait encore qu’il eût déjà fait une éducation ; il y aurait
acquis des lumières auxquelles l’efprit ne fupplée point.'
Entre un militaire 8c un homme de lettres, celui-ci ferait
préférable, comme aufli plus facile à trouver. Talens qui
rendraient un militaire plus propre que tout autre à frire
l’éducation d’un homme de qualité. Ibid. 793. a. Néceflité de
faire par foi-même lç choix de l’homme dont on a befoin.
T o u t important qu’eft pour vous cet o b jet, prefque perfonne
ne fe fera fcrupule de vous tromper. Examinez par vos y e u x
tout ce que vous pourrez v o ir ; 8c du re fte , ne vous e a
rapportez qu’à des gens qui foient effentiellement vos amis ,
8c amis éclairés. Si le gouverneur que vous avez en vu e , a
déjà frit une éducation, vous aurez un grand avantage pour
le connoître. Plus un gouverneur eft un homme rare , plus
on lui doit d’égards 8c de confiance. Ne contrariez fes vues ,
ni par une tendreffe mal entendue , ni par l’opinion que vou»
a v ez de vo s lumières. Ibid. b. C e n’eft pas que vous deviez
perdre de vu e vo tre enfant : cette conduite feroit imprudente
, 8c répugnerait à votre tendreffe. . . Ne raifonnez point
de lui avec le jeun e homme, fi ce n’eft pour le faire reijje-
éter ; mais raifonnez beaucoup du jeune homme avec lui. Si
celui que vous avez pris fe trouve un peu inférieur à l’idée
qu’on vous en avoit donnée , traitez-le cependant comme fi
vous le jugiez homme fupérieur. Confeils au gouverneur. I l
faut qu’il connoiffe l’état qu’il v a prendre, 8c qu’il confulte
fes forces ; qu’il connoiffe le caraftere des parens, 8c iufqu’à
quel point ils font capables de raifon. Q a y ie u t réduire à
trois daffes le caraftere des jeunes g en s lW s uns font nés
doux 8c n’ont point été gâtés par une mauvaifé éducation ;
d’autres, doux en apparence, ne font rien moins que dociles
; d’autres, enfin, ont l’imagination v iv e 8c les paifions
impétueufes. Maniéré de fe conduire à l’égard des uns 8c
des autres. Ibid. 794. a. D è sq u e votre éleve vous fera remis ,
travaillez à établir vo tre autorité. Débutez avec la plus
grande politeffe ; mais que votre politeffe foit impofante.
S’il vient à vous manquer, qu’il foit puni févérement. A
l’âge où je fuppofe le jeune homme , il n’y a point de cata-
fteres indomptables, Lorfque yotre empire fera bien établi ,
fongez à vous faire aimer. C e n’eft pas l’autorité qui fait
obftacle à l’amitié, c’éft la maniéré dont on en ufe. Des que
les hommes que vous avez à gouverner font inftruits de
leurs devoirs, ne leur frites ni grâce, ni injuifice. Maniéré
de témoigner l’amitié. Q u e ce foit la loi oui ordonne les
punitions, 8c ne les exécutez qu’à regret. Elles feront ra re s ,
fi vous vous y êtes bien pris d’abord, 8c il importe qu elles
le foient. Ibid. b. Parlez-lui, s’il le fa u t , avec force ; jamais
avec impoliteffe. S’il eft v i f , *eprenez-le avec prudence. N e
foy ez point minutieux. Il y a des chofes graves fur lefquelles
vous ferez obligé de revenir fouvent ; tâchez de n’en avoir,
pas l’a i r . . . Moyens de diverfifier les le ço n s ;. . Abaiffez fa
hauteur, s’il en a ; mais n’humiliez pas fon amour p rop re,
fu r-tou t en p u b lic ... Méthode focratique à fuivre avec un
é le v e ... Fortifiez les principes qu’ il a ; donnez-lui ceux qui
lui manquent. Les premiers de tous 8c les plus négligés font
ceux de la religion. Ibid. 793. a. Q u e l fre in, cependant,
retiendra les grands, fi ce n’eft la religion ? Maniéré deJ imprimer
dans le coeur d’un jeune h omme ... Faites valoir à
fes y eu x les moindres chofes que font pour lui fes parens ;
frites envifrger à vo tre élev e qu’il fera pere un jour. Cum-
G G G G G g g g g g