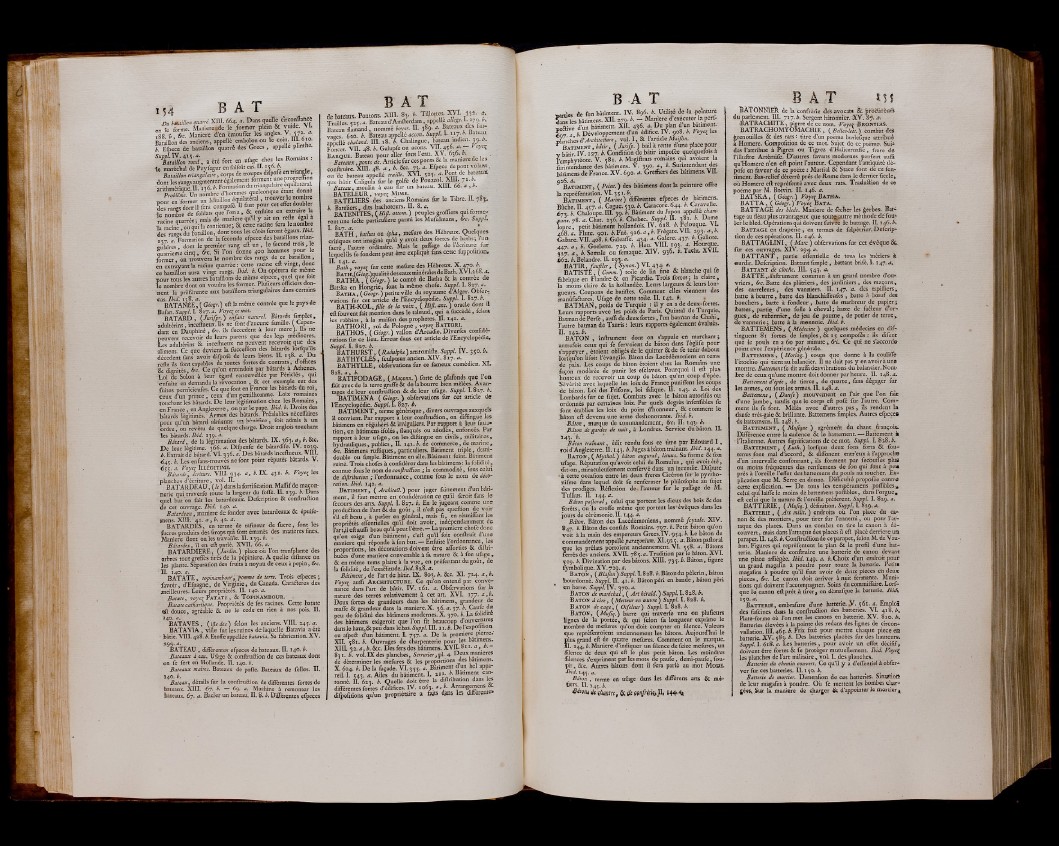
i54 BAT Du Maillon , narré. Xffl. 664-/- Dans quelle cttConttal.ce
on îe forme. Maniere»de le former plein & vuide. VI.
188 b , &c. Maniéré d’en èmouffer les angles. V. 57a. a.
Bataillon des anciens, appellè embolon ou le coin., 111. oïo.
b. Efpece de bataillon quarré des Grecs , appellé plrnth .
5“E iB o n ^ 'n d , a été fon en otage chez les Romains :
feu, pour ce, effet doubler
•le n 3 r e de foldats quel’ona, &. enfinte en extrare la
ractae quarrêe; mais de maniéré qu’.l y a,, un refte égd à
la racinl, ou qid la conuenne ; & cette racine fera le nombre
des ranes du iataiUon, dont tous les côtés feront égaux. lh,i.
, , , . formation de la fécondé efpcce des bataillons tnan-
utilaires , dont le premier rang eft un , le fécond trots, e
-quatrième cinq, ¡H Si l’on donne 400 hommes pour le
former on trouvera le nombre des rangs de ce bataillon,
en extrayant la racine quarrée : cette racine eft vingt, donc
ce bataillon aura vingt rangs. Ibid. b. On opérera de meme
pour tous les autres bataillons de même efpece, quel que toit
le nombre dont on voudra les former. Plufieurs officiers donnent
la préférence aux bataillons triangulaires dans certains
cas. Ibid. 138. a. .
BATANÉE, ( Géogr.) eft la même contrée que le pays de
Bafan. Suppl. I. 827. a. V c e mot.
BATARD, ( Jurifpr.) enfant naturel. Bâtards iimples,
adultérins, inceftueux. Ils né font d’aucune fomüle. f Cependant
en Dauphiné, &c. ils fuccedent à leur mere). Ils ne
•peuvent recevoir de leurs parens que des legs médiocres.
Les adultérins & inceftueux ne peuvent recevoiç que des
alimens. Ce que devient la fuccellion des bâtards lorfquils
décedent fans avoir difpofé de leurs biens. H. 138. a. Du
refte ils font capables de toutes fortes de contrats, doffaces
& dignités, &c. Ce qu’on entendoit par bâtards à Athènes.
Loi de Solon à leur éeard renouveUée par Périclès, oui
enfuite en demanda la révocation , & cet exemple eut des
fuites pernicieufes. Ce que font en France les bâtards du roi,
ceux oun prince, ceux d’un gentilhomme. Loix romaines
touchant les bâtards. De leur légitimation chez les Romains,
en France, en Angleterre, ou par le pape. Ibid. b. Droits des
bâtards légitimés. Armes des bâtards. Préalables néceflaires
pour qu’un bâtard obtienne un bénéfice, foit admis a un
ordre, ou revêtu de quelque charge. Droit anglois touchant
les bâtards. Ibid. 139. a. t ___ . '
Bâtard, de la légitimation des bâtards. IX. 363. at b.otc.
De leur légitime. 366. a. Difpenfe de bâtardife. IV. 1039.
b. Extrait de bâtard. VI. 336. a. Des bâtards inceftueux. VIII.
643. b. Les enfims-trouvés ne font point réputés bâtards. V.
6ç<. a. Voyez ILLÉGITIME.
Bâtarde, écriture. VIII. 934* a> t lX- 43 «• h- Voyel les
planches d’écriture, vol. II. ,
BATARDEAU, ( le ) dans la fortification. Maflif de maçonnerie
qui traverfe toute la largeur du foffé. II. 139 .b. Dans
quel but on fait les batardeaux. Defcription 8c conftruftion
cfe cet ouvrage. Ibid. 140. a.
Batardeau, maniéré de fonder avec batardeaux 6c épuife-
mens. XIII. 41. a , b. 40,. a. ^ ,
BATARDES, en terme de rafineur de fucre, iont les |
fucres produits des firops qui font émanés des matières fines. !
Maniéré Sont on les travaille. II. 130. b. .
Bâtardes, il en eft parlé. XVII. 66. a.-
BATARDIERE, ( Jardin.) place où l’on tranfplante des
arbres tout greffés tirés de la pépinière. A quelle diftance on
les plante. Séparation des fruits à noyau de ceux à pépin, &c.
II. 140. a. .
BATATE, topinambour9 pomme de terre. Trois efpeces ;
favoir, d’Efpagne, de Virginie, du Canada. Carâ&eres des
meilleures. Leurs propriétés. II. 140. a.
Batate , voyei Pa tate , & TOPINAMBOUR. .
Batate cathartique. Propriétés de fes racines. Cette batate
oft douce, agréable & ne le cede en rien à nos pois. II.
Z40. a. ,
BATAVES , ( ifle des ) félon les anciens. VIII. 245. a.
BATAVIA, ville fur les ruines de laquelle Batavia a été
• bâtie. VHI. 428. b. Etoffe appellée batavia. Sa fabrication. XV.
299. a.
BATEAU, différentes efpeces de bateaux. II. 140. b.
Bateaux à eau. Ufage & conftruâion de ces bateaux dont
on fe fert en Hollande. II. 140. b.
Bateaux maires. Bateaux de pofte. Bateaux de felles. II.
140. b.
Bateau, détails fur la conftruâion de différentes fortes de
bateaux. XIIL 67. b. — 69. a. Machine à remonter les
bateaux. 67. a. Bader un bateau, II. 8. b. Différentes efpeces
BAT
Eat«m flamand, nommé boy". II. 389-
vases. 6zo. b. Bateau appellé accon. Suppl. I. u S g | « l |
appellé chaland. III. 18. b. Chalmgue, Vjeau “ ichen.
Foncet. VII. 48. b. Galupie ou acons. Vn.436. <!.- Voyc^
Barque. Bateau pour aller fous 1 eau. XV. 636. ,. .
Bateaux, ponts de. Article fur ces ponts & la maniéré de les
conftruire. f i l . 48. * , b. 8tc. 7J. e. Efpece de H g B M | .
ou de bateau appellè "aille. X V I . « 5 . s
que bâtit Caligula fur le golfe de Pouzzol. X1U. 7 ;
Bateau, moulin à eau fur un bateau. XIII. 66. a 9b. ■
BA TE LEU R , voy<t Mime. .
BATELIERS des anciens Romains fur le Tibre. 11. 783.
b. Bateliers, dits bachoteurs. II. 8. a.
BATENITES, (-H1/- ottom. ) peuples greffiers qui formèrent
une Icéic particulière parmi les Mufulmans , Sec. Suppl.
— b Î t H bathns on ipha, mefure des Hébreux. Quelques
critiques ont ¡mariné qu’il y avoit deux fortes de baths; l’un
facré, l’autre ordinaire. Mais le paffage de 1 écriture fur
lequel üs fe fondent peut être expliqué fans cette fuppofiuon.
.B a h , noyer fur cette mefure des Hébreux. X. 470. B BATH.fGi'uc.'iqualitè des eaux minérales (le Baril. XV I.26S..1.
BATHA, < Géogr.) le comté de Batha & la contrée de
Batska en Hongrie, font la même chofe. Suppl. 1.817.U.
Ba th a , ( Géogr- ) petite ville du royaume d Alger. Lutter-,
varions fur cet article de l’Encyclopédie. Suppl. I. 827. b.
BATH-KOL, file de la voix, ( Hijl. anc. ) oracle dont tl
eft fouventfàit mention dans le talmud, qui a fuccédé, feloa
les rabbins, à la maifon des prophètes. IL 141. a.
BATHORI, roi de Pologne, voye[ B a t to r i .
BATHOS, ( Géogr. ) vallon d’Arcadie. Diverfes confidé-
rations fur ce lieu. Erreur dans cet article de l’Encyclopédie,
Suppl. I. 827. b. ’ •
BATHURST, ( Radulphe) anatomifte. Suppl. IV. 3 ço. b.
BATHYCLÈS, fculpteur ancien. XIV. 817. a.
BATHYLLE, obfervations fur ce fameux comédien. XI.
828. at b. ‘ «j.
BATIFODAGE, ( Maçonn. ) forte de plafonds que Ion
fait avec de la terre graffe & de la bourre bien mêlées. Avantages
de leur conftruâion & de leur ufage. Suppl. 1. 827. b.
BATIMENA ( Géogr. ) obfervations fur cet article de
l’Encyclopédie. Suppl. I. 827. b.
BATIMENT, terme générique, divers ouvrages auxquels
il convient. Par rapport à leur conftruftion, on diftingue les
bâtimens en réguliers & irréguliers. Par (rapport à leur fitua-
tion, en bâtimens ifolés, flanqués ou adoffés, enfoncés. Par
rapport à leur ufage, on les diftingue en civils, militaires,
hydrauliques, publics, II. 141. b.de commerce, de marine,
&c. Bâtimens ruftiques, particuliers« Bâtiment triple, demi-
double ou fimple. Bâtiment en aile. Bâtiment feint. Bâtiment
ruiné. Trois choies à confidérer dans les bâtimens: la foüdité,
connue fous le nom de confiruilion ,• la commodité , fous celui
de diftribution ; l’ordonnance, connue fous le nom de décoration.
Ibid. 142. a.
Bâtiment, ( ArchiteEl.') pour juger fainement d’un bâtiment
, il faut mettre en confidération ce qu’il feroit fans le
fecours des arts. Suppl. I. 827. b. En le jugeant comme une
production de l’art 8c du goût, il n’eft pas queftion de voir
s’il eft beau , à parler en général, mais fi, en réunifiant les
propriétés effentielles qu’il doit avoir, indépendamment de
l’artyileftaufii beau qu’il peut l’être.— La première chofe donc
qu’on exige d’un bâtiment, c’eft qu'il foit conftruit d une
maniéré qui réponde à fon but. —* Enfuite l’ordonnance, les
• proportions, les décorations doivent être afforties 8c diftri-
buées d’une maniéré convenable à fa nature 8c à fon ufage ,
8c en même tems plaire à la vue, en préfentant du goût, de
la foliditê, de l’exaftitude. Ibid. 828. a.
Bâtiment, de l’art de bâtir. IX. 803. b. 8cc. XI. 724. <*, b.
Voyci aufli A rchitecture. Ce qu’on entend par convenance
dans l’art de bâtir. IV. 161. a. Obfervations fur la
nature des terres relativement à cet art. XVI. 177. a,b.
Deux fortes de grandeurs dans les bâtimens, grandeur de
marie 8c grandeur dans la maniéré. X. 36. a. 37. b. Caufe du
peu de foliditê des bâtimens modernes. X. 370. b. La foliditê
des bâtimens exigeroit que l’on fît beaucoup d’ouvertures
dans le haut,8c peu dans le bas. Suppl. III. 11. b. De l’expofition,
ou afpeft d’un bâtiment. I. 757. a. De la première pierre.
XII. 581. A Ouvrages de charpenterie pour les bâtimens.
XIIL 32. a, b. 8cc. Des fers des bâtimens. XVII. 811 . a y b.—
831. b. vol. IX des planches, Serrurier, pl. 4- Deux maniérés
de déterminer les mefures & les proportions des bâtimens.
X. 604. b. De la façade. VI. 353. *. Bâtiment dun bel appareil.
I. 343. a. Ailes du bâtiment. I. ' c^n‘
tonné. H. 623. b. Quelle doit être la diftribution dans les
différentes fortes d’édifices. IV. io6y at b. Arrangemens &
difpofitions qu’un propriétaire a feits dans les différentes
BAT
S ü v e d’un bârimem. XII. 43«-/- Du plan d’un bâtiment,
éov a b Développement d’un édifice. IV. 908. b. Vtyeç les
I S S d g W i a M i vol. I , & l’article Maifon.
B â t im e n t , bâtir, ( Jurifi. ) bail à rente d’une place pour
V bâtir IV. 117. b. Condition de bâtir impofée quelquefois à
l’emphytêote. V. 581. b. Mag'tftrats romains qui avoient la
Îùrintendance des bâtimens. V. 390. 4, b. Surintendant_des
bâtimens dé France. XV. 690. a. Greffiers des bâtimens. VU.
^ Bâtiment, ( Peint. ) des bâtimens dont la peinture offre
la repréfentation. Vî. 3 31. A
Bâtiment, ( Marine) différentes efpeces de bâtimens.
Bûche. H. 457- a- CaSue- b- Caracore. 644. g Cflr.av®Ue-
6-7X. b. Chaloupe.III. 39. b. Bâtiment du Japon appellé cham-
paLyZ. a. Chat. 236. A Chebec. Suppl. H. |8|| b. Dame
lopre, petit bâtiment hollandois.IV. 618. ¿.Felouque. VI.
468. a. Flute. 901. b.Fné. 926. a , Frégate.VIL 29^. <i,¿.
Gabare.VII.408.b.Galeafle. 434- ^-Galere. 437. Galiote.
447. a , b. Goelette. 729. b. Heu. VIII. 193. a. Hourmie.
g27. a, b. Semale ou femaque. XIV. 936. b. Yacht. XVII.
662. b. Belandre. II. 193* a‘
BATIR, fcufler, ( Synon.) VI. 434- .
BATISTE, ( Comm. ) toile de lin fine 8c blanche qui fé
Fabrique en Flandre 8c en Picardie.Trois fortes; la claire,
la moins claire 8c la hollandée. Leurs largeurs & leurs lon^
gueurs. Coupons de batiftes. Comment elles viennent des
manüfaâures. Ufage de cette toile. II. 142. b. ♦
BATMAN, poids de Turquie : il y en a de deux.fortes.
Leurs rapports avec les poids de Paris. Qüintal de Turquie»
Batman de Perfe, aufii de deux fortes, l’un batman de Chahi,
l ’autre batman de Tauris : leurs rapports également évalués.
IL 142. b. . 1 1
BATON , infiniment dont on s appuie en marchant;
'autrefois ceux qui fe fervoient de bâton dans léglife pour
s’appuyer, étoient obligés de le quitter 8c de fe tenir debout
ïorfqu on lifoit l’évangile. Bâton des Lacédémoniens en tems
de paix. Les coups de bâton étoient chez les Romains une
façon modérée de punir les efclaves. Pourquoi il eft plus
honteux de recevoir un coup de bâton qu’un coup dépée.
"Sévérité avec laquelle les loix de France ¿unifient les coups
de bâton. Loi des Friions, loi falique. 11. 143. a. Loi des
Lombards fur ce fujet. Combats avec le bâton autorifés ou
ordonnés par certaines loix. Par quels degrés infenfibles fe
font établies les loix du point d’nonneur, 8c comment le
Jbâton eft devenu une arme deshonorante. Ibid. b.
Bâton, marque de commandement, &c. II. 143. b.
Bâton de gardes de nuit9 à Londres. Service du bâton. IL
143. b.
Bâton traînant, ¿dit rendu fous ce titre par Edouard I ,
toi d’Angleterre. II. 143. b. Juges à bâton traînant. Ibid. 144. a.
B â to n , ( Mythol.') bâton augurai, lituus. Sa forme & fon
tifage. Réputation qu’avoit celui de Romulus , qui avoit été,
dit-on, miraculeùfement confervé dans un incendie. Difpute
* à cette occafion entre les deux fferes Cicéron fur le pyrrho-
nifme dans lequel doit fe renfermer le philofophe au fujet
des prodiges. Réflexion de. l’auteur fur le pauage de M.
Tullius. fi. 144. a.
Bâton paftoral, celui que portent les dieux des bois 8c des
•forêts, ou la croffe même que portent les*évêques dans les
jours de cérémonie. H. 144. a.
Bâton. Bâton des Lacédémoniens, nommb fcytale. XIV.
847. b. Bâton des confüls Roidains. 797. b. Petit bâton qu’on
voit à la main des empereurs Grecs. IV. 934. b. Le bâton de
commandement appelle paraçonium. XI. 92 3. a. Bâton paftoral
que les prélats portoient ancienneritent. VI. 358. ^. Bâtons
ferrés des anciens. XVII. 783.it. Tradition par le bâton. XVI.
309. b. Divination par des bâtons. XIII. 73 3 .b. Bâton, figure
fymbolique. XV. 729. a.
B â to n , ( Blafonj Suppl. L 828. b. Bâton du pèlerin, bâton
Bourdonné. Suppl. II. 41. b. Bâton péri en bande, bâton péri
en barre. Suppl. IV. 37O. a.
B â to n de maréchal, ( Art herald.} Suppl. 1. 828. b.
B â to n â cire , ( Metteur en oeuvre ) Suppl. ï. 828. b,
BATON de cage, f Oïfeleur) Suppl. I. 828. b.
B â to n , (Mufiq.) barre qui traverfe une ou plufieurs
lignes de la portée, 8c qui félon fa longueur exprime le
nombre de mefures qu’on doit compter en filence. Valeurs
que repréfentoient anciennement les bâtons. Aujourd’hui le
dus grand eft de quatre mefures. Comment on le marque,
il. 144. b. Maniéré, d’indiquer un filence de feize mefures, un
filence de deux qui eft le plus petit bâton. Les moindres
filences s’expriment par les mots de paufe, demi-paufe, fou-
pir, Stc. Autres bâtons dont il fera parlé au mot Mode.
Ibid. 14e. a.
' Bâton , terme eil ufage dans les différons arts 8c mé-
6ers.lL 143.4.
Bâtons de t/wntre, & Ç9nfrif\itJU 144* %
fi
B A T }M
BÂTONNIER de la confrérie des avocats & pfôêtirèuri
du parlement. III. 717. b. Sergent bâtonhî'er. XV. S f a-.
BATRACHITE, pierre de ce nom. Voyez B ront ias .
BATRACHOMYOMACHIE, ( BclUs-lett».) combat dès
grenouilles 8c des rats : titre d’un poème burlcfque attribué
à Homere. Compofition de ce mot. Sujet de ce poëme. Suidas
l ’attribue à Pigrez ou Tigrez d’Halicarnafie, frere de
l’illuftre Artémife. D’autres favans modernes penfent aufli
qu’Homere n’en eft point l’auteur. Cependant l’antiquité <lè-
pofe en faveur de ce poète : Martial 8c Stace font de ce fen-
riment. Bas-relief déterré près de Rome dans le dernier fiecle*
où Homere eft représenté avec deux rats. Tradu&ion de ce
poëme par M. Boivin. II. 146. a.
BATSKA, {Géogr.) VoyezBATHA-.
•BATTA, ( Géogr. ) Voye[ B a t a .
BATTAGE des bleds. Maniéré de lécher les gerbes. Battage
au fléau plus avantageux que tout&jautre méthode dé'fou^
1er le bled-. Opérations qui doivent fuivro le battage. II. 146. b-.
B a t t ag e en draperie, en termes de falpétrier. Defcrip-
tion de ces opérations. IL 446. b.
BATTAGLINI, {Marc) obfervations fur cet évêque 8ç,
fur ces ouvrages. XTV". 294. a.
B A T TAN T , partie eflentielle de tous les hiériers à
eurdir. Defcription. Battant fimple , battant brifé.l. 14y. a.
B a t t a n t de cloche. III. 343. a.
BATTE ,.infiniment commun à un grand nombre d’ou*
vriers, &c. Batte des plâtriers, des jardiniers, des maçons »
des carreleurs, des vanniers. II. 147. *. des tapifliers,
batte à beurre, batte des blanchiffeufes, batte à boeuf des
bouchers, batte à fondeur, batte de marbreur de papier ;
battes, parti^ d’une felle à cheval ; batte de fafteur d’orgues,
de rubannier, de jeu de paume, de potier de terre ,
de vannerie ; batte à la monnoie. Ibid. b.
BATTEMENS , ( Médecine ) quelques médecins en distinguent
81 fortes de fimples,oci3 compofés ; ils difent
que le pouls en a 60 par minute, &c. Ce qui ne s’accorde
point avec l’expérience générale.
BattemeNs , ( Horlog. ) coups que donne à la coulifle
l ’étochio qui’ tient au balancier. Il ne doit pas y en avoir à une
montre. Battement fe dit aufli des vibrations du balancier. Nombre
de ceux qu’une montre doit donner par heure. II. 148. a.
Battement d’épée 9 de tierce, de quarte, fans dégager fur
les armes, ou fous les armes. II. 148. a.
Battemens, {Danfe) mouvement en l’air.qüè l’on fait
d’une jambe, tandis que le corps eft pofé fur l’autre. Comment
üs fe font. Mêlés avec d’autres pas, ils rendent la
dànfe très-gaie & brûlante. Battemens fimples. Autres efpece#
de battemens. II. z48. b.
Battement , ( Mufique .) agrémefit du chaut François»
Différence entre la cadence & le battement. — Battement à
• l’Italienne. Autres fignifications de Ce mot. SuppL I. 828. b.
Battement, {Luth.) lorfqué deux fons forts & fou-
tenus font mal d’accord, 8c tüflbnent entr’eux à l’approclns
d’un intervalle conformant, üs forment par fecOufies plu#
ou moins fréquentes des renflemens de fon qui font à ne»
près à l’oroÜle l’effet des battemens du pouls au toucher. Explication
que M. Serre en donne. Difficulté propofée contre
cette explication. — De tous les tempéramens poflibles *
celui qui laiffe le moins dé battemens poflibles, dans l’orgue,
eft celui que la nature 8c l’oreille préfèrent. Suppl. I. 829. a.
BATTERIE, ( Mufiq. ) définition» Suppl. 1. 029. a.
B a t t er ie , {Art milit.) endroits où l’on place du canon
8c des mortiers, pour tirer fur l’ennemi, ou pour l’attaque
des places. Dans un combat on tire le canon à découvert
, mais dans l’attaque des places il eft placé derrière un
parapet. II. 148. b. Conftruftion de ce parapet, félon M.tie Vau-
ban. Figures qui reprêfentent le plan 8c le profil d’une batterie.
Maniéré de conftruire une batterie de canon devant
une place afliêgée» Ibid. 149. a. ¿.Choix d’un endroit pour
un grand magafin à poudre pour toute la batterie. Petits
magafins à poudre qu’ü faut avoir de deux pièces en deux
pièces, &c. Le canon doit arriver à nuit fermante. Munitions
qui doivent l’accompagner. Soins du commiflaire. Lorf-
que 1« canon eft prêt à tirer, on démafque la batterie. IbiA
^Bat t erie , embrafure d’une batterie. . 561. a. Emploi
des fafeines dans la conftruéHon des batteries. VL 418. ¿.
Plate-forme où l’on met les canons en batterie. XV. 810. ¿.
Batteries élevées à la pointe des redans des lignes de circonvallation.
III. 463. b. Prix fixé pour mettre chaque piece en
batterie. XV. 583» b. Des batteries placées fur des hauteurs*
Suppl. I. 618. a. Les batteries, pour avoir un effet décifif,
doivent être fortes 8c fe protéger mutuellement. Ibid* Voye£
les planches de l’art militaire, vol» I. des planches.
Batteries du chemin couvert. Ce qu’il y a d’effentiel à obfer*
Ver fur ces batteries. II. 130. b.
Batterie de mortier. Dimenfion de ces batteries. Sîtujftioft
de leur magafin à poudre. Où fe mettent les bombes char*
gé?ÿt .Su,r la manière de charger 8c d’appointer le mortier *