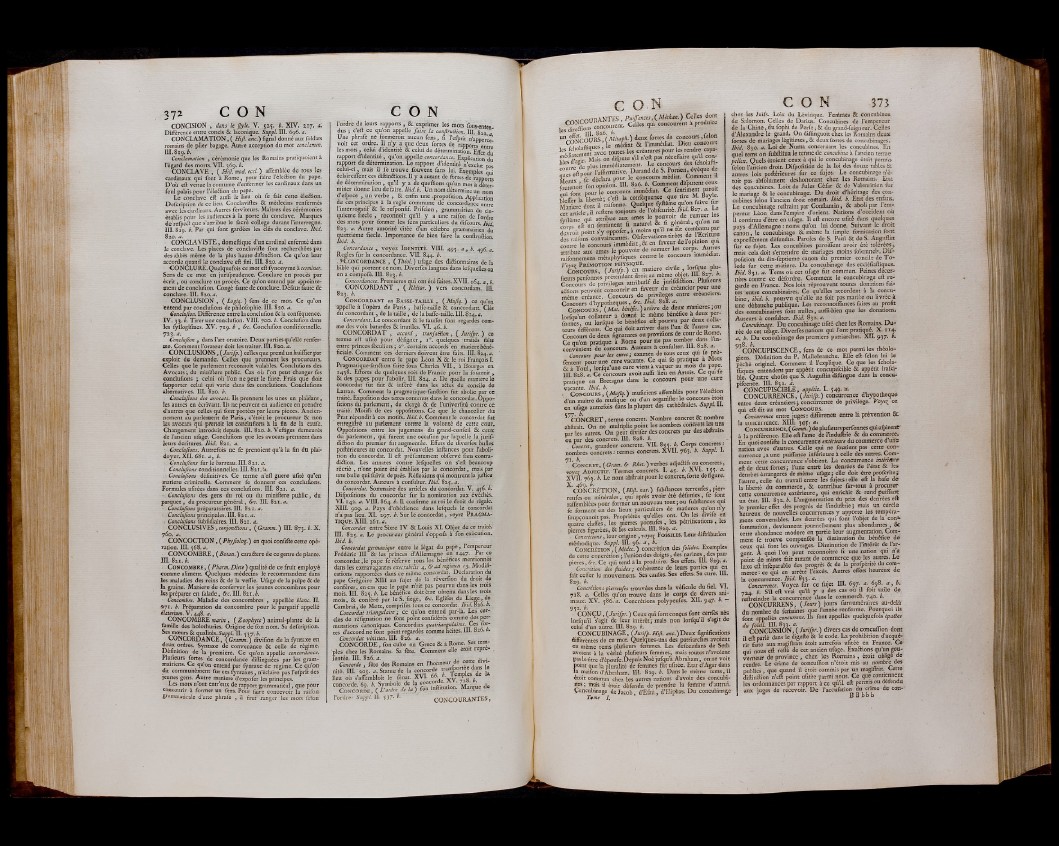
372 C O N
CONCISION , dans le ßyle. V. çaç. b. XIV. 217. d.
Différence entre concis 8c laconique. Suppl. HI. 696. a.
CONCLAMATION, ( Hiß. anc.) fignal donné aux foldats
romains de plier bagage. Autre acception du mot conclamen.
IIL81Q.*.
Conctamation , cérémonie que les Romains pratiquoicnt à
l’égard des morts. VII. 369. b.
CONCLAVE , ( Hiß. mod. tccl. ) affemblée de tous les
cardinaux qui font à Rome, pour faire l’éleétion du pape.
D’où eft venue la coutume d’enfermer les cardinaux dans un
feul palais pour l’éleétion du pape. x .
Le cônclave eft auffi le lieu ou fe fait Cette éleéhon.
Defcriptibn de ce lieu. Conclaviftes 8c médecins renfermés
avec les cardinaux. Autres ferviteurs. Maîtres des cérémonies
établis pour les audiences à la porte du conclave. Marques
de'reipeii que s’attribue le facré collège durant l’interregne.
III. 819. b. Par qui font gardées les clés du conclave. Ibid.
820. a.
• CONCLAVISTE, domeftique d’un cardinal enfermé dans
le conclave. Les places de condavifte font recherchées par
des abbés même de la plus haute diftinélion. Ce qu’on leur
accorde quand le conclave eft fini. III. 820. a.
CONCLURE. Quelquefois ce mot eft iynonyme à terminer.
Sens de ce mot en jurifprudence. Conclure en procès par
écrit, ou conclure un procès. Ce qu’on entend par appointe-
ment de conclufton. Congé faute de conclure. Défaut faute de
conclure. III. 820.1z.
CONCLUSION , ( Logiq. ) fens de ce mot. Ce qu’on
entend par condufions de philofophie. III. 820. a.
Conclufton. Différence entre la conclufton & la conféquence.
IV. 33. b. Tirer une conclufton. VIII. 700. b. Conclufton dans
les fyllogifmes. XV. 719. * , bc. Conclufton conditionnelle.
723. a.
Conclufton , dans l’art oratoire. Deuxparties qu’elle renferme.
Comment l’orateur doit les traiter. III. 820. a.
CONCLUSIONS, ( Jurifp.) celles que prend un huiftier par
exploit de demande. Celles que prennent les procureurs.
Celles que le parlement reconnoît valables. Concluftons des
Avocats; du miniftere public. Cas oh l'on peut'changer fes
concluftons ; celui 011 l’on ne peut le faire. Frais que doit
fupporter celui qui varie dans les concluftons. Concluftons
alternatives. I1L 820. b.
. Conclufions des avocats. Ils prennent les unes en plaidant,
les autres en écrivant. Us ne peuvent en audience en prendre
d’autres que celles qui font portées par leurs pièces. Anciennement
au parlement de Paris, c’étoit le procureur 8c non
les avocats qui pfenoit les concluftons à la fin de la caufe.
Changement introduit depuis. III. 820. b. Veftiges demeurés
de l’ancien ufage. Concluftons que les avocats prennent dans
leurs écritures. Ibid. 821. a.
■ Conclufions. Autrefois ne fe prenoient qu’à la fin du plaidoyer.
XII. 681. a, b.
■ Conclufions fur le barreau. III. 821. a.
. Conclufions conditionnelles. III. 821.‘a.
. ■ Conclufions définitives. Ce terme n’eft guere ufité qu’en
matière criminelle. Comment fe donnent ces conduirons.
Formules ufitées dans ces concluftons. III. 821. a.
■ Conclufions des gens du roi ou du miniftere public, du
parquet, du procureur général, bc. III. 821. a.
- Conclufions préparatoires. III. 821. a.
■ Conclufions principales. III. 821. a.
Conclufions fubftdiaires. IQ. 821 .a.
CONCLUSIVES, confondions, ( Gramm. ) IIÏ. 873.*. X.
760. a.
CONCOCTION, ( Pkyfiolog.) en quoi confifte cette opération.
III. 568. a.
• CONCOMBRE, ( Bot an. ) caraâere de ce genre de plante,
m . 821. b.
■ C o n com b re , ( Pharm. Dicte ) qualité de ce fruit employé
comme aliment. Quelques médecins le recommandent dans
les maladies des reins oc de la vefiie. Ufagc de la pulpe & de
la graine. Maniéré de conferver les jeunes concombres pour
les préparer en fa la d e&c. III. 821. b.
- Concombre. Maladie des concombres , appellée blanc. II.
271. b. Préparation du concombre pour le purgatif appellé
ilaterium. V. 448. a.
CONCOMBRE marin , ( Zoophyte ) animal-plante de la
famille des holothuries. Origine de fon nom. Sa defeription.
Ses moeurs & qualités.Suppl. II. 537. b.
CONCORDANCE, \Gramm. ) divifion de la iyntaxe en
tvS? Syntaxe de convenance 8c celle de régime.
Définition de la première. Ce qu’on appelle concordance.
Plufieurs fortes^ de concordance diftinguées par les grammairiens.
Ce qu’on entend par iyntaxe de régime. Ce qu’on
dit communément fur ces fyntaxes, n’éclaire pas l’eiprit des
jeunes gens. Autre maniéré d’expofer les principes.
Les mots n’ont entr’eux de rapport grammatical, que pour
concourir- à former un fens. Pour faire concevoir la rai fou <
grammaticale d’une phrafe , il finit ranger les mots feion'
C O N
l’ordre de leurs rapports, 8c exprimer les mots fous-enten-
dus ; c’eft ce qu’on appelle faire la conflruSion. III 822 *
Une phrafe ne formeroit aucun fens, fi l’efprit n’apperce-
voit cet ordre. Il n’y a que deux fortes de rapports entre
les mots, celui d’identité & celui de détermination. Effet du
rapport d’identité , qu’on appelle concordance. Explication du
rapport de détermination. Le rapport d’identité n’exclut pas
celui-ci, mais il fe trouve fouvent fans lui. Exemples oui
éclairciflent ces diftinâions. Il y a autant de fortes de rapports
de détermination , qu’il y a ,ae queftions qu’un mot à ^terminer
donne lieu de faire. Ibid. b. Un nom détermine un nom
d’efpece , un verbe , & enfin une .propofition. Application
de ces principes à la réglé commune de concordance entre
l’interrogatif & le refponfif. Prifcien , grammairien du cinquième
fiecle , reconnoît qu’il y a une raifon de l’ordre
des mots pour former les fens particuliers du difeours. Ibid.
823. a. Autre autorité citée d’un célébré grammairien du
quinzième fiecle. Importance de bien faire la conftrufiion.
Ibid. b.
Concordance , voyez I d e n t i t é . VIII. 495. a , b. 496. a.
Réglés fur la concordance. VII. 844. b.
. .''C o n c o rd an c e , ( Théol.) ufage des dictionnaires de la
bible qui portent ce nom. Diverfes langues dans lefquellesoa
en a compofé. III. 823. b.
Concordances. Premières qui ont été faites. XVII. 164. a b.
CONCORDANT , ( Rhitor. ) vers concordans. IIL
823. b.
C o n c o rd a n t ou B a s s e - ta ille , ( Mufiq. ) ce qu’on
appelle à l’opéra de Paris , baffe-taille & concordant. Clés
du concordant, de la taille, de la baffe-taille. III. 824. a.
Concordant. Le concordant 8c le fauffet font regardés comme
des voix bâtardes & inutiles. VI. 46. b.
CONCORDAT , accord , tranfaSion , ( Jurifpr. ) ce
terme eft ufité pour défigner, i°. quelques‘ traités faits
entre princes féculiers ; 20. certains accords en matière bénéficiai.
Comment ces derniers doivent être faits. III. 824. a.
CONCORDAT entre le pape Léon X & le roi François I.
Pragtaatique-iànétion faite fous Charles V I I , à Bourges en
1438. Efforts de quelques rois de France pour la foutenir ,
8c des papes pour l’abolir. III. 824. a. De quelle maniéré le
concordat fut fait 8c inféré dans les aâes du concile de
Latran. Comment la pragmatique-fanâion fut abolie par ce
traité. Expofition des titres contenus dans le concordat. Oppo-
fttions du parlement, du clergé & de l’univèrfité contre ce
traité. Motifs de ces oppofitions. Ce que le chancelier du
Prat répondit à ces motifs. Ibid. b. Comment le concordat fut
enregiftré au parlement contre la volonté de cette cour.
Oppofitions entre les jugemens du grand-confeil 8c ceux
du parlement, qui furent une occafion par laquelle la jurif-
diétion du premier fut augmentée. Effets de diverfes bulles
poftérieures au concordat. Nouvelles inftances pour l’abolition
du concordat. Il eft préfentement obfervé fans contradiction.
Les annates contre lefquelles on s’eft beaucoup
récrié , n’ont point été établies par le concordat, mais par
une bulle qui fuivit de près. Réflexions qui montrent la juftice
du concordat. Auteurs à confulter. Ibid. 825. a.
Concordat. Sommaire des articles du concordat V. 456. b.
Difpofitions du concordat fur la nomination aux évêchés.
VI. 142. a. VIO. 864. b. Il confirme au roi le droit de régale.
Xin. 909. a. Pays d’obédience dans lefquels le concordat
n’â pas lieu. XI. 297. b. Sur le concordat, voyez P ragm a t
iq u e . XIII. 261. a.
Concordat entre Sixte IV & Louis XI. Objet dé ce traité.'
IIÏ. 825. a. Le procureur général s’oppofa à fon exécution*
Ibid. b.
Concordat germanique entre le légat du pape, l’empereur
Frédéric M & les princes d’Allemagne en 1447- f ar
concordat,le pape fe réferve tous les bénéfices mentionnés
dans les extravagantes execrabilis 4, b od regimen 13. Modifications
rapportées dans ce même concordat. Déclaration du
pape Grégoire XIII au fujet de la réveriion du droit d*
conférer, en cas que le pape n’ait pas pourvu dans les trois
mois. III. 825. b. Le bénéfice doit être obtenu dans les trois
mois, & conféré par le S. fieçe, (rc. Eglifes de Licge, de
Cambrai, de Metz, comprifes fous ce concordat. Ibid. 826. b.
Concordat triangulaire ; ce qu?on entend par-là. Les cercles
de réfignation ne font point eonfidérés comme des permutations
canoniques. Concordats quatriangulaires. Ces fortes
d’accord ne font point regardés comme licites. III. 826. b.
Concordat vénitien. III. 826. a.
CONCORDE, fon culte en Grece 8c à Rome. Ses temples
chez les Romains. Sa fête. Comment elle étoit repr - .
Tentée. III. 826. a. , .. .
Concorde , fête des Romains en l’honneur
niré. III. aô5. „.Statuede la concorde £
lieu où s’affembioit neu ou sauemmoit liec fkéuna«t.. »X»V»I•. 6-6-., • w ,,P ß .
l’ordre.- Suppl. U. 537- l - CONCOURANTES,
C O.N
ewoCOURANTES, Puijfances. ( Michan. ) 'Celles dont
, « c o n c o u r e n t . Celles qui concourent a produite
les direction» . ^
“ "^SfrOURS f Mitaph.) deux fortes de concours,félon
Cr°J S taue s! h médiat & l’inunédiat. Dieu concourt
J«ëment avec toutes les créatures pour les rendre capa-
médiatemen ¿¡foute s’il n’eft pas nèceffaire quil con-
’ rt^e plus imméduîtement. i/concours des fcholaffi-
i S Î à â l’affirmative. Durand de S. Portien, évéque de
Ï Ï nv fe déclara pour le concours médiat. Comment il
Meaux , f P jlt. 826. b. Comment difputent ceux
iuTfont pour le concours immédiat. Ce fentiment paroit
Welfer la Liberté; c’eft la conféquence que tire M.éayle.
raifonnemens métaphyftques contre le concours immédiat.
Voy.7 P rém o t io n ph y siq u e . . , , 1
C o n c o u r s , (Jurifp.) en mauere cre''e .’ l7 5 u8eJ >1"
fleurs perfonnes prétendent
Concours de privilèges attributif de jurifdiétion. Flulieurs
affious^envent concourir en faveur du créancier pour une
même créance. Concours de privilèges entre créanciers.
Concours d’hypotheques, bc. Ibid. 828.a.
CONCOURS, (Mat. Untfat.Sarrive de deiut manieresjou
lorftu’un collateur a donné le même bénéfice à deux per-
f o n S , ou lorfque le bénéfice eft pourvu par deux colla-
teurs différens. Ce qui doit arriver dans 1 un & 1 autre cas.
Concours de deux fignatures ou provifions de cour de Ronie.
Ce qu’on pratique à Rome pour ne pas tomber dans lm-
convéltient du concours. Auteurs à confulter. III. « a.
Concours four Us cures; examen de tous ceux qui le pré-
fentent pour une cure vacante. Ce qui fe pranque a Metz
& à Tout, lorfqu'une cure vient à vaquer au mois du pape.
III 828. a. Ce concours avoit auffi lieu en Artois. L.e qui le
pratique en Bretagne dans le concours pour une cure
vacante. Ibid. b.- _
. C o n c o u r s , (Mufiq.) muficiens aflemblés pour lélethon
d’un maître de mufique ou d’un organifte : le concours éton
en ufage autrefois dans la plupart des cathédrales. Suppl. II.
S7CONCRET, terme concret. Nombre concret & nombre
abftrait. On ne multiplie point les nombres concrets les uns
par les autres. On peut divifer des concrets par desabftraits
ou par des concrets. III. 828. b.
Concret, grandeur concrète. VIL 8çç. *. Corps concrets.
nombres concrets: termes concrets. XVII. 763. b. Suppl. 1.
71 C o n c r e t ,(Grdm. b Rhet.) verbes adjeétifsou concrets,
voyer A d j e c t i f . Termes concrets. I. 4Ï- *• I55< a-
XVII. 763. b. Le nom abftrait pour le concret, forte de figure.
X CONCRÉTION, (Hiß.nat.) fubftances terreufes, pier*
reufes ou minérales, qui après avoir été défunies, fe font
raftfemblées pour former un nouveau tout ; ou fubftances qm
fe forment en des lieux pardeuliers de matières quonny
foupçonnoit pas. Propriétés qu’elles ont. On les dmfe en
quatre claftfes, les pierres poreufes, les pétrifications, les
pierres figurées, & les calculs. III. 829. a. .
Concrétions, leur origine, voye^ FOSSILES. Leur diftnbuuon
méthodique. Suppl. 111. 96. at b. r 1
C o n c r é t io n , ( Mêdec. ) concrétion des folides. Exemples
de cette concrétion; l’union des doigts, des narines, des paupières,
bc. Ce qui tend à la produire. Ses effets. III. 829. a.
Concrétion des fluides ; cohérence de leurs parties qui en
fait ceffer le mouvement. Ses caufes. Ses effets. Sa cure. IU.
829. b.
Concrétions pierreufes trouvées dans la véficule du fiel. VI.
718. a. Celles qu’on trouve dans le corps de divers animaux;
XV. 586. a. Concrétions polypeufes. XII. 947* *• “
952. b.
■ CONÇU, ( Jurifpr. ) Ceux qui font conçus font cenfés nés
loriqu’il s’agit de leur intérêt; mais non lorfqu’il s’agit de
celui d’un autre. III. 829. b.
CONCUBINAGE, (Jurifp.Hifl. anc.)Deux fignifications
différentes de ce mot. Quelques-uns des patriarches avoient
en même tems plufieurs femmes. Les defeendans de Seth
avoient à la vérité plufieurs femmes, mais toutes n’avoient
pas le titre d’époufe.Depuis Noé jufqu’à Abraham, on ne voit
point que la pluralité de femmes fût ufitée. Etat d’Agar dans
la maifon d’Abraham, lit. 819. b. Dans le même tems, il
étoit commun chez les autreg nations d’avoir des concubines;
maisil ètoit défendu de prendre la femme d’autrui.
Concubinage de Jacob, d’Efaü, d’Eliphas. Du concubinage
Tome I,
C O N 373
chez les juifs. Loix du Lévitique. Fetdmés & concubines
de Salomon. Celles de Darius.
v.uuuuomes u c 1 c iu p u u u .
de la Chine, du fophi de Perfe
; 8c du grand-feigneur. Celles
d’Alexandre le grand* On diftii
iguoit chez les Romains deux
fortes de mariages légitimes, 8c — deux »fortWIIS5 « UU rnn^kUULUUlIlilgCS.
ul.!.-
Ibid. 830. a. Loi de Numa concernant les concubines. E11
quel tems on fubftftUa le terme de concubina à l’ancien terme
pellex. Quels étoieilt ceux à qui le concubinage ètoit permis
félon l’ancien droit* Difpofitiôn de la loi des douze tables 8c
autres loix poftérieures fur ce fujet» Le concubinage n’è-
toit pas abfolument deshonorant chez les Romains. Etat
des concubines. Loix de Jules Céiar 8c de Valentinien fur
le mariage 8t le concubinage. Du droit d’héritage des concubines
félon l’ancien droit romain. Ibid. b. Etat des enfans.
Le concubinage reftraint par Conftantin, & aboli par 1 cm»,
pereur Léon dans l’empire d’orient. Nations d’occident ou
il continua d’être en ufage. Il eft encore ufité dans quelques
pays d’Allemagne : noms qu’on lui donne. Suivant le droit
canon, le concubinage & même la fimple fornication foné
expreftement défendus. Paroles de S. Paul & de S. Auguftiit
fur ce fujet. Les concubines paroiffent avoir été tolerées ,
mais cela doit s’entendre de mariages moins folemnels. Dif*
pofition du dix-feptieme canon du premier concile de To-
, lede fur cette matière. Du concubinage des eccléfiaftiques.
Ibid. 831. a. Tems oh cet ufage fut commun. Peines décer-*
nées contre ce défordre. Comment le concubinage eft regardé
en France. Nos loix réprouvent toutes donations fai*
tes entre concubinaires. Ce qu’elles accordent à la concubine,
ibidl b. pourvu qu’elle ne foit pas mariée ou livrée à
une débauche publique. Les reconnoiffances faites au profit
des concubinaires font nulles, auffi-bien que les donations*
Auteurs à confulter. Ibid. 832. a. _
Concubinage. Du concubinage ufité chez les Romains. Durée
de cet ufage. Diverfes nations qui l’ont pratiqué. X. 114.
a, b. Du concubinage des premiers patriarches. XII. 937. **
95 CONCUPISCENCE, fens de ce mot parmi les théologiens.
Définition du P, Mallebranche. Elle eft félon lui le
péché originel. Comment il l’explique. Ce que les fchola-
ftiques entendent par appétit concupifcible 8c appétit irafci*
ble. Quatre chofes que S. Auguftiû diitingue dans la concu-
pifeence. III. 832. a.
CONCUPISCIBLE, appétit. L Ç49. u.
CONCURRENCE, (Jurifp.) concurrence d’hypotheque
entre deux créanciers; concurrence de privilège. Voye^ ce
qui eft dit au mot C o n c o u r s .
Concurrence entre juges: différence entre la prévention 8c
la concurrence. XIII. 34Ç. a- .
C o n c u r r e n c e , ( Comm. ) de plufieursperfonnes qmafptrenr
à la préférence. Elle eft l’arae de l ’induftrie 8c du commerce*
En quoi confifte la concurrence extérieure du commerce d’une
nation avec d’autres. Celle qxti ne foutient pas cette concurrence
, a une puiftance inférieure à celle des autres. Comment
cette concurrence s’obtient. La concurrence intérieure
eft de deux fortes; l’une entre les denrées de l’état 8c les
denrées étrangères de même ufage; elle doit être proferite;
l’autre, celle du travail entre les fujetstelle eft la bafe de
la liberté du commerce, 8c contribue fur-tout à procurer
cette concurrence extérieure, qui enrichit 8c rend puiflartt
un état. III. 832. b. L’augmentation du prix des denrées eft
le premier effet des progrès de rmduftrie; mais un cercle
heureux de nouvelles concurrences y apporte les tempéra-
mens convenables. Les denrées qui font l’objet de la cor£
fommation, deviennent journellement plus abondantes, 8c
cette abondance modéré en partie leur augmentation. Comment
fe trouve compenfée là diminution du bénéfice de
ceux qui font les ouvrages. Diminution de l’intérêt de l’argent.
A quoi l’on peut reconnoître fi une nation qui na
point de mines fait autant de commerce que les autres. Le
luxe eft inféparable des progrès 8c de la profpérite du commerce:
ce qui en arrête l’excès. Autres effets heureux de
la concurrence. Ibid. 823. a.
Concurrence. Voyez iur ce fujet III. 697. a. 698. <z, é.
724. b. S’il eft vrai qu’il y a des cas ou ü foit utile de
reftreindre la concurrence dans le commerce. 740. b.
CONCURRENS, (Jours) jours furnuméraires au-delà
du nombre de ferhaines que l’année renferme. Pourquoi ils
font appellés concutrens. Ils font appellés quelquefois épaûes
du foleil. IIL 833« u. , ,
CONCUSSION, (Jurifpr.) divers cas de concuflion dont
il eft parlé dans le digefte 8c le code. La prohibition d’acquérir
feite aux magiftrats étoit autrefois ufitée en France. Ce
qui nous eft refté de cet ancien ufage. Exa&ions qu’un gouverneur
de province, chez les Romains , étoit obligé de
rendre. Le crime de ooneuffion n’étoit mis au nombre des
publics, que quand il étoit commis par un magiftrat. Cette
diftinétion n’eft point ufitée parmi nous. Ce que contiennent
les ordonnances par rapport à ce qu’il eft permis ou défendu
aux juges de recevoir. De l’accufation du crime de con-
B B bbb