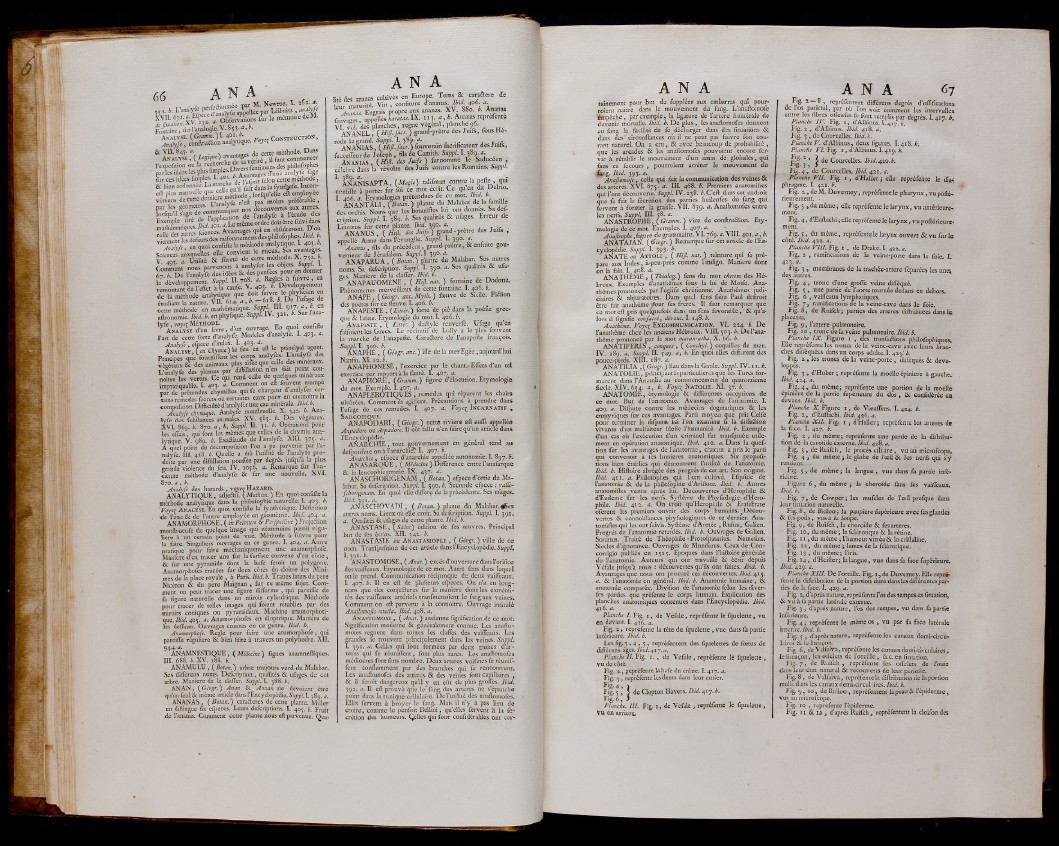
66 A N A
8c VII. o41' ***, % „mîtpc de cette méthode. Dans
A n a ly s e , ( Logtque) f ' “ !“ ? vérité il &ut commencer
l’expofition ou la recherche fentiineus des philofopSies
p a r l e s i t o t o p l f t o P ^ ^ ^ d ï n e fige
fur ces idées fimples. 1. 4*3 ■_ ..ei-prjt filon cette méthode,
& bien ordonnée. Lamardi• P ^ ia fyntljefe. Inconeft
plus naturelle que celle a iorfqu’ elte eft employée
véniens de cette g - n r t g H lorl, ^
par les séomptres. L ^ ? ¿¿couvertes aux autres,
lorfqu'ihs-agu:de îo n de Panalyfe à l’étude des
Exemple tiré d e l m Lemêmeordre doit être fuivi dans
jnathematiques.7W.40a. . rèfulteront. D’ou lbU- f ÂnXfe en quoi confdle lamétliode analytique. 1. epyb
S c ie n c e s auxquelles elle convient le mieux. Ses avannges.
V L . a. Utilité & fureté de cette méthode. X 75a. i.
dë
c “ të méthode en mathématique,
afironomie. U t i b. en phyfique. SuppL IV. 32X. A Sur lana
iy t S f S ° t e , d’un ouvrage En quoi confdle
l ’art de cette forte dhnalyfe. Modelés danalyfe. I. 4° 3- g
Analyfe » efpece d’index. I. 4° 3- a‘ . . . . .
A n a ly s e . M Chymie) le feu en eft le principal agent.
Principes nue fournirent les corps analyfés. L analyfe des
v é g é tL & des animaux plus aifée que celle des minéraux,
l ’analyfe des plantes par diftilladon n’en fait point con-
noître les vertus. Ce qui rend celle de quelques minéraux
imptaùquable. I. 403- «. Comment on eft fouvent nompé
par de prétendus chymiftes qui fe chargent d analyler cer-
iam s remedes fecrets ou certaines eaux pour en connourela
compofition. Difficidté d’analy fer une eau minérale. Ibid. b.
Analyfe chvmique. Analyfe menftrueUe. X. 342. b. Analyfe
des fub'ftances animales. XV. 385. b. Des végétaux.
XVI 869. b. 870. a , b, Suffi. II. 31. g Opérations pour
les effais, qui font les mêmes que celles de la chymie analytique.
V. 989. b. Exactitude de l’analyfe. X1U. 375. a. ■
A quel point de décompofition l’on a pu parvenir par la-
nalyle. III. 418. b. Quelle a été l’utilité de l’analyfe produite
par une diiHllation pouffée par degrés jufqu’à la plus
grande violence du feu. IV. 1050. a. Remarque fur 1 ancienne
méthode d’analyfe & fur une nouvelle. XVI.
•870. «y b.
Analyfe des hazards , voyez H a z a r d .
ANALYTIQUE, adjeftif. (Mathèm.) En quoi confifte la
méthode analytique dans la philofophie naturelle. I. 403. b.
Voyez A naly se. En quoi confiile la fynthénque. Définition
tle l’une & de l’autre employée en géométrie. Ibid. 404. a.
ANAMORPHOSE, ( en Peinture & Perfpcâive ) Projection
monftrueufe de quelque image qui néanmoins paraît régulière
à un certain point de vue. Méthode à fuivre pour
la faire. Singuliers ouvrages en ce genre. I. 404, a. Autre
pratique pour faire méchaniquement une anamorphofe.
Maniéré d’en tracer une fur la furface convexe d’un cône,
& fur une pyramide dont la bafe feroit un polygone.
Anamorphofes tracées fur deux côtés du cloître des Minimes
de la place royale , à Paris. Ibid. b. Traités latins dupere
Nicéron & du pere Maignan , fur ce même fujet. Comment
on peut tracer une figure difforme , qui paroiffe de
fa figure naturelle dans un miroir cylindrique. Méthode
pour*tracer de telles images qui foient rétablies par des
miroirs coniques ou pyramidaux. Machine anamorphoti-
que. Ibid. 405. a. Anamorphofes en dioptrique. Maniéré de
les defliner. Ouvrages connus en ce genre. Ibid. b.
Anamorphofe. Réglé pour faire une anamorphofe, qui
paroiffe régulière & bien faite à travers un polyhedre. XII.
944. a.
ANAMNESTIQUE, ( Médecine ) fignes anamneiliques.
ffl. 688. b. XV. 188. b.
ANAMULU, ( Botan.) arbre toujours verd du Malabar.
Ses différens noms. T)efcnption , qualités & ufages de cet
arbre. Maniéré de le daifer. Suppl. I. 388. b.
AN A N , ( Géogr. ) Anan 8c Annan ne devoient être
qu’un feul & même article dans l’Encyclopèdie.S«pp/.1.389. a.
ANANAS , ( Botan. ) caraéleres de cette plante. Miller
en diftingue fix efpeces. Leurs deferiptions. I. 405. b. Fruit
de l’ananas. Comment cette plante nous eft parvenue. Qua-
Eté ¿es ananas cultivés en Europe. Tems & caraitere Je
.„oniriré Vin , confiture d ananas. Ibid. 406. a.
.Ananas. Engrais propre aux ananas. X V. 880. b. Ananas
appellés karatas. IX. 1 .5 . 4 , é Ananas reprèfentè
VI vol des planches, regne végétal, planche96.
ÀNANEL , ( Hifl.facr. ) grand-pretre des Juifs, fous Hé-,
10 ANa IÎÎÂ s A H i f iJ u a S fouverain facrificateur des Juifs,
fucceffeur de Jofeplt, fils de Camith. Suppl. I. 389. a.
A n a n i a s , (Hifi. des Juifs ) furnommé le Saducéen ,
célébré dans la révolte des Juifs contre les Romains. Suppl.
1 ANANISAPTA, (Magie) talifman contre la pelle , qui
cenftfte à porter fur foi ce mot cent. Ce quen dit Delno.
I. 406. i Etymologies prétendues de ce mot. Ibid. b.
AN A N T A L I, (Botan.) plante du Malabar de la famille
des orchis. Noms que les botaniftes lui ont donnés. Sa def-
cription. Suppl. I. 389. b. Ses qualités 8c ufages. Erreur de
Linnæus fur cette plante. Ibid.^390. a. | .
AN ANUS , ( Hifi. des Juijs) grand-prêtre des Juifs ,
appelle Anne dans l’évangile. Suppl. I. 390. a.
Ananus, fils du précédent, grand-pretre,8cenfuite gouverneur
de Jérufalem. Suppl. I. 390. a.
ANAPARUA, (Botan.) plante du Malabar. Ses autres
noms. Sa deicription. Suppl. J. 390. a. Ses qualités & ufages.
Maniéré de la daifer. Ibid. b. . , _ £
ANAPAUOMENE, ( Hifi. nat. ) fontaine de Dodone.
Phénomènes merveilleux de cette fontaine. I. 406. b.
ANAPE , ( Géogr. anc. Myth. ) fleuve de Sicile, fiction
des poètes fur ce fleuve. 1 .406. b.
ANAPESTE , ( Littér. ) forte de pié dans la poéfie grecque
8c latine. Etymologie du mot. I. 406. b.
A napeste , ( Littér. ) daftyle renverfé. Ufage qu’en
faifoient les Grecs. Le récitatif de Lully a le plus fouvent
la marche de l’anapefte. CaraCtere de l’anapcfte françois.
Suppl. I. 390. b. fi
ANAPHE , ( Géogr. anc.) ifle de la mer Egée, aujourd hui
Nanfio. XI. 12. b. ' .
ANAPHONESE, l’exercice par le chant.» Effets d un tel
exercice par rapport à la fanté. I. 407. a.
ANAPhORE, IGramm. ) figure d’élocution. Etymologie
du mot. Exemple. 1. 407. a. .
ANAPLEROTIQUES, remedes qui réparent les chairs
ulcérées. Comment ils agiifent. Précautions à prendre dans
l’ufage de ces remedes. I. 407. a. Vjye^ In c a r n a t if ,
Sa r c o t iq u e .
ANAPODARI, ( Géogr. ) cette riviere eft aufli appellee
Anpadore owArpadore. Il eût fallu n’en faire qu’un article dans
l’Encyclopédie. _
ANARCHIE, tout gouvernement en général tend au
dcfpotifme ou à l’anarchie^ I. 407. b.
Anarchie., efoece d’anarcliie appellée autonomie. I. 897. b.
ANAS ARQ U E , ( Médecine ) Différence entre l’anafarque
& la leucophlegmatie. IX. 437. a.
ANASCHORIGENAM , ( Botan. ) efpece d’ortie du Malabar.
Sa defeription. Suppl. I. 390. b. Seconde efpece : valli-
fchorigenam. En quoi elle différé de la précédente. Ses ufages.
Ibid. 391. a.
ANASCHOVADI,. ( Botan. ) plante du Malabar. ^6es
autres noms. Lieux où elle croît. Sa defeription. Suppl. I. 391.
a. Qualités & ufages de cette plante. Ibid. b.
ANASTASE, \ Saint) édition de fes oeuvres. Principal
but de fes écrits. XII. 34a. b.
ANASTASIE ou A n a s t a s io p l e , (Géogr. ) ville de ce
nom. Tranfpofition de cet article dans ^Encyclopédie. Suppl.
1 .391. b.
ÀN.ASTOMOSE, ( Anat. ) excès d’ouverture dans l’orifice
des vaifleaux. Etymologie de ce mot. Autre fens dans lequel
on le prend. Communication réciproque de deux vaifleaux.
I. 407. b. Il en eft de plufieurs efpeces. On n’a eu long-
tems que des conjcétures fur la maniéré dont les extrémités
des vaifleaux artériels tranfmettoient le fang aux veines.
Comment on eft parvenu à la connoitre. Ouvrage intitulé
Anafiomofis ret cela. Ibid. 408. a.
A nastomose , ( Anat. ) ancienne fignification de ce moth
Signification moderne & généralement Connue. Les anafto-
mofes régnent dans toutes les clafles des vaifleaux. Les
grandes le trouvent principalement dans les veines. Suppl.
I. 391. a. Celles qui font formées par deux troncs a’ar-
teres qui fe réuniflent, font plus rares. Les anaftomofes
médiocres font fans nombre. Deux arteres voflines fe réunifi-
fent conftainment par des branches qui fe rencontrent.
Les anaftomofes des arteres & des veines font capillaires ,
& il feroit dangereux qu’il y en eût de plus grofles. Ibid.
392. a. Il eft prouvé que le fang des arteres ne s’épanche
point dans la tunique cellulaire. De l’utilité des anaftomofes.
Elles fervent à broyer le fang. Mais il n’y a pas lieu de
croire, comme le penfoit Bellini, qu’elles fervent à la fé-
crétion des humeurs. Çslles qui font confidérables ont cer-
A N A
tainement pour but de fuppléer aux embarras quî pour-
roient naître dans le mouvement du fang. L’anaftomofe
impêche, par exemple, la ligature de l’artere humérale de
devenir mortelle. Ibid. b. De plus , les anaftomofes donnent
au fang la facilité de fe décharger dans des firuations &
dans des circonftances où il ne peut pas fuivre Ion cou-
Tant naturel. On a cru, & avec beaucoup de probabilité ,
que les arcades & les anaftomofes pouvoient encore fer-
vir à rétablir le mouvement d’un amas de globules, qui
fans ce fecours , pourraient arrêter le mouvement au
iàng. Ibid. 393. a.
Anafiomoje, celle qui fait la communication des veines &
des arteres. XVI. 875. a. III. 468. b. Premiers anatomiftes
qui l’ont découverte. Suppl. IV. 238. b. C ’eft dans cet endroit
que fe fait la fécrétion des parties huileufes du fang qui
lervent à former la graifle. VII. 839. a. Anaftomofes entre
les nerfs. Suppl. III. 58. a. _
ANASTROPHE, ( Gramm. ) vice de conftruéhon. Etymologie
âe ce mot. Exemples. I. 4° 7-a' ' l rrTT
Anaftrophe, figure de grammaire. VI. 769. a. VIII. 401. a , b.
ANATAJAN. ( 6iéogr. ) Remarque fur cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. I. 393. A _ .
ANATE ou A t t o l e , ( Hifi. nat. ) teinture qui fe prépare
aux Indes, à-peu-près comme 1 indigo. Maniéré dont
on la fait. I. 408. a.
ANATHÊME , ( Théolog.) fens du mot cherem des Hébreux.
Exemples d’anathêmes fous la loi de Moife. Ana-
thêmes prononcés par l’églife chrétienne. Anathêmes judiciaires
& abjuratoires. Dans quel fens faint Paul defiroit
être fait anathême [tour fes freres. Il faut remarquer que
ce mot eft pris quelquefois dans un fens favorable, & qu’alors
il fignifie confacré, dévoué. 1 .148. b.
Anathême. Voyeç EXCOMMUNICATION. VI. 224. b. De
l’anathême chez les anciens Hébreux. VIII. 503. b. D e l’ana-
thême prononcé par le mot maran-atha. X. 66. b.
ANATIFERES, conques, ( Conchyl. ) coquilles de mer.
IV. 189. a. Suppl. II. 549. u, b. En quoi elles different des
pouce-pieds. XIII. 187. a.
ANATILIA , ( Géogr. ) lieu dans la Gaule. Suppl. IV . 11. b.
ANATOLIE, principautés particulières que les Turcs formèrent
dans l’Anatolie au commencement du quatorzième
fiede. XIV. 654. a , b. Voyei Na t o l ie . XI. 37. b.
ANATOMIE, étymologie & différentes acceptions de
ce mot. But de l’anatomie. Avantages de l’anatcmie. I.
409. a. Difpute contre les médecins dogmatiques & les
empyriques fur ces avantages. Parti moyen que prit Celfe
pour terminer la difpute. ici l’on examme fi la difle&ion
vivante d’un malfaiteur blefl'e l’humanité. Ibid. b. Exemple
d’un cas où l’exécution d’un criminel fut tranfjnuée utilement
en opération anatomique. Ibid. 410. a. Dans la quef-
tion fur les avantages de l’anatomie, chacun a pris le parti
qui convenoit à fes lumières anatomiques. Six propofi-
tions bien établies qui démontrent futilité de l'anatomie.
Ibid. b. Hiftoire abrégée des progrès de cet art. Son origine.
Ibid. 411. a. Philofophes qui font cultivé. Efquiflè de
l’anatomie & de la philofophie d’Ariftote. Ibid. b. Autres
anatomiftes venus après lui. Découvertes d’Herophile &
d’Eudeme fur les nerfs. Syftême de Phyfiologie d’Herophile.
Ibid. 412. a. On croit qu’Heropl.ile & Erafiftrate
oferent les premiers ouvrir des corps humains. Découvertes
8c connoiflanccs/ phyfiologiques de ce dernier. Ana-
tomiftes qui les ont fuivis. Syftême d’Aretée , Rufùs, Galien.
Progrès de l’anatomie retardés. Ibid. b. Ouvrages de Galien.
Soranus. , Traité de Théophile-Protofpatarius. Nemefius.
Siècles d’ignorance. Ouvrages de Mundinus. Ceux de Con-
corrigio publiés en 1515. Epoques dans l’hiftoire générale
de l’anatomie. Auteurs qui ont travaillé 8c écrit depuis
Véfale jufqu’à nous : découvertes qu’ils ont faites. Ibid. b.
Avantages que nous ont procuré ces découvertes. Ibid. 415.
a. 8c l’anatomie en général. Ibid. b. Anatomie humaine, 8c
anatomie comparée. Divifion de 1’anatomie félon les diver-
fes parties que préfente le corps humain. Explication des
planches anatomiques contenues dans l’Encyclopédie. Ibid.
416. a.
Planche I. Fig. 1 , de Vefale, repréfente le fquelette, vu
en devant. I. 416. a.
Fig. 2 , repréfente la tête du fquelette , vue dans fa partie
inférieure. Ibid. b. . . .
Les fig. 3 , 4 , 5 , repréfentent des fquelettes de foetus de
différens âges. Ibid, 417. a.
Planche II. Fig. 1 . , de Vefale, repréfente lê fquelette ,
vu de côté.
Fig. 2 , jeprèfente la bafe du crâne. 1. 417. a.
Fig; 3, reprèfente les dents dans leur entier.
Fig. 4 , j
Fig. 5 , | de Clopton Hâvers. Ibid. 417. b.
Fig.6 , j
Planche. III. Fig. i , de Vefale, reprèfente le fquelette,
Vu en arriéré.
A N A
Fig. a 8 , repréfentent différens degrés d’oflificatrons
de lo s pariétal, par où l’on voit comment les intervalles
entre les fibres offeufes fe font remplis par degrés. ¿4 17 . b.
Planche IV. Fig. 1 , dAlbinus. 1.417. b. .
Fig. 2 , d’Albinus. Ibid. 418. a.
Fig. 3 , de Courcelles. Ibid. b.
Ptanche V. d’Albinus, deux figures. 1. 418. b.
Planche VI. Fig. 1 , d’Albinus. 1. 419. b.
J- de Courcelles. Ibid. 420. b.
Fig. 4 , de Courcelles. Ibid. 421. a.
Planche VIL Fig. 1 , d’HaBer ; elle reprèfente le diV
phragme. I. 421. b.
Fig. 2 , de M. Duverney, repréfente le pharynx, vu pofté-
rieurement. -
Fig- 3 , du même; elle repréfente le larynx, vu antérieurement.
Fig. 4 > d’Euftachi ; elle reprèfente le larynx , vu poftérieure»
ment.
AFig. 5 , du même, repréfente le larynx ouvert & vu furie
coté. Ibid. 422. a.
Planche VIII. Fig. 1 , de Drake. I. 422. a.
Fig. 2 , ramifications de la veine-porte dans le foie. L
423. a.
Fig. 3 , membranes de la trachée-artere féparées les une*
des autres.
Fig. 4 , tronc d’une groffe veine difféqué.
Fig. 5 , une partie de l ’aorte tournée dedans en dehors.
Fig. 6 vaifleaux lymphatiques.
Fig. 7 , ramifications de la veine-cave dans le foie.
Fig. 8 , de Ruifch ; parties des arteres diftribùées dans le
placenta.
Fig. 9 , l’ar;ere pulmonaire.
Fig. 10 , tronc de la veine pulmonaire. Ibid. B.
Planche IX. Figure 1 , des tranfa&ions philofophiques.
Elle repréfente les troncs de la veine-cave avec leurs branches
dillêquées dans un corps adulte. 1 .423 ’. b. ?
Fie. 2 , les troncs de la veine-porte , dïiïéqués 8c développés.
Fig. 3 , d’Huber ; repréfente la moelle épiniere à gauche.
Ibid. 424. a.
Fig. 4 > du même; repréfente une portion de la moelle
épinière de la partie fupérieure du dos, 8c confidérée ea
devant. Ibid. b.
Planche X. Figure 1 , de Vieuflens. I. 424. b.
Fig. 2 , d’Euftachi. Ibid. 426. a.
Planche XII. Fig. 1 , d’Haller ; repréfente les arteres de
la face. I. 427. b.
Fig. 2 , du même ; repréfente une partie de la diftribü-
tion de la carotide externe. Ibid. 428. a.
Fig. 3 , de Ruifch, le procès ciliaire , vu au microfcope.
Fig. 4 , du même ; le globe de l’oeil 8c les nerfs qui s’ÿ
rendent...-
Fig. Ç, du même ; la langue , vue dans ià partie inférieure.
Figure 6 , du même ; la choroïde fans fes vaifleaux.
Ibid. b.
Fig. 7 , de Cowper; les mufcles de l’oeil prefque dans
leur iituation naturelle.
Fig. 8 , de Bidloo; 1a paupiere fupérieure avec ies glandes
8c fes poils, vus à la loupe.
Fig. 9 , de Ruifch, la choroïde 8c fes arteres.
Fig. 10, du même; la fclêrotique 8c la rétine.
Fig. 1 1 , du même ; l’humeur vitrée 8c la criftaline.
Fig. 12 , du même ; lames de la fclêrotique.
Fig. 13 , du même ; l’iris.
Fig-14» d’Heifter; la langue, vue dans fa face fupérieure.
Ibid. 429. a.
Planche XIII. De l’oreille. Fig. x, de Duverney. Elle repréfente
la diftribution delà portion dure dans les différentes parties
de la face. I. 429. a.
Fig. 2, d’après nature, repréfente l’os des tempes en fituation,'
8c vu à fa partie latérale externe.
Fig. 3 , d’après nature, l’os des tempes, vu dans la partie
inférieure.
Fig. 4 , repréfente le même os , vu par fa face latérale
interne. Ibid. b.
Fig. 5 , d’après nature, repréfente les canaux demi-circü»
laircs 8c le limaçon.
Fig. 6,.de Valfalva, repréfente les canaux demi-circulaires ,
le limaçon, les offelets de l’oreille ,, 8cc. en fituation.
Fig. | , de Ruifch , reprèfente les offelets de l’ouïe
dans leur état naturel 8c recouverts de leur perioftè.
Fig. 8 , de Valfalva, repréfente la diftribution de la portion
molle dans les canaux demi-circuhires. Ibid. b.
Fig. 9 , 10, de Bidloo , repréfentent la peau 8c l’épiderme,
vus au microfcope.
Fig. 10 , reprèfente l’épiderme.
Fig. 11 8c ia , d’après Ruifch, repréfentent la cloifon des