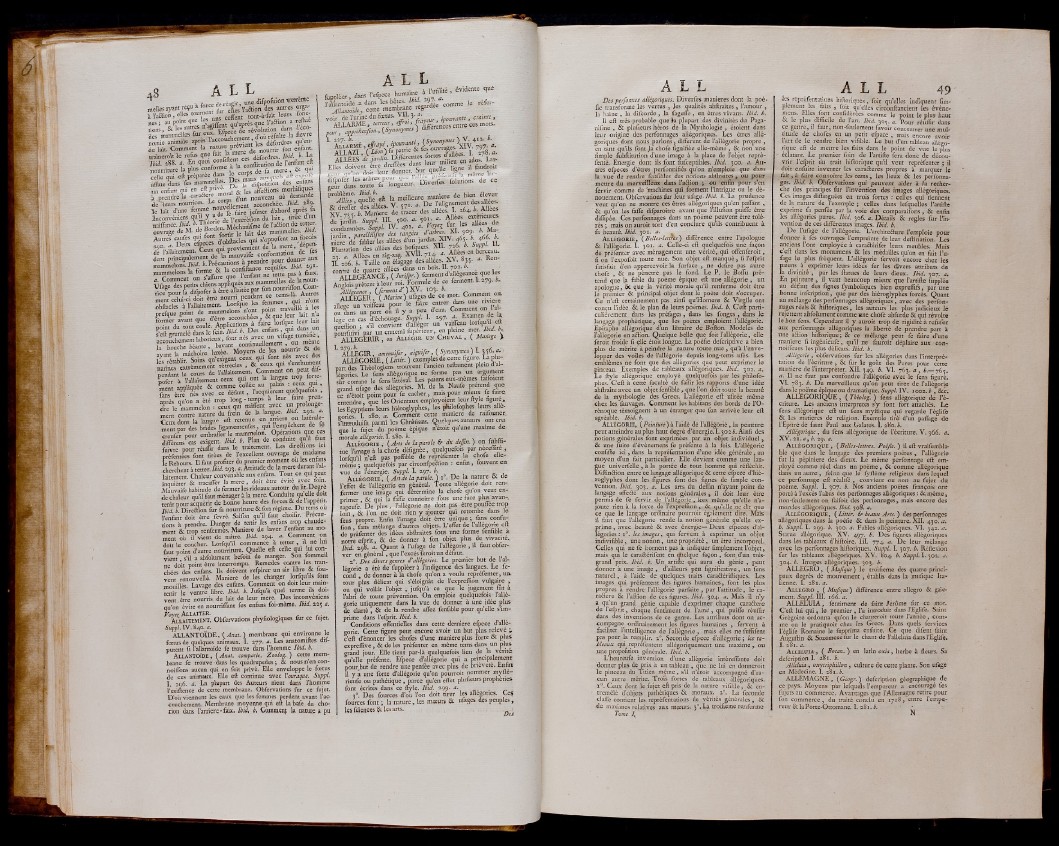
A L L
i l I S rW i r , une difpofmon «ttème
melles ayantreçu ? &«* 4 ^ i’g&çii des J8S S |Ü s 1
ïM i o S .eues tournent fur e w s i lems forrenes
; au point q«e *ef " i L f n u W s que l ’aflion a reflué
.ions, & de résolution dans l’écoâes
mammelbs fur eux. ent , d’où rèfulte Ja fièvre
uomie animale après 1 accoucneme ^ défordres qu’en-
üe lait. Comment la W tm f fM . de n0Urru: fon enfant,
tràîneroit le refus que fait _ défordres. Uid. k: %
Mnoui.r r*it8u8r.e ula. plus conforme a la “cÔonnmffi.t udou^de l'en f&ant eft
celle qm eft préparée dam j a M W B W l ! J f f i S
afflue dans fes mammelles. di&ofition des cntans
un enfant qm en eftprivé- L y affeffions morbifiques
à prendre le caraflere ^ ^ nouveau ne demande
de ieurs nourrices. L *£,i ment accouchée. Jbid. 189-
le lai. d'une femme "»vellemen g g y | d’abord après fa
Jnconvémens qud y . > Texcrètion du lait, urée d un
naifiance. Ibid. ^ / t é°r^ u Mèchamfme de l’aûion de tetter.
W K B Ë È m Ê H Ê Ê H m
mammelons la forme & l’enfant ne tette pas à faux.
U fa^ d e s peti«1cWem applimtés Comobftades
à l'allaitement. Lorfque les fera ^ g
prefque point de mammelons nont P“ nt
& 3 S S ü l s s s .
leXs rétablir. Soins
n ê n S t r " è M om e n t . Commmt on peut dK-
nofer à l’allaitement ceux qui ont la langue trop forte
ment appliquée & comme collée au palais : ceux qui ,
ême dés avec ce défaut , l’acquieren.
« _„»nn a ¿ré trop long - temps a leur faire prendre
le mammelon : ceux qui naiffent avec m
ment contre nature du frein de la langue. Ibii. 292. p
Ceux dont la langue eft retenue en arrière ou latéralement
par des brides ligamenteufes, qui lempechent de fe
creufèr pour embraffer le mammelon. Opérations que ces
S r e L Pcm exigent. Ibii. b. Plan de conduite qu'il faut
fuivre pour réuffir dans le traitement. Les direâions ici
prèfemees font tirées de l’excellent ouvrage de madame
Je Rebours. Il fcut profiter du premier moment ou les enfans
cherchent à tetter. Ibii. 293. e. Attitude de la mere durant 1 a^-
Jaitement. Chaleur convenable aux enfans. Tout ce qui peut
inquiéter & tracafler lamere, doit être évité avec: foin.
Mauvaifehabin.de de fermer les rideaux autour du ht. Degré
de chaleur qu’il faut ménager à la mere. Conduite qu elle doit
tenir pour acquérir de bonne heure des forces & de 1 appétit.
ibii. b. Direûion fur fa nourriture & fon régime. Du rems ou
l’enfant doit être fevré. Saifon qu’il faut choifir. Précau-
rions à prendre. Danger de tenir les enfans trop chaudement
& trop renfermés. Maniéré de laver 1 enfant au moment
où il vient de naître. Ibii. 294. a. Comment on
doit le coucher. Lorfqu’il commence à tetter, il ne lu.
faut point d’autre nourriture. Quelle eft celle qui lut con-
vient s’il a abfolument befoin de manger, bon iommeil
ne doit point être interrompu. Remedes contre les tranchées
des enfans. Ils doivent refpirer un air libre & fou-
vent renouvellé. Maniéré de les changer lorfquils font
mouillés. Lavage des enfans. Comment on doit leur maintenir
le ventre libre. Ibid. b. Jufqu’à quel terme ils doivent
.être nourris du lait de leur mere. Des inconvémens
qu’on évite en nourriflant fes enfans foi-même. Ibid. 225 a.
A l l a i t e m e n t . Obfervations phyfiologiques fur ce fujet.
Suppl. IV. 840. a.
ALLANTOÏDE, ( Anat. ) membrane qui environne le
foetus de quelques animaux. 1. 277. a. Les anatomiftes dif-
putent fi l’allantoïde fe trouve dans l’homme Jbid. b.
A llantoïde , f Anat. comparée., Zoolog. ) cette membrane
fe trouve-dans les quadrupèdes; oc nous n’en con-
noiffons aucun qui en foit privé. Elle enveloppe le foetus
de ces animaux. Elle eft continue avec Vouraque. Suppl.
I. 206.: a. La plupart des Auteurs nient dans l’homme
Vexiftence de cette membrane. Obfervations fur ce fujet.
D’où viennent Jes eaux que les femmes perdent avant l’accouchement.
Membrane moyenne qui eft la bafe du cho-
rion dans l’arriere - faix. Ibid, b. Commenf la nature a pu
A U ....... . ,
fcppiiM, 1 1 1“ * * ’
l’allantoide-a dans J dée COmme le rèfer-
Allantoïde, cette membrane rega
j i | l S l t e | î S î ï î S
f S i S î ï i ' a A “ “ * ••
f e ; f % & dreffer des allées. V. 571. v. De Allées
| v ; 73, j j | | de uacer AUées
con& n é e s Suppl. IV. | | | p p C® *«
p i a a s s - f t f f e II. 206. b. Taille ou flagage desaüées. XV. 835. a. Ke
C° ALLEG^ANCE^ Uenueitt d’alhigeàncè que les
Ai^lols prérau à leur roi. ^Formule de ce ferment. 1. 279. A.
m M S Ê Ê Ê Ê È Ê Ê Ë Ê È Ê & Comment cm
allure un vfifleau nourrie l i r e entter dans une nv.ere
ô „ £ n s un port À il y a peu d’eau. Comment on 1 a -
lene en cas d’èchouage. Suppl. I. 297. a. Examen de iq
aueftion ; s’il convient d’alléger un vaiffeau lorfqu d eft
pourfuivi par un ennemi fupéneur, en pleme met.lbti. .
ALLEGERIR , ou A ix é g ir un C h e v a l , ( Mainte >
L lO xE G IR , ammmftr, mguifer, ( Synonymes) I. 356. a. ï
ALLÉGORIE, (Unir. ) exemples de cette figure. La plupart
des Théologiens trouvent l’ancien teftament plem dal-
lèeories. Le fens allégorique ne forme pas un argument
sûr comme le fens littéraf. Les fe n fh e“ ' ,?emeL^
erand nfage des allégories. M. de la Naufe prétend que
le n’étoit pornt pour fe cacher, mats pour mieux fe fore
entendre, que les Orientaux employotent leur ftyle figuré,
les Egyptiens leurs hiéroglyphes, les pKilofophes leurs allé-
eories I. 280. a. Comment cette mamere de raifonner.
s’introdulfît parmi les Chrétiens. Quelques auteurs ont cru
que le fujet du poëme épique n’étoit qu une maxime de
morale allégoriée. I. 280. b. ,
ALLÉGORIE , ( Arts de la parole 6* du dejjîn. ) on iubra-
tue l’image à la chofe défignée, quelquefois par néceffité ,
lorfqu’il n’eft pas poflible de reprefenter la chofe eUe-
même ; quelquefois par circonfpe&ion : enfin, fouvent en
vue de l’énergie. Suppl. I. 297. b.
A l l é g o r i e , ( A n de la parole. ) 1 . De la nature & de
l’effet de l’allégorie en général. Toute allégorie doit ren-.
fermer une image qui détermine la chofe qu’on veut exprimer
& qui la fafie conrioître fous une race plus avan-
tageufe. De plus 5 l’allégorie ne doit pas être pouffée trop
loin, & l’on ne doit rien y ajouter qui retombe dans le
fens propre. Enfin l’image doit être unique ; fans confu-
fion, fans mélange d’autres objets. L’effet de l'allégorie eft
de prèfenter des idées abftraites fous une forme fenlible a
notre efprit, & de donner à fon objet plus de vivacité.
Ibid. 298. a. Quant à l’ufage de l’allégorie, il faut obfer-
ver en général, que l’excès feroitun défaut.
20. Des divers genres d'allégories. Le premier but de l’allégorie
a été de fuppléer à l’indigence des langues. Le fécond
, de donner à la chofe qu’on a voulu repréfenter, ui*
tour plus délicat qui s’éloignât de l’expreflion vulgaire ,
ou qui voilât l’objet , jufqu’à ce que le jugement fut à
l’abri de toute prévention. On empfoie quelquefois l’allégorie
uniquement dans la vue de donner à une idée plus
de clarté, & de la rendre aflez fenfible pour qu’elle s’imprime
dans l’efprit. Ibid. b.
Conditions eflentielles dans cette derniere efpece d’allégorie.
Cette figure peut encore avoir un but plus relevé j
c’eft d’énoncer les chofes d’une maniéré plus forte & plus
I expreflive, & de les prèfenter en même tems dans un plus
grand jour. Elle tient par-là quelquefois lieu de la vérité
qu’elle préfente. Efpece d’allégorie qui a principalement
pourvut de rendre une penfée avec plus de brièveté. Enfin
il y a une forte d’allégorie qu’on pourroit nommer myfté-
rieufe ou pathétique, parce qu’en effet plufieurs prophéties
font écrites dans ce ftyle. Ibid. »99- <*• .
30. Des fources d’ou l’on doit nrer les allégories. Ces
fources font ; la nature, les moeurs 6c ufages des peuples f
les fciences6t les arts. , >
A L L
Des perfonpes allégoriques. Diverfes maniérés dont la poé-
fie transforme les vertus , les qualités abftraites , l’amour ,
la haine , la difeorde, la fageife, en êtres vivans. Ibid. b.
Il eft très-probable que la plupart des divinités du Paga-
nifme , 8c plufieurs héros de la Mythologie , étoient dans
leur origine des perfonnages allégoriques. Les êtres allégoriques
dont nous.parlons, différent de l’allégorie propre ,
en tant qu’ils font )s. chofe fignifiée elle-même, & non une
fimple fubftitution d’une image à la place de l’objet repré-
fenté. Energie dont ils font iufceptibles. Ibid. 300. a. Autres
efpeces d’êtres perfonnifiés iqu’on n’emploie que dans
la vue de rendre lenfibles des notions abftraites, ou pour
mettre du merveilleux dans l’aélion ; ou enfin pour s’en
fervir comme de 'machines qui forment l’intrigue ou le dénouement.
Obfervations fur leur ufage. Ibid. b. La prudence
veut qu’on ne montre ces êtres allégoriques qu’en paflànt,
& qu’on les M e difparoître avant que l’illufion puifle être
diflipée. Ces perfonnages dans un poëme peuvent être tolérés
; mais on auroit tort d’en conclure qu’ils contribuent à
fa beauté. Ibid. 301. a. .
A l l é g o r ie , ( Belles-lettres) différence entre l’apologue
& l’allégorie. I. 301. a. Celle-ci eft quelquefois une façon
de prèfenter avec ménagement une vérité, qui offenferoit,
fi on l’expofoit toute nue. Son objet eft manqué, fi l’éiprit
fatisfait d’en appercevoir la furface , ne defire pas autre
chofe , 8c ne pénétré pas le fond. Le P. le Bofiu prétend
que la fable du poëme épique eft une allégorie , un
apologue, Sc que la vérité morale qu’il renferme doit être
le premier 8c principal objet dont le poëte doit s’occuper.
Ce n’eft certainement pas ainfi qu’Homere 8c Virgile ont
conçu l’idée & le plan de leurs poëmes. Ibid. b. C’en particulièrement
dans les préfages, dans les fonges, dans le
langage prophétique, que les poëtes emploient l’allégorie.
Epitaphe allégorique d’un libraire de Bofton. Modèles de
f allégorie en a&ion. Quelque belle que foit l’allégorie, elle
feroit froide fi elle étoit longue. Là poéfie defcriptive a bien
filus de mérite à peindre la nature toute nue , qu’à l’enve-
opper des voiles de l’allégorie depuis long-tems ufés. Les
emblèmes ne font que des allégories que peut exprimer le
pinceau. Exemples de tableaux allégoriques. Ibid. 302. a.
Le ftyle allégorique employé quelquefois par les philofo-
phes. C ’eft à cette faculté de faifir les rapports d’une idée
abftraite avec un objet fenfible , que l’on doit toute la beauté
de la mythologie des Grecs. L’allégorie eft ufitée même
chez les fauvages. Comment les habitans des bords de l’O-
rénoque témoignent à un étranger que fon arrivée leur eft
agréable. Ibid. b.
A l lég or ie , ( Peinture) à l’aide de l’allégorie, la peinture
peut atteindre au plus haut degré d’énergie.1.302 ¿.Ainfi des
notions .générales font exprimées par un objet individuel,
& une iuite d’événemens fe préfente à la fois. L’allégorie
confifte ic i , dans la rcprêfentation d’une idée générale, au
moyen d’un fait particulier. Elle devient comme une lanfue
univerfelle, à la portée de tout homme qui réfléchit.
)iftinétion entre ce langage allégorique 8c cette efpece d’hié-
roglyphes dont les figures font des fignes de fimple convention.
Ibid. 303. a. Les arts du deflin n’ayant point de
langage affeâé aux notions générales, il doit leur être
permis de fe fervir de l’allégorie^ lors même qu’elle n’a-
joute rien à la force de l’expreflion, ôc qu’elle ne dit que
ce que le langage ordinaire pourroit également dire. Mais
il faut que l'allégorie rende la notion générale qu’elle ex-
{»rime, avec beauté 8c avec énergie— Deux efpeces d’al-
égories : i°. les images, qui fervent à exprimer un objet
inaivifible, une notion, une propriété , un être incorporel..
Celles qui ne fe bornent pas à indiquer Amplement l’objet,
mais qui le caraâérifent en qtielque façon, font d’un très-
grand prix. Ibid. b. Un artifte qui aura du génie , peut
donner à une image, d’ailleurs peu fignificative, un fens
naturel, à l’aide de. quelques traits caraétériftiques. Les
images qui préfentent des figures humaines, font les plus
propres à rendre l’allégorie parfaite , par l'attitude, le ca-
raélere 8c l’aâion de ces figures. Ibid. 304. a. Mais il n’y
a qu’un grand génie capable d’exprimer chaque cara&ere
de l’eiprit, chaque fentiment de l’amd, qui puifle réuflir
dans des inventions de ce genre. Les attributs dont on accompagne
^ ordinairement les figures humaines , fervent à
faciliter l’intelligence de l’allégorie , mais elles ne fuffifent
pas pour la remplir. 20, Seconde efpece d’allégorie ; les tableaux
qui reprefentent allégoriquement une maxime, ou
une propofition générale. Ibid. b.
L’heureufe invention d’une allégorie intéreflante doit
donner plus de prix à un tableau , que ne lui en donneroit
le pinceau du Titien même, s’il n’etoit accompagné d’aucun
autre mérite. Trois fortes de tableaux allégoriques.
i° . Ceux dont le fujet eft pris de la nature vifible, 8c entremêlé
d’objets pathétiques 8c moraux. 2?. La féconde
clafle contient les repréfentations de vérités générales, 8c
de maximes relatives aux moeurs. 3°«L» troifiemerenferme
Tome I,
A L L 49
les représentations liiftoriques, foit qu’elles indiquent Amplement
les faits , foit qu’elles circonftancient les événement
Elles font confidérées comme le point le plus haut
le Pfosdifficile de 1 art. Ibid. 305. | % u r réuflir dans
ce genre, il faut, non-feulement favoir concentrer une multitude
de chofes en un petit efoace , mais encore avoir
l’art de le rendre bien vifible. Le but d’un tableau allégorique
eft de mettre les faits dans le point de vue le plus
1 éclatant. Le premier foin de l’artifte fera donc de découvrir
l ’eiprit du trait hiftorique qu’il veut repréfenter ; il
doit enfuite inventer les carafteres propres à marquer le
fait, à faire connoître les tems, les lieux 8c les perfonna-
ges. Ibid. b. Obfervations qui peuvent aider à la recherche
des principes fur l ’invention des images allégoriques.
Ces images diftinguées en trois fortes : celles qui tiennent
de la nature de l’exemple ; celles dans lefquelles l’artifte
exprime fa penfée par la voie des comparailbns, 8c enfin
les allégories pures. Ibid. 306. a. Détails 8c réglés fur l’invention
de ces différentes images. Ibid. b.
De 1 ufage de l’allégorie. L’architeéhire l’emploie pour
donner à fes ouvrages l’empreinte de leur deftination. Les
anciens l’ont employée à caraâérifer leurs meubles. Mais
c’eft dans les monumens 8c lès médailles qu’on en fait l’u-
fage le plus fréquent. L’allégorie fervoit encore chez les
païens à exprimer leurs idées fur les divers attributs de
la divinité , par les ftatues de leurs dieux. Ibid. 307. a.
En peinture, il vaut beaucoup mieux que l’artifte fupplée
au défaut des fignes fymboliques bien expreififs, par une
bonne infeription, que par des hiéroglyphes forcés. Quant
au mélange des perfonnages allégoriques , avec des perfonnages
réels 8c hxftoriques, les auteurs les plus judicieux le
rejettent abfolumentcomme une chofe abfurde 8c qui révolte
le bon fens. Cependant il y auroit trop de rigidité à refufer
aux perfonnages allégoriques la liberté de prendre part à
une aétion hiftorique ; & ce mélange peut fe faire d’une
maniéré fi ingéniëufe, qu’il ne fauroit déplaire aux con-
noiffeurs les plus délicats. Ibid. b.
Allégorie, obfervations fur les allégories dans l’interprétation
de l’écriture, 8c fur le goût des Peres pour cette
maniéré de l’interpréter. XII. 340. b. VI. 763. a , b.— 765.
a. Il ne fout pas confondre l’allégorie avec le fens figuré.
VI. 783. b. Du merveilleux qu’on peut tirer de l’allégorie
dans le poëme épique ou dramatique. SuppL IV. 1002. b , 8cc.
ALLÉGORIQUE, ( Theolog. ) fens allégorique de l ’écriture.
Les anciens inteipretes s’y font fort attachés. Le
fens allégorique eft un fens myitique qui regarde l’églife
8c les matières de religion. Exemple tiré d’un paffagè de
l’Epitre de foint Paul aux Galates. 1. 280. b.
Allégorique, du fens allégorique de l’écriture. V . 366. a.
XV. 21. a, b. 29. a.
A l l é g o r iq u e , ( Belles-lettres. Poéfie.") il eft vraifembla*
ble que dans le langage des premiers poëtes , l’allégorie
fut la pépinière des dieux. Le même perfonnage eft employé
comme réel dans un poëme, 8c comme allégorique
dans un autre, félon que le iyftême religieux dans lequel
ce perfonnage eft réalifé , convient ou non au fujet du
poëme. Suppl. I. 307. b. Nos anciens poètes fiançois ont
porté à l’excès l’abus des perfonnages allégoriques: 8c même,
non-feulement on foifoit des perfonnages, mais encore des
mondes allégoriques. Ibid. 308. a.
A l l ég o r iq u e , ( Littér. & beaux Arts. ) des perfonnages
allégoriques dans la poéfie 8c dans la peinture. XII. 430. a.
b. Suppl. I. 299. b. 300. ai Fables allégoriques. VI. 342. a.
Statue allégorique. XV. 497. b. Des figures allégoriques
dans lés tableaux d’hiftoire. III. 774. a. De leur mélange
avec les perfonnages liiftoriques. Suppl. \. 307. b. Réflexion
fur les tableaux allégoriques. XV. 804. b. Suppl. I. 302. a.
304. b. Images allégoriques. 303. b.
ALLEGRO, | MufiqUe| le troifieme des quatre principaux
degrés de mouvement, établis dans la mufique Italienne.
1. 281. a.
A l l e g r o , ( Mufique) différence entre allegro 8c gaie*
ment. Suppl. III. 166. a.
A LLE l U IA , fentiment de faint Jérôme fur ce mot.
C’eft lui qui, le premier, l’a introduit dans l’Eglife. Saint
Grégoire ordonna qu’on le chanteroit toute l’année, comme
on le pratiquoit chez les Grecs. Dans quels fervices
l’églife Romaine le fupprima enfuite. Ce que difent faint
Auguftin 8c Sozomene fur le chant de l’alleluia dans l’Eglifc.
I. 201. a..
A lléluia-, ( Botan. ) en latin oxis, herbe à fleurs. Sa
defeription I. 281. b.
Alléluia, oxytriphillon , culture de cette plante. Son uiàge
en Médecine. I. 281. b.
ALLEMAGNE, ( Géogr. ) defeription géographique de
ce pays. Moyens par leiquels l’empereur a encouragé fes
fujets au commerce. Avantages que l’Allemagne retire pour
fon commerce, du traité conclu en 1718, entre l’empereur
8c la Porte-Ottomane. I. 281. b.
N