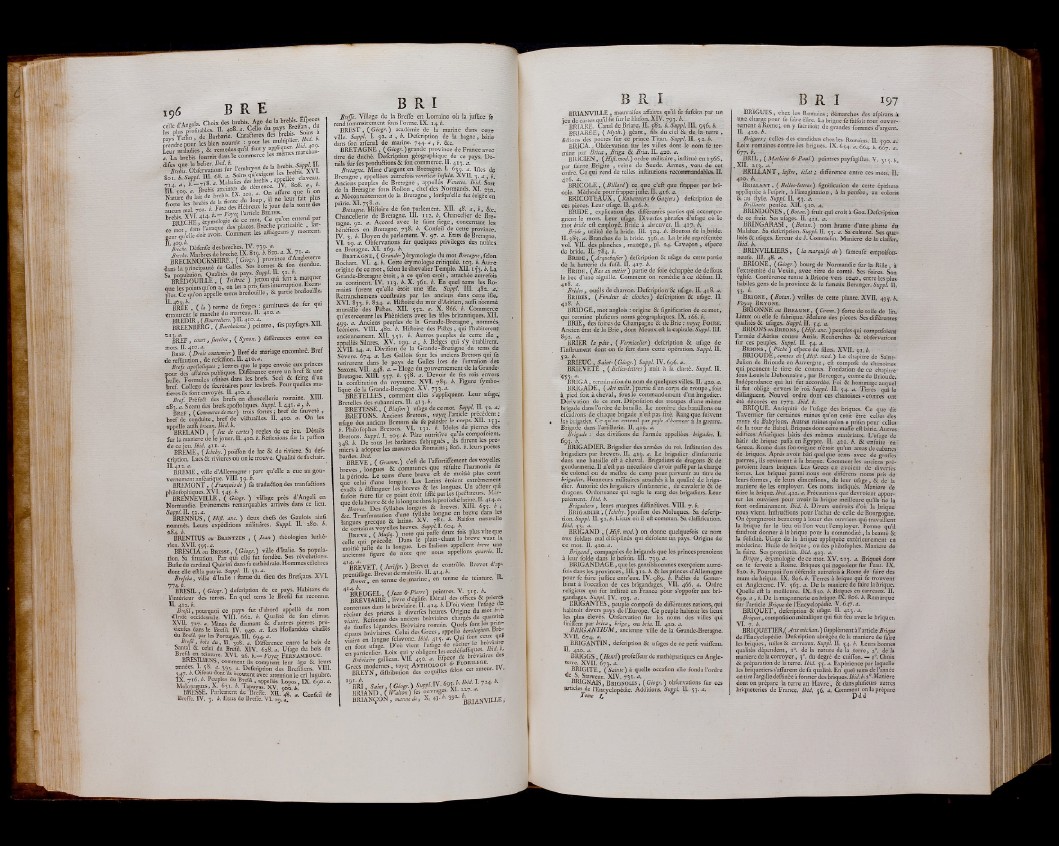
196 B R E
DavsPTeiÎn , de Barbarie. Carafteres des brebis. Soins ^
prendre pour les bien nourrir 1 pour les § ¡ 1
£eur maladies , & remedesquil ^ marchan-
La brebis fournit dans le commerce les mêmes
difes que le belier. Ibid.b. brebis. Suppl. IL
S w â A v l
n i. W a. S M g | g | g On affure que fi on ,
Nature du lait de ^ -j ne leur fait plus
frotte les brebis d Hébre„ x le jour de la tonte des
aucun % 7 o a . “ | æ g g B e ’ IER.
BRECHE, étymologie de ce mot. Ce qu’on entend par
. l’attaque des places. Breche praticable , larjgeirT
qu’elle doit avoir. Comment les affiégeans y montent.
â/wÀî. Défenfe desbreches. TV. 739.
Breche Marbres de breche. IX. 8x9. ¿.820* <*-X. 71. •
BRECKNOCKSHIRE, ( Géogr.) province dÂngleterre
ifians la principauté de Galles. Ses bornes & fou étendue.
Sa population. Qualités du pays. SuppL IL f f iA
BREDOUILLE , ( Tritlrac ) jetton qut fert à marquer
nue les points qu’on a, on les a pris, fans mterntption. Exemples.
Ce qu’on appelle trous bredouille, & parue bredouille.
b ÎîIe , ( S ) terme de forges : garnitures de fer qui
■entourent le manche du marteau. II. 410. a.
BREDIR, (Bourreliers. ) II.410. a.
BREENBERG, ( Bartholome ) peintre, fes paylages. Ali.
^ R E F , court, fuccint, ( Synon. ) différences entre ces
Bref. ( Droit coutumier ) Bref de mariage encombré. Bref
rie reftitution, de refdfion. II. 410. a.
Brefs apoftoliques ; lettres que le pape envoie aux princes
pour des affaires publiques. Différence entre un bref & une
huile. Formules ufitées dans les brefs. Scel 8c feing dua
bref. College de fecrétaires pour les brefs. Pour quelles maxieres
ils font envoyés. D. 410. a.
Bref. Préfeft des brefs en chancellerie romaine. Aili.
g f ! .a. Sceau des brefs apoftoliques. Suppl. 1. 441. a , b.
Bref , ( Commerce de mer| trois fortes bref de fauveté ,
bref de conduite, bref de viftuailles. II. 410. a. On les j
appelle auffi brieux. Ibid.b. .
BRELAND, {Jeu de cartes) réglés de ce jeu. Détails
fur la maniéré de le jouer. H. 410. b. Réflexions fur la paffion
rie ce jeu. Ibid. 411. a. .. g
BREME, ( Ichthy. ) poiffon de lac & de nyiere. Sa description.
Lacs & rivieres où on le trouve: Qualité de fa chair.
II.412.tf.
BREME, ville d’Allemagne : part qu’elle a eue au gouvernement
anféarique. VHI. 30. b.
BREMONT, (Françoisde) fa traduétiondes tranfaûions
philofophiques. XVI. 543. b.
BRENNEVILLE, ( Géogr. ) village près d’Angeli en
Normandie. Evénemens remarquables arrivés dans ce lieu.
Suppl. II. <2. a. .
BRENNUS, ( Biß. anc. ) deux chefs des Gaulois ainû
nommés. Leurs expéditions militaires. Suppl. IL 280. b.
284. b.
BRENTIUS ou B ren tz en , (Jean) théologien luthérien.
XVII. 393. a.
BRESCIA ou B re s se , (Géogr.) ville d’Italie. Sa population.
Sa fituation. Par qui elle fut fondée. Ses révolutions.
Buftedu cardinal Quirini dans fa cathédrale. Hommes célébrés
dont elle eft la patrie. Suppl. II. 52. a. i .
Bref cia t ville d’Italie : ftatue du dieu des Brefçans. AVI.
*77BRÊSIL, (Géogr.) defcription de ce pays. Habitans de
l’intérieur des terres. En quel tems le Brefil fut reconnu.
U. 412. b. •
Brefil y pourquoi ce pays fut d’abord appellé du nom
fflndè occidentale. VlU. 662. b. Qualité de fon climat.
I | î 727. a. Mines de diamant & d’autres pierres pré-
cieufes dans le Brefil. IV. 940. a. Les Hollandois chaffés
du Brefil par les Portugais. III. 694. a.
Brefil y bois du, ü . 308. a. Différence entre le bois de
Santal & celui du Brefd. XIV. 628. a. Ufage du bois de
RPpecmi?Mcre' XVL B b~ v°ye<- F ern amb ouc .
i t o ’ comment comptent leur âge & leurs
années. 1.. 58. a. 393. Defcription des Brefiliens. VIII.
347. b. Dileau dont ils écoutent avec attention le cri lugubre.
IX. 716. b. Peuples du Brefil , appelé Lopos, IX. 690. a.
Molopaguzs, X. 631. b. Tapuyas. XV. 000 b
BRESSE. Parlement de Breffc. Xïl. V a. Confell de
Breffe. IV. 3. ». Etats de Breite. VL e9. : °
B R I
Brejfe. Village de la Breffe en Lorraine où la juftice fe
rend fommairement fous l’orme. IX. 14. b.
BREST, ( Géogr. ) académie de la marine dans cette
ville. Suppl. L 92. a , b. Defcription de la bagne, bâtie
dans fon arfenal de marine. 744. d , b. &c.
BRETAGNE , (Géogr.) grande province de France avec
titre de duché. Defcription géographique de ce pays. Détails
fur fes productions 8c fon commerce. II. 413. a.
Bretagne. Mine d’argent en Bretagne. I. 629. a. Iflcs de
Bretagne, appellées autrefois venetica injula. XWll. 3. a , b.
• Anciens peuples de Bretagne , appellés Venetes. lbid. Sort
de la Bretagne fous Rollon, chef des Normands. XI. 230.
a. Mécontentement de la Bretagne , lorfqu’elle fut érigée en
pairie. XI. 758. a.
Bretagne. Hiftoire rie fon parlement. XII. 48. a , bt &c.
Chancellerie de Bretagne. III. 112. b. Chancelier de Bretagne.
92. a. Accord avec le faint fiege, concernant les
bénéfices en Bretagne. 738. b. Confeil de cette province.
IV. 3. b. Doyen du parlement. V. 97. a. Etats de Bretagne.
VI. 29. a. Obfervations fur quelques privilèges des nobles
en Bretagne. XI. 169. b.
B re ta gn e , ( Grande- ) étymologie du mot Bretagne, félon
Bochart. VI. 4. b. Cette étymologie critiquée. 103. b. Autre
origine de ce mot, félon le chevalier Temple. XII. 153. b. La
Grande-Bretagne étoit, à ce qu’on croit, attachée autrefois
au continent. IV. 113. b. X. 361. b. En quel tems les Romains
furent qu’elle étoit une ifle. Suppl. III. 482. aj
Retranchemens conftruits par les anciens dans cette ifle.'
XVL 833. b. 824. a. Hiftoire du mur d’Adrien, aufli nommé
muraille des Piétés. XII. 352. a. X. 866. b. Commerce
qu’exercerent les Phéniciens avec les ifles britanniques. XII.
499. a. Anciens peuples de la Grande-Bretagne, nommés,
Icéniens. VHI. 480. b. Hiftoire des Piétés, qui l’habiterent
anciennement. XII. 351. b. Autres peuples de cette ifle ,
appellés Silures. XV. 109. a , b. Belges qui s’ÿ établirent.
XVII. 24. a. Divifion cfe la Grande-Bretagne du tems de
Sévere. 674. a. Les Gallois font les anciens Bretons qui fe
retirèrent dans le pays de Galles lors de l’invafion des
Saxons. VII. 448. a. - Eloge du gouvernement de la Grande-
Bretagne. XIII. 557. b. 558. a. Devoir de fes rois envers
la conftitution du royaume. XVI. 785. b. Figure fymbo-»
lique de la Grande-Bretagne. XV. 733. a. ■
BRETELLES, comment elles s’appliquent. Leur ufage;
Bretelles des rubanniers. II. 413. A .
BRETESSE, (Blafon) ufage de ce mot. Suppl. 11. p . aj
BRETONS. Anciens Bretons, voye^ l’article précédent :
ufaee des anciens Bretons de fe peindre le corps. XII. 133-
b. Philofophes Bretons. VI. 131. b. Idoles de pierres des
Bretons. Suppl. I. 205, b. Pâte nutritive qu ils comportent.
348. b. De tous les barbares fubjugués . i ls furent les premiers
à adopter les moeurs des Romains ; 806. b. leurs poetes
k^BREVE, ( Gramm.) c’eft de l’affortiffement des voyelles
brèves, longues & communes que réfulte l’harmonie de
la période. Le tems d’une breve eft de moitié plus coutt
que celui d'une longue. Les Latins étotent extrêmement
exafls 1 diftinguer les brèves & les longues. Un afteur qui
faifoit faute fur ce point étoit fifflé par les fpeaateurs. Marque
delà breve & de la longue dans laprofodie Imine. H 414..a.
Brtvts. Des fyllabes longues & brèves. XIII. 655. b ,
&c. Tranfmutation d’une fyilabe longue en breve dans les
tangues grecque & latine. XV. f f M R*« » naturelle
de certaines voyelles brèves. SuppL I. 604. L
BREVE, (Mufa.) note qui paffe deux fois plus vite que
celle qui précédé. Dans le plain-chant la breve vaut la,
moitié jufte de ta longue. Les Italiens appellent brtv, une
ancienne figure de note que nous appelions qtiarrit. H.
BREVET. ( Jurijpr. ) Brevet de contrôle. Brevet d’ap-.
prentiffage. B re v e t de maîtrife. II. 4 ‘ 4 -L R
Breva, en terme de marine, en terme de teinture. IL
4IBRÉUGEL, (jMn&Pierr,) peintres. V. 313. é.
BRÉVIAIRE , livre d’églile. Détail des offices & prières
contenues dans le bréviaire. II. 41+ © » ™nt l’ufage de
réciter des prières à diverfes heures. Origine du mot br.
viaire. Réforme des anciens bréviaires chargés de Suan<n-
dé faufles légendes. Bréviaire romain. Quels font les principaux
brévilres.. Celui des Grecs, appellé
viaire en tangue fclavone. lbid. 415. a. Qui fom J
en font ufagl. D’où vient l'ufage de
ehpatticnlier. Loix O T ^ io b h g e n t | |q c q l^ | |^ res g
Bréviaire gallican. VII. 430. a. Efpece ne
Grecs modernes, Poyet A n th o lo g e fr F jy ,
BREYN, diftribution des coquilles félon cet auteur.
I9BM , S a i a , . {G é o g r .) S a p p l. lV .6 ^ b .m f . 7a4- J
BRI AN D , ï Wallon) fes mivrages. XL |»7- "•
BRIANÇON , marine de, X. 43-1 W2' ¿ llIANv lU.E ;
B R I BRI 197 BRIANVILLE , mauvaifes affaires qu’il fe fufcica par un
jeu de cartes qu’il fit fur le blafon. XIV. 793. b.
BRIARE. Canal de Briare. II. <82. b. Suppl. III. 936» b.
BRIARÉE, ( Myth.) géant, fils du ciel & de, la terre ,
ïétions des poètes fur ce prince Titan. Suppl. H. 52. b.
BRICA. / Obfervation fur les villes dont le nom fe termine
par Brica , Briga & Bria. II. 420. a.
BRlCIEN, (Hift.mod.) ordre militaire, inftitué en, 1366,
jiar fainte Brigite , reine de Suede. Armes, voeu de cet
ordre. Ce qui rend de telles inititutions recommandables. ÏI>
•416. a.
.BRICOLE, (Billard) ce que c’eft. que frapper par bricole.
Méthode pour frapper jufte. II. 4,16. a.
BRICOTEAUX, (Rubanniers & Gabiers) defcription de
ces pièces. Leur ufage. IL 416. b.
BRIDE, explication des différentes parties qui accompagnent
le mors. Leur ufage. Diverfes phrafes d’ufage où le
mot bride eft employé. Bride à abreuver. II. 417. b.
Bride y utilité de la bride. III. 304. b. Bouton de la.bride.
II. 383. a. Branches de la bride. 396. a. La bride repréfentée
vol. VIL des planches , manege, pl. 24. Caveçon , efpece
de bride. H. 784. b.
B r id e , (Arauebufter) defcription & ufage de cette partie
de la batterie du fufil. fi. 417. b.
Brid e , (Bas au métier) partie de foie échappée de deffous
le bec d’une aiguille. Comment on remédie à ce défaut. U.
418. a.
Brides y outils de charron. Defcription'& ufage. H. 418. a.
BRIDES, (Fondeur de cloches) defcription & ufage. II.
418. b.
BRIDGE, mot anglois : origine & fignification de ce mot,
qui termine plufieurs noms géographiques. IX 166. b,
BRIE, des foires de Champagne & de Brie : voye^ F o ir e .
Ancien état de la Brie, dont Meaux eft la capitale. Suppl. III.
892. a.
BRIER la pâte, ( Vermicelier) defcription & ufage de
rinftrument dont on fe fert dans cette opération. Suppl. II.
,52. A
BRIEUC, Saint- (Géogr.) Suppl. IV. 696. a.
BRIÈVETÉ | | Belles-lettres f nuit à la clarté. Suppl. II.
433. <7.
ÉRIGA, terminaifondu nom de quelques villes. II. 420. a.
BRIGADE, ( Art milit. ) partie d’un corps de troupe , foit
a pied foit.à cheval, fous le commandement d’un brigadier.
Dérivation de ce mot. Difpofition des troupes d’une même
brigade dans l’ordre de bataille. Le nombre des bataillons ou
efeadrons de chaque brigade n’eft pas fixé. Rang que fuivent
les brigades. Ce qu’on entend par pofie d'honneur à la guerre.
Brigade dans l’artillerie. U. 419. a.
Brigade : des divifions de l’armée appellées brigades. I.
693. b.
BRIGADIER Brigadier des armées du roi. Inftitution des
brigadiers par brevets. II. 419. a. Le brigadier d’infanterie
dans une bataille eft à cheval. Brigadiers de dragons & de
endarmerie. Il n’eft pas néceffaire d’avoir paffé par la charge
e colonel ou de meftre de camp pour parvenir au titre de
brigadier. Honneurs militaires attachés à la qualité de brigadier.
Autorité des brigadiers d’infanterie, de cavalerie & de
dragons. Ordonnance qui réglé le rang des brigadiers. Leur
paiement. lbid. b.
Brigadiers , leurs marques diftinétives. VIII. 7. b.
B r ig ad ie r , (Ichthy. ) poiffon desMoluques. Sa defcription.
Suppl. IL 32. b. Lieux où il eft commun. Sa daftification.
lbid. 33. a.
BRIGAND , (Bifi. mod.) on donne quelquefois ce nom
aux foldats mal difeiplinés qui défolent un pays. Origine de
Ce mot. II. 420. a.
Brigand y compagnies de brigands que les princes prenoient
a leur folde dans le befoin. lu . 739. a.
. BRIGANDAGE, que les gentilshommes exerçoient autrefois
dans les provinces, III. 312. A & les princes d’Allemagne
pour fe faire juftice entr’eux. IV. 989. A Paâes, de Ganer-
binat à l’occauon de ces brigandages. _ VIL 466. a. Ordre
religieux qui fut inftitué en France pour s’oppofer aux brigandages.
Suppl. IV. 303. a.
BRlGAN TES, peuple compofé de différentes nations, qui
habitoit divers pays de l’Europe. Ce peuple habitait les lieux
les plus élevés. Obfervation fur les noms des villes'qui
finiifent par brica, briga, ou bria. II. 420. a.
BRIGANTIUM, ancienne ville de la Grande-Bretagne.
XVIL 674. I
BRIGANTIN, defcription & ufages de ce petit vaiffeau.
II. 420. a.
BRIGGS, (Henri) profeffeur de mathématiques en Angleterre.
XVIL 673. a.
BRIGITE, ( Sainte ) à quelle occafion elle fonda l’ordre
de S. Sauveur. XIV. 731. a.
BR1GNAIS, B rigno les , (Géogr.) obfervations fur ces
Wticles de l'Encyclopédie. Additions, Suppl. II. 33. a.
Tome J,
BRIGUÉS, chez les Romains ; démarches des afpirans à
une charge pour fe faire élire. La brigue fe fàifoit tout ouvertement
a Rome; on y facrifioit de grandes femmes d’argent.
II. 420. b. 0
Brigues; celles des candidats chez les Romains. H. 39o.a-:
Loix romaines contre les brigues. IX. 634. a. 664. A 667. a.
¿77' b.
BRIL , ( Mathieu & Paul) peintres payfagiftes. V . 313.
, XII. 213. a.'
BRILLANT, lufire, éclat ; différence entre ces mots. IL
420. A -
B r i l l a n t , ( Belles-lettres) fignification de cette épithete
appliquée à l’efj>rit, à l’imagination , à la penfée, au coloris
oc au ftyle. Suppl. IL 33. a.
Brillante penfée. XII. 310. a.
BRINDONES, (Botan.) fruit qui croît à Goa. Defcription
de ce fruit. Ses ufages, H. 421. a.
BRINGARASI, (Botan.) nom brame d’une plante du
Malabar.. Sa defcription. Suppl. II. 33. a. Sa culture. Ses qualités
& ufages. Erreur de J. Commelin. Maniéré de la claifer.
lbid. A
BRIN VILLIERS, (la marquife de ) fameufé empoifen-
neufe. III. 48. a.
BRIONE, (Géogr.) bourg de Normandie fur la Rille, à
l’extrémité du Vexin, avec titre de comté. Ses foires. Son
églife. Conférence tenue à Brione vers 1040, entre les plus
habiles gens de la province & le fameux Beranger. Suppl IL
33. A
B r io n e , (Botan.) vrilles de cette plante. XVIL 493. A
Voyez B ry on e .
BIÙONNE ou B r e a u n e , (Comm.) forte de toile de lin.
Lieux où elle fe fabrique.-Mefure des pièces. Ses différentes
qualités & ufages. Suppl. II. 34. a.
BRIONSowBreons, (Hifi. anc. ) peuples qui compofoient
l’armée d’Aétius contre Attila. Recherches & obfervations
fur ces peuples. Suppl. U. 34. a.
B r io n s , (Pêche) efpece de filets. XVH. 91. A
BRIOUDL, comtes de (Hifi. mod.) Le chapitre de Saint-
Julien de Brioude en Auvergne, eft compofé de chanoines
qui prennent le titre de comtes. Fondation de ce chapitre
lous Louis le Débonnaire , par Berenger, comte de Brioudei.
bidépendance qui lui fut accordée. Foi & hommage auquel
il fut obligé envers le roi. Suppl. IL 34. a. Titres qui le
diftiriguent. Nouvel ordre dont ces chanoines - comtes ont
été décorés en 1772. lbid. A
BRIQUE. Antiquité de l’ufage des briques. Ce que dit'
Tavernier fur certaines ruines qu’on croit être celles des
murs de Babylone. Autres ruines qu’on a prifes pour celles
de la tour de Babel. Briques dont cette mafle eft bâtie. Autres
édifices ' Afiatiques bâtis des mêmes matériaux. L’ufage de
bâtir de brique paffa en Egypte. IL 421. A & enfuite en
Grece. Rome dans fon origine n’étoit qu’un amas de cabanes
de briques. Après avoir bâti quelque tems avec de groffes
pierres, ils revinrent à la brique. Comment les anciens préparaient
leurs briques. Les Grecs en avoient de diverfes
fortes. Les briques parmi nous ont différens noms pris de
leurs formes , de leurs dimenfions, de leur uiàge, & de la
maniéré de les employer. Ces noms indiqués. Maniéré de
faire la brique, lbid. 422. a. Précautions que devroient apporter
les ouvriers pour avoir la brique meilleure qu’ils ne la
font ordinairement. lbid. A Divers endroits d’où la brique
nous vient. Inftruélions pour l’achat de celle de Bourgogne.
On épargneroit beaucoup à louer des ouvriers qui travaillent
la brique fur le lieu où l’on veut l’employer. Forme qu’il
faudroit donner à la brique pour la commodité, la beauté 8c
la folidité. Ufage de la brique appliquée extérieurement ert
médecine. Huile de brique, ou des philofophes. Maniéré de
la faire. Ses propriétés. lbid. 423. a.
Brique, étymologie de ce mot. XV. 213. a. Briques dont
on fe fervoit à Rome. Briques qui nageoient fur l’eau. IX.
820. A Pourquoi l’on défendit autrefois a Rome de faire des
murs de brique. IX. 806. b. Terres à brique qui fe trouvent
en Angleterre. IV. 363. a. De la maniéré de faire la brique»
Quelle eft la meilleure. IX.-820. A Briques en carreaux. II»
699. a , b. De la maçonnerie en brique. IX. 806. A Remarque
fur l’article Brique de l’Encyclopédie. V. 647.
BRIQUET, defcription & ufage. II. 423. a.
Briquet, compôfidon métallique qui fait feu avec le briquet»
VI. 7. A
BRIQUETIER,(^« méchan, ) fupplément à l’article Brique
de l’Encyclopédie. Defcription abrégée, de la maniéré de faire
les briques, tuiles 8c carreaux. Suppl. II. 34. b. Leurs bonnes
qualités dépendent, i°. de la nature de la .terre, 20. de la
maniéré de la corroyer, 30. du degré de cuiffon. — 1°. Choix
8c préparation de la terre. lbid. 33. <z» Expérience par laquelle
les briquetierss’ailùrent de fa qualité. En quel tems de l’année
on tire l’àrgille deitinéé à former des briques. lbid. b, 20. Maniéré
dont on prépare la terre au Havre, oc dans plufieurs autres
briqueteries de France, lbid. 56. a. Comment on la prépare