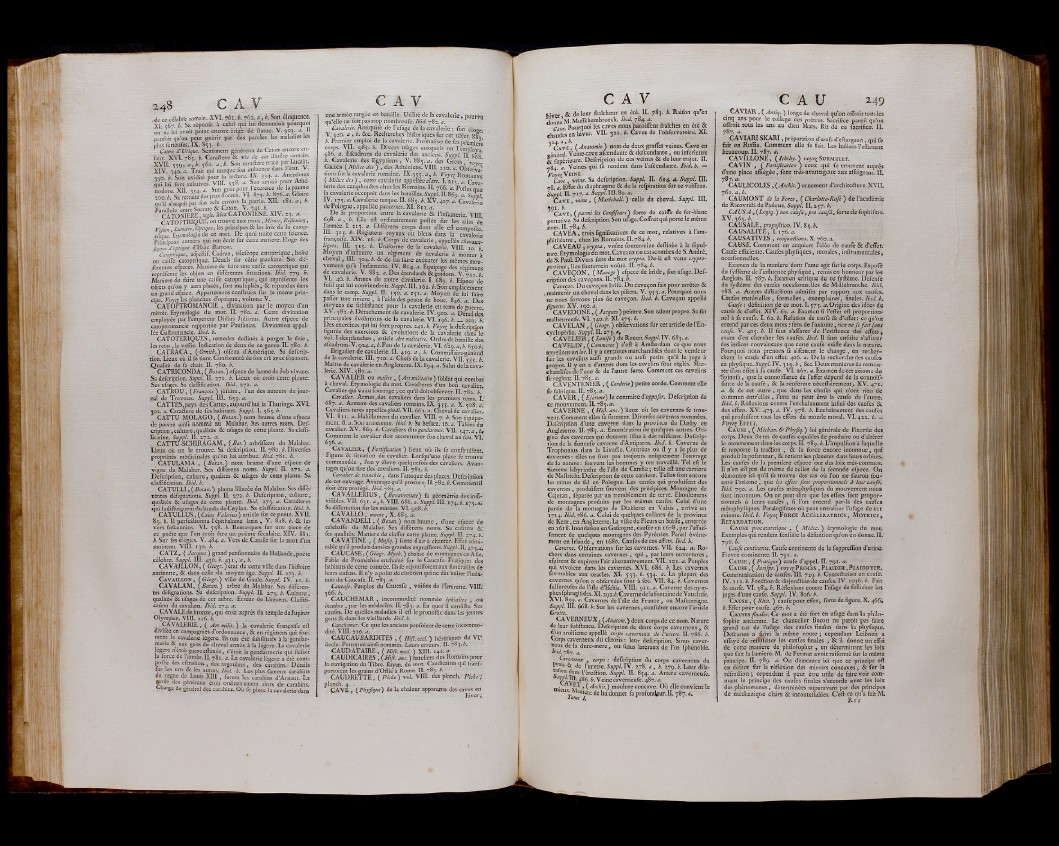
2 4 8 C .A V
.de ce célebVfe romain. XVI. y6i. b. 762. a, ¿. Son éloquence.
XI. 567. b. Sa réponfe à • celui qui lui demandoit pourquoi
on ne lu! avoit point encore érigé dé ftatue. V. 903. a. Il
penfoit qu’on peut guérir par des paroles les maladies les
plus férieufes. IX.833. ¿.
Coton éCUtique. Sentiment généreux de Caton encore enfant.
XVI. 785. i Cara&ere & vie de cet illuftre romain.
-XVII. <<oy ¿S b. <60. a,b. Son caraftere tracé par Lucam.
XIV. 3'àôi a. Trait qui marque fon influence dansai état. ■ .
390. t. Son avidité pour la kitarc. IX. 334-.«-
P lui font relatives. VIII. 53«- '■ « 5§ S S #
nodore. XII. 354- «• Son 200. b, S a retritedes jenixoffuotrpau°xïA. V If. “87T5. f4i n8 76. În. -GSloire
qu’il s’acquit par fon zele envers la patne XII. 181. n, b.
Parallèle entre Socrate & Caton. V .jq r . i-
CATONIERE, réglé* liiez CATONIENE. XIV. 23. a.
CATOPTRIQUE, on trouve aux mots,Miroir,Réflexion,
Vifion Lumière, Optique, les principes & les loix de la catop-
trique. Etymologie de ce mot. De quoi traite cette lcience.
'Principaux auteurs qui ont écrit fur cette matière. Eloge des
leçons d'optique d’Ifaac Barrow.
Catoptrique, adjeftif. Cadran, télefcope catoptrique, boîte
ou caille catoptrique. Détails fur cette machine. Ses différentes
elpeces. Maniéré de faire une caille catoptrique qui
repréfente les objets en différentes fituadons. Ibid. 779. ¿4
.Maniéré de faire une caille catoptriquequi repréfente les
Objets qu’on y aura placés, fort muldpliés, & répandus dans
un grand efpace. Appartenions conftruits fur le même principe.
Voyelles planches d’optique, volume V.
CATOrTROMANCIE , divination par le moyen d’un
miroir. Etymologie du mot. II. 780. a. Cette divination
employée par l’empereur Didius Julianus. Autre efpece de
catoptromancie rapportée par Paufanias. Divination appel-
lée Gaftromancie. Ibid. b.
CATOTERIQUES, remedes deltinés à purger le. foie,
les reins, la veflie. Indication de deux de ce genre. II. .780: b.
ÇATRACA, | Omit h.) oifeau d’Amérique. Sa defcription.
Lieux où il fe tient. Conformité de fon cri avec fon nom.
.Qualité de fa chair. II. 780. b.
CATRICONDA, (Botan.) efpece de larme de Job vivace.
Sadefcription.Suppl. II. 271. ¿.Lieux où croît!cette plante.
Ses ufages. Sa claflification. Ibid. 272. a.
. CATTIOU, ( François ) jéfuite, l’un des auteurs du journal
de Trévoux. Suppl. III. 659. a.
• CATTES,pays des Cattep, aujourd’hui la Thuringe. XVL
302. a. Caraftere de feshabitans. Suppl. I. 365. b.
CATTU MOLAGO, ( Botan. ) nom brame d’une efoece
de poivre ainfi nommé au Malabar. Ses. autres noms. Def-
criprion,culture,qualités & ufages de cette plante. Saclafli-
ïcation. Suppl. II. 272. a.
. CATTU-SCHIRAGAM, (Bot.) arbriffeau du Malabar,
lieux où on le trouve. Sa defcription. II. 780. b. Diverfes
propriétés médicinales qu’on lui attribue. Ibid. 781. b.
CATULAMA , (Botan/) nom brame d’une efpece de
vigne du Malabar. Ses differens noms. Suppl. II. 272. a.
Defcription, culture , qualités & ufages de cette plante. Sa
claflification. Ibid. b.
. CATULLI, I Botan. ) plante.liliacée du Malabar. Ses différentes
défignations. Suppl. II. 272. b. 'Defcription, culture,
qualités &-ufages de cette plante. Ibid. 273. a. Cara&eres
qui ladiftineuentdulunala deCeylan. Sa clalfification. Ibid. b.
CATULLUS, | Cdius Valetius ) article fur ce poëie. XVII.
83. b. Il perfeétionna l’épithalame latin , V. 8x8. b. & les
vers fefcennins. VI. 538. b. Remarques fur une piece de
ce poëte que l’on croit être un poëme féculaire. XIV. 881.
b. Sur fes élégies. V. 484. a. Vers de Catulle fur la mort d’un
moineau. VIIL 130. b.
CATZ, ( Jacques ) grand penfionnaire de Hollande,poëte
célébré. SuppL III. 430. b. 431, a, b.
CAVAILLON, ( Géogr. ) état de cette ville dans l’hifloire
ancienne, & dans celle au moyen âge. Suppl. II. 273. b.
C a v a il lo n , (Géogr.) ville de Gnule. Suppl. IV. xi. ¿.
CAVALAM, ( Botan. ) arbre’ dix. Malabar. Ses: différentes
défignations. Sa defcription. Suppl. II. 273. b. Culture ’,
qualités & ufages.de cet arbre. Erreur de’Linnæus. Claflification
du cavalam. Ibid. 274. a.
. CAVALE de bronze, qui étoit auprès du temple de Jupiter
Olympien. VIIL 216. b.
■ . OAVALERIE," ( An milit.ÿla cavalerie françoife eft
divifée en compagnies d’ordonnance, & en régimens qui fon-1
ment la cavalerie, légère. Ils ont été’ fubftituéfs à la’gèhdàr-
mene & aux gens cheval armés à la légère..La cavalerie
legere n étoit guere eftimée, c’étoit la gendarmerie qui faifoit
la force de 1 armée. II. 781. a. La cavalerie légère a été coni-
polée des .eftradiots, des argoulets , des carabins.* Détails
fur les uns & les autres. Ibid. b. Les plus fameux carabins
du regne de D>uis XIII , furent'les carabins d’Arnaut. La
« des généraux étoit ordinairement alors de carabins,
ymarge. de général des carabins. Où fe place, la cavalerie dans
C A V
une armée rangée en bataille. Utilité de la cavalerie 1 pouiVii
qu’elle ne foit pas trop nombreufe. Ibid. 782. a:
Cavalerie. Antiquité de l’ufage de la cavalerie : fon éloge;
V. 920. a , b. &c. Recherches hiftoriqùes fur cet objet. 882*
b. Premier emploi de la cavalerie. Formation de fes premiers
corps. VU. 983. b. Divers ufages auxquels on l’employa
986. a. Efcadrons de cavalerie des anciens. Suppl. IL 868*
b. Cavalerie des Egyptiens , V. 883. a. des Grecs, 'voyez
Grecs ( Milice• des ) , des Athéniens. VIH. 210. a. Obferva-
tionsfurla cavalerie romaine. IX.333. a, b. '^ / ¿ {R omains
( Milice des) , cette cavalerie appeÜéealare. I. 213. a. Cavalerie
des cataphraéles chez les Romains. II. 766. d. Poftes que
la cavalerie occupoit dans les batailles. Suppl. II. 869. a. Suppl
IV. 173. a. Cavalerie turque. II. 683. b. XV. 427. a. CavalerU
de Pologne, appelléc pancernes. XI. 8 i i . æ.
De la proportion entre la cavalerie & l’infartterie. VUL
698. a , b. Elle eft ordinairement poftée fur les ailes de
l’armée. I. 213. a. Différons corps dont elle eft compofée
HL 315- A. Régimens royaux ou bleus dans la cavalerie
françoife. XIV. 16. b. Corps de cavalerie, appellés chevaux-
3 ers' spi 31 ?* é. Uniforme de la cavalerie. VUI. 10 P
Moyen d’inftruirc un régiment de cavalerie à monter à
cheval, HI. 304. b. & de lui faire exécuter les mêmes mou-
yemens qu’à l’infanterie. IV. 814. 47. Équipage des régimens
de cavalerie. V. 882. a. Des étendards & guidons. V .7 1 1 .b:
VI. 40. b. Armes de notre cavalerie. I. 689. b. Efpece de
fufil qui lui conviendroit. Suppl. UI. 162. ¿. Son emplacement
dans le camp. Suppl. II. 150. *.131.47. Moyen de lui faire
paffer une rivière , à l’aide des peaux de bouc. 846. 47. Des
moyens de fubfiftance pour la cavalerie en tems de guerre.
XV. 382. ¿.Détachement de cavalerie. IV. 900. a. Détail des
principales évolutions de la cavalerie. VI. 196. b 201. b:
Des exercices qui lui font propres. 241. b. Voye| la defcription
figurée des exercices & évolutions de la cavalerie dans le
vol. I dès planches , article Art militaire. Ordre de bataille des
efcadrons. V. 924.47, b. Feu de la cavalerie. VI. 629. a, b. 6-to.b.
Brigadier de cavalerie. II. 419. a , b. Commiffaire-général
de la cavalerie. IU. 710.47. Chefs de la cavalerie. VII. 33 3. b.
Maître de cavalerie en Angleterre. IX. 894.47. Salut de la cavalerie.
XIV. 587.47.
CAVALIER ou maître , (Art militaire ) foldat qui combat
à cheval. Étymologie du mot. Caraéteres d’un bon cavalier.
Cavalier qui va au fourrage | ce qu’il doitobferver. II. 782. ¿/
Cavalier. Armes,des cavaliers dans les premiers tems. î ;
687. *. Armure des cavaliers romains. IX. 333.47. X. 308'. à:
Cavaliers turcs appellésgindi.Vïl. 662.47. Cheval de cavalieri
VI. 811. 47. Habillement du cavalier. VIIL 7. b. Son équipe-,
ment. 8. a. Son armement. Ibid. b. Sa beface. xo. a. Talons du
cavalier. XV. 869. b. Cavaliers dits gendarmes. VII. 347. a, b*
Comment- le cavalier doit accoutumer fon cheval au feu. VI.
636.47.
C a v a l ie r , (Fortification) lieux où ils fe conftruifentJ
Figure &. fituation du cavalier. Lorfqu’une place fe trouve
commandée , l’on y éleve quelquefois des cavajiers. Avantages
qu’pn tire des cavaliers. II. 782. b.
Cavalier de tranchée , dans l’attaque dés places. Defcription
rie cet ouvrage. Avantage qu’il procure. IL 782. b. Commentil
doit être protégé. Ibid. 783. a.
CAVALLERIUS , (Bonaventure) fa géométrie des indï-
vifibles. VII. 631.47,¿ .VIIL6 8 6 . Suppl.III. 174.b. 173.47.
Sa differtatibn fur les marées. VI.'908. ¿.
CAVALLO ,' monte, X. 683. à.
CAVANDELI, (Botan.) nom brame , d’une efpece de
calebaffe du Malabar. Ses différens noms. Sa culture ' &'
fes qualités. Manière de claffer cette plante. Suppl. II. 274. b:
CAVATINE , (Muflq.) forte d’air à chanter. Effet admirable
qu’il produit dansles grandes expreftions. Suppl. ïl.ije.aJ
CAUCASE, (Géogr. Myth.) chaîne de montagnes en Afie.
Fable de Prométhée enchaîné fur le Gaucafe.- Pratiques des
habitans de cette contrée. Ils fe réjouiffoientaux funérailles de
leurs enfans. Il n’y a point de chrétien qui ne dût imiter l’habi-,
tant du Càucafe. IL 783.47.
Caucafe. Peuples du Caucafe , voifins de l’Imirette. VIH.'
366. b.
CAUCHEMAR, incommodité nomm.ée éphialtes , ou
incubus , par les médecins. II. 781.47. En quoi il confifte. Ses
caufes. De quelles maladies il eft le pronoftic ’dans les jeunes1
gens & dans les vieillards. Ibid. b.
. Cauchemar. Ce que les anciens penfoient de cette incommodité.
VIII. 210.'47.
CAUCAUBARDITES , ( Hifl. eccl. ) hérétiques du VI-
fiécle. Pourquoi ainfi nommés. Leurs erreurs. II. 783. ¿.
CAUDATAIRE, ( Hift. mod. ) XIII. i4*-*-
CAUDICAIRES, (Hifl. anc. ) bateliers des Romains pour
la navigation du Tibre. Étym. du mot. Caudicaires qui tranf-,
portoient les grains d’Oftie à Rome. H. 783. b.
CAUDRETTE, ( Pèche) vol. VIH. des planch. Pèche ;
planch. 4.. i . ■
ÇAV E , ( Phyfique) de la chaleur apparente des caves en
hiver,'
C A V C A U M9
& de leur fraîcheur en été. II. 783. b. Raifon qu’en
donne* M. Muffchembroeck. Ibid. 784.0.
Cave Pourquoi les caves nous jîaroiffent fraîches en été oc
chaudes en hiver. VU. 321. b. Caves de l’obfervatoiré. XI.
3 Ca ve ,* ( Anatomie) nom de deux groffeS veines. Cave en
général. Veine-cave amendante & defeertdante , ou inférieure
& fupérieure. Defcription de ces veines & de leur trajet. II.
84. *. Veines qui fe rendent dans l’afcendante. Ibid. b. —■
Cave, veine. Sa defcription. Suppl. ÏÏ. 614. a. Suppl. ni.
78. a. Effet du diaphragme & de la refpiration fur ce vaiffeau.
Suppl. II. 717*a- Suppl. l l l . 80.47.
C a v e , veine, (MaréchalL ) celle du cheval. Suppl. UI,
^ C Av e , (parmi les Confifeurs) forte de caifTe de fer-blanc
portative. Sa defcription. Son ufage. Coffret qui porte le même
nom.n.784.b.
CAVEA, trois Lignifications de ce mot, relatives a 1 amphithéâtre
, chez les Romains, n. 784. b.
CAVEAU, crypta, voûte fouterreine deftinée à la fépul-
ture. Étymologie du mot. Caveaux ou catacombes de S. André,
de S; Paul. Divers fens du mot crypta. De-là eft venu crypto-
porticus, lieu fouterrein voûté. II. 784. ¿.
CAVEÇON, ( Manege ) efpece de bride, ¡Ton ufage. Defcription
des caveçons. II. 784. b.
Caveçon. Du caveçon brifé. Du caveçon fait pour arrêter &
.maintenir un cheval dans les piliers. V . 932.47. Pourquoi nous
ne nous fervons plus de caveçon. Ibid. b. Caveçon appelle
flguette. XV.-190.47.
. C AVEDONE, ( Jacques ) peintre. Son talent propre. Sa fin
malheureufe. VI. 340. ¿. XI. 275. b. IT.
CAVELAN , ( Géogr.) obfervations fur cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. n . 273. *,
CAVELÏER, ( Loutfe ) de Rouen. Suppl. IV. 683. a.
CAVELIN, (Commerce) c’eft à Amfterdam ce que nous'
appellonsun /of. ll.y a certaines marchandifes dont le vendeur
fait les cavelins aufli grands ou aufli petits qu’il le juge à
propos. Il y en a d’autres dont les cavelins font réglés. Marchandifes
de l’une & de l’autre forte. Comment ces cavelins
fe règlent. II. 783.47.
CAVENTENIER, ( Corderie) petite corde. Comment elle
fe fabrique. II. 783.47.
CAVER, (Eflcrime) le contraire d'oppofier. Defcription de
ce mouvement. II. 783. a.
CAVERNE , f Hifl. anc.) lieux ou les cavernes fe trouvent.
Comment eues le forment. Diverfes cavernes nommées.
Defcription d’une caverne dans la province de Darby en
Angleterre. IL 783.47. Énumération de quelques aiitres. Origine
des cavernes qui donnent iffue à des ruiffeaux. Defcription
de la fameufe caverne d’Antiparos. Ibid. b. Caverne de
Trophonius dans la Livadie. Contrées où il y a le plus de
Cavernes : elles ne font pas toujours uniquement l’ouvrage
de la nature: fouvent les hommes y ont travaillé. Tel eft le
fameux labyrinthe de l’ifle de Candie ; telle eft une carrière
de Maftricht. Defcription de cette carrière. Telles font encore
les mines de fel en Pologne. Les caufes qui produifent des
cavernes , produifent fouvent des précipices. Montagne de
Cajetan, féparée par un tremblement de terre. Éboiuemens
de montagnes produits par les mêmes caufes. Celui d’une
partie de la montagne de Diableret en Valais , arrivé en
Ï714. Ibid. 786.47. Celui de quelques collines de la province
de Kent, en Angleterre. La ville de Pleurs en Sniffe, enterrée
en 1618. Inondation en Gafcogne,caufée en 1678, par l’affaif-
fement de quelques montagnes des Pyrénées. Pareil événement
en Irlande, en 1680. Caufes de ces effets. Ibid. b.
Caverne. Obfervations fur les cavernes. VII. 624. a. Rochers
dans certaines cavernes, qui, par leurs ouvertures,
afpirent & expirent l’air alternativement. VII. 101.47. Peuples
qui vivoient dans les cavernes. XVI. 686. b. Les cavernes
favorables aux oracles. XI. 333. b. 334. a. La plupart des
cavernes qu’on a obfervées font à fec. VII. 84. b. Cavernes,
fulfureufes de l’ifle d’Ifchia. Vin. 911. a. Caverne des nymphes
fphragitides. XI. 292.b. Caverne de lafontaine de Vauclufe.
XVI. 839.47. Cavernes de l’ifle de France, ou Mafcareigne.
Suppl. III. 668. b. Sur les cavernes, confulter encore l’article
Grotte.
CAVERNEUX, (Anatom.) deux corps de ce nom. Nature
de leur fubftance. Defcription de deux corps caverneux, &
dun trolfleme appellé corps caverneux de l’uretre. II. 786. b.
Corps caverneux du clitoris : leur defcription. Sinus caverneux
de la dure-mere, ou flnus latéraux de l’os fphénoîde.
Ibid. 787. a. . * . .
Caverneux , corps : defcription du corps caverneux du
Pcrus & de l’uretre. Suppl. IV. 278.47, b. 279. b. Leur dila-
Uon dans l’éreôion. Suppl. II. 834. 47. Artère càverneufe.
« H b. Veine cavemeufe. 487.47.
»ni a î (Archit.) moulure concave. Où elle convient le
“^Manière de lui donner fa profondeur. H. 787.47,
CAVIAR , ( Ànùq. ) longe de cheval qu’on offroit tous les
cinq ans pour le collège des prêtres. Sacrifice pareil qu’on
onroit tous les ans au dieu Mars. Rit de ce lacrifice. II.
787* 47.
CAVIARISKARI, préparation d’oeufs d’efturgeon, qui fe
fait en Ruflie. Comment elle fe fait. Les Italiens l’eftiment
beaucoup. II. 787.47.
CAVILLONE, ( Ichthy. ) voye^ Surmulet.
CAVIN , ( Fortification ) ceux qui fe trouvent auprès
d’une place afliégée, font tres-avantageux aux afliégeans. H»
787.47.
CAULICOLES, (Archit. ) ornement d’architefture. XVII.
761.47, b.
CAUMONT dé la Force > ( Charlotte-Rofe ) de l’académie
de Ricovrifti de Padoue. Suppl. II. 237. b.
CAUSA, (Logiq. ) non caufa, pro caùfâ, forte de fophifmé.
XV. 363. b.
CAUSALE, propofition. IV. 83. b.
CAUSALITÉ, I.176.47.
CAUSATIVES , conjonflions. X. 760.4».
CAUSE. Comment on acquiert l’idée de Caule 8c d’effet.*
Caufe efficiente. Caufes phyfiques, morales, inftrumentales,
occafionnelles.
Examen de la manière dont l’ame agit fur le corps. Expofé
du fyftême de l’influence phyfique, remis en honneur par les
Anglois. II. 787. b. Examen critique de ce fyftême. Défenfe
du lyftême des caufes occafionnelles de Mallebranche. Ibid.
788. 47. Autres diftinétions admifes par rapport aux caufes.
Caufes matérielles, formelles, exemplaires, finales. Ibid. ¿.
Caufe : définition de ce mot. I. 373. a: Origine des idées de
caufe & d’effet. XIV. 62. a. Examen fi l’effet eft proportionnel
à fa caufe. I. 62. b. Relation de caufe & d’effet: ce qu’on
entend par ces deux mots : fens de l’axiome, rien ne fe fait fans
caufe. V. 403. b. Il faut s’affurer'de l’exiftence des effets,
avant d’en cnercher les caufes. Ibid. Il faut énfuite s’affurer
des indices convaincans que cette caufe exifte dans la nature.
Pourquoi nous prenons fi aifément le change, en recherchant
la caufe d’un effet. 406. a. De la recherche des caufes
en phyfique. Suppl. IV. 319. b, 8cc. Deux maniérés de-remon-
ter d’un effet à fa caufe. VI. 267. a. Examen decet axiome de
'Spinofaque la connoiffance de l’effet dépend de la connoif-
fance de la caufe, & la renferme néceffairement, XV. 471.
47. & de cet autre, que dans les chofes qui n’ont rien de
commun entr’elles, l’une ne peut être la caufe de l’autre.
Ibid. b. Réflexions contre l’enenaînement infini des caufes &
des effets. XV. 473. a. IV. 978. b. Enchaînement des caufes
qui produifent tous les effets du monde moral. VL 422. b. —
Voye[ Effet.
- C ause , ( Méckan. 6* Phyfiq. ) loi générale de l’inertie des.
corps. Deux fortes de caufes capables de produire ou d’altérer
le mouvement dans les corps. IL 789. b. L’impulfion à laquelle
fe rapporte la traéfion , & la force encore inconnue, qui
Eroduit.la pefanteur, & retient les plane tes dans leurs orbites^
es caufes de la première efpece ont des loix très-Connues.
Il n’en eft pas de même de celles de la fécondé èfjjece. On
démontre ici qu’il fe trouve des cas où l’on ne fauroit fou-
tenir l’axiome , que les effets font proportionnels à leur caufe»
Ibid. 790. a. Les caufes métaphyfiques du mouvement nous
font inconnues. On ne peut dire que les effets font proportionnels
à leurs caufes , fi l’on entend par-là des caufes
métaphyfiques. Paralogifmês où peut entraîner l’ufage de cet
axiome. Ibid. b. Voyc{ FORCE ACCÉLÉRATRICE, MOTRICE,
Retardat ion.
C ause procataretique , ( Médec. ) étymologie du mot;
Exemples qui rendent fenfible la définition qu’on én donne. II. *
790. b.
Caufe continente. Caufe continente de la fuppreffion d’urine.
Fievre continente. H. 79 1.47.
C ause , ( Pratique) caufe d’appel, n . 791. a.
C ause , ( Jurifvr. ) v o w Procès , Plaider , Plaidoyer.
Communication de caufes. III. 729. b. Conteftation en caufe.
IV. 112. b. Jonction & disjon£tion de caufes. IV. 1036. b. Fait
& caufe. VI. 384. b. Réflexions contre l’iifage de folliciter les
juges d’une caufe. Suppl. IV. 806.* b.
■ C ause , ( Rkét. ) caufe pour effet, forte de figure. X. 466*
b. Effet pour caufe. 467. b.
Cavses finales. Ce mot a été fort en ufage dans la philo-
fophie ancienne. Le chancelier Bacon ne paroît pas faire
grand cas de l’ufage des caufes finales dans la phyfique.
Defcartes a ûiivi la même route ; cependant Leibnitz a
effayé de reflmcitër les caufes finales , & il donne un effai
de cette manière de philofopher , en déterminant les loix
que fuit la lumière. M. de Fermât avoit raifonné fur le même
■principe. H. 789. a. On démontre ici que ce principe eft
en défaut fur la réflexion des miroirs concaves -, & fur la
réfraftion ; cependant il peut être utile de faire voir comment
le principe des caufes- finales s’accorde avec les loix
des phénomènes, déterminées auparavant par des principes
de méchanique clairs & inconteftables. C’eft ce. qu’a fait M*