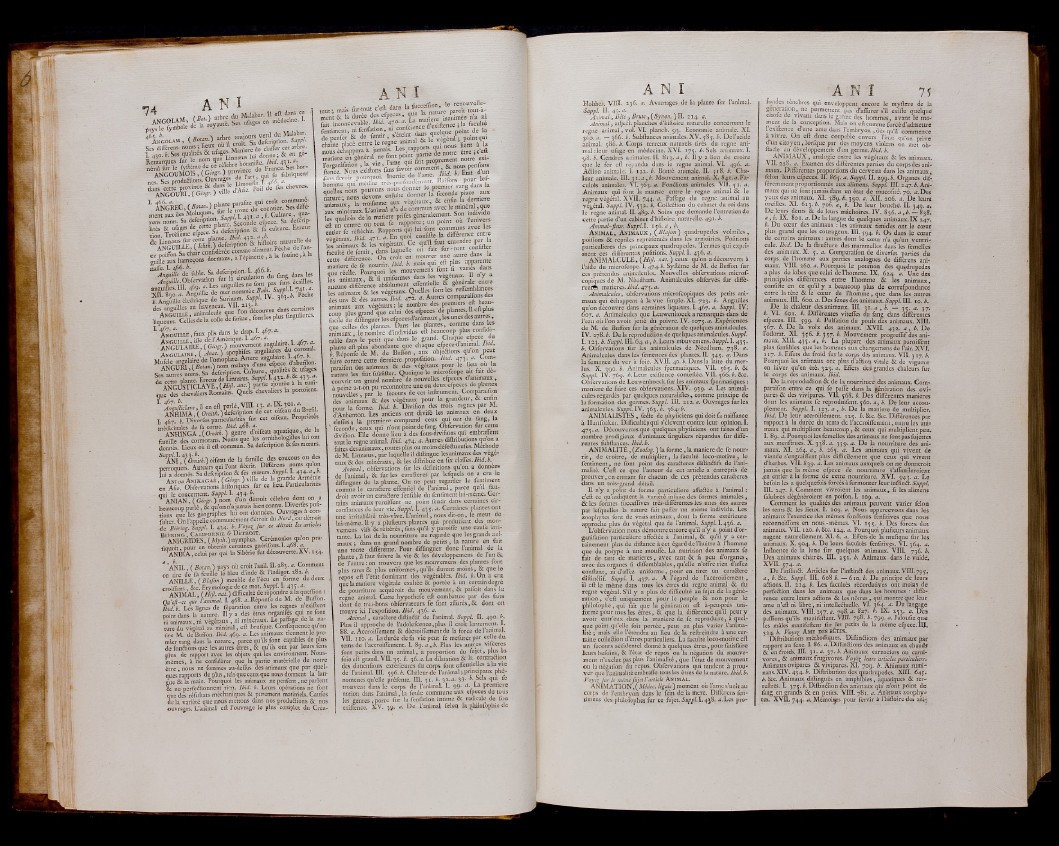
nA A N I
S s r y ü I S S ê p 1. 430. b. S e s qua\ités & g ¿ nnæUs lui donne ; & en ge-
Remarques fur le nom que mi .fte j bi^ m .a.
nèralfur le fy^ème de ce c . ¿e France. Ses bor- I
ANGOUMG1S , (Gregr.) F<w fe fabriquent
«es Ses produftions. Ouvrages de 1 art, 4 ^
?
IS ^ ff.ChCVreS'
lités «& g^ u t e s de SÈ&cett £ & artsi1 cuUure. Erreur ce poiffon. Saehair confidèrèe comnie a m 4 g
guille aux hameçons tam a r is , a Upmette , a la
^ S H U Ê S l i S i i l i fang dans les
f f i É M S u H pas fîifrç- ;sh.
Anguilleélcftrique de Surinam.Suppl IV.. 3 3
des anguilles au havf n<? u' ¡, découvre dans certaines
A n gu il l e , faux plis dans le drap. 1- 4p - a'
I S g u S iM ( « & ) ^mouvement' angulaire. I. 467-1
^GULAUIE, ( Anau) apophifes angulaires du eoronal.
3 f Ê S î ^ S H ^ l è
Je ÎNC JsTrciSvE w “ S) p "^ i 8 s la” “ -
g g r l p 8 l | Quels chevaliers la porroienr.
Î f f f i T S E m I de3 % ^ r d u B r e f f l .
I. 467. 4. Diverfes parücuhrités fur cet oifeau. Propriétés
médicinales de fa corne. Ibid. 468. a. . , ,
ANH1NGA , ( Orailh. ) genre d oifeau aquatique, de la
famille des cormorans. Noms que les ornidiologiftes lut ont
t a f â S u r oh il eft commun. Sa deferipuon Icfesmceurs.
oifeau de la famille des coucous ou des
perroquet Auteurs qui l’on, décrit. Différons noms quon
lui a donnés. Sa defeription & fes moeurs.Suppl. I. 434- *>?•
Ani ou A n ik a g a é , ( Gcogr. ) ville de la grande Arménie
en Afie. Obfervations hiftoriques fur ce Leu. Particularités
<mi le concernent. Suppl. I. 434. b. 1 ,
ANIAN, ( Glogr. ) nom d’un détroit célébré dont on a
beaucoup parlé, & qu’on n’a jamais bien connu. Diverfes portions
que les géographes lui ont données. Ouvrages à con-
fulter. On l’appelle communément détroit du Nord, ou détroit
de Bééring. Suppl. I. ¡ ¡ 1 bVoye^ fur cc détroit Us articles
B é é r in g , C a l i f o r n i e 6* D é t r o i t . ,
ANÎGR1DES, ( Myth.)nymphes. Cérémonies quon pra- 1
tiquoit, pour en obtenir certaines guérifons.I.468. a.
AN1K A , celui par qui la Sibérie fut découverte. XV. 154.
* lÉ B É , ( Bot an. ) pays où croît l’anil. II. 283. ¿. Comment I
on tire de fa feuille le bleu dinde & l’indigot. 282. b
AN IL L E ,(Blafon') meuble de lécu en forme de deux .
croiffans, &c. Etymologie de ce mot. Suppl. I. 43Î- “>•
ANIMAL (HiS. nai.) difficulté de repondre a la queihon.
Qu-tn-cc aùi Vanimai 1. 1§ | a. Réponfe de M. de Buffon. Si A Les lignes de féparation entre les rentes nexffient
point dans la nature. Il y a des êtres orgamfe qui ne font,
ni animaux, ni végétaux , m minéraux. Le paffage de la nature
du végétal au minéral, eft brufque. Conféquencequen
tire M. de BufFon. Ibid. 469. a. Les animaux tiennent le premier
rang dans la nature, parce qu’ils font capables de plus
de fondions que les autres êtres, 8c qu’ils ont par leurs iens
plus de rapport avec les objets qui les environnent. Nous-
mêmes, à ne confidérer que la partie matérielle de notre
être , nous ne fommes au-deffus des animaux que par quelques
rapports de plus, tels'que ceux que nous donnent la langue
& la main. Pourquoi lés animaux ne penfent, ne parlent
%c ne perfectionnent rien. Ibid. b. Leurs opérations ne font
que des réfultats méchaniques 8c purement matériels. Caufes
ae la variété que nous mettons dans nos productions 8c nos
ouvrages. L’animal eft l’ouvrage le plus complet du Créa-
A N Í
B a t ; mais fta p u t c’é f e g h
ment & la durée des efp , q matiere inanimée n’a ni
fait inconcevable. Ibid. 470. a' d’exiftence ; la faculté
f e n t im e n t , nifenfation, ni con queique point de la -
de penfer & de fentir, ^ je v ¿g¿tal ; point qui
chaîne place.entre le reg raoports qui nous lient à la
nous échappera à jamais. Les rapports « g ^
matiere en général ne font p P ement n0tre exil’organifation
, la v ie , 1 am q P j * & nous penfons
ftence. Nous exiftons fans favotr comment■ & d.un
m ^ s m m
m s Ë m m m
iiÉ iiid S ? jB ferdS
nue réeüe. Pourquoi les mouvemens font li vanes aans
I ?es animaux, & fi uniformes dans les végétaux. U n y a
I ,S=SS3£3??^5 animaux aux végétaux: le nombre des premiers elt beau
coup plus grand que celui des efpeces de Plantesd * ^ p' f
facile de diffinguer les efpecesdammaux, les unes desa“ tres ’
que celles des plantes, fcans les plantes, comme dans les
animaux , le nombre d’individus eft beaucoup plus confide-
I I dans le petit que dans le grand. Chaque efpece de
plante eft plus abondante que chaque efpece d animal. Jtid.
I. Réponfe de M. de Buffon, aux obreatons quon peut
faire contre cette demiere propofition. ibid. 473. a. com-
paraifon des ammaux & des végétaux pour le M M
nature les fait fubfffier. Quoique le nucrofcope ait t a découvrir
un grand nombre de nouvelles efpeces d animaux ,
à peine a-t-on pu reconnoître une ou deux efpeces de plantes
I nouvelles, par le fecours de cet inftrument. Comparaifon
des animaux & des végétaux pour la grandeur, & enfin
pour la forme. Ibid. b. Divifton des trois régnés par M.
d’Aubenton. Les anciens ont divifé les ammaux en deux
I claiTes ; la première comprend ceux qui ont du lang, la
1 * fécondé, ceux qui n’ont point de fang. Obfervauon fur cette
divifion. Elle donne Leu à des fous-divifions qui embraflent
L tout le regne animal. Ibid. 474-1 Autres diftribunons qifon a
I faites des animaux, toutes plus ou moins défeftueufes. Méthode
I de M Linnæus, par laqueUe il diitingue lesanimaux des végétaux
& des minéraux I & les diftribue en fix claffes. Ibid. b.
I Animal, obfervations fur les définitions qu’on a données
I de l’animal, & furies caraéleres par lefquels on a cru le
I diftinguer de la plante. On ne peut regarder le fentiment
1 comme le caraâere eflentiel de l’animal, parce quil &11-
I droit avoir un caraftere fenfible du fentiment lui-même. Cer-
I tains animaux paroiflent ne point fentir dans certaines cir-
conftanees de leur vie. Suppl. I. 43 5. a. Certaines plantes ont
I ung irritabilité très-vive. L’animal, nous dit-on, fe meut de
lui-même. Il y a plufieurs plantes qui produifent des mouvemens
vifs & réitérés, fans qu’il y paroiffe une caufe irritante.
La loi de la nourriture ne regarde que les grands animaux
; dans un grand nombre de petits, la nature en fuit
une toute différente. Pour diftinguer donc l’animal de la
plante, il faut fuivre la vie & les développemens de l’un 8ç
de l’autre : on trouvera que les mouvemens des plantes font
plus rares & plus uniformes,qu’ils'durent moins, & que le
! repos eft l’état dominant des végétables. Ibid. b. On a cru
que la matiere végétale exaltée 8c portée à un certain degré
de pourriture acquéroit du mouvement, 8c pafioit dans le
regne animal. Cette hypothefe eft combattue par des faits
dont de très-bons obfervateurs fe font aflùrés,8c dont 011
trouve ici l’expofition. Ibid. 436. a.
Animal, carattere diftinftif de l’animal. Suppl. IL 490. b.
Plus il approche de l’adolefcence,plus il croit lentement. I.
• 88. a. Accroiflement 8c décroiffement de la force de l’animal.
VU. 110. a. La durée de fa vie peut fe mefurer par celle du
tems de l’accroiflement. I. 89. a , b. Plus les autres vifeeres
font petits dans un animal, à proportion du fujet, plus lô
foie eft grand. VU. 35. b. 36.¿.La dilatation 8c la contraétion
des dimenfions extérieures du corps font effentielles à la vie
de l’animal. III. 596. b. Chaleur de l’animal ; principaux phénomènes
qu’elle préfente. III. 31. b .^ .a . l | f ¿. Sels qui fe
trouvent dans le corps de l’animal. I. 99- <*• La première
notion dans l’animal, la feule commune aux efpeces de tous
les genres , porte fur la fenfation intime 8c radicale de fou
exiftence. XY. 39, a. De l’animal félon la çbilofophie de
A N I
Hobbes. VIII. 236. a. Avantages de la plante fur l’animal.
Suppl. IL 4 Î- a'
Animal, Bête , Brute, ( Synon. ) II. 214. a.
Animal, adjeél. planches d’hiftoire naturelle concernant le
regne animal, vol. VI. planch. 93. Economie animale. XI.
360. a. — 366. b. Subftances animales. XV. 585. b. De l’acide
animal. 586. b. Corps terreux naturels tirés du regne animal:
leur ufage en médecine. XVI. 175. b. Sels animaux. I.
98. b. Cendres animales. II. 813. ¿ , b. Il y a lieu de croire
. que le fer eft répandu dans le regne animal. VI. 496. a.
Aétion animale. 1. 1^2. b. Bonté animale. II. 318. b. Chaleur
animale. III. 31 .a ,b . Mouvement animal. A. 841.¿.Facultés
animales. VI. 363. a. Fonctions animales. VII.. 51. a.
Animaux qui font la nuance entre le regne animal 8c le
regne végétal. XVII. 744. a. Paflage du regne animal au
végétal. Suppl. IV. 532. b. Collection du cabinet du roi dans
le regne animal. II. 489. b. Soins que demande l’entretien de
cette partie d’un cabinet d’hiftoire naturelle. 491 .b.
Animal-fleur. SuppL I. 1 *6 .a ,b .
A n im a l , A n im a u x , (Blafon) quadrupèdes volatiles,
poifions 8c reptiles repréfentés dans les armoiries. Pofitions
particuLeres des principaux quadrupèdes. Termes qui expriment
ces différentes pofitions. Suppl. I. 436. a.
ANIMALCULE, (Hifl. nat. ) ceux qu’on a découverts à
l’aide du microfcope. 1. 474. b. Syftême de M. de Buffon fur
ces prétendus animalcules. Nouvelles obfervations microfi-
copiques de M. Néedham. Animalcules obfervés fur différ
e n t matières. Ibid. 475. a.
Animalcules, obfervations microfcopiques des petits animaux
qui échappent à la vue fimple. XL. 723. b. Anguilles
qu’on découvre dans certaines Lqueurs. 1. 467. a. Suppl. IV;
607. a. Animalcules que Leuweimoeck a remarqués dans de
l’eau où l’on avoit ietté du poivre. IV. 1075. ¡1 Expériences
de M. de Buffon lur la génération de quelques animalcules.
IV. 278. b. De la reproduction de quelques animalcules. Suppl.
I. 123. b. Suppl. III. 64. ¿ , b. Leurs mbuvemens. Suppl. I. 43 5.
b. Obfervations fur les animalcules de Néedham. 738. a.
Animalcules dans les femences des plantes. II. 345. a. Dans
la femence du ver à foie. XVII. 40. b. Dans la laite du merlus.
X. 390. b. Animalcules fpermatiques. VII. 563. b. 8c
Suppl. IV. 769. b. Leur exiftence conteftée. V II. <{66. b. 8cc.
Obfervations de Leuwenhoeck fur les animaux ipermatiques :
maniéré de faire ces obfervations. XIV. 939. a. Les animalcules
regardés par quelques naturaliftes, comme principe de
la formation des germes. Suppl. III. 2x2.^. Ouvrages furies
animalcules. Suppl. IV. 363. b. 364/ b.'
ANIMALISTES , feâe de phyficiens qui doit fa naiffance
à Hartfoeker. Difficultés qui s’élèvent contre leur opinion. I.
475^. Découvertes que quelques phyficiens ont faites d’un
nombre prodigieux d’animaux finguüers répandus fur différentes
fubftances. Ibid. b.
ANIMALITÉ, (Zoolog. ) la forme, la maniéré de fe nourrir,
de croître, de multipUer, la faculté loco-motive, le
fentiment, ne font point des caraâeres diitin&ifs de l’animalité.
C ’eft ce que l’auteur de cet article a entrepris de
prouver, en entrant fur chacun de ces prétendus cara&eres
dans un très-grand détail.
Il n’y a point de forme particulière affeélée à l’animal :
c’eft ce qu’indiquent la variété infinie des formes animales,
8c les formes fucceflives très-différentes les unes des autres
par lefquelles la nature fait paffer un même individu. Les
zoophytes font de vrais animaux, dont la forme extérieure
approche plus du végétal que de l’animal. Suppl. 1. 436. a.
JL’obfervation nous démontre encore qu’il n’y a point d’or-
ganifation particüüere affeôée à l’animal, & qu’il y a certainement
plus de diftance à cet égard de l’huitre à l’homme
que du polype à une mouffe. La nutrition des animaux fe
mit de tant de maniérés, avec tant & fi peu d’organes,
avec des organes fi diffemblables, qu’elle n’offre rien d’affez
confiant, ni d’affez uniforme, pour en tirer un caraftere ■
diftinftif. Suppl. I. 437. a. A l’égard de l’accroiffement,
îl eft le même dans tous les êtres du regne animal 8c du
regne végétal. S’il y a plus de difficulté au fujet de la génération
, c’eft uniquement pour le peuple & non pour le
philofophe, qui fait que la génération eft à-peu-près uniforme
pour tous les êtres, & que la différence qu’il peut y
avoir entr’eux dans la maniéré de fe reproduire, à quelque
point qu’elle foit portée, peut au plus varier l’anima-
lité ; mais elle l’étendra au Leu de la reftreindre à une cer-
taùie collection d’êtres particuliers. La faculté loco-motive eft
un fecours accidentel donné à quelques êtres, pour fatisfaire
leurs befoins, & l’état de repos ou la négation du mouvement
n’exclut pas plus l’animalité, que l’état de mouvement
ou la négation du repos. Obfervations qui tendent à prouver
que l’animalité embraffe tous les êtres de la nature. Ibid. b.
Voycrfiirle même fujet l'article ANIMAL.
ANIMATION, (Médec. légaU) moment où l’amc s’unit au
corps de l’embryon dans le fein de la mere. Différens fen-
timens des philofophes fur ce fujet, Suppl. 1, 438, a, Les pro- |
A N I 75
fondes ténebres qui enveloppent encore le myftere de la
génération, ne permettent pas d’aflùrer s’il exifte quelqué
chofc de vivant dans le g^rmc des hommes, avant le moment
de la conception. Mais on eft comme forcé d’admettre
lexdience dune ame dans l’embryon ,dès qu’il commence
a vivre. Un elt donc coupable envers l’état qu’on prive
d’un citoyen, lorfque par des moyens violons on met ob-
ftacle au développemerit d'un germe. Ibid. b.
ANIMAUX, analogie entre les végétaux & les animaux.
VII. 228. ¿. Examen des différentes parties du corps des animaux.
Différentes proportions du cerveau dans les animaux,
félon leurs efpeces. IL 86j. a. Suppl. II. 299, b. Organes dif-,
féremment proportionnés aux alimens. Suppl. III. 247. b. Animaux
qui ne font jamais dans un état de mucofité. 70, ¿. Des
yeux des animaux. XI. 389. A 390. ¿. XII. 206. a. De leurs
oreilles. XI. 613. b. 706. ¿ , b. De leur bouché. II. 349. ¿.
De leurs dents & de leurs mâchoires. IV. 836. a yb. — 838*
a,b. IX. 801. a. De la langue de quelques animaux.IX 247.
b. Du coeur des animaux1: les animaux timides ont le coeur
plus grand que les courageux. III. 594. b. Os dans le coeur
de certains animaux : autres dont le coeur n’a qu’un ventricule.
Ibid. De la ftruéhire des mammelles dans les femelles
des animaux. X. 5. a. Comparaifon de diverfes parties du
corps, de l’homme aux parties analogues de différens animaux.
VIII. 260. a. Pourquoi le poumon des quadrupèdes
a plus de lobes que celui de l’homme. IX. 624. a." Une des
principales différences entre l'homme & les animaux,
confifte en ce qu’il y a beaucoup plùs de correfpondancé
entre la tête & le coeur de l’homme, que dans les autres
animaux. III. 600. a. Des fexes des animaux. Suppl. III. 10. b.
De la chaleur des animaux. III. 2i. ¿ , b. — 33. a. 37*
b. VI. 60 x. b. Différentes vîtefles du fang dans différentes
efpeces. III. 599. b. Pulfation du pouls des animaux. XIII.
<67. b. De la voix des animaux. XVII. 432. ¿ , b. De
1 odorat. XI. 356. b. 257. b. Mouvement progreffif des animaux.
XIII. 433. ¿ , b. La plupart des animaux paroiflent
plus fenfibles que les hommes aux chsngemens de l’air. XVI.
117. A Effets du froid furie corps des animaux. VII. 317. b.
Pourquoi les animaux ont plus d’aétioij vitale & de vigueur
en hiver qu’en été. 323. ¿. Effets des grandes chaleurs fut
le corps des animaux. Ibid.
De la réproduétion & de la nourriture des animaux. Comparaifon
entre ce qui fe paffe dans la génération des ovipares
8c des vivipares. VU. 568. b. Des différentes maniérés
dont les animaux fe reproduifent. 560. ¿ , b. De leur accouplement.
Suppl. I. 123. ¿ , b. De la maniéré de multiplier..
Ibid. De leur accroiflement. 125. b.8cc. &c. Différences par
rapport à la durée du tems de l’accroiffemént, entre les animaux
qui multipLent beaucoup, 8c ceux qui multiplient peu.
I. 89. a. Pourquoi les femelles des animaux ne font pas fujettes
aux menftrues. X. 338. a. 339. a. De la nourriture des animaux.
XI. 264. ¿ , b. 265. a. Les animaux qui vivent de
viande s’engraiffent plus difficilement que ceux qui vivent
d’herbes. VII. 839. ¿. Les animaux auxquels on ne donnerait
jamais que la même efpece dé nourriture s’affimileraient
xen entier à la forme de cette nourriture. XVI. 943. a. Le
befoinles à quelquefois forcés à furmonter leur infuna. Suppl.
IIL 247. b. Comment vivraient les animaux, fi les ahmens
fal ubres dégénéraient en poifon. I. 109. a.
Comment les quahtés des animaux peuvent varier félon
les tems 8c les lieux. I. 109. a. Nous appercevons dans les
animaux l’exercice des mêmes fonctions fenfitives que nous
reconnoiffons en nous-mêmes. VI. 153. b. Des forces des
animaux. VII. 120. b. 8cc. 124. a. Pourquoi plufieurs animaux
nagent naturellement. XI. 6. a. Effets de la mufique fur les
animaux. X. 904. b. De leurs facultés fenfitives. VI. 364. a.
Influence de la lune fur quelques animaux. VIII. 736. b*
Des animaux châtrés. III. 231. b. Animaux dans le vuide.
XVII. 374.
De l’inftinét. Articles fur l’inftinél des animaux. VIII. 795'.
¿ , b. 8cc. Suppl. III. 608 b. — 610. b. Du principe de leurs
a&ions. II. 214. b. Les facultés récordatives ont moins dé
perfection dans les animaux que dans les hommes : différence
entre leurs allions 8c les nôtres, qui montre que leur
ame n’eftni libre, ni intellectuelle. VI. 164. a. Du langage
des animaux. VIII. 237. a. 708. a. 827. b. IX. 233. ¿ .D e s
pallions qu’ils manifeftent. VHI. 798. b. 799. a. Jaioüfieque
les mâles manifeftent fur les petits de la même efpece. 1U.
3 24. b. Voye| Ame d e s bëtes.
Diftributions méthodiques.^ DiftinCtions des animaux par
rapport au fexe. I. 86. a.DiftinCtions des animaux en chauds
8c en froids. III. 31. a. 37. b. Animaux carnaciers ou carnivores
, 8c animaux frugivores. Vov\ Uurs articles particuliers.
Animaux ovipares 8c vivipares. aI. 709. b. Aiiimaüx rumi-*
nans. XIV. 434. b. Diftributiôn des quadrupèdes. XIII. 643.
b, 8cc. Animaux diftingués en amphibies, aquatiques 8c ter-
reftres. I. 373. ¿.DiftinCtion des animaux qiii n’orit point de
fang engranas 8c en petits. VIII. 781. a. Animaux zoophy-
tes, XYÎl, 744. a, Mémoiys pour fervir à l’hiftoire des ani-.