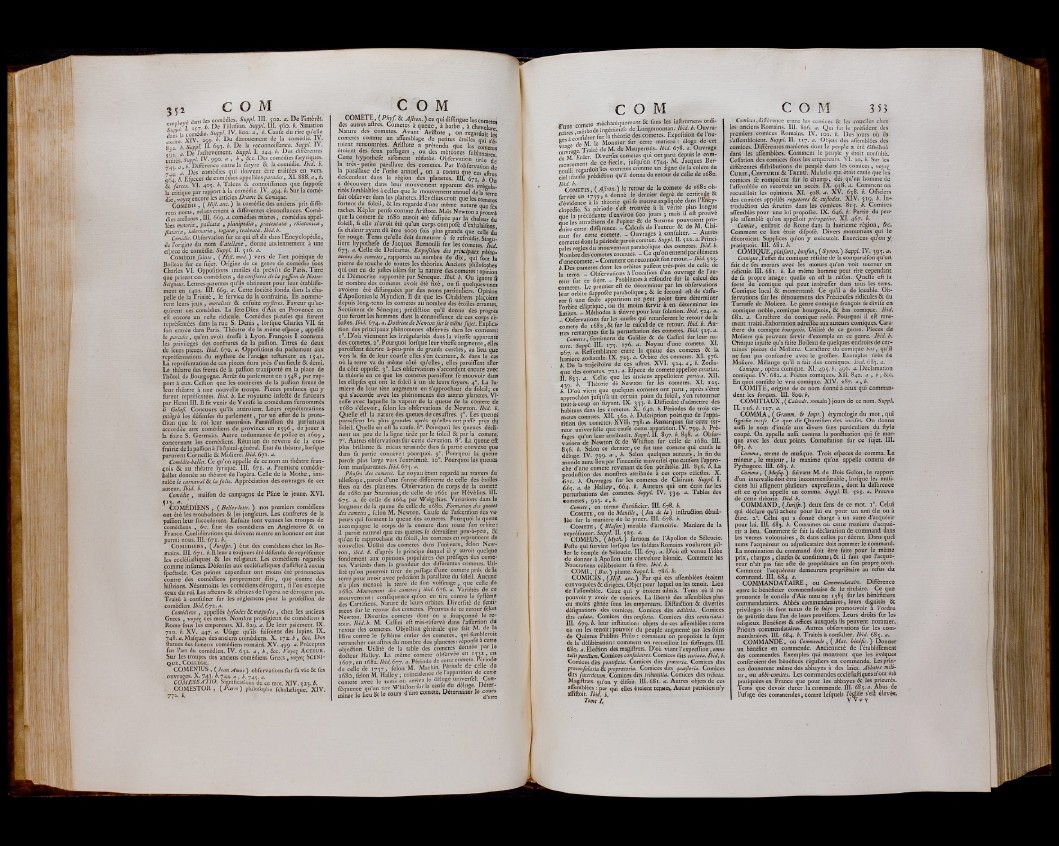
352 C O M
F' le
u , h n s les comédies. Suppl. III. jo î. a. De l’intérêt,
employé <ms 4 De nllufl0„ s L l i i ¿. Situation
5 la comédie. Suppl. IV. 800. o, 4. Caufe du rire qu’elle
x i v . 299. !>• Du dénouement de la comédie. IV.
8?2 b. Suppl. Il- 693. b. De la reconnoiffance. Suppl. IV.
<02 à De l’achevement. Suppl. I. 144. b. Des différentes
unités. Suppl. IV. 990. a , b , &c. Des comédies fatyriques.
a ¿. Différence entre la fatyre & la comédie, lbid. b.
744. a. Des comédies qui doivent être traitées en vers.
064! ¿. Efpcces de comédies appellées parades, XI. 888. a, b.
6 farces. VI. 405. b. Talens 8c connoifTances que. fuppofe
la critique par rapport à la comédie. IV. 494. b. Sur la comédie
voyez encore les articles Drame 8c Comique.
C omédie , ( Htfi. une. ) la comédie des anciens prit diffé-
rens noms, relativement à différentes circonftances. Comédies
atellanes, III. 669. a. comédies mixtes, comédies appellées
motor/a, palliata , planipedia, prxtextatx | rhinton'ux ,
flatarix, tabernarix, togatx, trabeatx. lbid. b.
Comédie. Obfervation fur ce qui eft dit dans l’Encyclopédie,
de l’origine du nom d'atellanc, donné anciennement à une
cfpece de comédie. Suppl. II. 516. a.
C omédie fainte, ( Hijl. mod.) vers de l’art poétique de
Boilcau fur ce fujet. Origine de ce genre de comédie fous
Charles VI. Oppofitions inutiles du prévôt de Paris. Titre
que prirent ces comédiens, de confrères de la pajfion de Noire-
Seigneur. Lettres joatentes qu’ils obtinrent pour leur établiffc-
ment en 1402. ÛI. 669. a. Cette fociété fonda dans la chapelle
de la Trinité , le fervicc de la confrairie. Ils nommèrent
leurs jeux , moralités 8c enfuite myjleres. Faveur qu’acquirent
ces comédies. La fête-Dieu d’Aix en Provence en
eft encore un refte ridicule. Comédies pieufes qui furent
représentées dans la rue S. Denis , lorfque Charles VII fit
fon entrée dans Paris. Théâtre de la même efpece , appellé
le paradis, qu’on avoit dreffé à Lyon. François I confirma
les privilèges des confrères de la paftion. Titres de deux
de leurs pièces, lbid. 670. a. Oppofitions du parlement aux
repréfentations du myftere de l’anqgn teftament en 1541.
La repréfentarion de ces pièces dura près d’un iiecle 8c demi.
Le théâtre des freres de la paffion tranfporté en la place de
l ’hôtel de Bourgogne. Arrêt du parlement en 1548, par rapport
à eux. Ceiuon que les confrères de la paluon firent de
leur théâtre à une' nouvelle troupe. Pièces profanes qui y
furent repréfentées. lbid. b. Le royaume infeélé de farceurs
par Henri III. Il fit venir de Venife le comédiens furnommés
li Gelofi. Concours qu’ils attiroient. Leurs repréfentations
malgré les défenfes du parlement, par un effet de la protection
que le roi leur accordoit. Permiflion du parlement
accordée aux comédiens de province en 1596 , de jouer à
la foire S. Germain. Autre ordonnance de police en 1609 >
concernant les comédiens. Réunion du revenu de la confrairie
de la paftion à l’hôpital-général. Etat du théâtre, lorfque
parurent Corneille 8c Molière, lbid. 671. a.
Comédie-ballet. Ce qu’on appelle de ce nom au théâtre fran-
çois 8c au théâtre lyrique. III. 671. a. Première comédie-
ballet donnée au théâtre de l’opéra. Celle de la Mothe, intitulée/
« carnaval Sx. la folie. Appréciation des ouvrages de cet
auteur, lbid. b. (
Comédie , maifon de campagne de Pline le jeune. XVI.
513. a. ’ .
COMÉDIENS , ( Belles-lettr. ) nos premiers comédiens
ont été les troubadours & les jongleurs. Les confrères de la
paftion leur fucccderent. Enfuite lont venues les troupes de
comédiens , &c. État des comédiens en Angleterre 8c en
France. Gonfidérations qui doivent mettre en honneur cet état
parmi nous. III. 671. b.
C omédiens, ( Jurifpr. ) état des comédiens chez les Romains.
III. 671. b. Il leur a toujours été défendu de repréfenter
les eccléfiaftiques 8c les religieux. Les comédiens regardés
comme infâmes. Défenfes aux eccléfiaftiques d’aftifter à aucun
fpeélacje. Ces peines cependant ont moins été prononcées
contre des comédiens proprement dits, que contre des
hiftrions. Néanmoins les comédiens dérogent, fi l’on excepte
ceux du roi. Les afteurs 8c aétrices de l’opéra ne dérogent pas.
Traité à confulter fur les réglemens pour la profelfton de
comédien, lbid. 672. a.
Comédiens , appcllés lyfiodes 8c magodes , chez les anciens
Grecs , voye[ ces mots. Nombre prodigieux de comédiens à
Rome fous les empereurs. XI. 820. a. De leur paiement. IX.
710. b. XV. 447. a. Ufage qu’ils fàifoient des lupins. IX.
748. a. Mafqucs des anciens comédiens. X. 172. b , &c. Des
ftatues des fameux comédiens romain^. XV. 499. a. Préceptes
fur l’art du comédien. IV. 632. a, b t &c. Voyei A cteur.
Sur les troupes des anciens comédiens Grecs, voye^ Sceni-
QUE, COLLEGE.
COMEN1US , (Jean Amos ) obfervations fur fa vie & fes
. ouvrages. X. 743. b. 744. * , a.
CO MESS A T 10. Significations de ce mot. XIV. 323. b.
COMESTOR , ( Vivre ) phjlofophc fcholaftique. XIV.
C O M
COMETE, ( Phyf. & AJlron. ) ce qui diftingue les cometa
des autres aüres. Cometes à queue, i barbe , à chevelure
Nature des cometes. Avant Ariflote , on regardoit1«
cometes comme un aflemblage de petites étoiles nui
toient rencontrées. Ariflote a prétendu que les cornet«
étoient des feux paflagers , ou des météores fublunairoe
Cette hypothefe aifément réfutée. Obfervation tirée dé
la très - petite parallaxe des cometes. Par l’obfervation de
là parallaxe de l’orbe annuel, on a connu que ces aftres
defeendent dans la région des planetes. III. 672. b. On
a découvert dans leur mouvement apparent des irrégula
rités femblables à celles que le mouvement annuel de la terre
fait obferver dans les planetes. Hévélius croit que les cometes
fortent du foleil, & les regarde d’une même nature que fes
taches. Képler penfe comme Ariflote. Mais Newton a prouvé
que la comete de 1680 auroit été diflipée par la chaleur du
foleil, fi elle n’avoit été qu’un corps compofé d’exhalaifons
fa chaleur ayant dû être 2000 fois plus grande que celle du
fer rouge. Tems qu’elle doit demeurer à fe refroidir. Singulière
hypothefe de Jacques Bernoulli fur les cometes. lbid.
673. a. Celle de Defcartes. Expofaion des principaux phénomènes
des cometes, rapportés au nombre de dix, qui font la
pierre de touche de toutes les théories. Anciens phüofophes
qui ont eu de juftes idées fur la nature des cometes : opinion
de Démocrite rapportée par Séneque. lbid. b. On ignore Ü
le nombre des cometes avoit été fixé, ou fi quelques-unes
avoient été diftinguées par des noms particuliers. Opinion
d’Apollonius le Myndien. Il dit que les Chaldéens plaçoient
depuis long-tems fes cometes au nombre des étoiles errantes.
Sentiment de Séneque; prédiélion qu’il donne des progrès
que feront les hommes dans la connoiffance de ces corps cé-
leftes. lbid. 674. a. Doflrine de Newton fur le mime fujet. Explication
des principaux phénomènes obfervés dans les cometes:
i°. D’où viennent les irrégularités dans la vîtefle apparenté
des cometes. 20. Pourquoi lorfque leur vîtefle augmente, elles
paroiflent décrire à-p’eu-près de grands cercles, au lieu que
vers la fin de leur courfe elles s en écartent, & dans le cas
où la terre va du même côté qu’elles, elles paroiflent aller
du côté oppofé. 30. Les obfervations s’accordent encore avec
la théorie en ce que les cometes paroiflent fe mouvoir dans
les ellipfes qui ont le foleil à un de leurs foyers. 40. La lumière
de leur tête augmente en s’approchant du foleil; ce
qui s’accorde avec les phénomènes des autres planetes. Vî-
teffe avec laquelle la vapeur de la queue de la comete de
1680 s’élevoit, félon les obfervations de Newton. lbid. b.
Quelle eft la nature des queues de ces aftres. 50. Les queues
paroiflent les plus grandes après qu’elles ont pafTé près du
foleil. Quelle en eft la caufe. 6°. Pourquoi les queues déclinent
un peu de la ligne tirée par le foleil 8c par la comete.
7°. Autres obfervations fur cette déviation. 8°. La queue eft
plus brillante & mieux terminée dans fa partie convexe que
dans fa partie concave : pourquoi. 90. Pourquoi la queue
paroît plus large vers l’extrémité. io°. Pourquoi les queues
font tranfparentes. lbid. 675. a.
Phafes des cometes. Le noyau étant regardé au travers du
télefeope, paroît d’une forme différente de celle des étoiles
fixes ou des planetes. Obfervation du corps de la comete
de 1680 par Sturmius;de celle de 1661 par Hévélius. III.
675. a. de celle de 1664 par Weigelius. Variations dans la
longueur de la queue de celle de 1680. Formation des queues
des cometes, félon M. Newton. Caufe de l’afcenfion des vapeurs
qui forment la queue des cometes. Pourquoi la queue
accompagne le corps de la comete dans toute fon Orbite:
il paroit naturel que ces queues fe détruifent peu-à-peu, &
qu’en fe rapprochant du foleil, les cometes en reprennent de
nouvelles. Utilité des cometes dans l’univers, félon Newton
, ib'td. b. d’après le principe duquel il y auroit quelque
fondement aux opinions populaires des prèfages des cometes.
Variétés dans la grandeur des différentes cometes. Utilité
qu’on pourroit tirer du paffage d’une comete près de la
terre pour avoir avec précifion la parallaxe du foleil. Aucune
n’a plus menacé la terre de fon voifinage, que celle,de
1680. Mouvement des cometes ; ibid. 676. a. Variétés de ce
mouvement : conféquence qu’on en tire contre le fyftême
des Cartéficns. Nature de leurs orbites. Divcrfité de fenti-
mens fur le retour des cometes. Preuves de ce retour félon
Newton. Diverfes cometes dont ôn a foùpçonné le retour.
lbid. b. M. Caflini eft très-réfervé dans l’aflertion du
retour des cometes. Objeûion générale que fait M. de là
Hire contre le fyftême entier des cometes, qui fembleroit
retrancher ces aftres du nombre des planetes : reponfe a cette
objection. Utilité de la table des cometes donnée par le
doéleur Halley. La même comete obfervée en ?:£!&?, en
1607, en 1682. Ibid. 677. a. Période de cette comete. Pcnodo
de celle de 1737, félon M. Machin. Mnodç de celle de
1680, félon M. Halley ; coïncidence de 1 apparition de cette
comete avec le tems oit arriva le déluge umverfel. Cou-
féquencc qu'en tire Wltifton fur la caufe du déluge. Déter-
Jn c r le lieu Scie cou« d'une comete. Déterminer le cou«
C O M C O M
méchaniqticmcnt & fans les inftrumens ordi-
ffune : ineénieufe de Longomontan. Ibid. b. Ouvranairfs’
nfulter fur fa théorie des cometes. Expofition de l’ou-
gCSi de M. le Monnier fur cette matière : éloge de cet
mrn-aee Traité de M. de Maupertuis. Ibid. 678. a. Ouvrage
S? M Euler. Diverfes cometes qui ont paru depuis le commencement
de ce fiecle, jufqu’en i 744- M. Jacques Bernoulli
regardoit les cometes comme un figne delacoleredu
ciel rfaulfe prédiftion qu’il donna du retour de celle de z68o.
^ C ometes, ( AJlron.) le retour de la comete de 1682 obfervée
en <759, » donné le dernier degré.de certitude &
d’évidence à fa théorie qui fe trouve expliquée dans l’Encyclopédie.
Sa période s’eft trouvée à la vérité plus longue
oue la précédente d’environ 600 jours ; mats il eft prouvé
oue les attrapions de Jupiter & de Saturne pouvoient prod
u ire cette différence. - Calculs de l’auteur & de M. Uai-
raut fur cette comete. - Ouvrages à confulter. - Autres
cometes dont la période paroît connue. Suppl. II. 522 .a. Principales
réglés du mouvement parabolique des cometes. Iota. b.
Nombre des cometes connues. - Ce qu’on entend par élèmens
d’une comete. - Comment on reconnoît fon retour.- lbid. 5 et.
4 Des cometes dont les orbites paflent tres-pres de celle de
la terre. - Obfervations à l’occafion d'un ouvrage de 1 auteur
fur ce fujet. - Problèmes i réfoudre fur le calcul des
cometes. Le premier eft de déterminer par les obfervanons
leur orbite fuppofée parabolique ; & le fécond eft de s aflu-
rer fi une feule apparition ne peut point faire déterminer
l’orbite elliptique, ou du moins fervir à en déterminer les
limites. - Méthodes à fuivre pour leur folution. Ibid. 524. a.
- Obfervations fur les caufes qui retardèrent le retour de la
comete de 1682,8c fur le calcul de ce retour» Ibid.b. Autres
remarques fur la perturbation des cometes. lbid. 523. a.
Cometes, fentimens de Galilée 8c de Caflini fur leur nature.
Suppl. III. 175- !76- N°yau f une comete- Xf ‘
aÔ7 a. Reffcmblance entre la queue des cometes oc la
lumière zodiacale. IX. 7 Z 3 . q. Orbite des cometes. XL 376.
b De la trajeêoire de ces aftres. XVI. 524. a t b. Zodiaque
des cometes. 711.0. Efpece de comete appellée ceratias.
îï. 833. a. Celle que les anciens appelloient pertica. XII.
439. b. Théorie dè Newton fur les cometes. XL 125.
A D’où vient que quelques cometes ont paru , après s’être
approchées jufqu’à un certain point du foleil, s’en retourner
tout-a-coup en fuyant. IX. 353» Difficulté d’admettre des
habitans dans les cometes. X. 640. b. Périodes de trois cometes
connues. XII. 360. b. Defcription poétique de l’apparition
des cometes. XVII. 738. a. Remarques fur cette terreur
univerfelle que caufe cette apparition. IV. 799. b. Pré-
fages qu’on leur attribuoit. Suppl. il. 897. b. 898. a. Obfervations
de Newton 8c de Whifton fur celle de 1680. III.
¿«6. b. Selon ce dernier, ce fut une comete qui caufa le
déluge. IV. 799. x > b. Selon quelques auteurs, la fin du
monde aura-lieu par l’incendie univerfel que caufera l’approche
d’une comete revenant de fon périhélie. III. 856. b. La
production des monftres attribuée à ces corps céleftes. X.
671. b. Ouvrages fur les cometes de Clairaut. Suppl. I.
663. a. de Halley, 664. b. Auteurs qui ont écrit furies
perturbations des cometes. Suppl. IV. 534. a. Tables des
«ometeà, 923. a9b.
Comete, en terme d’artificier. III. 678. b.
C omete, ou de Manille, (/«« de la) inftruâion détaillée
fur la maniéré de le jouer. III. 678.. b.
C omete, ( Blafon) meuble d’armoirie.' Maniéré de la
repréfenter. Suppl. II. 523. a.
COMEUS, (Myth.) furnom de l’Apollon de Séleucie.
Pefte qui furvint lorfque les foldats Romains voulurent piller
le temple de Séleucie. III. 679. a. D’où eft venue l’idée
de donner à Apollon une chevelure blonde. Comment les
Naucratiens célébraient fa fête. lbid. b.
COMI, (Bot. ) plante. Suppl. I. 786. b.
COMICES, (Hijl. anc. ) Par qui ces affemblées étoient
Convoquées 8c dirigées. Objet pour lequel on les tenon. Lieu
de l’aflemblée. Ceux qui y etoiént admis. Tems où il ne
pouvoit y avoir de comices. La liberté des affemblées plus
Ou moins gênée fous les empereurs. Diftinâion 8c diverfes
défignations des comices. Comices -dits xdilitia. Comices
dits calata. Comices dits cenforia. Comices dits centuriata :
III. 670. b. leur inftitution: objets de ces affemblées : tems
où on les tenoit: pouvoir du peuple augmenté par les foins
de Quintus Publius Philo : comment on propofoit le fujet
de la délibération : comment on recueilloit les fuffrages. III.
É80. a. Eleétion des magiftrats. D’où vient l’expreflion, omne
iulit punflum. Comices confulaires. Comices dits curiata. Ibid. b.
Comices dits pontificia. Comices dits prxtoria. Comices dits
proconfularia oC proproetoria. Comices dits quxjloria. Comices
dits facerdotum. Comices dits tribunitia. Comices dits tributa.
Magiftrats qu’on y élifoit. III. 681. a. Autres objets de ces
«ffeniblécs : par qui elles étoient tenues. Aucun patricien n’y
alfiftoit. Ibid. b.
Tome 1.
Comices,différence entre les comices & les conciles chez
les anciens Romains. III. 806. a. Qui fut le préfident des
premiers comices Romains. IV. 101. b. Des jours où ils
s’affembloient. Suppl. II. 117. a. Objets des affemblées des
comices. Différentes maniérés dont le peuple a été diftribué
dans les affemblées. Comment le peuple y étoit confulté»
Ceffation des comices fous les empereurs. VI. 20. b. Sur les
différentes diftributions du peuple dans les comices, voytç
Curie , C enturie 8c T r ibu . Maladie qui étoit caufe que les
comices fe rompoient fur le champ, dès qu’un homme de
l’affemblée en recevoit un accès. lX» 938. a. Comment on
recueilloit les opinions. XI. 308. a. XV. 638. b. Officiers
des comices appellés rogatores 8c cujlodes. XÎV. 319. b. In*
traduétion des ferutins dans les comices. 813. b. Comices
affemblés pour une loi propofée. IX. 646» b. Partie du peuple
affemblé qu’on appelloit prérogative. XI. 467. b.
Comicet endroit ae Rome dans la huitième région, &c.
Comment ce lieu étoit diipofé. Divers monumens qui le
décoraient Supplices qu’on y exécutoit. Exercices qu on y_
pratiquoit. III. 681. b.
COMIQUE 9plaifant9 bon fon, (Synon.) Suppl. IV. 395* a"
Comique 9l’effet du comique réfulte de la comparaifon qu’on
fait de fes moeurs avec les moeurs qu’on voit tourner en
ridicule. III. 681. b. Le même homme peut rire cependant
de fa propre image : quelle en eft la raifon. Quelle eft la
forte de comique qui peut intéreffer dans tous les tems.
Comique local 8c momentané. Ce qu’il a de louable. Obfervations
fur les dénouemens des Précieufes ridicules 8c du
Tartuffe de Moliere. Le genre comique françois fe divife en
comique noble, comique bourgeois, 8c bas comique. Ibid.
682. a. Caraétere du comique noble. Pourquoi il eft rarement
traité. Exhortation adreffée aux auteurs comiques. Cara-
élere du comique bourgeois. Utilité de ce genre. jPieces dè
Moliere qui peuvent fervir d’exemple en ce genre. Ibid. b.
Critique injuue qu’a faite Boileau de quelques endroits de certaines'
pièces de Moliere. Caraélere du comique bas, qu’il
ne faut pas confondre avec le groflier. Exemples tirés de
Moliere. Mélange qu’il a fait des comiques, ibid. 683. a.
Comique y opéra comique. XI. 493. b. 496. a. Déclamation
comique. IV. 682. a. Poètes comiques. XII. 842. a , b , 8çc.
En quoi confifte le vrai comique. XIV. 287. a , b.
COMITE, origine de ce nom donné à ceux qui commandent
les forçats. III. 800. b.
COMITIAUX, ( Calendr. romain) jours de ce nom. SuppL
II. 116. b. 117. a.
COMMA, (Gramm. 8* Impr. ) étymologie du mot, qui
fignifie incife. Ce que dit Quintiuen des incifes. On donne
aufii le nom d’incife aux divers fens particuliers du ftyle
coupé. On appelle aufii comma la ponâuation qui fe marque
avec les deux points. Conteftation fur ce fujet. III.
083. b.
Comma, terme de mufique. Trois efpeces de comma. Le
mineur, le majeur , le maxime qu’on appelle comma de
Pythagore. III. 683. b.
Comma, ( Mufiq. ) fuivant M. de Bois Gélou, le rapport
d’un intervalle doit être incommenfurable, lorfque les mufi-
ciens lui aflignent plufieurs exprefiions, dont la différence
eft ce qu’on appelle un comma. Suppl. II. 323. a. Preuve
de cette théorie, lbid. b.
COMMAND, ( Jurifp. ) deux fens de ce mot. i°» Celui
qui déclare qu’il acheté pour lui ou pour un ami élu ou à
élire. 20. Celui qui a donné charge à un autre d’acquérir
pour lui. III. 683. b. Coutumes où cette maniéré d’acquérir
a lieu. Comment fe fait la déclaration de command dans
les ventes volontaires, 8c dans celles par décret. Dans quel
tems l’acquéreur ou adjudicataire doit nommer le command.
La nomination du command doit être faite,pour le même
prix, charges, claufes 8c conditions ; 8c il faut que l’acquéreur
n’ait pas fait afte de propriétaire en fon propre nom»
Comment l’acquéreur demeurera propriétaire au refus du
command. III. 684. a.
COMMANDATAIRE, ou Commendataire. Différencè
entre le bénéficier commendataire 8c le titulaire. Çe què
prononce le concile d’Aix tenu en 1383 fur les bénêficiers
commendataires. Abbés commendataires, leurs ^ dignités 8c
privilèges : ils font tenus de fe faire promouvoir à l’ordre
de prètrife dans l’an de leurs proVifions. Leurs droits fur les
religieux. Bénéfices 8c offices auxquels ils peuvent nommer.
Prieurs commendataires» Autres obfervations fur les commendataires.
ÜI. 684» b. Traités à confulter. Ibid. 683. a.
COMMANDE, ou Commentée, ( Mat. bènèfic. ) Donner
un bénéfice en commende. Ancienneté de l’établiffement
des commendes. Exemples qui montrent que les évêques
conféraient des bénéfices réguliers en commende. Les princes
donnèrent même des abbayes à des laïcs. Abbates milites
, ou abbi-comites. Les commendes eccléfiaftiques n’ont été
pratiquées en France que pour les abbayes 8c les prieurés.
Tems que de voit durer la commende. ÏII. 685. a. Abus de
l’ufage des commendçs, contre lefquels l’égUfe s’eft élevée,