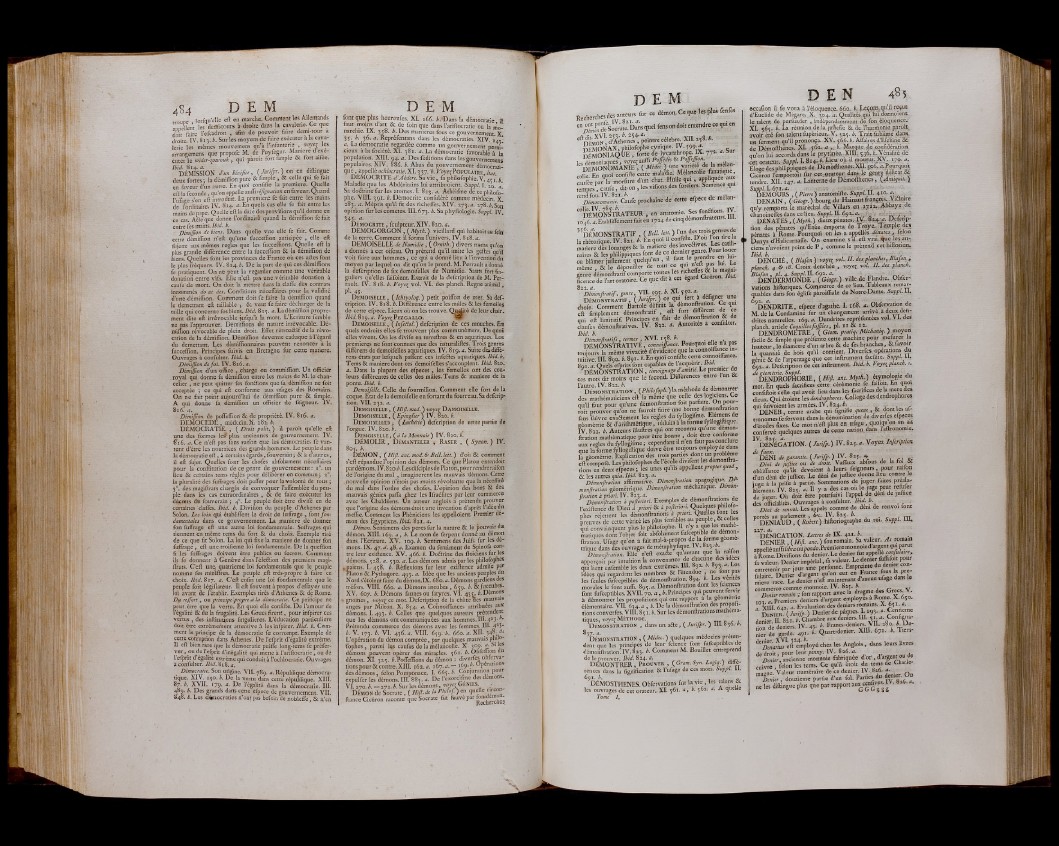
4 8 4 D E M
iorftju’clle eft en marche. Gommentles Allemands
annexent les demi-tours à-droite dans la cavalerie. Ce que
doit faire l’efcadron , afin de pouvoir faire demi-tour a
droite. IV. 813 .b. Sur les moyens de faire exécuter a la cavalerie
les mêmes mouvemens qu’à l’infanterie , voyez les
arrangemens que propofe M. de Puyfegur. Maniéré d exécuter,
le wider-çourouk, qui paroit fort fimple & fortaifée.
lbid.D É8M14IS. SaI. ON d'un bénéfice, (, Jru n-frp r. \f o n en d.fhn~gu kei
deux fortes ; la démiffion pure & fimple, & celle qui Te Bit
en faveur d’un autre. En quoi confifte la première. Quelle
eft la fécondé, qu’on appelle vMrefignatton en faveur. Quand
l’ufaee s’en eft introduit. La première fe fait entre les mains
de l’ordinaire! IV. 814. a. En quels cas elle fe fait entre les
mains du pape. Quelle eft la date des proyifions qffiildonneen
ce cas. Ailé que donne lordinaire quand la démuiion le tait
entre fes mains. lbid. b. v
I Démiffion de biens. Dans quelle vue elle fe fait. Comme
cette démiffion n’eft qu’une fucceffion anticipée , elle eft
fujerte aux mêmes réglés que' les fucceflions. Quelle eft la
plus grande différence entre la fucceflion & la démifliori de
biens. Quelles font les provinces de France où ces ailes font
le plus fréquens. IV. 814. b. De la part de qui ces démiflions
ïe pratiquent. On ne peut la regarder comme une véritable
donation entre vifs. Elle n’eft pas une véritable donation à
caufe de mort. On doit la mettre dans la claffe dès contrats
innommés do ut des. Conditions néceffaires pour la validité
d’une démiflion. Comment doit fe faire la démiflion quand
le démettant eft taiUable 5 & veut fe faire décharger de la
taille qui concerne fes biens, lbid. 813. a. La démifliori proprement
dite eft irrévocable ÿufqu’à la mort. L’Ecriture femble
ne pas l’approuver. Démiflions de nature irrévocable. De-
million révocable de plein droit. Effet rétroa&if de la révocation
de la démiflion. Démiflion devenue caduque à l’égard
du démettant. Les démiflionnaires peuvent renoncer à la
fucceflion. Principes fuivis en Bretagne fur cette matière.
Ouvrages à confulter. lbid. h.
Démiffion de foi. IV. 816. a.
Démiffion d’un office , charge ou commiflion. Un officier
royal qui donne fa démiffion entre les mains de M. le chancelier
, ne peut quitter fes fondions que fa démiffion ne foit
acceptée ; ce qui eft conforme aux ufages des Romains.
On ne fait point aujourd’hui de démiffion pure & fimple.
A qui donne fa démiffion un officier de feigneur. IV.
816. 4.
Démiffion de poffeffion & de propriété. IV. 816. a.
DEMOCEDE, médecin. X. ¡ § 1 b.
DÉMOCRATIE 1 ( Droit polit. ) il paroît qu’elle eft
une des formes le# plus anciennes de gouvernement. IV.
#16. a. Ce n’eft pas fans raifon que les démocraties fc vantent
d’être les nourrices des grands hommes. Le peuple dans
la démocratie eft, à certains égards, fouverain ; & à d'autres,
il eft fujet. Quelles font les chofes abfolument néceffaires
pour la conititution de ce genre de gouvernement: i°. un
lieu & certains tems réglés pour délibérer en commun ; 20.
la pluralité des fuffrages doit paffer pour la volonté de tous 5
30. dés magiftrats chargés de convoquer l’affemblée du peuple
dans les cas extraordinaires , & de faire exécuter les
décrets du fouverain ; 40. Le peuple doit être divifè en de
certaines clafles. lbid. b. Divifion du peuple d’Athenes par
Solon. Les loix qui établiffent le droit de luffrage , font f ondamentales
dans ce gouvernement. La maniéré ,de donner
fon fuffrage eft une autre loi fondamentale. Suffrages qui
tiennent en même tems du fort & du choix. Exemple tiré
de ce que fit Solon. La loi qui fixe la maniéré de donner fon
fuffrage, eft une troifieme loi fondamentale. De la queftion
fi les fuffrages doivent être publics ou fecrets. Comment
ils fc donnent à Genève dans l’éleâion des premiers magi-
ftrars. Ceft unq quatrième loi fondamentale que le peuple
nomme fes mimftres. Le peuple jeft très-propre à faire ce
choix. lbid. 817. a. C’eft enfin une loi fondamentale que le
peuple foit légiflateur. Il eft fouvent à propos d’effayer une
loi avant de rétablir. Exemples tirés d’Athènes & de Rome.
Du reffort, ou principe propre à la démocratie. Ce principe ne
peut .être que la vertu. En quoi elle confifte. De l’amour de
l’égalité & de la frugalité. Les Grecs firent, pour infpirer ces
vertus , des inftitutions fmgulieres. L’éducation particulière
doit être extrêmement attentive à les infpirer. lbid. b. Comment
le principe de la démocratie fe corrompt. Exemple de
cette corruption dans Athènes. De refont d’égalité extrême.
II eft bien rare que la démocratie puiffe long-tems fe préfer-
ver , ou de l’efprit d’inégalité qui mene à l’ariftocratie, ou de
l ’efprit d égalité extrême qui conduit à l’ochiocratie. Ouvrages
à confulter. lbid. 818. a.
Démocratie. Son origine. VII. 789. a. République démocratique.
XIV 150. b. De la vertu dans cette réplique. XIII.
o Ü » *79- a- légalité dans la démocratie. III.
489. b. Des grands dans cette efpece de gouvernement. VII.
»48. b. Les démocraties n’ont pas befoin de nobleffe, & ri’en
D E M
font que plus heureufes. XI. 166. ¿/"Dans la démocratie il
faut moins d art & de foin que dans l’ariftocratie ou la monarchie.
IX. 338. b. Des maniérés fous ce gouvernement. X.
33. b. 36. a. Repréfentans dans les démocraties. XIV.
a. La démocratie regardée comme un gouvernement pernicieux
a la fociété. XI. 381. a. La démocratie favorable à la
population. XIII. 94. a. Des féditions dans les gouvernemens
populaires. XIV. 886. b. Abus du gouvernement démocrati-
que, appellé ochlocratie. XI. 337/4. Voye^ Populaire état
DÉMOCRITE d'Abdere. Sa vie, fa philofophie. v ! 43 ï y
Maladie que les Abdéritains lui attribuoient. Suppl. I. îo>* ^
Sa doétrine fur les atomes. I. 823. a. Athéifme de ce philôfo-
phe. VIII. 391.4. Démocrite confidéré comme médecin. X.
283. a. Mépris qu’il fit des richeffes. XIV. 273. a. 278.4. Son
opinion fur les cometes. III. 673.4. Sa phyftologie. Suppl. IV.
343. *.
D emocrite , fculpteur. XIV. 820. a.
DEMOGORGON, (Myth.) vieillard qui habitoit au feirf
de la terre. Comment il forma l’iuiivers. IV. 818. <7.
DEMOISELLE de Numidie, ( Omit h.) divers noms qu’on
a donnés à cet oifeau. On prétend qu’il imite les géftcs qu'il
voit faire aux hommes, ce qui a donné lieu à l’invention du
moyen par lequel on dit qu’on le prend. M. Perrault a donné
la defeription de fix demoifelles de Nuiriidie. Sauts fortfm-
guliers qu’elles fàifoient. Extrait de la defcription.de M. Perrault.
IV. 818. 4. Voye{ vol. VI. des planch. Regne animal,
P '-45-
D emoiselle, (Ichtyolog.) petit poiflon de mer. Sadéf-
cription. IV. 818.4. Différence entre les mâles & les femelles
de cette efpece. Lieux où on les trouve. Qualité de leur chair.
lbid. 819. a. Voye^ Pezgallo.
D emoiselle, (Infeflol.) defeription de ces mouches. En
quels endroits elles fe trouvent plus communément. De qrioi
elles vivent. On les divife en terreftres & en aquatiques. Les
premières ne font connues que des naturaliftes. Trois genres
différens de demoifelles aquatiques. IV. 819 .a. Suite dès différens
états par lefquels paffent ces infeétes aquatiques. lbid. 4.
Tems & maniéré dont ces demoifelles s’accouplent. lbid. 820.
a. Dans la plupart des efpeces, les femelles ont des coih
leurs différentes de celles des mâles. Tems & maniéré de la
ponte. lbid. b.
Demoifelle. Celle du fourmilion. Comment elle fort de la
coque. Etat de la demoifelle en fortant du fourreau. Sa deferip?
tion. VIL 232. a.
D emoiselle , ( Hift. mod. ) voyez D emoiselle.
D emoiselle, (Epingliez) IV. 820.4.
D emoiselles , (Luthêrïe) defeription de cette partie de
l’orgue. IV. 820.4.
D emoiselle, (à la Monnaie) IV. 820.4.
DÉMOLIR, D émanteler £ Raser , ( Synon. ) IV.
805. 4.
DÉMON, ( Hift. anc. mod. & Bell. lett. ) d’où & comment
s’eft répandue l’opinion des démons. Ce que Platon entendoit
par démons. IV.820.4. Les difciples de Platon, pour rendre raifon
de l’origine du mal, imaginèrent les mauvais ’démons. Cette
.nouvelle opinion ri’étoit pas moins révoltante que la néceflité
du mal dans l’ordre des chofes. L’opinion des bons & des
mauvais génies pafla cher les IfraéUtes par leur commerce
avec les Chaldéens. Un auteur anglois à prétendu prouver
que l'origine des démons étoit une invention d’après l’idée du
meffic. Comment les Phéniciens les appelloient. Premier démon
des Egyptiens. lbid. 821. a.
Démon, oentimens des peres fur la nature & le pouvoir du
démon. XIII. 169. a , 4. Le nom de ferpent donne au démon
dans. l’Ecriture. XV. 109. 4. Sentimens des Juifs fur les démons.
IX. 47. d. 48. a. Examen du fentiment de Spinofa contre
leur exiitence. XV. 466.4. Doârine des ftoïciens fur les
démoris. 328. a. 330. a. Les démons admis par les philosophes
, païens. I. 438. 4. Réflexions fur leur exiftence admife par
rlatori & Py thagore. 493 . a. Idée que les anciens peuples du
Nords’étoient faite du démon.lX. 600. a. Démons gardiens des
XV. 607. 4. Démons faunes ou fatyres. V V 431- 4. Démons
\ gnomes, voye^ ce mot. Defeription de la chiite aes mauvais
anges par Milton. X. 854. a. Connoiflances attribuées aux
démons. I. 493. 4. Celles que quelques auteurs prétendent
que les démons ont communiquées aux hommes.ilL 4a3-
Prétendu commerce des démons avec les femmes. III. 4a3*
4. V. 17^. 4. VI. 436. a. « g 639. *4. 660. a. XII. 34°;
L’opération du démon comptée, par quelques mauvais phnO"
tfbphcs, parmi les caufes de la mélancolie. X- 309; *eS
démons peuvent opérer des miraples. 361. 4. Öbfemon du
démon. XL 323. 4.Poflefliohs du démon : diverfes obierva-
tions pour & contre. XIIL 162. a. 167. a.— tff^.b. Opération
des démons, félon Pompônace. I. 663. 4. Conjuration po
expulfer les démons. III. 883.0. De l’cxorcifme des démons.
VI. 270.4. - 272.4. Sur les démons, vovirOÉNiES. -
Démon de Socrate 1 ( H,fi. de la Philof) en quclle circon
fiance Cicéron raconte que Socrate fut firnvé par ^.^erches
D E M D E N
R e c h e r c h e s ,» ,« fur « démoq. Ce ,ttê ^ g g
CnÆ « S f s o c r â c !bm s quel fenson doit entendrece qui en
^Démon1, S t h e n i 4, peintre célébré’XII. »58. b.
7 7 , u- Sur
tempes , caufe, dit-on, les vifions,des forciers. Semence qui
^ Ô l i r ' c a u f e prochaine de cette efpece de mêla«-
“ d ÉMO^TOATEUR , en anatomie. Ses fonaïons. IV.
TO ^™ E ,a b h ffem en .fa i.en . 7a4 deeinqdemonftra.eurS.III.
3’ d é m o n s t r a t i f , (Bell B > D ^ f l ’l^ r i r c t
la rhétorique. IV. U s cafill-
S T s c les phffippiques fom de ce
r êm e T & ’f ^ X ' r î o n t ce q a ^ p a s^
heure déihôriftmif comporte tum c s l c s ncheires & la magu
lcei.ee de l'art oratoire. Ce que dit à cet égard Cicéron. Ibtd.
■ Dimonflratif. genre. VII. 195* SI. 5J°.
Démo n stra tif, (Jurifir._) ce qui fert à
chofe. Comment Bariole définit h f utonftrad°n Ce qui
eft Amplement démonflratif . eft fort différen^: de ce
qui eft limitatif. Principes en fait de démonftratton & de
âaufes démonftrafives. ÎV. 8aa. e. Autorités a confulter.
Démonftratifs, termes ; XVI. 138. 4. . ,
DÉMONSTRATIVE, connoijfance. Pourquoi elle n a pas
lONSTRATION , témoignage d amitié. iae premier w
:es mots dit moins que le fécond. Différences entre lun &
“ d é m o n s t r a t i o n , (P/iihfiph.) la méthode de démontrer
les mathématiciens eft la même que celle
ni’il faut pour qu’une démonftrauon foit parfaite. On pour-
•oit prouver qu’on ne fauroit faire une bonne demonftration
’ans ?,.ivre exaftement les réglés fy tttÿifmK Bémetts de
■éomêtrie & d'arithmétique, rêdmttà la forme fyllomftique.
V 812. b. Auteurs illuftres qui ont reconnu qu une démon-
Iration mathématique pour être bonnedoit être “ nforme
rax réglés du fyUogifme ; cependant il n en fiiut pas conclure
me la forme fyllogiftique doive être toujours employée dans
[a géométrie. Exphcat.on des ttois parues dont un problème
ïfteompofé. Les philofophes de l’école div.fent les démonftra-
lions endeux efpeces; fes unes qu’ils appellent pr»p«r}i«,<i,
& .es antres qu:a. lbid. 813. a. . . ,
Dbmonflration affirmative. Dlmonfrnuon apagogtque. Dl-
mïnjlrbnoii géométrique. Démonfiratton méchamque. Démon-
Exempies de “ ariens de
l’exiftence de Dieu l priori Sc ipofle,
phes rejettent les démonflrauons n priori. Quelles font la
preuves de cette vérité les plus fenf.bles au peuple , & celles
qui convainquent plus le philofophe. 11 n y a que les mathématiques
don. l’objet foit abfolument fufcepnble àoàémon.
ftration. Ufage qu’on a fait mal-à-oropos de la forme géomê-
trique dans des ouvrages de métaohyfique. IV. 823
Démonflration. Elle n’eft exaéle qu autant que la raifon
apperçoit par intuition la convenance de chacune des idées
qui lient enfemble les deux extrêmes. III. 892. 4. 893. j. Les
idées qui regardent les nombres & 1 étendue , ne font pas
les feules fulceptibles de démonflration. 894. 4. Les vérités
morales le font auffi. 893.V1. Démonflration dont les fciences
font fufceptibles. XVII. 70. * , 4. Principes qui peuvent fervir
à démontrer les propofttions qui ont rapport à la géométrie
élémentaire. VII. 634. a , 4. De la démonflration des p r o f i tions
converfes. VIII. 8 31.4. Sur les démonftrations mauiéma*
tiques, voyeç Méthode. •
D é m o n s t r a t i o n , dans un aéle, ( Jurïfpr. ) III. 030.-0.
D é m o n s t r a t i o n 1 (Médec.) quelques médecins prétendent
que les principes de leur fcience font fufceptibles de
démonflration. IV. 823. 4. Comment M. Bouillet entreprend
de le prouver. lbid. 824. a. .
DÉMONTRER , Prouver , (Gram.Syn. Lom■) ailte-
renccs dans la fignification & l’ufage de ces mots. Suppl. II.
69.1. 4. . 1 1 a,
DÉMOSTHENES. Obfcrvations fur la Vie , les talens ec
les ouvrages de cet orateur. XI. 361. a» 4. 362; a. A quelle
Tome I,
4 0 5
oçcafion il fe voua à l'éloquence. 660. 4. Ç jo s .r e ç u t
d’Éuctide de Mégare. X. 304. a. Qualités,qui lui donnpient
le talent de perfuader , indépendamment de fon éloquençe.1
XL 363. 4. La réunion de la jqfteffe 8c de Vh^nionie. pptoîlt,
avoir été fon talent fupèrieuç. V. 323. 4. Trrit-fobliiue dans.
un ferment qu’il prononça. XV. ^66.4. Afl^esjiEiclun.ê*SiT
de Démoftlienes. XI. ^562; a.?;;4. .Marqitô Ae^ofidéranôa
qu’iin lui accorda dans le prytanée..X«L; ( j U Vénalité dé
.cet orateur. Suppi. I. 8141M Lieu; ou. >1 jnounit-XV 170.
Éloge des plrilippiquesde.
Cicéron l’emportoit fur ifiSfe “ i 1%
tendre. XÏL 147. n. Lanterne de Démoftlienes,
Suppl.1. 671. a. r ■*'..%’} i : â:: ' '
DÈMOURS , (Pierre) anatomifte. Suppl. II. 4 10* u-1 j
DENAIN, CGiogr.) bourg du Hainaut françois. Viitoire
qu’y remporta le maréchal de. Villars en • 17 ' r^hbaye e
chanoineffes dans ce lieu. SuppLII. 692.Âriufb’e »:•' ^ r il
DÉNATES, ( Myth. ) dieux pénates; J y . 824^. Delcrip-
tion des pénates qü’Enée emporta de Troÿe. Temple des
pénates à Rome. Pourquoi on les a appellés menâtes , ielon
Denys d’Halicarnaffe. On examine s’il., eft vrai .-que le j an,-.
ciens n’avoient point de P , comme le prétend cet hiitofien.
^D Q fCH É , ( Sinfon ) vojKl vol. II. Jesplnnobes, Blnfonl
planch, 4 «• 18. Croix denchée , veyej, vol ll.-des planch.
£‘a^ w d w A O & E , 6^Géogr.) ville de Flandre. Obfer-
varions hiftoriques. Commerce de ce heu. Tableaux remar-
quahles dans fon églife paroifliale de Notre-Dame. Suppl. IL
6 iDENDRITE, efpece d’agathe. L 168. a. Obieryarion de
M. de la Condamine fur un changement arnyê a deux den-
drites naturelles. 169. a. Dendrites repréfentées vol. VI. des
planch. article CoauiüesfoJfiUs, pl. n Sc 12. .
DENDROMETRE, ( Giom. praua. Mechamq. ) moyeu
facile 8c fimple que préfente cette machine pour mefurer la
hauteur, le diametre d’un arbre 8c de fes branches, 8c lavoir
la quantité de bois qu’il contient. Diverfes. opérions du
génie 8c de l’arpentage que cet infiniment fiici^te. Smpl. il.
% i . a. Defeription de cet infirument. IbiiA. Voye^planch. 1.
^ÉeNDROPHORIE, {H,fi. anc. Myth.) étymologie du
mot. En quels facrifices cette cérémonie fe faifoit. En quoi
eonfiftoit celle qui avoit lien dans les faeirifices de 1a ¡U'« dea
dieux. Qui étoient les Jenirophores. College des dendrophores
qui fuivoient les armées. IV. 814. é. ; . a l
DENEB, terme arabe qui figmfie queue , 8c dont les al
ttonomes fe fervent dans la dénominanon de dtverfes « P « «
d’étoiles fixes. Ce mot n’eft plus en ufage ,
confervé quelques autres d e c e t t e nauon dans laftronomie.
IVDÉ?/éCÀTION. ( Jmlfp. ) IV. 815. a. Voyez Infirlpllon
* & N I de garantie. ( Jurifp. ) IV. 825. a, _
Déni de juftice ou de droit. Vaffaux abfous de la toi aÇ
obéiffance qu’ils devoient à leurs feigneurs, pour raifon
d’un déni de juflice. Le déni de juft.ee donne lien contre le
juge à la prife à partie. Sommations de juger, faites préalar
blliuent fv . 82 t a. Il y a des cas où le juge peut reffifer
de juger. Oh doit être pourfuivi l’appel de déni de juftice
des officialités. Ouvrages à confulter. ,w»* 0.
Dlni de renvoi. Les appels comme de déni de renvoi font
portés au parlement, Sec. IV. 815. b.
DENIAUD, ( Robert) hiftonographe du roi. Suppl 111,
“ ’ SêNICATION. Lettres de IX. 411. b.
DENIER ( Hiß. une.) fou romain. Sa valeur. As romain
appelle auffifiéraoupcndo.Premiercnionnoiedargentqui parut
entretenir par jour une perfonne. E^mpran.e du iemer » n .
10%.u. Premiers deniers d’argent employés à Rome. X. 650.
, îrin 641. a. Evaluation des deniers romains. X. 651. a.
DenIeR (.Jurifp.) Denierde pâques. L 193. «.Çenneme
dcmcr Îl S a , Æhambreaux deniers.Ul. t i.4 . Conf.gna-
9 A. dmiers IV. 43- i- Francs-demers. VII. 280. i.D e -
“ " de ^ d é 'N *- Quart-denier. XIU. 6 7 , ê. Tiers-
‘‘'S a L N r em p io y é c h e z les Anglois, dans leurs livres
d’or | B i
cuivre , félon les tems. Ce qu’il étoit du tems de Lnarle-
mavne. Valeur numéraire de ce denier. IV. Sa*, a.
Denier, douzième partie d’un fol. Parues <hi
ne les diffingue plus que par rapport aux_«nfive W »