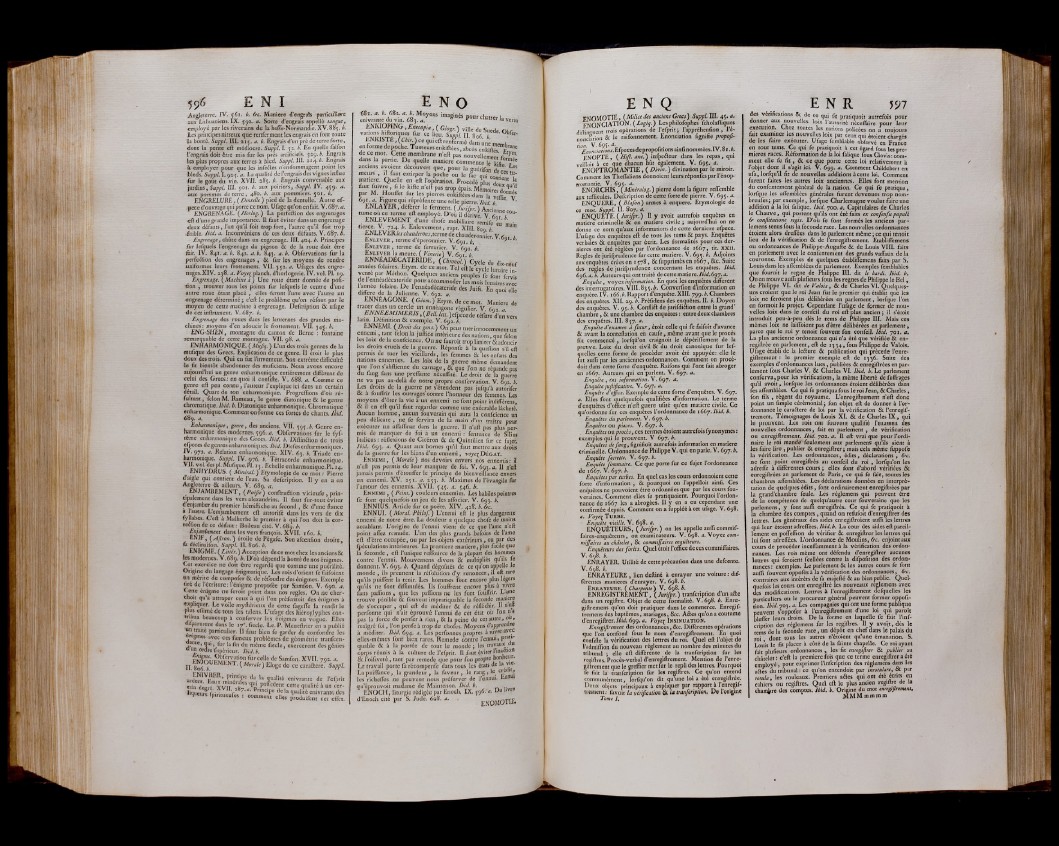
5 96 E N I
Angleterre. IV. 561. b. &c. Maniéré d'engrais particulière
aux Lithuaniens. IX. 592. a. Sorte d’engrais appellé tangue,
employé par les riverains de la baffc-Normanaic. XV. 885. b.
Les principes nitreux que renferment les engrais en font toute
la bonté. Suppl. III. ai«, a. b. Engrais d’un pré de-terre forte,
dont la pente eft médiocre. Suppl. I. 52. b. En quelle faifon
l’engrais doit être mis fur les p rè s artificie ls. 3 29. b. Engrais
les plus propres aux terres à bled. Suppl. III. 214. b. Engrais
à employer pour que les inieéles n’endommagent .point les
bleds. Suppl. 1. 925. a. La qualité de l’engrais des vignes influe
fur le goût du vin. XVII. 28f. A Engrais convenable aux
jardins, Suppl. III. 501. b. aux poiriers, Suppl. IV. 4*9. a.
aux pommes de terre, 480. b. aux pommiers. 501. b.
EnGRELURE, (Dentelle) pied de la dentelle. Autre ef-
,pece d’ou vrage qui porte ce nom. Ufage qu’on en fait. V. 687. a.
ENGRENAGE. ( Horlog. ) La perfection des engrenages
eft d'une grande importance. Il faut éviter dans un engrenage
deux défauts, l’un qu’il foit trop fort, l’autre qu’il loir trop
.¿bible. Ibid. a. Inconvéniens de ces deux défauts. V. 687. b.
Engrenage, chûte dans un engrenage. III. 404. b. Principes
fur lefquels l’engrenage du pignon & de la roue doit être
bit. IV. 841. a, b. 842. a. b. 843. a. b. Observations fur la
perfeâion des engrenages , & fur les moyens de rendre
-uniformes leurs rrottemens. VII. 352.4. Ufages des engre-
nages.Xl V. 238. a. Voyt[ planch. d’horlogerie. IV. vol. PL 10.
Engrenage. (Machinea) Une roue étant donnée de pou-
don , trouver tous les points fur lefquels le centre d’une
autre roue étant placé , elles feront l’une avec l’autre un
engrenage déterminé ; c’eft le problème qu’on réfout par le
moyen de cette machine à engrenage. Defcription & ufage
de cet infiniment. V. 687. b.
Engrenage des roues dans les lanternes des grandes machines:
moyens d'en adoucir le frottement. VIL 345. b.
ENGSEOEN, montagne du canton de Berne : fontaine
remarquable de cette montagne. VIL 98. a.
ENHARMONIQUE. (Mufiq. ) L’un des trois genres de la
mufique des Grecs. Explication de ce genre. Il étoit le plus
doux des trois. Qui en fut l’inventeur. Son extrême difficulté
le fit bientôt abandonner des muficiens. Nous avons encore
aujourd’hui un genre enharmonique entièrement différent de
celui des Grecs; en quoi il confifte. V . 688. a. Comme ce
genre eft peu connu, l’auteur l’explique ici dans un certain
détail. Quart de ton enharmonique. Progreffions d’où résultent
, félon M. Rameau, le genre diatonique & le genre
chromatique. Ibid. b. Diatonique enharmonique. Chromatique ’
enharmonique. Comment on forme ces fortes de chants. Aid.
689. a.
Enharmonique, genre, des anciens. VII. 595. b. Genre enharmonique
des modernes. 596. a. Obfervations fur le fyf-
tême enharmonique des Grecs. Ibid. b. Diftinftion de trois
efpcces de genres enharmoniques. Ibid. Diefescnharmoniqucs.
IV. 972. a. Relation enharmonique. XIV. 63. b. Triade enharmonique.
Suppl. IV. 976. b. Tétracorde enharmonique.
/ Iî ' ^ffiellcenharmonique.Pl. 14.
ENHYURUS. ( Minéral.) Etymologie de ce mot ; Pierre
d aigle qui contient de l’eau. Sa defcription. Il y en a en
Angleterre & ailleurs. V. 689. a.
, ENJAMBEMENT, ( Poéfie ) conflruétion vicieufe, principalement
dans les vers alexandrins. Il faut fur-tout éviter
d enjamber du premier hémiftiche au fécond, 8c d’une fiance
a 1 autre. L’emjambement eft autorifé dans les vers de dix
fyUabes. C’eft à Malherbe le premier à qui l’on doit la correction
de ce défaut : Boileau cité. V . 680. b.
Enjambement dans les vers françois. XVIL 160. b.
. » ( -djinn. ) étoile de Pégafc. Son afcenfion droite,
fa déclination. Suppl. II. 806. b.
ENIGM E. ( Littér. ) Acception de ce mot chez les anciens 8c
les modernes. V, 689. b. D’ou dépend la bonté de nos énigmes.
Cet exercice ne doit être regardé que comme une puérilité.
Origine du langage énigmatique. Les rois d’orient fc faifoient
un mérite de comnofer 8c de réfoudre des énigmes. Exemple
tiré de l’écrit tire: l’énigme propofée par Samfon. V. 690. a.
Cette énigme ne fcroit point dans nos règles. On ne clier-
choit qu’à attraper ceux à qui l’on préferitoit des énigmes à
-expliquer. Le voile myftérieux de cette fageffe la rendit le
plus eftimé de tous les talens. L’ufage des hiéroglyphes ‘contribua
beaucoup à conferver les énigmes en vogue. Elles
«^parurent dans le i f . fiecle. Le. P.Mcneftricr en a publié
_ tnutc particulier. Il faut bien fe garder de confondre les
daîilT*1 avcS ces ^ameux problèmes de géométrie tranfeen-
,1*„„ * <j ui y ur hh du même fiecle, exercèrent des génies
«un ordrefupéricur. Ibid.b.
Irir celle de Samfon. XVII. 792. a.
II 8o« i T ' ( A W '> *^°6e 1 « aÜ B iJ é . Suppl.
E N O
681. a. ». 68i. a b Moyens imaginés pour clmrtr la v.
enivrante du vin. 683. a. 1 ! " i f ,a vertu
ENKIOPING, Erteeopia, ( Géoer 1 ville. 4» ç . „
v e n k i s t é T « ' v r “ LNKISTE, ( CiirJ ce qui eft reSnufpeprLm "é• d a*n°s6 u- n*e fcr'
en forme d e M c h e . T u m e u r s e n k if t é e s , a b c è s e n ld fté , p ” c
de ce mot. Cette membrane n'eft pas nouvellement f» 5’? '
dans la partie. De quelle maniéré commence lé ï J on?ie
anciens avoient découvert que, pour la euérifon j S S
meurs , il faut eittirper la poehe ou le | c cÎ? J CCS
matière. Quelle en eft l’opération. Procédé ïlus T “ " ' ,*
faut fuivre , fi le kifte n’eft pas trop épais. m L ou« ï
par M. Houffct fur les picircs cuUées clansT v
8“' ^ ^ “ “ “ "etcHe pierre.Vi,V. i V’
ENLAYER, déférer le ferment. (Jurifpr. ) Ancienne
tumeouce terme eft employé. D’où il dfrivl V 601 *
ENLEVEMENT d’une chpfe mobiliairc mmlfcT„ mai»
tierce. V. 714. b. Enlèvement, rapt. XIII. 800 b
ENLEVER/rrcW.«/ir,termede chauderonnicr’ 1
E n l e v e r , terme d’éperonnicr. V. 6 9 1 . b. * °
E n l e v e r , terme de ferruricr. V. 6 9 1 'b.
E n l e v e r la meute. ( Vénerie) V. 6 0 1 b
ENNÉADÉCATERlDE, (chronA) Cycle de dix-neuf
années folaires. Erym. de ce mot. Tel eft le cycle i f e s Ë »
venté par Méihon. Quelques anciens peuples fe font fervii
de 1 ennéadécateridejioiir accommoder les mois lunaires avec
d î E “ r i n w t “ ^ d “ E ” <“ “ >i H
ENNÉAGONE. ( Giorn. ) Etym. de ce mot. Manière de
tracer dans un cercle un ennéagone régulier. V 602 S
latin. Définition & exemple. V. 692. b.
ENNEMI. (Droit des gens.) On peut tuer innocemment un
ennemi, tant félon la juftice intérieure des nations, que félon
les loix de la confciencc. O11 ne fauroit trop limiter ¿adoucir
les droits cruels de la guerre. Réponfe à la queftion s’il eft
permis de tuer les vieillards, les femmes 8c lesenfans des
nations ennemies. Les loix de la guerre même demandent
que 1 on s’abftienne du carnage, 8c que l’on ne répande pas
du fang fans une preffante néceffité. Le droit de la guerre
ne va pas au-delà de notre propre confcrvation. V. 69a. b.
Les droits de la guerre ne s’étendent pas jufqu’à autorifer
8c à fouffrir les outrages contre l’honneur des femmes. Les
moyens d’ôrer la vie à un ennemi ne font point indifférons,
8c il en eft qu’il faut regarder comme une exécrable lâcheté.
Aucun homme, aucun louvcrain qui aura la confcience un
peu délicate , ne fe fervira de la main d’un traître pour
exécuter un affaffinat dans la guerre. Il n’eft pas plus permis
de manquer de foi à un ennemi : fentence de Siliui
Italicus: réflexions de Cicéron 8c de Quintilien fur ce fujer.
Ibid. 6 9 3 . a. Quant aux bornes qu’il faut mettre aux droits
de la guerre fur les biens d’un ennemi, voyez DÉ G AT.
E n n e m i , ( Morale ) nos devoirs envers nos ennemis : il
n’eft pas permis de leur manquer de foi. V. 693.4. Il n’eft
jamais permis d’étouffer le principe de bienveillance envers
un ennemi. XV. 251. a. 253. b. Maximes de l’évangile fur
l’amour des ennemis. XVIL 545. 4 . 546. b.
E n n e m i , (Peint.) couleurs ennemies. Les habiles peintres
fe font quelquefois un jeu de les affocicr. V. 6 9 3 . b,
ENNIUS. Article fur ce poëtc. XIV. 428. b. 6/c.
ENNUI. (Moral. Philo/l) L’ennui eft le plus dangereux
ennemi de notre être. La douleur a quelque chofe de moins
accablant. L’origine de l’ennui vient de ce que l’ame n’eft
point affez remuée. L’un des plus grands befoins de l’amc
eft d’être occupée, ou par les objets extérieurs, ou par des
fpéculations intérieures. La première maniéré, plus facile que
la fécondé, eft l’unique rcffoiircc de la plupart des hommes
contre l’ennui. Mouvemens divers 8c multipliés qu’ils fe
donnent. V. 6 9 3 . b. Quand dégoûtés de ce qu’on appelle le
monde, ils prennent la réfolution d’y renoncer, il eft rare
qu’ils puiffent la tenir. Les hommes font encore plus légers
qu’ils ne font diflimulés. Ils fouffrent encore plus à vivre
uuis pallions, que les pallions ne les font fouffrir. Lanté
trouve pénible oc fouveut impratiquable la fécondé manicre
de s’occuper , qui eft de méditer 8c de réfléchir. Il ne»
perfonne qui n’ait éprouvé l'ennui de cet état où l’on na
pas la force de penfer à rien. 8c la peine de cet autre, ou,
malgré foi, l’on penfe à trop de choies. Moyens d’apprendre
à méditer. Ibid. 694. a. Les perfonnes propres à vivre ayee
elles-mêmes font bien rares. Rcmedc contre l’ennui» PraVT
qtiable 8c à la portée de tout le monde ; les ,ra^.a U „
eprus réunis à la culture de l’efprit. Il faut éviter 1 inaction
8c 1 oifiveté, tant par rcmedç que pour fon -propre bonheur.
Le travail porte fa récompense dans tous les états de la v* •
La puiflance, la grandeur, la faveur, le rang » le cj^<l 4
les richeffes ne peuvent nous préferver de l’ennui. Lnnut
qu’éprouvoit madame de Maiutenon. Ibid. b.
ENOCH, liturgie rédigée par Enoch. IX. 596?«. Du Jiv
d’Enoch cité par S. Jude. 608. a. . ENOMOTIE»
E N Q
E N O M O T I E , (Milice des anciens Grecs) Suppl. III. 45. a.
E N O N C I A T IO N . ( Logiq. ) Les philofophes fcholaftiques
diftineuenr trois opérations de l’efprit ; l’appréhenfion , l’é-
nonoation 8c le raifonnement. Enonciation fignifie propofitl°
Eiwnciations. Efpcces de propofitions ainfi nommées. IV. 81. b.
ENOPTE, (Hijl. anc.) infpe&cur dans les repas, qui
veilloir à ce que chacun bût également. V. 693. a.
ENOPTROMANTIE, ( Divin. ) divination par le miroir.
Comment les Theffaliens donnoient leurs réponfes par l’énop-
rromantie. V. 695. a. _
ENORCHIS, (Minéralog.) pierre dont la figure reffemble
aux tefticules. Defcription de cette forte de pierre. V . 695. a.
ENQUERE, (Bla/on) armes à enquere. Etymologie de
ce mot. Suppl. IL 807. a.
ENQUÊTE. ( Jurifpr.) Il y avoit autrefois enquêtes en
matière criminelle 8c en matière civile ; aujourd’hui on ne
donne ce nom qu’aux informations de cette aernicre efpece.
L’ufage des enquêtes eft de tous les tems 8c pays. Enquêtes
verbales 8c enquêtes par écrit. Les formalités pour ces dernières
ont été réglées par l’ordonnance de 1667, tit. x x i i .
Réglés de jurifprudence fur cette matière. V . 693. b. Adjoints
aux enquêtes crées en 1578, 8c fupprimés en 1607, 8cc. Suite
des réglés de jurifprudence concernant les enquêtes. Ibid.
696.4. b. Auteurs qui ont traité de cette matière. Ibid. 607. a.
Enquête, voyez, information. En quoi les enquêtes différent
des interrogatoires. VIII. 835. A Converfion d information en
enquête. IV. 166.b. Rapport d’enquête. XIII. 799. b. Chambres
des enquêtes. XII. 29. b. Préfidens des enquêtes. II. b. Doyen
des enquêtes. V. 95. b. Confliâ de jurifdiction entre la grand’
chambre, 8c une chambre des enquêtes : entre deux chambres
des enquêtes. III. 857. 4.
Enquête d’examen à futur, étoit celle qui fe faifoit d’avance
8c avant la conteftation eh caufe, même avant que le procès
fut commencé , lorfqtPon craignait le dêpêriflement de la
preuve. Loix du droit civil 8c du droit canonique fur lesquelles
cette forme de procéder avoit été appuyée: elle le
fut auffi par les anciennes ordonnances. Comment on procé-
doit dans cette forte d’enquête. Raifons qui l’ont fait abroger
en 1667. Auteurs qui en parlent. V. 697. a.
Enquête , ou information. V . 697. a.
Enquête jujlificative. V. 697. a.
Enquête d office. Exemple de cette forte d’enquêtes. V . 697.
4. Elles font quelquefois qualifiées d’information. Le terme
d’enquêtes d’office n’eft guere ufité qu’en matière civile. Ce
qu’ordonne fur ces enquêtes l'ordonnance de 1667. Ibid. b.
Enquêtes du parlement. V . 697. b.
Enquêtes ou pièces. V. 697. b.
Enquêtes ou procès, ces termes êtoient autrefois fy nonymes :
exemples qui le prouvent. V 697. b. _
Enquêtes de fang, fignifioit autrefois information en matière
criminelle. Ordonnance de Philippe V. qui en parle. V. 697. b.
Enquête fecrette. V. 697. b.
Enquête fommaire. Ce que porte fur ce fujet l’ordonnance
de 1667. V. 697. b.
Enquêtes par turbes. En quel cas les cours ordonnoient cette
forte d’information , 8c pourquoi on l’appelloit ainfi. Ces
enquêtes ne pouvoient être ordonnées que par les cours fou-
vcraincs. Comment elles fe pratiquoient. Pourquoi l’ordonnance
de 1667 les a abrogées. Il y en a eu cependant une
confirmée depuis. Comment on a fuppléé à cet ufage. V . 698.
4 . Voyez T u r b e .
Enquête vieille. V . 698. a.
ENQUÊTEURS, ( Jurifpr.) on les appelle aufficommif-
faires-enquêteurs, ou examinateurs. V. 698. 4. Voyez com-
miffaires au châtelet, 8c commiJJaires enquêteurs.
Enquêteurs des forêts. Quel1étoit l’office de ces commiffaircs.
V. 698. b.
ENRAYER. Utilité de cette précaution dans une defeente.
V. 698. b.
ENRAYEURE, lien deftiné à enrayer une voiture: différentes
maniérés d’enrayer. V. 698. b.
ENRAYEURE. (Charpente) V. 698. b.
ENREGISTREMENT, (Jurifpr.) tranfeription d’unaéle
dans un regiftre. Objet de cette formalité. V. 698. b. Enrc-
gifiremens qu’on doit pratiquer dans le commerce. Enrcgif-
tremens des baptêmes, mariages, 8cc. Aâes qu’on a coutume
d’enregiftrer. Ibid. 699.4 . Voye[ I n s i n u a t i o n .
Enregifirement des ordonnances, 8cc. Différentes opérations
que l’on confond fous le nom d’enregiftrement. E11 quoi
confifte la vérification des lettres du roi. Quel eft l’objet de
l’admiffion du nouveau règlement au nombre des minutes du
tribunal ; elle eft différente de la tranfeription fur les
reeiftres. Procès-verbal d’enregiftrement. Mention de l’enre-
giftrcmentque le greffier met lur le repli des lettres. Pourquoi
le fait la tranfeription fur les reeiftres. Ce au’on entend
communément, lorfqu’on dit qu une loi a été enregiftrée.
Deux objets principaux à expliquer par rapport à l’cnregif-
tienient.- l'avoir la vérification 8c U tranfeription. De l'origine
Tome J,
E N R V)l
des vérifications 8c de ce qui fi* pratiquoit autrefois pour
donner aux nouvelles loix l'autorité néceffairc pour leur
exécution. Chez toutes les nations policées on a toujours
fait examiner les nouvelles loix par ceux qui étoient chargés
de les faire exécuter. Ufage femblable obfervé en France
en tout tems. Ce qui fe pratiquoit à cet égard fous les premières
races. Réformation de la loi falique fous Clovis: comment
elle fc fit , 8c ce que porte cette loi relativement à
l’objet dont il s’agit ici. V. 699. a. Comment Qüldcbert en
ufa, lorfqu’il fit ae nouvelles aaditxonsàcettc loi. Comment
furent faites les autres loix anciennes. Elles font mention
du confcntement général de la nation. Ce qui fe pratiqua,
lorfque les affemblées générales furent devenues trop nom-
breufes; par exemple, lorfque Charlemagne voulut faire une
addition a la loi faiique. Ibid. 700. a. Capitulaires de Charles
le Chauve, qui portent qu’ils ont été faits ex confenfu populi
6* confiituiione regis. D’où fe font formés les anciens par-
lemens tenus ious la féconde race. Les nouvelles ordonnances
étoient alors dreffées dans le parlement même; ce qui tenoit
lieu de la vérification 8c de 1 enregifirement. Etabliffemens
ou ordonnances de Plûlippe-Augufte 8c de Louis VIII. faits
en parlement avec le confcntement des grands vaffaux de la
couronne. Exemples de quelques établiffemens faits par S.
Louis dans les affemblées du parlement. Exemples femblablcs
que fournit le regne de Philippe III. dit le hardi. Ibid. b.
On en trouve auffi plufieurs fous les régnés de Philippe le Bel,
de Philippe VI. dit de Valois, 8c de Charles VI. Quelques-
uns croient que le roi Jean fut le premier qui établit que les
loix ne feraient plus délibérées en parlement, lorfque l ’on
en formoit le projet. Cependant l’ufage de former ac nouvelles
loix dans le confeil du roi eft plus ancien ; il s’étoit
introduit peu-à-peu dès le tems de Philippe III. Mais ces
mêmes loix ne laiffoient pas d’être délibérées en parlement,
parce que le roi y tenoit fouvent fon confeil. Ibid. 701. a.
La plus ancienne ordonnance qui n’a été que vérifiée 8c cn-
regiftrée en parlement, eft de 1334, fous Philippe de Valois.
Ufage établi de la leéture 8c publication qui précédé l’enre*
giftrement : le premier exemple eft de 1336. Snite des
exemples d’ordonnances lues, publiées 8c enregiftrées en parlement
fous Charles V. 8c Charles VI. Ibid. b. Le parlement
confcrva,pour les vérifications, la même liberté de fuffrages
Îiu’il avoit, lorfque les ordonnances étoient délibérées dans
es affemblées. Ce qui fe pratiqua fous le roi Jean, 8c Charles,
fon fils, régent du royaume. L’enregiftrement n’eft donc
point un fimple cérémonial; fon objet eft de donner à l’ordonnance
le caraâere de loi par la vérification 8c l’enregiftrement.
Témoignages de Louis XI. 8c de Charles IX , qui
le prouvent. Les rois ont fouvent qualifié l’examen des
nouvelles ordonnances, fait en parlement , de vérification
ou enregifirement. Ibid. 702. a. Il eft vrai que pour l’ordinaire
le roi mande' feulement aux parlemens qu’ils aient à
les faire lire , publier 8c cnregiftrer; mais cela mênic fuppofe
la vérification. Les ordonnances, édits, déclarations, &c.
ne font point enregiftrés au confeil du ro i, lorfqu’on les
adreffe à différentes cours ; elles font d’abord vérifiées 8c
enregiftrées au parlement de Paris, -ce qui fe fait, toutes les
chambres affemblées. Les déclarations données en interprétation
de quelques édits, font ordinairement enregiftrées par
la grand’enambre feule. Les réglemens qui peuvent être
de la compétence de quelqu’autrc cour fouveraine que les
fmrlemcns, y font aufu enregiftrés. Ce qui fe pratiquoit à
a chambre des comptes, quand on refufoit d’enregiftrer des
lettres. Les généraux des aides enregiftroient aufli les lettres
qui leur étoient adreffées. Ibid. b. La cour des aides eft pareillement
en poffeffion de vérifier 8c enregiftrer les lettres qui
lui font adreffées. L’ordonnance de Moulins, &c. enjoint aux
cours de procéder inceffamment à la vérification des ordonnances.
Les rois même ont défendu d’enregiftrer aucunes
lettres qui feraient fcellées contre la difpofition des ordonnances:
exemples. Le parlement 8c les autres cours fe font
auffi fouvent oppofésà la vérification des ordonnances, 6/c.
contraires aux intérêts de fa majeflé 8c au bien public. Quel-
3uefois les cours ont enregiftré les nouveaux réglemens avec
es modifications. Lettres à l’enregiftrement dcfquelles les
particuliers ou le procureur général peuvent former oppofi-
tion. Ibid. 703.4. Les compagnies qui ont une forme publique
peuvent soppofer à renregiftrement d’une loi qui paroît
blciTer leurs droits. De la forme en laquelle fe fait l’inf-
cription des réglemens fur les regiftres. il y avoit, dès le
tems de la fécondé race, un dépôt en chef dans le palais du
roi dont tous les autres n’étoient qu’une émanation. S.
Louis le fit placer à côté de la fainte chapelle. Ce roi ayant
fcit plufieurs ordonnances, les fit enregiftrer 8c publier au
châtelet : c’eft la première fois que ce terme enregiftrer a été
employé, pour exprimer l’infcription des réglemens dans les
aftes du tribunal : ce qu’on entendoit par inrotulare, 8c par
rotula, les rouleaux. Premiers aftes qui ont été écrits en
cahiers ou regiftres. Quel eft le plus ancien regiftre de la
chambre des comptes. Ibid. b.'Origine du mot enregifirenunt,
MMMmmmm