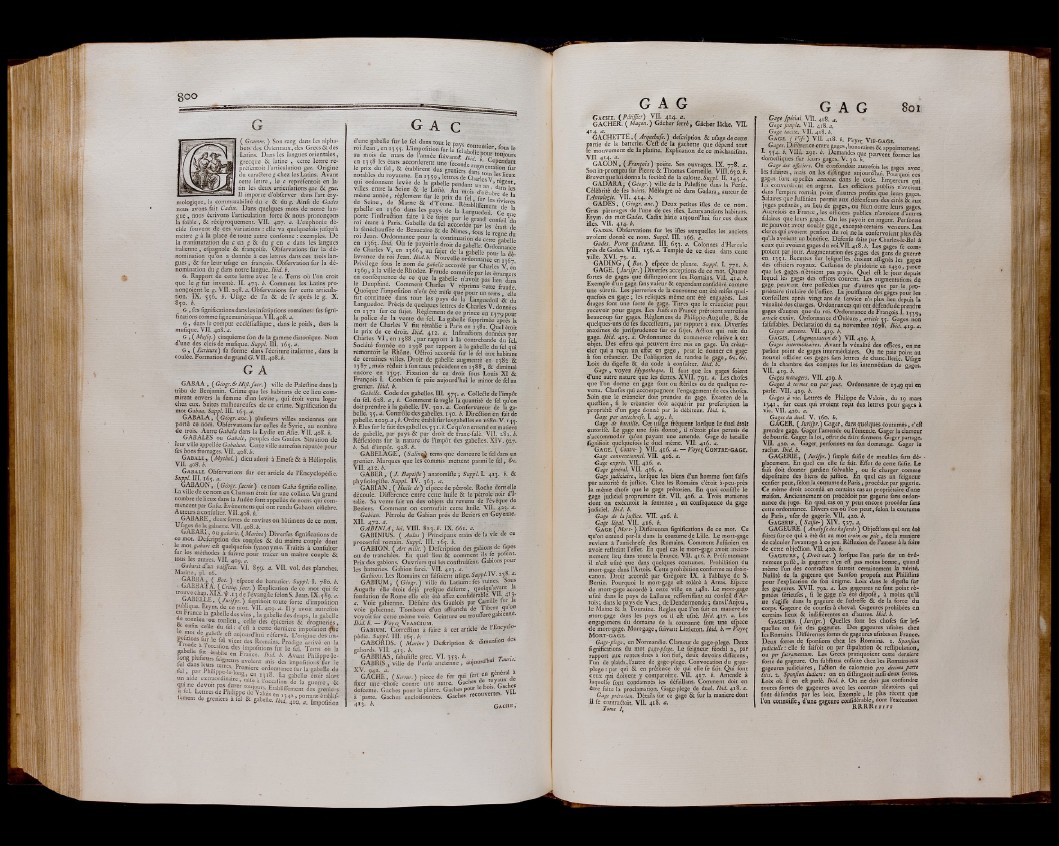
goo
G
( Gramm. ) Son rang dans les alphabets
des Orientaux, des Grecs & des
Latins. Dans les langues orientales,
grecque 8c latine , cette lettre re-
préfentoit l’articulation gue. Origine
du cara&ere g chez les Latins. Avant
cette lettre, le c repréfentoit en latin
les deux articulations que & gue.
Il importe d’obferver dans l’art étymologique,
la commutabilité du c & du g. Ainft de Gades
nous avons fait Cadix. Dans quelques mots de notre langue
, nous écrivons l’articulation forte 8c nous prononçons
la foible, & réciproquement. V II. 407. a. L’euphonie décide
fouvent de ces variations : elle va quelquefois jufqu’à
mettre c à la place de toute autre confonne : exemples. D e
la tranfmutation du c en g & du g en c dans les langues
italienne, efpagnole & françoife. Obfervations fur la dénomination
qu’on a donnée à ces lettres dans ces trois langues
, & fur leur ufage en françois. Obfervation fur la dénomination
du g dans notre langue. Ibid. b.
G . Rapport de cette lettre avec le c. Tems où l’on croit
que le g fut inventé. II. 473. b. Comment les Latins pro-
nonçoient le g. VII. 298. a. Obfervations fur cette articulation.
IX. 556. b. Ufage de 1’« & de IV après le g. X .
850. b.
G , fes lignifications dans les infcriptions romaines : fes lignifications
comme ligne numérique. VII. 408. a.
G , dans le comput e cclé fia ftiq u e , dans le p o id s , dans la
mufique. VII. 408. a.
G , ( Mufiq. ) cinquième fon de la gamme diatonique. Nom
d’une des clefs de mufique. Suppl. Iü . 163. a.
G» (Ecr iture) fa forme dans l’écriture italienne, dans la
coulée. Formation du grand G. VII. 408. b.
G A
G A B A A , ( Géogr. &H ift.fac r . ) ville de Palefiine dans la
tribu de Benjamin. Crime que les habitans de ce lieu commirent
envers la femme d’un le v ite , qui étoit venu loger
chez eux. Suites malheureufes de ce crime. Signification du
mot Gabaa. Suppl. III. 163. a.
G A B A L A , (Geogr.anc. ) pluiieurs villes anciennes ont
porté ce nom. Obfervations fur celles de Syrie, au nombre
de trois. Autre Gabala dans la Lydie en Afie. VII. 408. b.
GABALES ou Gabaliy peuples des Gaules. Situation de
leur ville appellée Gabalum. Cette ville autrefois réputée pour
fes bons fromages. V II. 408. b.
, „ Ç ABALE » (My tho l.) dieu adoré à Emefe & à Héliopolis.
VII. 408. b.
Gabale. Obfervations fur cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. III. 163. a.
G A B A O N , | Ge’ogr. facree ) ce nom Gaba lignifie colline.
La ville de ce nom en Chanaan étoit fur une colline. Un grand
nombre de lieux dans la Judée font appellés de noms qui commencent
par Gaba. Evénemens qui ont rendu Gabaon célébré.
Auteurs à confulter. VII. 408. b.
G A BA R E , deux fortes de navires ou bâtimens de ce nom.
Ufages de la gabarre. VII. 408. b.
G ABARi., ou gabarit. ( Marine) Diverfes fignifications de
ce mot. Defcription des couples & du maître couple dont
le mot.gabari eû quelquefois fynonyme. Traités à confulter
lur les méthodes à fuivre pour tracer un maître couple &
tous les autres. VII. 409. a.
Gabarit d u n vaiffeau. V I. 839. a. VII. vol. des planches.
Marine, pl. 16.
r^ÀnijA'ril ^ ot'X e*Pece bananier. Suppl. I. 780. b.
■ OA iiiJATA. fCWi/ÿ. Jacr. ) Explication de ce mot qui fe
îr° r a V f f ^ ‘-1 3 l’évangile felonS. Jean. IX. 589. *.
JjABLLLE, ( Jurifpr. ) fignifîoit toute forte d’impofition
publique. Etym. de ce mot. VII. 409. a . Il y avoit autrefois
n t rance la gabelle des v in s, la gabelle des draps, la gabelle
e tonnieu ou tonlieu, celle des épiceries 8c drogueries,
le m«»11! ; «u A 1 1 1 1 - cette derniere impofitibn mié
v o M n J l . 1“ cft aujourd'hui réfervè. L’origine des im-
Troadc à IV, ° r v ‘cm des Romains. Prodige arrivé en la
eabelle W f a l K des IfflEofitiotis fur le fel. Tems où la
lone DluReu,. ï - en Fra" ce’ Ibid- I A ™ ‘ PhiBppe-le-
f d dans eüS aVoicnt mis des impofitionS fur le
Tel, par P h ilip p e S lo i™ '“ “ “Æ T T f h'Î'l * P * | p p i
un aide extraordinaire , ¿ ¡fe à U c c a lm n ^ ’ i , ' Ru “ re S
fement de greniers | J &
G A C
d’une gabelle fur le fel dans tout le Dav . »___ • ,
rot Jean, en î 3 5 5. L ’impofnion fur le fel ,1,»? er> fo."s !f
au mois de mars de l'année fuivanti r S f ° 7 touJ°“ rs
en 1358 les étais accordèrent une fécondé...» ■ eP.e" daiIt
le prix du f e l, & établirent des greniers d a n fT " '? 10? r
notables du royaume. En 1359 , lettres de ChariS V a
qui ordonnent levée de la gabelle pendant un a„ J ge? ' ’
v.lles entre la Seine & le Lofié. Au mois d’o&b re 1
mente année, règlement fur le prix du fel f i , , 1°,"Ü * I
de Seine, de Marne & d’Yonne. L t a b i i f a e m T ' f
gabelle en 1360 dans les pays de la Laneuedoil V Î
porte 1 tnflruftion faite à ce fujet par le frand J l l l p
roi étant à Paris. Gabelle du fel accordée™" les
la fénechauflee de Beaucaire & de Nîmes, fous le regne du
rot Jean. Ordonnance pour la continuation de cette labelic
en 1363- IM . Ou fe payott le droit de gabelle. Ordonnance
de Cltarles V , en 1366 au frnet de la gabelle pour "a d“
hyrance du rot Jean. I t,d . i . Nouvelle ordonnance en „ « T
Privilège fous le nom de g M U accordé par Charles V en
1369, a la v i l e deRhodez. Fraude commife par les étrangers
en conféquence de ce que la gabelle n’avoir pas lieu dans
le Dauphtné. Comment Charles V réprima tetre fraude
Quoique 1 imposition n’eut été mife que pour un tems, eUe‘
fut commuée dans tout les pays de la Languedoil & du
Languedoc. Précis de quelques lettres de Charles V. données
en 1371 fur ce fujet. Règlement de ce prince en 1379 pour
la police de la vente du fel. La gabelle fupprimée après la
mort de Charles V fut rétablie à Paris en 1381. Quel étoit
le prix de ce droit. Ibid. 412. a. Inftruftions données par
Charles V I , en 1388 , par rapport à la contrebande du fel.
Société formée en 1398 par rapport à la gabelle du fel qui
remontoit le Rhône. Ôélroi accordé fur le fel aux habitans
de certaines villes. Droit de gabelle augmenté en 1382 &
13 8 7 , mais réduit à fon taux précédent en 1388, & diminué
encore en 1393. Fixation de ce droit fous Louis XI &
François I. Combien fe paie aujourd’hui le minot de fel au
grenier. Ibid. b.
Gabelle. Code des gabelles. III. 373. a. Colle&e de l’impôt
du fel. 628. a , b. Comment fe réglé la quantité de fel qu’on
doit prendre à la gabelle. IV . 301. a. Confervateur de la gabelle.
3 3. a. Contrôlé des gabelles. 130. b. Direction en fait de
gabelle. 1029. a , b. Ordre établi fur les gabelles en 1680. V . 143.
b. Elus fur le fait des gabelles. 3 3 i . b. C e qu’on entend en matière
de gabelle,par pays & par droit de tranc-falé. VII. 281 .b .
Réflexions lur la nature de l’impôt des gabelles. XIV. 927.
b. Sel d’impôt. 928. b.
G A B E L A G E , ( S a lin A tems que demeure le fel dans un
grenier. Marques que les commis mettent parmi le fe l, &c.
VU. 4Ï2. b.
G A B E R , ( J . Baptifte ) anatomifte ; Suppl. I. 413. b. 8c
phyfioloeifte. Suppl. IV . 363. a.
G A B IÀ N , ( Huile d e ) eipece de pétrole. Roche dont elle
découle. Différence entre cette huile & le pétrole noir d’Italie.
Sa vente fait un des objets du revenu de l’évêque de
Beziers. Comment on contrefait cette huile. VII., 423. a.
Gabian. Pétrole de Gabian près de Beziers en Guyenne.
XII. 472. <*.
G A B IN I A , loi. VIII. 823. b. IX. 661. *.
GABINIUS. | Aulus | Principaux traits de la vie de ce
proconful romain. Suppl. Iü . 163. b. ,
G A BION . ( A r t m ilit .) Defcription des gabions de fapes
ou de tranchées. En quel lieu 8c comment ils fe pofenr.
Prix des gabions. Ouvriers qui les conftruiferit Gabions pour
les batteries. Gabion farci. VII. 413.a . ,
Gabions. Les Romains en fàifoient ufage. Suppl. IV . 238. a.
G A B IU M , ( Géogr. ) ville du Latium: fes ruines. Sous
Augufte elle étoit déjà prefque déferre, quoiqu’avant la
fondation de Rome elle eût été affez considérable. VI h 413‘
a. Voie gabienne. Défaite des Gaulois par Camnle lur^ a
voie gabienné. Tombeau d’un affranchi de Tifaere qu
voyoitfu r cette même voie. Ceinture ou trouffure gabienn .
Ibid. b. — J'oycçVEASCIUM. .
Gabium. Correction à faire a cet article de 1 fcneye
pédie. Suppl. III. 163. b. r j._
G A BOR DS . ( Marine ) Defcription & dimenfion
gabords. VII. 413. b.
G A B R IA S , fabulifte grec. VI. 333. b. .
GABRIS x ville de Perfe ancienne, àujourdhui sa u r ,.
W m pie cede fer
fixer une-éhofe contre une autre. Oacn«
defeente. Gâches pour le plâtre. Gâches pour e 1 •
à 'patte. Gâches encloifonnées. Gâches recou
4*3- b- G â ch e ,'
G A G G A G 801 G âch e. (PâtiJJUr) VII. 414. a.
GACHER. (M a ç o n .) Gâcher ferré, Gâcher lâche. VII.
414. a. I
G A CH E T T E , ( Arquebufe. ) defcription & ufage de cette
fwrtie de la batterie. C ’eft de la gâchette que dépend tout
e mouvement de la platine. Explication de ce méchanifme.
,VII. 4M- *•
G A C O N , (F ra n ç o is ) poëte. Ses ouvrages. IX. 778.. a
Son in-promptu fur Pierre 8c Thomas Corneille. VIII. ,630. b.
Brevet que lui donna la fociété de la calotte. Suppl. II. 14e. a.
G A D A R A , (Ge'ogr.) ville de la Palefiine dans la Perfe.
Célébrité de fes bain?. Méléagre né dans Gadara, ameur.de
VAntologie. VII. 414. b.
G A D E S , (Géogr. anc.) Deux petites ifles de ce nom.
Gras pâturages de l’une de ces ifles. Leurs anciens habitans.
Etym. du mot Gades. Cadix bâtie aujourd’hui fur ces deux
ifles. V II. 414. b.
G ades. Obfervations fur les ifles auxquelles les anciens,
avoient donné ce nom. Suppl. Iü . 166. a.
Gades. Porta saditance. III.. 633. a. Colonnes d’Hercule
près de Gades. V ÏIL 136.«. Temple de ce. dieu dans cette
CVille. XV I. 73. a.
G A D IN G , ( Bot. ) efpece dé planté. Suppl. I. 771. b.
GAGE. (Jurifpr.) Diverfes acceptions de ce mot. Quatre
fortes de gages que diftinguoient les Romains. Vil.. 414. b.
Exemple d’un gage, fans valeur 8c cependant çopfidéré, comme
une sûreté. Les pierreries de la couronne ont été mifes quelquefois
en gage; les reliques.même opt été engagées. Les
étages font une forte de gage. Titres que le créancier peut
recevoir pour gages. Les Juifs en France prêtoient autrefois
beaucoup fur gages. Réglemens de Philippe-Augufte, 8c de
quelques-uns de tes fucceffcurs, par rapport à. eux. Diverfes
maximes de jurifprudence fur ce fujet. Aétion qui nait du
gage. Ibid. 413. a. Ordonnance du commerce relative à cet
objet. Des effets qui peuvent être mis en gage. Un créancier
qui a reçu un ëfiet en gage, peut le donner en gage
à fon créancier. D e l’obligation de rendre le gage, &c. &c.
Xoix du digefie 8c du code à confulter. Ibid. b.
Gage y voyez Hypothéqué. Il faut que les gages, forent
d’une autre nature que les dettes. XVIL 791. a. Les chofes
que l’on donne en gage font ou fiériles ou de quelque revenu.
Claufes qui acc.ompagnent l’engagement de ces chofes.
Soin que le créancier doit prendre du gage. Exanten de la
quefiion, fi le créancier doit acquérir par prefeription la
propriété d’un gage donné par le débiteur. Ibid. b.
Gage par antïçhrefe. I, 49p. b.
Gage de bataille. Cet.ufage fréquent lorfque le duel étoit
eutorifé. Le gage une fois donné, il n’¿toit plus permis de
s’accommoder qu’en payant une amende. Gage ae bataille
ügnifioit quelquefois le duel même. VII. 41.6. a.
G ag e . ( Contre- ) VII. 416. a. — Voye^ CONTRE-GAGE.
Gage conventionnel. VII. 416. a.
Gage expris. VII. 416. a.
Gage général. VII. 416. a.
Gage judiciaire, lorfque les. biens d’un homme font faifis
par autorité de juftice. Chez les Romains c’étoit à-peu-près
la même çhofe que le gage prétorien. En quoi confifie le
gage judiciel proprement dit. VII. 416. a. Trois maniérés
dont on exécutoit la fentençe , en conféquence du gage
judiciel. Ibid. b.
Gage de la juftice. VII. 416. b.
Gage légal. V IL 416. b.
G a g e ( Mort- ) Différentes fignifications de ce mot. Ce
qu’on entend, par-là dans la coutume de Lille. Le mott-gage
revient à l’antichrefe des Romains. Comment Jufiinien en
avoit refireint l’effet. En quel cas le mort-gage avoit anciennement
lieu dans toute la France. VU. 4 16 .0 . Préfentemcnt
il n’eft ufité que dans quelques coutumes. Prohibition du
mort-gage dans l’Artois, Cette prohibition.conforme au droit-
canon. Droit accordé par Grégoire IX. à l’abbaye de S.
Bertin. Pourquoi le mort-gage éfi toléré à Arras. Efpece
de mort-gage accordé à cette ville en 148t. Le mort-gage
ufité dans le pays de Lalloeue reflortiiïant au confeil d’A rtois
; dans le pays de Y a e s , de Dendermonde ; dans l’Anjou,
le Maine & fa Touraine. Réglés que l’on fuir en matière de
mort-gage dan? les. pays où il efi ufité. Ibid. 417. a. Les
engagemens du domaine de la couronne font une efpece
de mort-gage. Mort-gage, fuivant Littleton. Ibid. b. — Voyc^
M o r t - g a g e .
Gage-plegey en Normandie. Clameur de gage-plege. Deux
lignifications du mot gage-plege. Le feignent féodal a , par
rapport aux rentes, duès à fon fief, deux devoirs différens,
l ’un de plaids,l’autre de gage-plege. Convocation du gage-
plege: par qui 8c en prélence de qui ellefe fait. Qui font
ceux qui doivent y compatoitçe. VU. 417. b. Amende à
laquelle fo.nt condamnés les défaifians. Comment doit en
être faite la proclamation, ^age-plege de duel. Ibid. 418. a.
Gage prétorien. Détails fur ce gage 8c fur la maniéré dont
il fe contra&oit. VU. 418. a.
Tome 7,
Gage Jpécial. VU. 418. a.
Gage fimple. VU. 418. a.
Gage tacite. VU. 418.h.
G A G E . ( iTlf- ) VU. 418. b. Voyt{ VlF-GAGE.
G ^ s .m t K n ç c entre gages, honoraires & appointerons,
• 33 4. b. VIII, 291. b. Demandes que peuvent former les
aoraciiiques fur leurs gages. V . 30. b..
Gage des ojftciers. On confoiidoit autrefois les gages avec
les falaires, mais on les diflingue aujourd’hui. Pourquoi ces
gages font appellés annona. dans le code. Empereurs qui
les couvertirent en argent. Les officiers publics n’avoient
dans l’empire romain point d’autres profits que leurs gages.
Salaires que Jufiinien permit.aux ,défenfeurs des cités &.aux
jnges pedanés, au lieu,de gages, ou bien,outre leurs gages.
Autrefois en France, les officiers publics n’avoient d’autres
falaires que. leurs gagos.. On les payoit en argent. Perfonne
ne pqu voit avoir double gage, excepté certains veneurs. Les
clercs qui avoient penfion du roi ne la confervoient plus dis
qu’ils avoient un bénéfice. Défenfe faite par Charles-le-Bel à
ceux qui avoient gages du roi.VII. 418.4. Les gages fe com-
ptoient par jour. Augmentation des gages des gens de guerre
en. 1331. Recettes fur lefquelle? étoient alignés les gages
des officiers royaux. Ceffation de plaidoirie en 1430, parce
que les. gages n’étoient pas payés. Quel efi ie jour depuis
lequel les gages des offices courent. Les augmentations de
gage, peuvent être poffédées par d’autres que par le propriétaire
titulaire de l’office. La iouiflance des gages pour les
confeillers après vingt ans de fervice n’a plus Îieu depuis la
vénalfié.des charges. Ordonnances qui ont défendu deprendre
gages d’autres que-du roi. OtdQnnapce de François !.. 1339,
.article cxxiv. Ordonnance d’Orléans, article 33. Gages non
faififfables. Déclaration du 24 novembre 1678. Ibid. 4 10. a.
Gages anciens. V il. 419. b.
Ga QES, ( Augmentation de ) VII. 419. b.
Gages intermédiaires. Avant la vénalité des offices, on ne
parloit point de gages intermédiaires. On ne paie point an
nouvel officier ces gages fans lettres de chancellerie. Ufage
de la chambre des comptes fur les intermécüats de gages.
VII. 419. b.
Gages ménagers. VII. 419. b.
Gages, à termes ou par jour. Ordonnance de 1349 qui en
parle. VII. 419. b.
Gages à vie. Lettres de Philippe de Valois, du 19 mars
13 4 1 , fur ceux qui avoient reçu des lettres pour gages à
vie. VII. 420. a.
Gages du duel. V . 160. b.
GAGER. (Jurifpr.) Gager, dans quelques coutumes, c’eft
prendre gage. Gager l’amende ou l'émende. Gager la clameur
de bourfe. Gager la lo i, offrir <de faire ferment. Gager partage.
V IL 420. a. Gager perfonpes en ion dommage. Gager ie
rachat. Ibid. b.
GAGERIE, (Ju r ifpr .) fimple faifie de meubles fans dé- «
placement. En quel cas elle le fait. Effet de cette faifie. Le
faifi doit, donner gar.dien. folvable , ou fe charger comme
dépofitaire des biens de juftice. En quel cas un feigneur
cenfier peut, felonlacounime de Paris, procéder par gagerie.
C e même droit accordé, en certains cas au propriétaire a’une
maifon. Anciennement on procédoit par gagerie fans, ordonnance
du juge. En quej.cas on y peut encore procéder fans
cette ordonnance. Divers cas où l’on peut, félon la coutume
de Paris, ufer de gagerie. VU. 420. b.
G agerie , ( Saj/îe-) XIV. 327. a.
GAGEURE. ( Analyfe deshafards ) Objections qui ont été
faites fur ce qui a été dit au mot croix.ou p i le , de la maniéré
de calculer l’avantage à ce jeu. Réflexion de l’auteur à la fuite
de cette objeâion. VIL 420. b.
G ag eur e, (D r o itn a t. ) lorfque l’on parie fur un événement
pafté, la gageure n’en efi pas moins bonne, quand
même l’un dès contrafians fauroit certainement la vérité.
Nullité de la gageure que Samfon propofa aux Philiftins
pour l’explication de fon énigme. Loix dans le digefie fuf
les gageures. XVII. 79a, a. Les gageures ne font point réputées
férieufes, fi le gage n’a. été dépofé, à moins qu'il
ne s’agifle dans la gageure, de l’adrefie 8c de la force du
corps. Gageure de courfes à cheval. Gageures prohibées eu
certains lieux 8c indifférentes en d’autres. Ibid. b.
G ageure. (Jurifpr.) Quelles font les chofes fur lef-
quelles on fait des gageures. Des gageures ufitées chez
les Romains. Différentes fortes de gageures ufitées en France.
Deux fortes de fponfions chez les Romains. 1. Sponfion
judicielle : elle fe faifoit ou par fiipulation 8c reftipulation,
ou per facramentum. Les Grecs pratiquoient cette derniere
forte de gageure. On fubititua enfuite chez les Romains aux
gageures judiciaires, l’aâion de calomnie pro décima part*
litis. 2. Sponfion ludicre : on en dîftinguoit aufli deux fortes.
Loix où il en efi parlé. Ibid. b. On ne doit pas confondre
toutes fortes de gageures avec les contrats aléatoires qui
font défendus par les loix. Exemple, le plus récent que
l’on connoiffe, d’une gageure confidérable, dont l’exécution
! 6 6 R R R R r r r r r