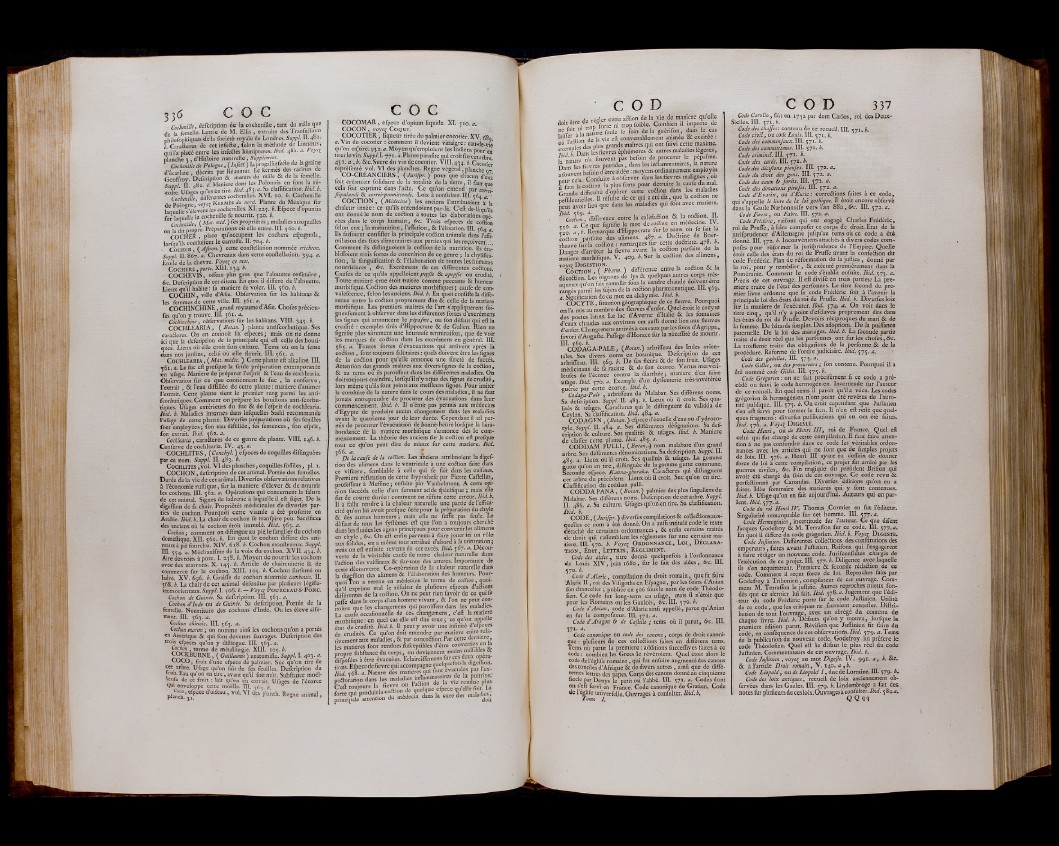
536 C O C
Cnékenïllà* defeription de la cochenille, tant du mâle que
de la femelle. Lettre de M. Ellis , extraite des Transitons
pliilofophiqueS 'de la fociété royale de Londres. Suppl. l l 481.
A. Carafteres. de cet infeéte, félon là méthode de Linnæus,
qui l’a placé entre les infeétes hémiptères. Ibid. 482. a. Voyej
planche 1 , d’Hiftoire naturelle | Supplément.
Cochenille de Pologne , {lnfeft.) la progalhnfefle de la graine
¿’écarlate , ¿écrite parRéaumur. Le kermes ¿es racmesi de
Geoffroy. Defeription & inoetifs du maie & de la femelle.
Suppl. Û. 482'. b. Maniéré dont les Polono.s en font g » .
Coch'miu, différentes cochenilles. XVL 10 i Cochemlle
de Pologne, vcm K»»»*? * »»¿f P1>"'= du Mdxtqüe fur
1 uelle s’élèvent les cochenilles. A l. 225. b. Efpece d opuntia
fur laquelle la cochenille fe nourrit. 520. b
Cochenille, { Mat. med. ) les propriétés ; maladies auxquelles
on la dit propre. Préparations oit elle entre. 111. 560. b.
COCHER , place qu’occupent les cochers elpagnols,
lorfoulls cotiduifeut le carroffe. II. 704. i.
• ¿OCHER, ( Ajlron. ) cette conftellation nommée erichton.
Suppl. II. 867. a. Chevreaux dans cette conftellation. 394. a.
Etoile de la chevre. Voye[ ce mot.
COGHERE, porte. XIII. 134. h. ^
COCHE VIS, oifeau plus gros que l’alouette ordirlaire,
&c. Defeription de cet oiléau. En quoi il différé de l’alouette.
Lieux qu’il habite : fa maniéré de voler. III. 560. b.
COÔHIN, ville d’Afie. Obfervation fur les habitans 8c
les femmes de cette ville. III. $61. a.
COCHINCHINE, grand royaume d Alie. Chofes précieu-
fes qu’on y trouve. IIL ç6i. a.
Cochinchine, obfervations fur les habitans. VIII. 345. b.
COCHLEARIA, ( Botan. ) plante antifeorbutique. Ses
caraéteres. On en connôît fix eipeces 5 mais on ne donne
ici que la defeription de la principale qui eft celle des boutiques.
Lieux où elle croît fans culture. Tems où on la feme
dans nos jardins, celui du elle fleurit. III. 361. a.
' Cochlearia , {Mac. médic. ) Cette plante eft alkaline. III.
361. a. Le fuc eft prefque la feule préparation extemporanée
en ufage. Maniéré de préparer l’efprit & l’eau de cochlearia.
Obfervation fur ce que contiennent le fuc , la conferve,
l’extrait, 8c l’eau diitillée de cette plante : maniéré d’animer
l’extrait. Cette plante tient le premier rang parmi les anti-
feorbutiques. Comment on prépare les bouillons anti-feorbu-
tiques. üfaees extérieurs du fuc & de l’efprit de cochlearia.
Ibid. b. Maladies internes dans lefquelles Stahl recommande
l’ufage de cette planté. Diverfes préparations où fes feuilles
font employées ; fon eau diftillée, fes femenccs, fon efprit,
fon extrait. Ibid. 562. a.
Cochlearia, càraéteres de ce genre de plante. VIII. 146. b.
Conferve de cochlearia. IV. 43 .a.
COCHLITES, ( Conckyl. ) efpeces de coquilles diftinguées
par ce nom. Suppl. II. 4^3*
C ochlites , vol. V I des planches, coquilles fôfliles, pl. 1.
COCHON, defeription de cet animal. Portée des femelles.
Durée de la vie de cet animal. Diverfes obfervations relatives
à l’économie ruftique, fur la maniéré d’élever 8c de nourrir
les cochons. III. 562. a. Opérations qui concernent la falure
de cet animal. Signes de ladrerie à laquelle il eft fujet. De la
digeiton de fa chair. Propriétés médicinales de diverfes parties
de cochon. Pourquoi cette viande a été proferite en
Arabie. Ibid. b. La chair de cochon fe tranfpire peu. Sacrifices
des anciens où le cochon étoit immolé. Ibid. 563. a.
Cochon ; comment on diftingue au pié.lefanglier du cochon
domeftique. XII. 561. b. En quoi le cochon différé des animaux
à pié fourchu. XIV. 618. b. Cochon monftrucux. Suppl.
III. 5 54. a. Méchanifme de la voix du cochon. XV IL 434. b.
Aire des toits à porc. I. 238. b. Moyen de nourrir les cochons
avec des marrons. X. 145. b. Article de chaircuiterie 8c de
commerce fur le cochon. XIII. 105. b. Cochon furfemé Ou
ladre. XV. 696. b. Graiffe de cochon nommée cambouis. II.
368. b. La chair de cet animal défendue par plufieurs légifla-
teursorientaux. Suppl. I. 306. b. — Vjyer Pourceau 6* Po r c .
Cochon de Guinée. Sa defeription. III. 363. a.
Cochon d’Inde ou de Guinée. Sa defeription. Portée de la
femelle. Nourriture des cochons d’Inde. On les éleve aifé-
ment. III. 363. a.
Cochon chinois. III. 363. a.
Cochon maron j on nomme ainfi les cochons qu’on a portés
en Amérique 8c qui font devenus fauvages. Defeription des
trois efpecès qu’on y diftingue. III. 363. a.
WÊM » terme de métallurgie. XIII. 105.b.
p S « ^ N E , ( Guillaume ) anatomifte. Suppl. I. 4° 3- a’
COCO, fruit d’une efpece de palmier. Suc qu’on tire de
cet. arbre. Ufage qu’oh fait de fes feuilles. Defeription du
truit. Eau qu’on en tire, avant qu’il foit mûr. Subftance moëlleufe
de ce fruit : lait’qu’on on extrait. Ufages de l’écorce
qui enveloppe cette moëlle. 111. 363. A.
Coco,efpece d’oifeau, vol.VI des ¿'an
planch. 31. , vol. VI des planch. Regm limai,
C O C
COCOMAR, efpece d’opium liquide. XI. 310. a-,
COCON, voye^ C o q u e .
COCOTIER, liqueur tirée du palmier cocotier. XV. 680•
a. Vin du cocotier : comment il devient vinaigre : eau-de-vie*
qu’on en'tire. 932. a. Moyen qu’emploient les Indiens pour'en
tirer levin. Suppl.Y. 771. à. Plante parafite qui croît fur Cet arbre
431. a , b. 8cc. Sucre du vin de cocotier. VIII. 434. b. Cocotier
repréfenté vol. VI des planches. Regne végétal, planche a*
CO-CRÉANCIERS , ( Jürifpr. ) pour que chacun d’eux
foit créancier folidaire de la totalité de la dette, il faut que
cela foit exprimé dans l’aéte. Ce qü’on entend par correi-
Jlipulandi 8c correï-promittehdi. Loix à confultef. IIL 364. a. ‘
COCTION, ( Médecine) les anciens l’attribuoient à la
chaleur innée : ce qu’ils entendoient par-là. C’eft de-là qu’ils
ont donné le nom de coélion à toutes les élaborations opérées
{lans le corps humain, &c. Trois efpeces de coélion
félon eux ; la maturation, l’affation, 8c l’élixation. III. 364. a
Ils faifoient confifter la principale coélion animale dans l’affi-
milation des fucs alimentaires aux parties qui les reçoivent....
Comment ils diftinguôiérit la coélion de là nutrition. Us érâ-
bliffoient trois fortes de concrétion de ce genre ; la chylifica-
tion -, la fanguification 8c l’élaboràtioh de toutes les humeurs
noürricieres , &c. Excrémens de ces différentes coélions.
Caufes de ce qu’ils appelloient pepfie 8c apcpfie ou crudité.
Toute matière crue étoit traitée comme peccante 8c humeur
morbifique. Coélion des matières morbifiques ; caufe de con-
valefcence, félon les anciens. Ibid. b. En quoi confiftela différence
entre la coélion proprement dite 8c celle de la mariere
morbifique. Les premiers maîtres de l’art-s’appliquèrent foi-
gneufement à oblerver dans les différentes fortes d’excrémens
les fignes qui annoncent le pépafme, ou fon défaut qui eft la
crudité : exemples tirés d’Hippocrate 8c de Galien. Rien né
fignifie plus sûrement une heureufe terminaifon, que de voir
les marqués de coélion dans les excrémens en général. III.
363. a. Toutes fortes d’évacuations qui arrivent après la
coélion, font toüjours falutaires : quels doivent être les fignes
de la coélion pour qu’elle annonce une fureté de fuccés.
Attention des grands maîtres aux divers fignes de la coélion,
8c au tems où ils paroiffent dans les différentes maladies. On
doit toujours craindre, lorfqu’il n’y a que des fignes de crudité,
lors même qu’ils font joints aux meilleurs fignes. Pour imiter
la conduite de la nature dans le cours des maladies, il ne faut
jamais entreprendre de procurer des évacuations dans leur
commencement. Ibid. b. Il n’étoit pas permis aux médecins
d’Egypte de produire aucun changement dans les maladie's
avant le quatrième jour de leur durée. Cependant il eft permis
de procurer l’évacuation de bonne-heure lorfque la fura-
bondance de la mariere morbifique s’annonce dés le commencement.
La théorie des anciens fur la coélion eft prefque
tout ce (fu’on peut dire de mieux fur cette matière. Ibid.
0B:. a. £ . . . . . -
De la caufe de la coflion. Les anciens attribuoient la digef-
tion des alimens dans le ventricule à une coflion faite dans
ce vifcere, femblable à celle qui fe fait dans les cuifines.
Première réfutation de cette hypothefe par Pierre Caftellus,
profeffeur à Meffine ; enfuite par Vanhelmont, A cette opinion
fuccéda celle d’un ferment acide ipécifique ; mais elle
fut de courte durée: comment on réfuta cette erreur.Ibid.b.
Il a fallu rendre à la chaleur naturelle une partie de l’efficâ-
cité qu’on lui avoit prefque ôtée pour la préparation du chyle
& des autres humeurs ; mais elle ne fuffit pas feule. Le
définit de tous les fyftêmes eft que l’on a toujours cherché
dans les fluides les agens principaux pour convertir les aliment
en chyle, 6>c. On eft enfin parvenu à faire jouer ici un rôle
aux folides, on a même tout attribué d’abord à la trituration;
mais on eft enfuite revenu de cet excès. Ibid. <¡67. a. Découverte
de la véritable caufe de notre chaleur naturelle dans
l’aflion des vaiffeaux 8c fur-tout des arteres. Importance de
cette découverte. Co-opératiori de la chaleur naturelle dans
la digeftion des alimens 8c l’élaboration des humeurs. PourquoiTon
a retenu en médecine le terme de, coflion, auoi-
qu’il exprime mal le réfultat de plufieurs efpeces d’aétions
différentes de la coflion. On ne peut rien favoir de ce qui fe
paffe dans le corps d’un homme vivant, 8c l’on ne peut con-
noitre que les changemens qui paroiffent dans les maladies.
La caufe occafionnelle de ces changemens, c’eft la matière
morbifique: en quel cas elle eft dite crue ; ce qu’on appelle
état de crudité. Ibid. b. Il peut y avoir une infinité d’eipeces
de crudités. Ce qu’on doit entendre par matière cuite relativement
aux maladies, 8c par concoflion. Par cette derniere,
les matières font rendues fùfceptibles d’être converties en la
propre fubftance du corps, ou deviennent moins nuifibles 8c
S f é e s à être évacuées. Eclairciffemens fur ces g g g
tions. Elbecede fievre qui accompagne EeXIbid
<68. a. Nature des m a tiè re s q u i font évacuées par ! ex
Ceft toujours a „jon quelque efpece qu’elle foit. La
pïâc.pak’ïren.ioa du médecin dans la cure des maladies.
C O D
. . . k réeler cette afrion de la vie de manière qu’elle
ni tro p forte ni tropfoible. Combien ¡1 importe de
f Tfer à la nature feule le loin de la guérifon , dans le cas
• r A'on de la vie eft convenablement animée & excitée .
011 m« des plus grands maîtres qui ont fuivl cette maxtme.
S S i^ Dans les fièvres éphémères & autres maladies légères.,
t. nintre n’a fouvent pas befoln de procurer le pépafme. I
les fievres putrides, dans les inflammatoires, la nature
.fouvent befoln Îêtre aidée : moyens ordinairement employés
nour cela. Conduite à obferver dans les fievres mabgnes , ou
Rsgât la coélion la plus forte pour détruire la caille du maL
Grande difficulté d'opérer cette cofhon dans les maladies
neffilentielles. Il réfulte de ce qui a été dit, que la coftton ne
peut avoir lieu que dans les maladies qui font avec matière.
^ ‘coflion, différence entre la'caléfaâion & la. coélion. II.
eto. a. Ce que fignifie le mot de coflion en médecine. IV.
cio! a .i. Remarque d’Hippocrate fur le tems ou fe frit la
coffion parfaite des alimens. 487. a. Doffrme de Boer-
rhaave fur la coflion : remarques fur cette doflr.ne. 478- \ ■
Danger d’arrêter la fievre avant la coéhon parfaite de la
matière morbifique. V. 4° 9- b- Sur ,a c°aion des al,menS’
’ T o c t i o n T c Wurm. ) différence entre la coflion & la
décoflîon. Les oignons de lys & quelques autres corps tres-
aqueux qu’on fait ramollir fous la cendre chaude dotvenc en-e
rangés parmi les fujets de la coflion pharmaceutique. IIL ¡69.
a. Signification de ce mot en alcbymie. Uni. i.
COCYTE, fituationgéograpltique de ce fleuve. Pourquoi
on l’a mis au nombre des fleuves d’enfer. Quel étoit le cocyte
des poètes latins. Le lac d’Averne d’Italie & les fontaines
d’eaux chaudes aux environs ont aufli donné lieu aux fleuves
d’enfer. Changemens arrivés à ces eaux parles foins d Agrippa,
favori d’Augiule. Paffage d’Horace fur la néceffné de mourir.
11 ¿ ¿^AGA-PALE, {Botan.) arbriffeau des Indes orientales.
Ses divers noms en botanique. Defeription de cet
arbriffeau. III. 369. b. De fes fleurs & de fon fruit. Ufages
médicinaux de fa racine 8c de fon écorce. Vertus merved-
leufes de l’écorce contre la diarrhee; maniéré d en faire
ufage. Ibid. 370. û. Exemple d’un dyffenterie tres-mvétérée
guérie par cette écorce. Ibid. b.
Codaea-Palc , arbriffeau du Malabar. Ses différens noms.
Sa defeription. Suppl. II. 483. b. Lieux où il croît. Ses qualités
8c ufages. Caraéleres qui le diftinguent du validda de
Ceylan. Sa claflification. Ibid. 484. a.
CODAGEN , {Botan. ) efpece d’écuelle d eau ou d ydroco-
tyle Suppl. II. 484. a. Ses différentes défignations. Sa description
& culture. Ses qualités 8c ufages. Ibid. b. Manière
de claffer cette plante. Ibid. 483. a.
CODDAM PULLI, {Botan.) nom malabare dun grand
arbre. Ses différentes dénominations. Sa defeription. Suppl. II.
483. a. Lieux où il croît. Ses qualités 8c ufages. La gomme
gutte qu’on en tire, diftinguée de la gomme gutte commune.
Seconde efpece. Kanna-ghoraka. Carafteres qui diftinguent
cet arbre du précédent. Lieux où il croît. Suc quon en tire.
Claflification du coddam pulli.
CODDA PANA, {Botan.) palmier des plus Singuliers du
Malabar. Ses différens noms. Defeription de cet arbre. Suppl.
II. 486. a. Sa culture. Ufages qu’on en tire. Sa claflification.
CODE, ( Jurifpr. ) diverfes compilations 8c collections auxquelles
ce nom a été donné. On a aufli intitulé code le texte
détaché de certaines ordonnances, 8c enfin certains traités
de droit qiii raffemblent les réglemens fur une certaine matière.
III. 370. b. Voyei O rdonnance, Loi , DECLARATION
, Édit , Lettres , R èglement.
Code des aides, titre donné quelquefois à l’ordonnance
de Louis X IV , juin 1680, fur le fait des aides, &c. III.
570. b. . t .ï . "V
Code d’Alaric, compilation du droit romain, que fit faire
Alaric I I , roi des Vifigoths en Efpagne, par les foins d’Anian
fon chancelier ; publiée en 306 fous le nom de code Théodo-
fien. Ce code fut long-tems en ufage, mais il n’étoit que
pour les Romains ou les Gaulois, &c. III. 370. b.
Code d’Anian, code d’Alaric ainfi appellé, parce qu’Anian
en fut le compofiteür. III. 371. a.
Code d’Aragon & de Cafiille ; tems où il parut, &c. III.
j p j a. • , W k H
Code canoniquç ou code des canons, corps de droit canonique
: plufieurs de ces collections faites en différens tems.
Tems où parut la première : additions fucceflives faites à ce
code : combien les Grecs le révéroient. Quel étoit alors le
code del’églife romaine, qui fut enfuite augmenté des canons
des conciles d’Airique & ne divers autres, ainfi que de différentes
lettres des papes. Corps des canons donné au cinquième
fiede gar Denys le petit ou l’abbé. III. 371. a. Codes dont
on s’ell fervi en France. Code canonique de Gratien. Code
de l’églife univerfeUe. Ouvrages à coniulter. Ibid. b,
Tome I,
C O D 3 3 7
Code Carolin, fait en 1732 par dom Carlos, roi des Deux-
Siciles.III. 371 .b.
Code des chaff es: contenu de ce recueil. IIL 371 .b.
Code civil, ou code Louis. III. 371. A,
Code des commenfaux. IIL 371. A.
Code des committimus. III. 37t. b.
Code criminel. III. 571» b.
Code des curés. III. 371. b.
Code des décifions pieufes. III. 372. a.
Code du droit des gens. III. 372. a.
Code des eaux & forêts. HI. 572. a.
Code des donations pieufes. III. 372. a.
Code d’Evarix, ou d’Euric: corrections faites à ce code,
qui s’appelle le livre de la loi gothique. Il étoit encore obfervè
dans la Gaule Narbonnoife vers l’an 880, &c. III. 372. a.
Code Favre , ou Fabre. III. 372. a.
Code Frédéric, raifons qui ont engagé Charles Frédéric,
roi de Pruffe, à faire compofer ce corps de droit. Etat de la
jurifprudence d’Allemagne jufqu’au tems où ce code a été
donné. III. 372. b. Inconvéniens attachés à divers codes composés
pour réformer la jurifprudence de l’Empire. Quelle
étoit celle des états du roi de Pruffe avant la confection du
code Frédéric. Plan de réformation de la juftice, donné par
le roi, pour y remédier, & exécuté premièrement dans la
Poméranie. Comment le code s’établit enfuite. Ibid. 373. a.
Précis de cet ouvrage. Il eft divifé en trois parties.* La premiere
traite de l’état des perfonnes. Le titre fécond du premier
livre ordonne que le code Frédéric foit à l’avenir la
principale loi des états du roi de Pruffe. Ibid. b. Diverfes loix
fur la maniéré de l’e x é c u t e r . 374. a. On voit dans le
titre cinq, qu’il n’y a point d’efclaves proprement dits dans
les états du roi de Pruffe. Devoirs réciproques du mari & de
la femme. De bâtards fimples. Des adoptions. De la puiffance
paternelle. De la loi des mariages. Ibid. b. La ieconde partie
traite du droit réel que les perfonnes ont furies chofes,&c.
La troifieme traite des obligations de la perfonne 8c de la
procédure. Réforme de l’ordre judiciaire. Ibid. 373. a.
Code des gabelles. III. 373. a.
Code Gillety ou des procureurs ; fon contenu. Pourquoi il a
été nommé code Gillet. III. 373
Code Grégorien : on ne fait précifément ft ce code a précédé
ou fuivi le code hermogénien. Incertitude fur l’auteur
de ce recueil. En quel tems il parôît qu'il a vécu. Les codes
grégorien 8c hermogénien n’ont point été revêtus de l’autorité
publique. III. 373. b. On croit cependant que Juftinien
s’en eft fervi pour former le fien. Il n’en eft refté que quelques
fragmens : diverfes publications qui en ont été faites.
Ibid. 370. a. Voyeç DlGESTÈ.
Code Henri, ou de Henri ///, roi de France. Quel eft
celui qui fut chargé de cette compilation. Il faut faire attention
à ne pas confondre dans ce codé les véritables ordonnances
avec les articles qui ne font que de fimples projets
de loix. III. 376. a. Henri III ayant eu deffein de donner
force de loi à cette compilation, ce projet fut arrêté par les
guerres civiles, 6>c. Fin tragique du préfident Briûon qui
avoit été chargé du foin de cet ouvrage. Ce code revu 8c
perfeétionné par Carondas. Diverfes éditions qu’on en a
faites. Idée fommaire des matières qui y font contenues.
Ibid. b. Ufage qu’on en fait aujourd’hui. Auteurs qui en parlent.
Ibid. 577. a. _ _ .
Code du roi Henri IV. Thomas .Cormier en fut l’éditeur.
Singularité remarquable fur cet homme. III. 377. a.
Code Hermogénien, incertitude fur l’auteur. Ce que difent
Jacques Godefroy 8c M. Terraffon fur ce code. III. 377. *.
En quoi il différé du code grégorien. Ibid. b. Voye[ D igeste.
Code Juftinien. Différentes collections des conftitutions des
empereurs, faites avant Juftinien. Raifons, qui 1 engagèrent
à faire rédiger un nouveau code. Jurifconfultes chargés de
l’exécution de ce projet. III. 377. b. Diligence, avec laquelle
ils s’en acquittèrent. Premiere 8c fécondé rédaction de ce
code. Comment il reçut force de loi. Reproches faits par
■Godefroy à Tribonien, compilateur de cet ouvrage. Comment
M. Terraffon le juftifie. Autres reproches mieux fondés
que ce dernier lui fait. Ibid. .578. a. Jugement que 1 éditeur
du code Frédéric porte fur le code Juftutien. Utilité
de ce code, que les critiques ne /auraient contefter. Diftri-
bution de tout l’ouvrage, avec un abrégé du contenu de
chaque livre. Ibid. A. Défauts qu’on y trouva, lorfque la
premiere édition parut. Révifion que Juftinien fit faire du
code, en conféquence de ces obfervations.Ibid. 379. a. Tems
de la publication du nouveau code. Godefroy lui préféré le
code Théodofien. Quel eft le défaut le plus réel du code
Juftinien. Commentateurs de cet ouvrage. Ibid. b.
Code Juftinien, voyeç au mot Digefte. IV. 991. a , b. 8cc.
8c à l’article Droit romain, V . 140. a , b.
Code Léopold, ou deLéopold / , duc de Lorraine. HI. 379. A.
Code des loix antiques, recueil de loix anciennement ob-
fervées dans les Gaules. III. 379. A. Lindembroge a fait des
notes fur plufieurs de ces loix. Ouvrages à confülter. Ibid. 3 8o.<*.
Q Q q q