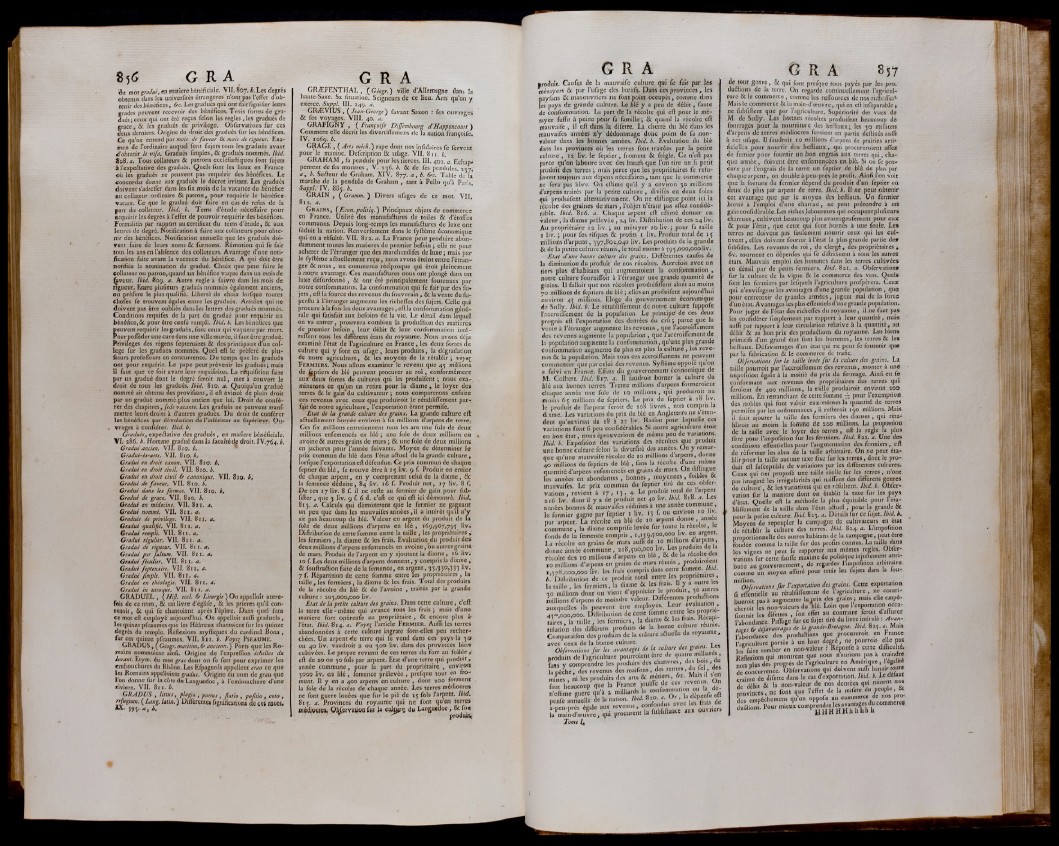
G R A G R A
'du mot gradui, en matière bénéficiale. V U . 8 0 7 .1. Les degré*
obtenus dans le* univerfité# étrangères n’ont pas l’effet d obtenir
des b én é fic e s , b c . L e s gradués qui ont faitfignificr leurs
«rades peuvent recevoir des bénéfices. Trois fortes d e gradués
; c eu x qui ont été reçus félon les réglés, les gradués de
grâce, & les gradués de privilège. Obfervations fur ces
deux derniers. Origine du droit jdes gradués fur les bénéfices»
C e qu’on entend par mou de fav eu r de mois de rigueur» Examen
de l’ordinaire auquel font fujets tous les gradués avant
d ’obtenir le v i f a. Gradués fimples, & gradués nommés. Ibid.
808. a. Tous collateurs & patrons eccTéfiaftiques font fujets
k l'expeûative des gradués. Quels font les lieux en France
où les gradués ne peuvent pas requérir des bénéfices. Le
concordat donne aux gradués le décret irritant. Les gradués
doivent s’adreffér dans les fut mois de la vacance du bénéfice
au collateur ordinaire & patron, pour requérir le bénéfice
vacant. C e que le gradue doit faire en cas de refus de la
part du collateur. Ibid. b. Tems d’étude néceffaire pour
acquérir les degrés k l’effet de pouvoir requérir des bénéfices.
Formalités par rapport au certificat du tems d’é tude, 6c aux
lettres de degré. Notification à faire aux collateurs pour obtenir
des bénéfices. Notification annuelle que les gradués doivent
faire de leurs noms 8c furnoms. Rémotion qui fe fait
tous les ans en l’abfence des collateurs. Avantage d une notification
faite avant la vacance du bénéfice. A qui doit être
notifiée la nomination du gradué. Choix que peut faire le
Collateur ou patron, quand un bénéfice vaque dans un mois de
fitveur. Ibid. 809. a. Autre réglé à fuivre dans les mois de
rigueur. Entre plufieurs gradués nommés également anciens,
on préféré le plus qualifie. Liberté de choix lorfque toutes
choies fe trouvent égales entre les gradués. Articles qui ne
doivent pas être oubliés dans les lettres des gradués nommés.
Conditions requifes de la part du gradué pour requérir un
b én é fic e ,d e pour être ccnfé rempli. Ibid. b. Les bénéfices que
euvent requérir les gradués, font ceux qui vaquent par mort.
ourpoiTéder une cure dans une v ille murée, il faut être gradué.
Privilèges de* régens feptenaires & des principaux d'un collège
fur les gradués nommés. Q u e l cft le préféré de plufieurs
profeffeurs en concurrence. D u temps que les gradués
ont pour requérir. L e pape peut prévenir les gradués » mais
il faut que ce foit avant leur requifuion. La rffquifition faite
par un gradué dont le degré feroit n u l, met a couvert le
droit de tous les gradués, Ibid. 810. a. Quoiqu’un gradué
nommé ait obtenu des provifions, il eff évincé dé plein droit
par un gradué nommé,plus ancien que lui. Droit de conférer
des chapitres, fed e vacante, Les gradués ne peuvent tranf-
mettre leurs droits à d’autres gradués. D u droit de conférer
les bénéfices par dévolution d e l’inférieur au fupérieur. Ou vrages
à consulter. Ibid. b.
Gradués» expeélative des g ra du é s , en matière bénéficiale.
V L 18 6 . b. H om m e gradué dans la facu lté d e droit. IV.764. b.
Grad u i ancien. VIT. 8 10 . b.
Gradui-ès-arts. V II, 810. b.
Grad u i en droit canon. V II. 8 10 . b.
Grad u i en droit civil. VU . 810. b.
Grad u i en droit c iv il b canonique. V II, 810. t ,
Grad u i de faveur. V IL 810. b.
Grad u i dans les formes. V I I , 810. b.
Grad u i de grâce. V IL 810. b,
Gradui en médecine. V IL 8 x j. a.
Gradui nommi. V IL 8 1 1 , a,
Graduis de privilège. V IL 8 1 1. a,
Gradui qualifié. V IL 8 1 1 . a .
Gradui rempli. V IL 81 1 . a.
G rad u i régulier. V IL 8 1 1 . a.
G rad u i de rigueur. V IL 81 1 . a.
G ra d u i per Jalfum. V II. 8 1 1 . a,
Grad u i ficu lier. V IL 81 1 , a.
G rad u i feptenaire. V II. 8 1 1 . a.
Grad u i Jimpie, V IL 8 1 1 . a.
Gradui en théologie, V IL 8 1 1 . a.
Gradui in ut roque. V IL 8 1 1 , a.
G R AD U E L , ( H t f i . eccl. b L iturgie) O n appelloit autrefois
de ce nom, & un livre d'églife, & les prières qu’il con-
teooit, 8c qui fe chantoient après l’épitre. Dans quel fens
c e mot eff employé aujourd'hui. On appelloit auffi graduels,
les quinze pfeaumes que les Hébreux enantoient fur les quinze
degrés du temple. Réflexions myffiques du cardinal u o n a ,
fur ces quinze pfeaumes. V IL 8 1 1 . b. Voyc[ P s e a u m e ,
G R A D U S , ( Giogr. maritim. b ancienn. ) Ports que les Romains
nommoient amfi. Origine de l’cxpreflion échelles du
levant. Etym, du mot gras dont on fe fert pour exprimer les
embouchures du Rhône, Les Efpagnols appellent crao ce que
les Romains appelloient gradus. Origine du 'nom de grau que
l’on donne fur la côte du Languedoc, à l’embouchure d’une
rivière. V IL 8 1 1 . b.
G R A D U S , lit tu s , plagia , portus, jla t io , pofitio , coto ,
rtfupum. ( Lang. la tin .) Différentes fignifiçation* de ces mots.
*A* 595- a , h.
GRÆFENTHAL , ( Giogr. ) ville d’A llemagne dans la
haute-Saxc. Sa fituatioh. Seigneurs de ce lieu. Arts qu’on y
exerce. Suppl. III. 249. a.
G R Æ V Iu S , (Jean-George ) favant Saxon : fes ouvrages
8c fes voyages. VIII. 40. a.
G R A F iG N Y , ( Françoife Dijfembourg d'Happoncourt )
Comment elle décrit les divertiflemens de Ta nation françoife.
IV . 1069.
G R A G E , ( Ar ts m ich .) rape dont nos infulaires fe fervent
pour le manioc. Dcfcription 8c ufage. V I I . 8 1 1 . b.
G R A H A M , fa pendule pour les tierces. 111. 402. a. Echappement
de fes montres , V . 236. b. tic de fes pendules. 237;
a , b. Seéleur de Graham. XIV. 877. a , b. b c . Table de la
marche de la pendule de Graham , tant k Pello qu’à Paris.
Suppl¿1IV . 80 t . b.
G R A IN , ( Gramm. ) D iv er s ufages de ce mot. V i f .
812. a.
G r a i n s , (E c o n . p o lit iq .) Principaux objets de commerce
en France, utilité des manufaélures de toiles 8c d’étoffes
communes. Depuis long-temps les manufaélures de luxe ont
féduit la nation. Rcnverfement dans le fyffême économique
ui en a réfulté. V I I . 812. a. La France p eu t produire abon-
amment toutes les matières de premier befoin ; elle ne peut
acheter de l’étranger que des marchandées de luxe j mais par
le fyffême aéluellcmcnt re çu , nous avons éteint entre l’étranger
8c n o u s , un commerce réciproque qui étoit pleinement
a notre avantage. Ces manufaélures nous ont plongé dans un
luxe défordonné, 8c ont été principalement foutcnucs par
notre confommation. La confommation qui fe fait par des fujets
, eff la fource des revenus du fouverain, 8c la vente du fu-
perflu à l’étranger augmente les richeffes des fujets. Celle qui
procure à la fois les deux avantages, eff la confommation générale
qui fatisfait aux hefoins de la vie. Le détail dans lequel
on va entrer, prouvera combien la produélion des matière»
de premier b e io in , leur débit 8c leur confommation inté-
reffent tous les différons états du royaume. Nous avons déjà
examiné l’état de l’agriculture en F ran ce, les deux fortes de
culture qui y font en u fa g e , leurs produits, la dégradation
de notre agriculture, 8c les moyens de la rétablir ; voy$£
F e rm i e r s . Nous allons examiner le revenu que 45 million»
de fep tie r s de blé peuvent procurer au r o i , conformément
aux deux fortes de cultures qui les produisent ; nous examinerons
ce ü ffon en retire pour la d ixm e , le lo y e r de»
terres 8c le gain*du cultivateur ; nous comparerons enfuite
ces revenus avec ceux que produirait le rétabliffement parfait
de notre agriculture, l’exportation étant permife.
E ta t de la grande culture des erains. L a grande culture c(t
aéluellement bornée environ à iix millions d’arpens de terre.
Ces fix millions entretiennent tous les ans une foie de deux
million# enfemencés en blé ; une foie de deux millions e n
avoine 8c autres grains de mars ; 8c une foie de deux millions
en jacheres pour l’année fuivante. Moyen de déterminer le
■prix commun du blé dans l’état aéluel de la grande culture,
or fa u e l’exportation eff défendue. C e prix commun de chaque
feptier du b lé , fe trouve être à 15 liv. 9 f. Produit eu entier
de chaque arpent, en y comprenant celui de la dixme, 8c
la femence dédu ite, 84 liv. 16 f. Produit n e t , 17 liv. 8 f.
D e ces 1 7 liv. 8 f. il ne reffe au fermier de gain pour fub*
f iffc r , que 3 liv. 9 f. 6 d. c’eff ce qui eff ici démontré. Ib id.
813. a. Calculs qui démontrent que le fermier ne gagnant
un peu que dans les mauvaifes années ,11 a intérêt qu il n V
ait pas beaucoup de blé. Valeur en argent du produit de fa
foie de deux millions d’arpens en b l é , 169,907,703 liv.'
Diffribution de cette fomme entre la ta ille , les propriétaires »
les fe rm ie r s , la dixme 8c les frais. Evaluation du produit de*
deux millions d’arpens enfemencés en avoine , ou autres grain*
de mars. Produit de l’arpent en y ajoutant la dixme, 10 liv.'
10 f. Les deux millions d arpens donnent, y compris la dixme ,
8c fouftraélion faite de la femence, en argent, 33>33°»333 l‘v *
7 f. Répartition de cette fomme entre les propriétaires, la
taille, les fe rm ie r s , la dixme 8c les frais. To ta l des produit»
de la récolte du blé 8c de l’avoine , traités par la grande
culture : 203,000,000 liv.
E ta t de la petite culture des grains. Dans cette culture ,.c ’eft
la terre elle - même qui avance tous les frais mais d’une
maniéré fort onéreuie au propriétaire, 8c encore plus »
l’état. Ibid. 814.' a . Voyt,[ l’article F e r m ie r . Auffi les terre»
abandonnées k cette culture ingrate font-elles peu recherchées.
Un arpent d e terre qui fe vend dans ces pays-lâ 30
ou 40 liv. vaudrait 2 ou 300 liv. dans des provinces b ie n
cultivées. L e propre revenu de ces terres du fort au foible s
eff de ao ou 30 fols par arpent. Etat d’une terre qui produit,
année commune, pour la part du propriétaire , en v iro n
3000 liv. en b l é , femence p ré le v é e , prefque tout en froment.
I l y en a 400 arpens en culture , dont 200 fo rm en t
la foie de la récolte de chaque année. Les terres médiocre»
ne font guere louées que fur le pié de t ç fols l’arpent. Ibid.
813. a. Provinces du royaume qui ne fon t qu’en terre»
médiocres. Q b f c r v a u o o fw U c y iu u ç du Languedoc, & »qn
1 * ^ , produ it
G R A
produit. Caufts de la mauvaife culture qui fe fàk par le»
métay er s 8c par l’ufage des boeufs. Dans ces provin ce s, les
Îiaylans 8c manouvriers ne font point occupés, c om m e dans
es pays de grande culture. Le blé y a peu de d éb it, faute
de confommation. La part de la técoltc qui eff pour Je métayer
fuffit à peine pour fa famille ; 8c quand la récolte eff
mau vaife, il eff dans la difetre. La cherté du blé dans les
mauvaifes années n’y dédommage doiic point de fa non-
valeur dans les bonnes années. Ibid. b. Evaluation du blé
dans les provinces où les terres font traitées par la petite
culture , 12 liv. le fep tie r , froment 8c feigle. C e n’eff pas
parce qu’on laboure avec des boeufs que l’on tire un fi petit
produit des terres ; mais parce que les propriétaires fe refu-
feront toujours aux dépens néceflaircs, tant que le commerce
ne fera pas libre. O u effime qu’il ÿ a environ 30 millions
d’arpens traités par la petite cu ltu re , divifés en deux foies
qui praduifent alternativement. On ne diftingue point ici la
récolte des graines de mars, l’objet n’étant pas aflez confidé-
rable. Ibid. 816. a. Chaque arpent eff effimé donner en
v a leu r , la dixme p ré le v é e , 24 liv. Diffribution de ces 24 liv.
A u propriétaire 12 liv. j au métayer 10 l iv . : pour fa taille
1 liv. ; pour fes rifques 8c profits 1 liv» Produit total de 13
millions d’a rpen s, 397,802,040 liv. Les produits de la grande
8c de la petite culture réunis, le total monte à 393,000,000 liv.
E ta t d ’une bonne culture des grains. Différentes caufes de
la diminution du produit de nos récoltes. Autrefois avec un
tiers plus d’habitans qui augmentoicnt la confommation ,
notre culture fourniffoit à l’étranger une grande quantité de
grains. I l falloit que nos récoltes produififient alors au moins
70 millions de feptiers de blé j elles en praduifent aujourd'hui
environ 45 millions. Eloge du gouvernement économique
de Sully. Ibid. b. Le rétabliffement de notre culture fuppofe
l'accraiffcment de la population Le principe- de ces deux
progrès eff l’exportation des denrées du cru ; parce que la
vente à l’étranger augmente lès revenu s, que l'accroiflemcnt
des revenus augmente la population, que l’accroiffemcnt de
la population augmente la confommation, qu’une plus grande
Confommation augmente de plus en plus la culturé, les revenus
8c la population. Mais tous ces accroiffemcns ne peuvent
commencer que par celui des revenus. Syftéme oppofé qu'on
a fui vi en France. Effets du gouvernement économique de
M. Colbcrr. Ibid. 8 1 7 . a. Il faudrait borner la culture du
blé aux bonnes terres. Trente millions d’arpens formeraient
chaque année une foie de 10 millions, qui produirait au
moins 65 millions de feptiers. Le prix du feptier k 18 Hv.
le produit de l’arpent feroit de 108 l iv r e s , non compris la
dixme. Les variations du prix du blé en Angleterre ne s étendent
qu’environ de 18 k a» liv. Raifon pour laquelle ces
variations font fi peu confidérablcs. Si notre agriculture étoit
en bon é ta t , nous éprouverions de m êm e peu de variations.
Ibid. b. Expofition des variations des récoltes que produit
une bonne culture félon la diverfité des année*. O n y remarque
qu’une mauvaife récolte de 10 millions d arpens, donne
40 millions de feptiers de blé , fans la récolte d u n e même
quantité d’arpens enfemencés en grains de mars. O n dijtinguc
les années en abondantes , bonnes, moyennes, toiblei; üc
mauvaifes. Le prix commun du feptier tiré de ces obier-
varions, revient à 1 7 . M 4 Le proamtiotal de 1 arpent
a i 6 liv. dont il y a de produit net 40 liv. Ibid. 810. a. Les
années bonnes 8c mauvaifes réduites i une année commune,
le fermier gagne par feptier i liv. 13 f. ou environ 10 liv.
par arpent. La récolte en blé de 10 irpcnS donne .an n é e
commune, la dixme comprife levée fur toute la >&<>«*, le
fonds de la femence comp ris, i ,M iM 00"00° , ; lv ’
La récolte en grains de mars aulïï de 10 millions d arpens,
donne année commune, »8,300,000 ltv. Les prodnM
récolte des 10 millions d’arpens en b lé , & de la récolte des
10 millions d’arnens en grains de mars réu n is, ^ ¡ ‘u'rment
>,378,000,000 fiv. les frais compris dans cette fomme.«
b. Diftribtttion de ce produit total entre les pr0Pr**tal^c ' ’
la ta ille , les fermiers, la dixme 6c les frais. I y a outre le.
30 millions dont on vient d'apprécier c produit, 3®
millions d'arpens de moindre valeur. Différente, r i i o n s
auxquelles ils peuvent être employés. U »
4 1 - 000,000. Diftribtttion de cette fomme entre les proprié
taircs la 'ta i lle , les fermiers, la dixme 8c les frais. Récapitulation
des différens produits de la bonne culture réunie.
Coinparaifon des produits de la culture aûuelle du royaume,
avec ceux de la bonne culture. ,
Obftrvations fu r l e , avuntugn i ‘ I f cullure des ,« 1 « . Les
produits de l’agriculture pourrolent être de quatre^miUtard.,
fans y comprendre le . produits’ des chanvres, des b o is , de
lÎ pêche, d e , revenus J e , m a ifon ., des rentes, du f e l , des
mines ni les produits des arts & métiers, b c . Mais il s en
fa ". beaucoup que la France jouiffe de c e , revenus. On
n’eftime guère ou’à a milllards la con fom ma .ion o u la dé^
penfe annuelle de la nation. Ibsd. 810. | O r | g g dép«n» e»
4-pcu-prê, égale aux r e v en u ., ouvriers
la main-d’o iiiv re , qui procurent la fubftftance aux ouvr.er.
Tome ||
G R A 85 7
de tour g en re , 8c qui font prefque tous pavés par les pra»
ducrion* de la terre. On regarde continuellement 1’agncul-
ture 8c le commerce, comme les rcffourcc* de nos richeffes*
Mais le commerce 8c lu main-d’oe u v re, qui en eff inséparable *
ne fubfirtcnt que par l’agriculture. Supériorité des vues de
M. de Su lly. Les bonnes récoltes praduifent beaucoup dé
fourrage# pour la nourriture des beffiaux ; les 30 million»
d’arpens de te rres médiocres feraient en partie dertinés auffi
à cet ufage. Il faudrait 10 millions d'arpens de prairies arti*
ficiellcs pour nourrir des beffiau x, qui procureraient affez
de fumier pour fournir un bon engrais aux terres qui, chaque
année, doivent être enfemencées en blé. Si on fe procure
par l’engrais de la terre un feptier de blé de plus pat
chaque arpent » on double à-peu-près le profit. A in fi l’on voit 3ue la fortune du fermier dépend du produit d'un feptier où
eux de plus par arpent de terre. Ibid. b. Il n e p eu t obtenir
cet avantage que par le moyeu des beffiaux. Un fermie r
b o rn é à l’emploi d'une charrue, ne peut pr é ten d re k un
gain confidérable. Les riches.laboureurs qui o c c u p en t p lufieu r s
charrues, cultivent beaucoup plus avantageufement pour eux
8c pour l'è ta t , que ceux qui font bornes à une feule. Les
terres ne doivent pas feulement nourrir ceux qui les cultivent,
elles doivent fournir à l'état la plus grande partie dcar
fubfides. Les revenus du r o i , du clergé, des propriétaires *
b c . tournent en dépenfes qui fe diffribuent à tous les autres
étars. Mauvais emploi des hommes dans les terres cultivées
en détail par de petits fermiers. Ibid. 8 a t. a. Obfcrvation»
fur la culture de la vigne 8c le com m e r c e des vins. Quel»
font les fermiers par lefquels l’agriculture prafpércra. Ceux
qui n’envifagent les avantages d’une grande population , que
pour entretenir de grandes armées, jugent mal de la force
d’un état. Avantages les plus effcntiels d’une grande population.
Pour juger de l’état des richeffes du royaume > il ne faut pas
les confidércr Amplement par rapport à leur quantité, mais
auffi par rapport à leur circulation relative à la quantité, au
débit 8c au non prix des produélion# du royaume. Les biens
primitifs d’un grand état font les hommes, les terre# 8c le»
beffiaux. Défavantages d’un état qui ne peut fe foutenir que
par la fabrication 8c le commerce dé trafic.
Obfervations fn r la taille levée fu r la culture des grains. La
taille pourrait par l’accroiffemcnt des revenus, monter à uné
impoution égaie à la moitié du prix du fermage. Ainfi en fe
conformant aux revenus des propriétaires des terres qui
feraient de 400 millions, la taille produirait environ 200
millions. En retranchant de cette fomme 7^ pour l’cxemptioil
des nobles qui font valoir eux-mêmes la quantité de terre»
permiies par les ordonnances, il relierait i$o millions. Mai»
il faut ajouter la taille des fermiers des dixmes, qui réta-*
bliroit au moins la fomme de aoo millions. La proportion
de la taille avec le lo y e r des terres, cft la réglé la plu»
Itire p ou rV im p o fit io n fur les fermiers. Ibid. 82». a. U n e dos
conditions cffenticllcs pour l’augmcnratien des fe rm ie r s , eff
de r éform er les abus de la taille arbitraire. On ne peut établir
pour la taille aucune taxe fixe fur les terres, dont le produit
eff fufccpriblc de variations par les différentes cultures.
C eu x qui ont propofé une taille réelle fur Ics^ te r r e s , n’o n t
pas imaginé les irrégularités qui naiffent des différens g enres
de culture', 8c les variations qui en réfultcnt. Ibid. b. Obfcrvation
fur la manière dont on établit la taxe *fur les Pay*
d’état. Quelle cft la méthode la plus équitable pour l eta-
bliffemcnt de la taille dans l’état aé lu e l, pou r la grande 8c
pour la petite culture, Ibid. 823. a. Détails fur ce fujet. Ibid. b.
Moyens de repeupler la campagne de cultivateurs en état
de rétablir la culture des terres. Ibid. 824. a. Limpofition
proportionnelle des autres habitans de la campagne, peut être
fondée comme la taille fur des profits connus. La taille dans
les vignes ne peut fe rapporter aux mêmes réglés. Obfervations
fur cette fauffe maxime de politique injuffcmcnt attribuée
an gouvernement, de regarder l’impofuion arbitraire
comme un m o y en «ffuré pour tenir les fiqets dans la fou-
^O bferva tions fhr l ’exportation des grains. Cette exportation
fi effentielle au rétabliffement de Tagriculture , ne contribuerait
pas k augmenter lep r ix des grains i mais elle empêcherait
les non-valeurs du %lé. Loin que 1 exportation occa-
fionnât les difetres , fon effet au contraire ferait daffure*
t’ohnmhnce Paffage fur ce futet tiré du livre intitulé : A v a n -
I S 1 ¡ Ü l de U r 'n d ,.B r „ „ in e . Ibid. M M *
•X n t lsn c e des produafons m * nrocttrerott en France
¡•agriculture portée 1 un haut c W , ne pourro.t- elle oae
les faire tomber en non-valeur ? Réponfe à cette difficulté*
Réflexions qui montrent que nous n aurions pas a craindre
non plus des progrès de l’agriculture en non piu» ww i ç*. „ . .. r__ w..-. Am«»é./rri.q ue, légmaluitteé
de concurrence. Obfervations qui doivent auffi
erainte de difette dans le cas d’exportation. Ibid. b. Le défaut
de débit 8c la non-valeur de nos denrées qui ruinent no»
:sLf, - “il. Énc flontt xque l’effet de la mifere du peuple, 8c nM S duaions! Pour mieux comprCTtftc^lôiganbi^sdu commerce