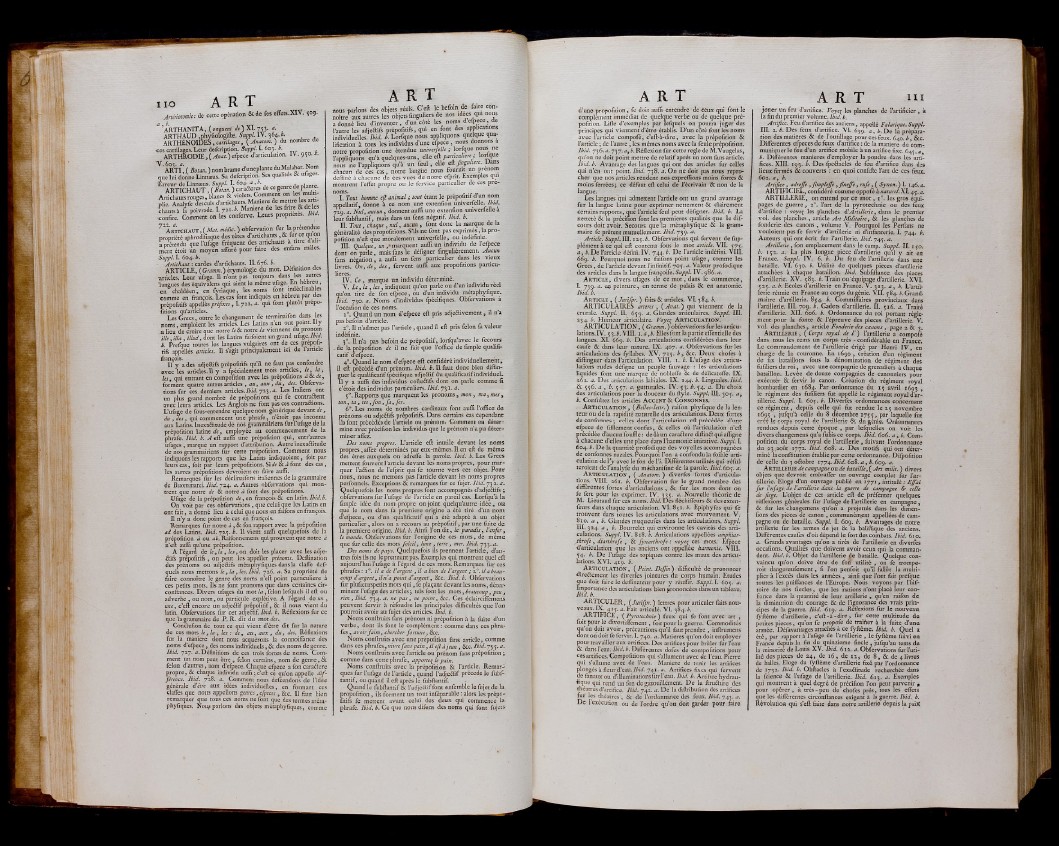
ô ART
HiRa
Hi
N
1 1 > 0 _ _ - ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artériotomie : de cette opération & d e fes é ffe ts .X lV .W
a ARTHANITA, ( onguent de ) XI. 7 « . B ,
ARTHAUD ,phyfiologifte. Suppl. IV. 364.6.
ARTHÉNOIDES, cartilages, ( Anatom. ) du nombre ae
«es cartilages. Leurdefcription. Suppl. I. 603. 6.
ARTHRODIE, ( Anat.)efpece d’articulation. IV. 950.
A R Î Î ' ( Bot an. ) nom brame d’uneplante du Malabar. Nom
que lui donne Linnæus. Sa defcription. Ses qualités & ufage .
I A'i nui u * .4
Artichauts rouges, blancs & v.ol='^Comment on leS mutaolie
Analvfe Jesculs d’a r tich au ts . M a n ié r é de mettre les aru
chauts à la poivrade. 1. par. i. Manière de les fore: &deles
«confire. Comment on les conferve. Leurs propriétés. Ibid.
^ A r t i c h a u t ( Mat. médic. j obfervation fur la prétendue
propriété aphrodifiaque des têtes d’artichauts ,& fur ce qu on
a prétendu que l’ufaee fréquent des artichauts a titre d aliment
étoit un moyen affuré pour faire des enfans maies.
Suppl. I. 604. h. "
Artichaut : cardes d’artichauts. II. 676. b. . .
ARTICLE, ( Gramm.) étymologie du mot. Définition des
■articles. Leur ufage. 11 n’ont pas toujours dans les autres
'langues des équivalens qui aient le même ufage. En hébreu,
•en chaldéen, en fyriaque, les noms font indéclinables
comme en françois. Les cas font indiqués en hébreu par des
prépofitifs appellés préfixes, 1.722. a. qui font plutôt prépositions
qü’articles. . ,
Les Grecs, outre le changement de terminailon dans les
noms, emploient les articles. Les Latins n’en ont point. 11 y
.a lieu de croire que notre le 8c notre la viennent du pronom
ille,iüa, illud, dont les Latins faifoient un grand ufage.Ibid.
b. Prefque toutes les langues vulgaires ont de ces prépofitifs
appellés articles. Il s’agit principalement ici de 1 article
françois. _ ,
Il y a des adjeftifc prépofitifs qu’il ne faut pas confondre
avec les articles. 11 y a ipècialement trois articles, le, la,
les, qui entrant en compofition avec les prépofitions à 8x.de,
forment quatre autres articles , au, aux, du, des. Obferva-
tions fur ces derniers articles. Ibid. 723. a. Les Italiens ont
un plus grand nombre de prépofitions qui fe contractent
avec leurs articles. Les Anglois ne font pas ces contractions.
L’ufage de fous-entendre quelque nom générique devant de$
du, des, qui commencent une phrafe, n’étoit pas inconnu
aux Latins. Inexactitude de nos grammairiens furl’ufage de la
prépofition latine de, employée au commencement de la
phrafe. Ibid. b. A eil aufli une prépofition qui, entr’autres
ufages , marque un rapport d’attribution. Autre inexactitude
de nos grammairiens fur cette prépofition. Comment ^ nous
indiquons les rapports que les Latins indiquoient, foit par
leurs cas, foit par leurs prépofitions. Si de oc à font des cas.
les autres prépofitions devroient en faire aufli.
Remarques fur les déclinaifons italiennes de la grammaire
de Buommatei. Ibid. 724. a. Autres obfervations qui montrent
que notre de 8c notre à font des prépofitions.
Ufage de la prépofition de, en françois & en latin.Ibid.b.
On voit par ces obfervations, que celui que les Latins en
ont fait, a donné lieu à celui que nous en faifons en françois.
Il n’y a donc point de cas en françois.
Remarques fur notre à ,8c fon rapport avec la prépofition
ad des Latins. Ibid. 725. b. 11 vient aufTi quelquefois de la
prépofition à ou ab. Raifonnemens qui prouvent que notre à
n’eu aufli qu’une prépofition.
A l'égard de le ,la , les, on doit les placer avec les adjectifs
prépofitifs, on peut les appeller prénoms. Deftination
des prénoms ou adjeCtifs métaphyfiques dans la clafle def-
quels nous mettons le, la, les.Ibid. 726. a. Sa propriété de
faire connoître le genre des noms n’eft point particulière à
ces petits mots. Ils ne font pronoms que dans certaines cir-
conitances. Divers ufages du mot la , félon lefquels il eil ou
adverbe , ou nom, ou particule explétive. A l’égard de un ,
une, c’eft encore un aajeCtif prépofitif, & il nous vient du
latin. Obfervations fur cet aajeCtif. Ibid. b. Réflexions fur ce
que la grammaire de P. R. dit du mot des.
Condufion de tout ce qui vient d’être dit fur la nature
de ces mots le, la., les : de, au, aux, du, des. Réflexions
fur la maniéré dont nous acquérons la connoiflance des
noms d’efpece, des noms individuels, 8c des noms de genre.
Ibid. 727. a. Définitions de ces trois fortes de noms. Comment
un nom peut être , félon certains, nom de genre, 8c
félon d’autres, nom d’efpece. Chaque efpece a fon caraCtere
propre, & chaque individu aufli | c’eft ce qu’on appelle différence.
Ibid. 728. a. Comment nous defeendons de l’idée
générale d’étre aux idées individuelles, en formant ces
dafles que nous appelions genres, efpeces , &c. Il faut bien
remarquer que tous ces noms ne font que des termes métaphyfiques.
Noqs parlons des objets métaphyfiques, comme
ART
“ donné lieu d’inventer, d’vn eôté les noms d’efpece , de
l’autre les adjeftifs prépofitifs, qui en font des applications
individuelles. Ibid. b. Lorfque nous appliquons quelque qualification
à tous les individus d’une eipece, nous donnons a
notre propofition une étendue mmrJiUe ; lorfque nous ne
l’appliquons qu’à quelques-uns, M N H H i S H g .
nous ne l’appliquons qu’à un feul, elle eft fingu lere.
chacun de ces cas, notre langùe nous fournit un prénom
neitinc à chacune de ces vues de notre efprit. Exemples qui
montrent l’effet propre ou le fervice particulier de ces prêtais.
I. Tout homme efi animal ; tout étant le prépofitif d un nom
appellatif, donne à ce nom une extenfion universelle. Ibid.
729. a. Nul, aucun, donnent aufli une extenfion univerfelle a
leur fubftantif, mais dans un fens négatif. Ibid. b. j |
II. Tout, chaque, nul, aucun , font donc la marque de la
généralité des propofitions. S’ils ne font pas exprimés, la pro-
pofition n’eft que moralement univerfelle, ou indéfinie.
ni. Quelque, an,*marquent aufli un individu de 1 efpece
dont on parle, mais fans le défigner finguliérement. Aucun.
fans négation, a aufli un fens particulier dans les vieux
livres. On, de, des, fervent aufli aux propofitions particulières.
;;
IV. Ce, marque un individu déterminé. • g •
V. Le, la , les, indiquent qu’on parle ou d’un individu réel
qu’on tire de fon efpece, ou d’un individu métaphyfique.
Ibid. 730. a. Noms d’individus fpécifiques. Obfervations à
l’occafion de ces noms. . . . ,
i°. Quand un nom d’efpece eft pris adjectivement, il n a
pas befoin d’article.
2°. Il n’admet pas l’article, quand il eft pris félon fa valeur
indéfinie.
3°. Il n’a pas befoin de prépofitif, lorfqu’avec le fecours
, de la prépofition de il ne fait que l’office de fimple qualificatif
a’efpece.
40. Quand le nom d’efpece eft confidéré individuellement,
il eft précédé d’un prénom. Ibid. b. Il faut donc bien diftinf
11er le qualificatif fpécifique adjeétif du qualificatif individuel.
1 y a aufli des individus collectifs dont on parle comme fi
c’étoit des individus particuliers. Ibid. 75,1. a.
50. Rapports que marquent les pronoms, mon, ma, mes,
ton, ta, tes, fon, fia, fies.
6°. Les noms de nombres cardinaux font aufli l’office de
prénoms ou adjeCtifs prépofitifs. Dans certains cas cependant
ils font précédés de l’article ou prénom. Comment on déter-?
mine avec précifion les individus que le prénom n’a pu déterminer
aflez.
Des noms propres. L’article eft inutile devant les noms
propres, aflez déterminés par eux-mêmes. Il en eft de même
des êtres auxquels on adreffe la parole. Ibid. b. Les Grecs
mettent fouvent l’article devant les noms propres, pour marquer
l’aCtion de l’efprit qui fe tourne vers cet objet. Pour
nous, nous ne mettons pas l’article devant les noms propres
perfonnels. Exceptions 8c remarques fur ce fuj.et. Ibid. 732. a.
Quelquefois les noms propres font accompagnés d’adjeCtifs ;
obfervations fur l'ufàge de l’article en pareil cas. Lorfqu’à la
fimple idée du nom propre on joint quelqu’autre idée, ou 3ue le nom dans fa première origine a été tiré d’un nom
’efpece, ou d’un qualificatif qui a été adapté à un objet
particulier, alors on a recours au prépofitif, par une fuite de
la première origine. Ibid. b. Ainfi l’on dit, le paradis, l'enfer,
le monde. Obfervations fur l’origine de ces mots, de même
que fur celle des mots fioleil, lune , terre, mer. Ibid. 733.a.
Des noms de pays. Quelquefois ils prennent l’artide, d’autres
fois ils ne le prennent pas. Exemples qui montrent quel eft
aujourd’hui l’ufage à l’égard de ces mots. Remarques fur ces
phrafes : i°. il a de l'argent , il a bien de l'argent ; 20. il a beaucoup
d'argent, il n'a point d’argent, 8c c. Ibid. b. Obfervations
fur plufieurspetits mots qui, fe plaçant devant les noms, déterminent
l’ufage des articles ; tels font les mots, beaucoup, peu ,
rien, Ibid. 734. a. ne pas, ne point, 8cc. Ces éclairciflemons
peuvent fervir à réfoudre les principales difficultés que l’on
pourroit avoir au fujet des articles. Ibid. b.
Noms conftruits lans prénom ni prépofition à la fuite d’un
verbe, dont ils font le complément : comme dans ces phrafes,
avoir faim, chercher fortune , &c.
Noms conftruits avec une prépofition fans article, comme
dans ces phrafes, vivre fans pain , il efi à jeun , 8c c. Ibid. 735. a.
Noms conftruits avec l’article ou prénom fans prépofition ;
comme dans cette phrafe, apporte£ le pain.
Noms conftruits avec la prépofition 8c l’article. Remarques
fur l’ufage de l’article, quand l’adjeétif précédé le fubftantif,
ou quand il eft après le fubftantif.
Quand le fubftantif & l’adjeétif font enfemble le fujet de la
propofirion, ils forment un tout inféparable : alors les prépofitifs
fe mettent avant celui des deux qui commence la
phrafe. Ibid, b. Ce que nous difens des noms qui font fujets
ART A R T ni
d’une propofition, fe doit aufli entendre de ceux qui font le
complément immédiat de quelque verbe ou de quelque prépofition.
Lifte d’exemples par lefquels on pourra juger des
principes qui viennent d’être établis. D’un côté font les noms
avec î’article compofé, c’eft-à-dire, avec la prépofition &
l’article ; de l’autre, les mêmes noms avec la feule prépofition.
Ibid. 73 6. a. 737. a, b. Réflexion fur cette réglé de M.Vaugelas,
qu’on ne doit point mettre de relatif après un nom fans article.
Ibid. b. Avantage des langues qui ont des articles fur celles
qui n’en ont point. Ibid. 738. a. On ne doit pas nous reprocher
que nos articles rendent nos expreflions moins fortes 8c
moins ferrées ; ce défaut eft celui de l’écrivain 8c non de la
langue.
Les langues qui admettent l’article ont un grand avantage
fur la langue latine pour exprimer nettement 8c clairement
certains rapports, que l’article feul peut défigner. Ibid. b. La
netteté & la précifion font les premières qualités que le discours
doit avoir. Secours que la métaphyfique & la grammaire
fe prêtent mutuellement. Ibid. 739. a.
Article. Suppl. III. 125.6. Obfervations qui fervent de fup-
plétnent à ce qui eft contenu fous le • mot article. VII. 575.
a, b.De l’article défini.IV. 744. b. De l’article indéfini. VIII.
66g. b. Pourquoi nous ne faifons point ufage, comme les
Grecs, de l’article devant l’infinitif. 705. a. Valeur profodique
des articles dans la langue françoife. Suppl. IV. 986. a.
A rt ic l e , divers ulages de ce mot, dans le commerce,
I. 739. a. en peinture, en terme de palais 8c en anatomie.
Ibid. b.
A rt icle , ( Jurifipr. ) faits 8c articles. VI. 384. b.
ARTICULAIRES arteres, ( Anat. ) qui viennent de la
crurale.- Suppl. II. 659. a. Glandes articulaires. Suppl. III.
234. b. Humeur articulaire. Voye{ A r t i c u la t i o n .
ARTICULATION, ( Gramm. ) obfervations fur les articu-
lations.IV. 53.6. VIII. i.a,b. Elles font la partie eflentielle des
langues. XI. 669. b. Des articulations confidérées dans leur
caufe & dans leur nature. IX. 407. a. Obfervations fur les
articulations des fyllabes. XV. 715. b , 8cc. Deux chofes à
diftinguer dans l’articulation. VIII. 1. b. L’ufage des articulations
rudes défigne un peuple fauvage : les articulations
liquides font une marque de noblefle 8c de délicatefle. IX.
202. a. Des articulations labiales. IX. 144. b. Linguales. Ibid.
8c ççô. a , b. 557. a. gutturales. IV. 53; b. 54. a. Du choix
des articulations pour la douceur du ftyle. Suppl, III. 305. a,
b. Confultez les articles A ccent & C onsonnes.
A r t ic u l a t io n , (Belles-lettr.) raifon phyfique de la lenteur
ou de la rapidité naturelle des articulations. Deux fortes
de confonnes ; celles dont l’articulation eft précédée d’une
efpece de fiffiement confus, & celles où l’articulation n’eft
précédée d’aucun fouffie : de-là un caraétere diftinâ qui afiigne
à chacune d’elles une place dans l’harmonie imitative. Suppl. I.
604. b. De la quantité profodique des voyelles accompagnées
de confonnes nazales. Pourquoi l’on a confondu la foible articulation
de l’y avec le fon de l ’i. Différentes utilités qui réful-
teroient de l’analyfe du méchanifme de la parole. Ibid. 60^. a.
A r t ic u l a t io n , (Anatom. j diverfes fortes d’articula-
tions. VIII. 261. b. Obfervation fur le grand nombre des
différentes fortes d’articulations, & fur-les mots dont on
fe fert pour les exprimer. IV. 335. a. Nouvelle théorie de
M. Lieutaud fur ces noms. Ibid. Vie s fléchifleurs & desexten-
feurs dans chaque articulation. VI. 851. b. Epiphyfes qui fe
trouvent dans toutes les articulations avec mouvement. V.
810. a , b. Glandes muqueufes dans les articulations. Suppl.
III. 3 24. a , b. Bourrelet qui environne les cavités des articulations.
Suppll IV. 818. b. Articulations appellécs ampkiar-
jhrofie, diarthrofie , 8c fiynarthrofie : voye{ ces mots. Efpece
d’articulation que les anciens ont appellée harmonie. VIII.
54. b. De l’ufage des topiques contre, les maux des .articulations.
XVI. 419. b.
A r t icu l a t io n , (Peint. Deffinj difficulté de prononcer
direfrement les diverfes jointures du corps humain. Etudes
que doit faire le deffinateur pour y réuffir. Suppl. I. 60ç. a.
Importance des articulations bien prononcées dans un tableau.
Ibid. b.
ARTICULER, ( Jurifipr. ) lettres pour articuler faits nouveaux.
IX. 411. a. Fait articulé. VI. 384. b.
ARTIFICE, ( Pyrotechnie ) feux qui fe font avec art ,
foit pour le diyertiflement, foit pour la guerre. Commodités
u’on doit avoir, précautionsqu’il faut prendre, inftrumens
ont on doit fe fervir. 1. 740. a. Matières qu’on doit employer
pour travailler aux artifices. Des artifices pour brûler fur l’eau
& dans l’eau. Ibid. b. Différentes dofes de compofitions pour
ces artifices. Compofitions qui s’allument avec de l’eau. Pierre
qui s’allume avec de l’eau. Maniéré de tenir les artifices
plongés a fleur d’eau. Ibid. 741. a. Artifices fixes qui fervent
de fanaux ou d’illuminations fur l’eau. Ibid. b. Artifice hydraulique
qui rend un fon de gazouillement. De la ftruéhire des
théâtres d’artifice. Ibid. 742. a. De la diftribution des artifices
fur les théâtres, 8c de l’ordonnance des feuic. Ibid. 743. a.
De l’exécution ou de l’ordre qu’on doit garder pour faire
jouer un feu d’artifice. Voyt[ les planches de l’artificier, à
la fin du premier volume. Ibid. b.
Artifice. Feu d’artifice des anciens, appellé Falarique.Suppl.
III. 2. b. Des feux d’artifice. VI. 639. a, b. De la préparation
des matières 8c de l’outillage pour ces feux. 640. b 8cc.
Différentes efpeces de feux d’artifice : de la maniéré de communiquer
le feu d’un artifice mobile à un artifice fixe. 643. a,
b. Différentes maniérés d’employer la poudre dans les artifices.
XIII. 193. b. 'Des ipeétacles de feu d’artifice dans des
lieux fermés 8c couverts : en quoi confifte l’art de ces feux.
602. a , b.
Artifice , adreffe , fiouplejfie, fineffie , rufie, ( Synon.j 1. 146. a.
ARTIFICIEL, confidéré comme oppofé à naturel. XI. 4^. a.
ARTILLERIE, on entend par ce mot, i°. les gros équipages
de guerre, 20. l’art de la pyrotechnie ou des feux
d’artifice : voyc{ les planches d’Artillerie, dans le premier
vol. des planches, article Art Militaire, 8c les planches de
fonderie des canons, volume V. Pourquoi les Perfans ne
vouloient pas fe fervir d’artillerie ni d’infanterie. I. 744. b.
Auteurs qui ont écrit fur l’artillerie. Ibid. 74^. a.
Artillerie, fon emplacement dans le camp. Suppl. II. 1 ço.
b. 132. a. La plus longue piece d’artillerie qu’il y ait en
France. Suppl. IV. 6. b. Du feu de l’artillerie dans une
bataille. VI. 630. b. Utilité de quelques pièces d’artillerie
attachées à chaque bataillon. Ibid. Subfiftance des pièces
d’artillerie. XV. 583. b. Train ou 'équipage d’artillerie. XVI.
Ç2Ç. a. b. Ecoles d’artillerie en France. V. 313. a , b. L’artillerie
réunie en France au corps du génie. VII. 584. b. Grand-
maître d’artillerie. 854. b. Commiffaires provinciaux dans
l’artillerie. III. 709. b. Cadets d’artillerie. H. çi6. a. Traité
d’artillerie. XIl. 006. b. Ordonnance du roi portant règlement
pour la fonte 8c l’épreuve des pièces d’artillerie. V.
vol. des planches, article Fonderie des canons , page 2 & 3.
A rtillerie , ( Corps royal de l ’ j l’artillerie a compofé
dans tous les tems un corps très - confidérable en France.
Le commandement de l’artillerie érigé par Henri IV , en
charge de la couronne. En 1690, création d’un régiment
de fix bataillons fous la dénomination de régiment des
fùfiliers du roi, avec une compagnie de grenadiers à chaque
bataillon. Levée de douze compagnies de canonniers pour
exécuter & fervir le canon. Création du régiment royal
bombardier en 1684. Par ordonnance du 15 avril 1693 ,
le régiment dés fùfiliers fut appellé le régiment royal d’artillerie.
Suppl. I. 605. b• Diverfes ordonnances concernant
ce régiment, depuis celle qui fut rendue le 25 novembre
i 6<)5 , jufqu’à celle du 8 décembre 175?, par laquelle frit
créé le corps royal de l’artillerie & du génie. Ordonnances
rendues depuis cette époque , par lefquelles on voit les
divers changemens qu’a fubisce corps. Ibid. 606. a, b. Compofition
du c.orps royal de l’artillerie, fuivant l’ordonnance
du 23 .août 1772. Ibid. 608. a. Des motifs qui ont déterminé
laconftitution établie par cette ordonnance. Diipofition
de celle du 3 ofrobre 1774. Ibid. 608. a , b.600. a.
ARTILLERIE de campagne ou de bataille, ( Art milit. ) divers
objets que devroit embraifer un ouvrage complet fur l’artillerie.
Eloge d’un ouvrage publié en 17 71, intitulé ; EJfiai
fur Vufage. de l ’artillerie dans la guerre de campagne & celle
de fiege. L’objet de cet article eft de préfenter quelques
réflexions générales fur l’ufage de l’artillerie en campagne,
& fur les changemens qu’on a projettés dans les dimen-
fions des pièces de canon , communément appellées de campagne
ou de bataille. Suppl. I. 609. b. Avantages de notre
artillerie fur les armes de jet 8c la baliftique des anciens.
Différentes caufes d’où dépend le fort des combats. Ibid. 610.
a. Grands avantages qu’on a tirés de l’artillerie en diverfes
occafions. Qualités que doivent avoir ceux qui la commandent.
Ibid. b. Objet de l’artillerie de bataille. Quelque convaincu
qu'on doive être de fon utilité , on fe tromperait
dangereufement, fi l’on penfoit qu’il fallût la multiplier
à l’excès dans les armées, ainfi que l’ont frit prefque
toutes les puiflances de l’Europe< Nous voyons par l’hif-
toire de nos fiecles, que les nations n’ont placé leur confiance
dans la quantité de leur artillerie , qu’en raifon de
la diminution au courage 8c de l’ignorance des vrais principes
de la guerre. Ibid. 619. a. Réflexions fur le nouveau
fyftême d’artillerie, c’eft-à-dire, fur cette multitude de
petites pièces, qu’on fe propofe de traîùer à la fuite d’une
armée. Défavantages attachés à ce fyftême. Ibid. b. Quel a
été, par rapport à l’ufàge de l’artillerie , le fyftême fuivi en
France depuis la fin du quinzième fiecle, jufqu’au tems de
la minorité de Louis XV. Ibid. 612. a. Obfervations fur l’utilité
des pièces de 24, de 16 , de 12 , de 8 , 8c de 4 livres
de balles. Eloge du fyftême d’artillerie fixé par l’ordonnance
de 1732. Ibid. b. Obftades à l’exa&itude recherchée dans
la fcience 8c l’ufage de l’artillerie. Ibid. 613. a. Exemples
qui montrent à quel degré de précifion l’on peut parvenir r
pour opérer, à très - peu de chofes près, tous les effets
Sue les différentes circonftances exigent à la guerre. Ibid. b.
.évolution qui s’eft faite dans notre artillerie depuis la paùç