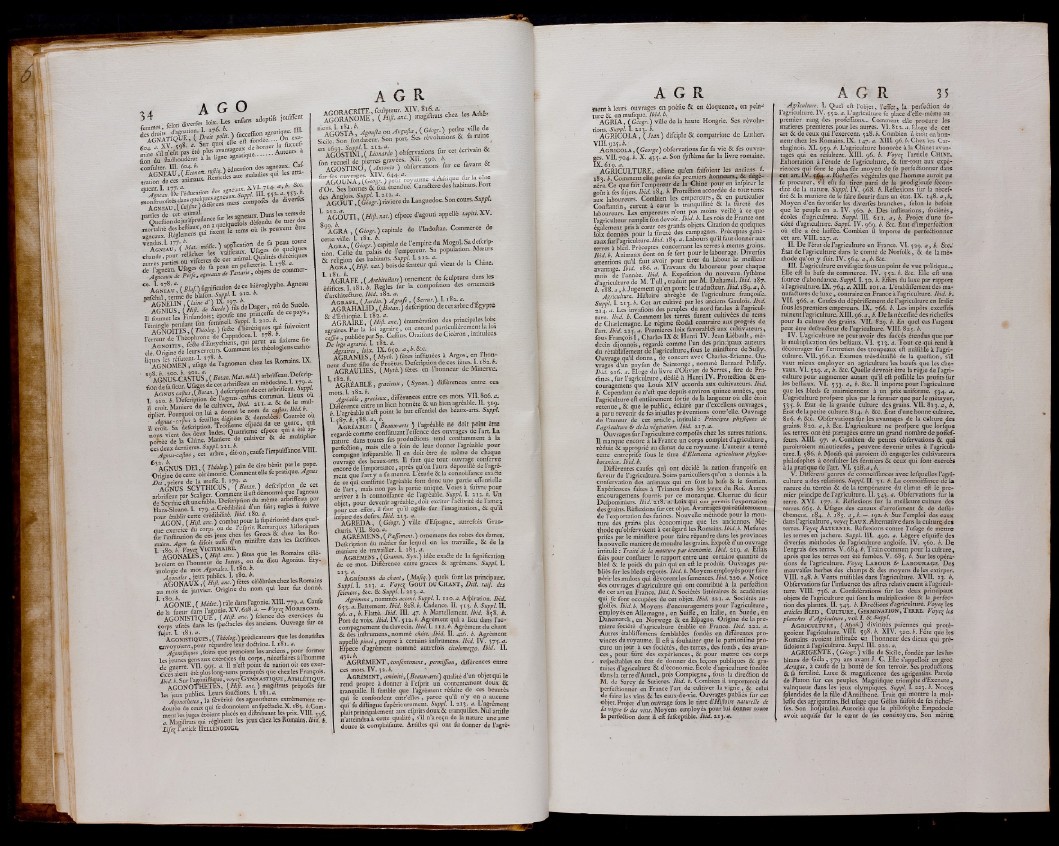
A G O
; , g l « m Les ïnfans a(IoptIft )0Mirent
fion du ftadhoudérat a la ligne g
confulter. Ä fi°4- & „ . \ ¿ducation des agneaux.
m f ®10
A G R
trao„ndTces’ ^ ma u ,B J=mcdes
quent. I. 177* i j j
n ^ n „ r i
Cafattac.
XVI. 7M- *> *•
f fl-7 s i / i . ' î S î A 1
Ü t S Ë fixent le n > i J ï « « “ être
vendus. L l 77'^\ . . >• -\ an«îication de fa peau toute
A g n e a u , ( M * ^ ; \ S a? x Ufages de quelques
chaude, pour relacher le Qualités diététiques
autres L *
* J S t P t f . 4 - - * ■ feM , objets de cotnmerjrafchal,
terme de b i f '
AGNEL1N , » J t 1 de Dager roi de Suede.
'.’ S« ssB siBsæSÇa gl^jlÆfegfs H l'erreur de fiee1e
Or,sme“ è leurs errcus. Comment les dtéologienseatho-
^ A G N O M ^ : ^ 7de lagnomen cher les Romains. IX.
^ AGNUS-CÀSTUS*, ( Botan. Mat. midi) arbriffeau-Defcrip* ÆBsÊSÊSÊBmmm en M * 1.
m m m m m
“ I g O S Î ^AgouJlaovtAugufit, AGéogr.) petite j f c f e
SicUe Son fondateur. Son port. Ses révohmons & & rume
É ,AGNUS DEI, ( Thcolog. ) pain de cire bénit parle pape.
Origine de cette cérémonie. Comment elle fe pratique. Agnus
^ a ’JnU S SCY TfflCUS^ l's 'a a n .) defcription de cet
arbriffeaupar Scaliger. C om men t U eft démontré que 1 agneau
de Scvthie eft une fable. Defcnpdon du même arbriffeau par
HanvSloane. 1. S H H » | d'un fait; réglés à fmvre
nour établir cette crédibilité, lbid. iVo. a.
AGON, ( Hift. anc. ) combat pour la fupénoritè dans quel-
que exercice du çoips''ou de l'cfprir. Rcmarqucs lurtonimes
fur l’inftitution de ces jeux chez les Grecs & chez les Ko
mains. Agon fe difoit auffi d’un mmiftre dans les facnfices.
T 180 b VovczVicriMAiRÉ. .
AGON ALES, p j t une. ) fêtes que les Romains célé-
broien.cn l’honneur de Janus ou du dieu Agonius. Etymologie
du mot AgonaUsA. 180. i.
Àponales -, ieux publics. I. ioo. b- , _
AGONAUX ( Hiß- anc. ) fêtes célébrées chez les Romains
au mois de janvier, Origine du nom qui leur fut donné.
p ’ a riÂvTp ( Médec. 1 râle dans l’agonie. XIII. 779. a. Caufe
de h fiieur dans l’agonie. XV. 6*8 u - Voycg, M o r ib o n d
AGONISTIOUE, (Hift- une.) fcience des exercices du
corps alités dans lesfpeihcles des anciens. Ouvrage fur ce
ÎU-AgonistÎquîs , ( Thcolog.') prédicateurs que les donatiftes
e n v o y o ie n t ,pour répandre leur doélrine.1.181. u.
Agoniftiques, foins que prenoient les anciens , pour former
le s jeunes gens aux exercices du corps, néceffaires à l’homme
de euerre. VII. 995. a. U n’eft point de nation où ces exercices
aient été plus long-tems pratiqués que chez les François.
lbid b. Sur l’agonifoque, voye^G y m n a s t iq u e , A t h l é t iq u e .
A G O N O t H E T É S , {Hiß. anc.) magiftrats prépofôs fur
les jeux publics. Leurs fonâions. 1. 181. a.
Aeonothetes, la févéritè des agonothetes extrêmement redoutée
de ceux qui fe donnoient enfpeétacle.X. 183. ¿.Comment
les juges étoient placés en diftribuant les pnx. VIII. 336.
a. Magiftrats qui régloient les jeux chez les Romains, lbid. b.
¿ f a L’article H e l lÉNODICE.
) °“ °ns f “ * “ &
f0\G O S Tm O P: ' f l S y o b & n s fur ce favant &
I S S I E i B S S d'Afiique fiir la cé.e
d’Or. Ses bornes & fon étendue. Caraûeredes habitans. Fort
dC A G c f l J T du Lan8uedoc-Son cours- S“Ppl'
* A G O U T I , (Hî/î.nei.) efpece d!agoud appellé tapiiLXV.
^^AGRA , (Ceogr.) capitale de l’Indoftan. Commerce de
‘ T G ^ x t c G ^ W p i t a l e de l’empire du Mogol. Sa deferip-
ùon. Celle du palais de l’empereur. Sa population. Moeurs
& religion des habitans. Suppl-1. a i a. a- 7, r , .
A g r a ,(HiJl. nat.) boisde fenteur qui vient de la Chine.
^ AGRAFE , ( ArchiteÜure) ornement de fculpture dans les
édifices.I.1S1 .b. Réglés fur la compofidon des ornemens
d’architefture. lbid. 18a. a.
A g r a f e , ( Jardin. ) Agrafe , (Serrur.). 1. 182. a-
AGRAHALID, (Botan.) deferipuon de cet arbre d’Egypte
& d’Éthiopie. 1 . 182. a. , . . , . -
AGRAIRE, {Hift. anc.) énumération des principales loue
agraires. Par la loi agraire, on entend particulièrement la loi
caj/ù1 1 publiée par Sp. Caflius. Oraifons de Ciceron, intitulées
De lege agrariâ. I. 182. a.
Agraires , loix. IX. 650. a,b. &c. t
AGRANIES, {Myth.) fêtes inihtuées a Argos, en 1 honneur
d’une fille de Proëtus. Defcription de ces ietes. 1. iba.i-
AGRAULIES, (Myth.) fêtes en 1 honneur de Minerve.
AGRÉABLE, gracieux , ( Synon. ) différences entre ces
^A&ialu*' pacitux, différmees entre ces mots. VIL 806. a.
Différence entre un bien honnête & un bien agréable. II. 319.
b. L ’agréable n’eft point le but effentiel des beaux-arts. Suppl.
I *»87. ¿. <88. dy b. .
’ A g r é a b l e : ( Beaux-arts ) l’agréable ne doit pomt être
regardé comme conftituant l’effence des ouvrages de l’art La
nature dans toutes fes productions tend conllamment à la
perfeCtion, mais elle a foin de leur donner l’agréable pour
compagne inféparable. Il en doit être de même de chaque
ouvrage des beaux-arts. Il faut que tout ouvrage conferve
encore de l’importance, après qu’on l’aura dépouillé de l’agrément
que l’art y a fu mettre. L’étude & la connoifiance exaCte
de ce qui conftitue l’agréable font donc une partie effentielle
de l’art, mais non pas la partie unique. Voies à fuivre pour
arriver à la connoiifance de l’agréable. Suppl. I. 212. b. Un
objet, pour devenir agréable, doit exciter l’aCtivité de l’ame;
pour cet effet, il faut qu’il agiffe fur l’imagination, & qu’il
inipire des defirs. lbid. 213. a. _
AGREDA, | Géogr. ) ville d’Efpagne, autrefois G rao
churis.VIL 800. a.
AGRÉMENS, (Pajfement.) ornemens des robes des dames.
Defcription du métier fur lequel on les travaille, & de la
maniéré de travailler. I. 183. a. 1
AGRÉMENS ,(Gramm. Syn.) idée exaCte de la figmfication
de ce mot. Différence entre grâces & agrémens. Suppl. L
213. a.
A g r ém e n s du chant, (Muftq. ) quels font les principaux.
Suppl. I. 213. a. Voye[ G OU T DU CH A N T , Dïtt. raif. des
feiencesy &c. & Suppl. I. 213. a.
Agrémens, nommés accent. Suppl. I. 110. a. Aipiration. lbid.
6 ïï-a. Battement, lbid. 828. b. Cadence. II. 513. b. Suppl. IL
96. a , b. Flatté, lbid. III. 47. b. Martellement. lbid. 858. b.
PJroorrtt dace vVoIRixA.. XlbOiIdU.. IAV » .. -5y 1R2*.. *b».. Agrément iqjuuii. . Cal uliweuu Uda.1nU3s 1l’ !a«c•-
compagnement du clavecin. lbid. 1. 112. b. Agrément du chant
& dés inftruraens, nommé chute, .lbid. II. 426. b. Agrément
appellé pincé, propre à certains inftrumens. lbid. \ \ . 375. <*.
Efpece d’agrément nommé autrefois cicolome^o. lbid. IL
431. b.
AGRÉMENT, confentement, permijfton, différences entre
ces mots. IV. 32. b.
AGRÉMENT, aménité ¿(Beaux-arts) qualité d’un objet qui le
rend propre à donner à l’esprit un contentement doux &
tranquille. Il femble que l’agrément réfulte de ces beautés
qui fe confondent entr’elles, parce qu’il n’y en a. aucune
qui fe diitingue fupérieurement. Suppl. I. 213. a. L agrément
plaît principalement aux efprits doux& tranquilles. Nul artifte
n’atteindta à cette qualité, s’il n’a reçu de la nature une ame
douce &. complaifante. Artiftes qui ont fu donner de l’agré-
A G R A G R 35
ment à leurs ouvrages en poéfie & en éloquence, en peinture
en mufique. lbid. b.
AG R IA, (Géogr.) ville de la haute Hongrie. Ses révolu- .
tions. Suppl. I. 213. b. r .
AGRICOLA, (Jean) difciple & compatriote de Luther.
VIII. 925. b. -
A g r i c o l a , (George) obfervations fur fa vie oc fes ouvrages.
VÙ. 704. b. X. 435. a. Son fyftême fur la livre romaine.
IX. 619. a. . '
AGRICULTURE, eitime qu’en foifoient les anciens. I.
183. b. Comment eüe perdit fes premiers honneurs, & degé- -
néra. C e que fait l’empereur de la Chine pour en infpirer le
goût à fes fujets.lbid. 184. b. Protection accordée de tout tems
aux laboureurs. Combien les empereurs, & en particulier
Conftanrin, eurent à coeur la tranquillité oc la prêté des
laboureurs. Les empereurs n’ont pas moins veillé a ce que
l’agriculteur remplît fon devoir. lbid. b. Les rois de France ont
également pris à coeur ces grands objets. Citation de queloues
loix données pour la iïireté des campagnes. Préceptes généraux
fur l’agriculture. lbid. 18 ç. a. Labours qu d feut donner aux
terres à bled Préceptes concernant les terres a menus grams.
lbid b Animaux dont on fe fert pour le labourage. Diverfes
attentions qu’il faut avoir pour tirer du labour le meilleur
avantage lbid. 186. *. Travaux du laboureur pour chaque
mois de l’année, lbid. b. Expofition du nouveau , fyftème
d’agriculture de M. T u ll, traduit par M. Duhamel, lbid. 187.
t 188 a , ¿.Jugementqu’etl porte le tradufteur.lbid. 189. a , é.
’ Agriculture. Hiftoire abrégée de l’agriculture françoife,
Suppl. I. 213. A Cet art cultivé par les anciens Gaulois, lbid.
114. a. Les invafions des peuples du nord fatales à l’agricul.
tore. lbid. b. Comment les terres furent cultivées du tems
de Charlemagne. Le régime féodal contraire aux progrès de
l’art lbid. a i t . a. Premières loix favorables aux cultivateurs,
fous François I , Charles IX & Henri IV. Jean Liébault, médecin
dijonnois, regardé comme l’un des principauxj auteurs
du rétabliffement de l’agriculture, fous le miniftere de Sully.
Ouvrage qu’il donna, de concert avec Charles-Etienne. Ouvrages
d’un payfan de Saintonge, nommé Bernard Paliffy.
lbid. 216. a. Élcge du livre d’Olivier deSerres, fire de Pra-
cünes,fur l’agriculture, déthé à Henri IV. Protection & en-
couragemens que Louis XIV accorda aux cultivateurs, lbid.
b. Cependant ce n’eft que depuis environ quinze années, que
l’agriculture eft entièrement fortie de la langueur où elle étoit
retenue, & que le public, éclairé par d’excellens ouvrages,
a paru revenir de fes injuftes préventions contr’elle. Ouvrage
de l’auteur de cet article, intitulé : Principes phyfiques de
Vagriculture 6* de la végétation, lbid. %\y. a.
Ouvrages fur l’agriculture compofés chez les autres nations.
U manque encore à la France un corps complet d agriculture,
réduit & approprié au climat de ce royaume. L’auteur a tenté
cette entreprife fous le titre à?Elément a agriculture phyfico-
botanica. lbid. b.
Différentes cauies qui ont décidé la nation françoife en
faveur de l’agriculture. Soins particuliers qu’on a donnes à la
confervation des animaux qui en font la bafe & le foutien.
Expériences faites à Trianon fous les yeux du Roi. Autres
encouragemens fournis par ce monarque. Charrue du fieur
Deipommiers. lbid. 218. a. Loix qui ont permis l’exportation
des grains. Réflexions fur cet objet. Avantages qui réfulteroient
de ^exportation des farines. Nouvelle méthode pour la mouture
des grains plus économique que les anciennes. Méthode
qu’obfervoient à cet égara les Romains. Ibid. b. Mefures
prifes par le miniftere pour faire répandre dans les provinces
la nouvelle maniéré de moudre les grains. Expofé d’un ouvrage
intitulé: Traité de la mouture par économie, lbid. 219. a. Effais
faits pour conftater le rapport entre une certaine quantité de
bled & le poids du pain qui en eft le produit. Ouvrages publiés
fur les bleds ergotés. lbid. b. Moyens employés pour faire
périr les mulots qui dévorent les femences. lbid. 220. a. Notice
des ouvrages d’agriculture qui ont contribué à la perfection
de cet art en France. lbid. b. Sociétés littéraires & académies
qui iè font occupées de cet objet, lbid. 221. a. Sociétés an-
gloifes. lbid. b. Moyens d’encouragemens pour l’agriculture,
employés en Allemagne, en Suiffe, en Italie, en Suede, en
Danemarck, en Norwege & en Efpagne. Origine de la première
fociété d’agriculture établie en France, lbid. 222. a.
Autres établiffemens femblables fondés en différentes provinces
du royaume. Il eft à fouhaiter que le patriotifme procure
un jour à ces fociétés, des terres, des fonds, des avances
, pour faire des expériences, & pour mettre ces corps
. refpeaables en état de donner des leçons publiques & gratuites
d’agriculture 8c d’économie. École d’agriculture fondée
dans la terre d’Annel, près Compiegne, fous la direction de
M. de Sarcy de Sutieres. lbid. b. Combien il importerait de
perfectionner en France l’art de cultiver la vigne , 8ç celui
de faire les vins 8c les eaux-de-vie. Ouvrages publiés fur cet
objet. Projet d’un ouvrage fous le titre d'Hiftoire naturelle de
la vigne 6* des vins. Moyens employés pour lui donner toute
la perfection dont il eft fufceptible. lbid. n y * .
Agriculture. 1. Quel eft l’objet, l’effet, la perfection de
l’agriculture. IV. 552, a. L’agriculture fe place d’elle-même au
premier rang des profeffions... Comment elle procure les
matières premières pour les autres. V I .8 ia . <z. Éloge de cet
art 8e de ceux qui l’exercent. 328. b. Combien ilètoit en honneur
chez les Romains. IX. 147. a. XIII. 96. b. Chez les Carthaginois.
XI. 9<9. b. L’agriculture honorée à la Chine: avantages
qui en refultent. XÎII. 96. b. Voyez l’article C h in e .
Exhortation à l’étude de l’agriculture, & fur-tout aux expériences
qui font le plus fiir moyen de fe perfectionner dans
cet art. IV. $£4.a . RiciieiZcs végétales que l’homme aurait pu
fe procurer, s il eût fù tirer parti de la prodigieufè fécondité
de la nature. Suppl. IV. 968. b. Réflexions fur la nécef*
fité & la maniéré de le faire fleurir dans un état. IX. 148 .a , b.
Moyen d’en favorifer les diverfes branches, félon le befoin
que le peuple en a. IV. 360. b.. Des inftiturions, fociétés,
écoles d’agricultnre. Suppl. n i. t in . a , b. Projet d’une fociété
d’agriculture. Suppl. IV. 969. b. &c. État d’imperfeétion
où elle a été laiffée. Combien u importe de perfectionner
cet art. VHI. 227. a.
IL De l’état de l’agriculture eft France. VI. 329, a , b. &C*
État de l’agriculture dans le comté de Norfolk, & de la méthode
qu’on y fuit. IV. 364. a , b. 8cc.
III. L’agriculture envifagée fous un point de vue politique..,'
Elle eft la baie du commerce. IV. 332. ¿. &c. Elle eft une
fource d’abondance. Suppl. I. 30. b. Eft'ets du luxe par rapport
à l'agriculture. IX. 764. a. XIII. 101 .a. L’établiffement des manufactures
de luxe, contraire en France à l’agriculture, lbid. b.
VII. 3titi. a. Caufesdu dépériffement de l’agriculture en Italie
fous les premiers empereurs. IX. 766. b. Les impôts exceflifs
ruinent l ’agriculture. XIII. 96. b. D e la néceflité des richeffes
pour la culture des grains. VII. 829. b. En quel cas l’argent
peut être délimiteur de l’agriculture. VIII. 823. b.
IV. L’agriculture ne peut avoir des fuccès étendus que par
la multiplication des beftiaux. VI. 313. a. Tout ce qui tend à
décourager fur l’entretien des troupeaux eft nuifible à l’agriculture.
VII. 366. a. Examen très-détaillé de la queftion, s’il
vaut mieux employer en agriculture les boeufs que les chevaux.
V I. 329. <z, b. 8cc. Quelle devrait être la régie de l’agriculture
pour augmenter autant qu’il eft poflible les profits fur
les beftiaux. VL 333. <*, b. 8cc. Il importe pour l’agriculture
ue les bleds fe maintiennent à un prix uniforme. 334. a»
’agriculture profpere plus par le fermier que par le métayer, •
533. b. État de la grande culture des grains. VII. 813. <1, b.
État de la petite culture. 814. b. 8cc. État d’une bonne culture,
816. b. 8cc. Obfervations fur les avantages de la culture des
grains. 820. a,b. 8cc. L’agriculture ne profpere que lorfque
les terres ont été partagées entre un grand nombre de pouef-
feurs. XIH. 97. a. Combien de petites obfervations 8c qui
paraîtraient minutieufes, peuvent devenir utiles à l’agriculture.
I. 386. b. Motifs qui juraient dû engager les cultivateurs
philofophes à cônfulter les fermiers 8c ceux qui font exercés
à la pratique de l’grt. VI. 528. a, b.
V. Diffèrens'"genres de connoiffanCes avec lefquelles l’agriculture
a.des relations. Suppl. II. 31. b. La connoiflânce de la
nature du terrein 8c de la température du climat eft le premier
principe de l’agriculture. II. 343. a. Obforvations fur la
terre. XVI. 177. b. Réflexions fur la meilleure culture des
terres. 66 q. b. Ufàges des canaux d’arrofement & de deffér
chôment. 184. b. 18j. a, b. — 192. b. Sur l ’emploi des eaux
dans l’agriculttire, voyeç E a u x . Alternative dans la culturq des
terres. Voye^ A l t e r n e r . Réflexions contre l’ufage de mettre
les terres en jachere. Suppl. 111. 490. a. Légère efquiffe des
diverfes méthodes de l’agriculture angloife. IV. 360. b. De
l’engrais des terres. V. 684. b. Train commun pour la culture,
après que les terres ont été fumées. V. 683. b. Sur les opérations
ae l’agriculture. Voyeç L a b o u r 6» L a b o u r a g e . Des
mauvaifes herbes des champs 8c des moyens de les extirper.
VIII. 148. b. Vents nuifiblès dans l’agriculture. XVII. 23. b.
Obfervations fur l’influence des aftres relativement a l’agriculture:
VIII. 73 ti. a. Confidérations fur les deux principaux
objets de l’agriculture .qui font la multiplication & la perfection
des plantes. II. 343. b. Directions d’agriculture. Voyc^ les
articles B l e d , C u l t u r e , G e r m in a t io n , T e r r e . Voye^ les
planches d'Agriculture, vol. J- 8c Suppl.
A g r i c u l t u r e , (MyiA-) divinités païennes qui proté-
geoient l’agriculture. ylIL 598. b. XIV. 310. b. Fête que les
Romains avoient initituèe en l’honneur des dieux qui pré-
fidoient à l’agriculture. Supvl. III. 222. a.
AGRIGENTE, (Géogr.) ville de Sicile, fondée par les habitans
de Géla, 379 ans avant J. C. Elle s’appelloit en grec
Acragos, à caufe de la bonté de fon terroir. Ses productions
& fa fertilité. Luxe & magnificence des agrigentins. Parole
de Platon fur ces peuples. Magnifique triomphe d’Exenete,
vainqueur dans les jeux olympiques. Suppl. I. 223. b. Noces
fplendides de la fille d’Antifthene. Trait qui montre la mol-
leffe des agrigentins. Bel ufage que Gélias fàifoit de fes richeffes.
Son holpitalitè. Autorité que le philofophe Empedocle
avoït acquife fur le coeur de fes concitoyens. Son mérite