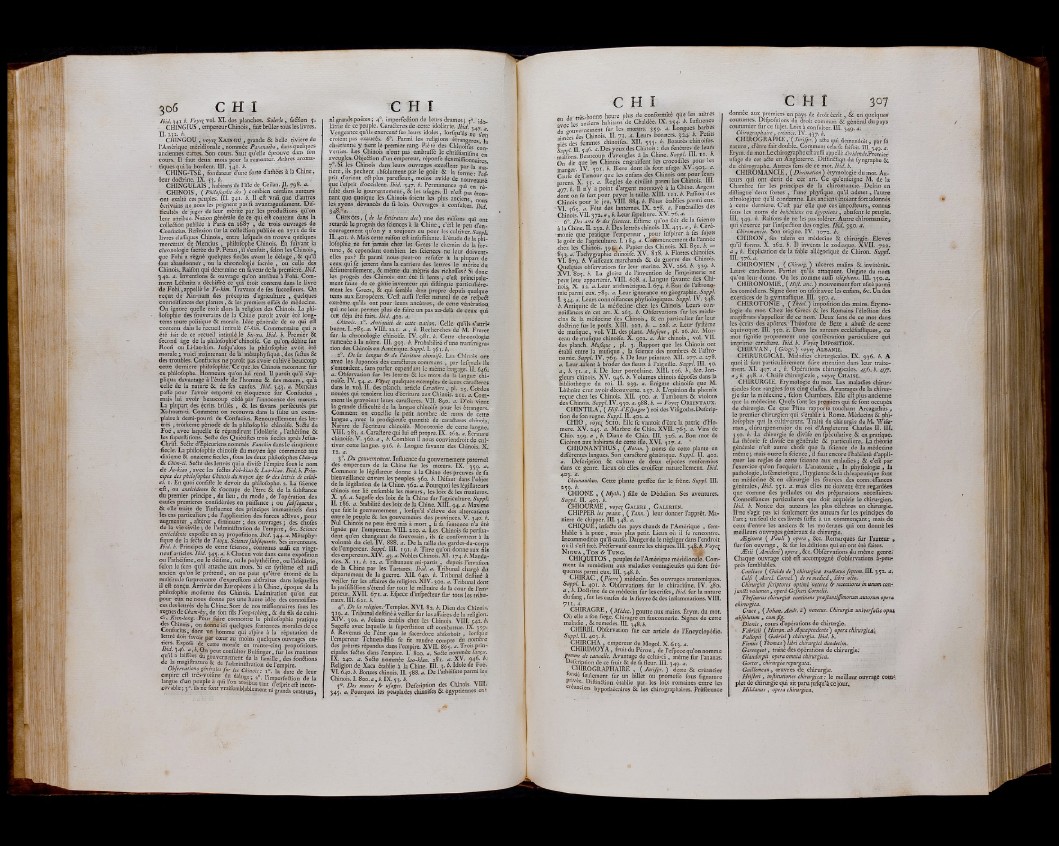
3 0 6 C H I
Ibid. 341 b. Foye{ vol. XL des planches. Soierie, feétion Ç.
CHINGIüS, empereur Chinois, fait brûler tous les livres. n. a«, b.., , •
CHINGOU, voye[ XaINGÜ > grande & belle riviere de
l’Amérique, méridionale , nommée Paranaïba, dans quelques
anciennes cartes. Son cours. Saut qu’elle éprouve dans ion
cours. Il faut deux mois pour la remonter. Arbres aromatiques
qui la’ bordent. III. 341. b. .
CHING-TSÉ, fondateur d’iine forte d’athées à la Chine ;
leur doétrine. IX. 53. b.
CHINGULÀIS, habitansde lïfle de Ceilan. 'JL 798. a.
CHINOIS, ( Philofophie des ) combien certains auteurs
ont exalté ces peuples. III. 341- b. Il eft vrai,'qué d’autres
écrivains ..ne. nous les peignent pas fi avantageuïement. Difficultés
de’juger de leur mérite par les produâions qu’on
leur attribue. Nation générale de Ce qui eft contenu dans la
colieftion publiée à Paris en 1687 , de trois ouvrages de
•Confucius. Réflexion fur la Colleétion publiée en 1711 de fix
livres çlafliques Chinois, entre lefquels On trouve quelques
morceaux aç Mcncius , philofophe Chinois. Ên fuivant la
chronologie focrée du P. Petan, il s’ehfuit, félon les Chinois,
que Fohi a régné quelques fiedes avant le déluge ,-8c qu’il
faut abandonner , ou la chronologie focrée , ou celle des
Chinois. Raifon qui détermine en raveur de la première. Ibid.
34a. a. Inventions 8c ouvrage qu’on attribuèà Fohi.. Comment
Léibnitz a déchiffré ce qui étoit contenu dans le livre
de Fohi, appellé le Ye-kim. Travaux de fes fuccefleurs. On
reçut de Xin-num des préceptes d’agriculture ».quelques
connoiffances des plantes, & les premiers effais de médecine.
On ignore quelle étoit alors la religion des Chinois. La phi-
lofopnie des fouverains de la Chine paroit avoir été long-
tems toute politique & morale. Idée générale de ce qui eft
contenu dans le recueil intitulé U-kim. Commentaire qui a
été fait de ce recueil intitulé le Sù-xu. Ibid. b. Premier 8c
-fécond âge de la philofophie-* chinoife. Ce qu’on débite fur
Roofi ou Li-lao-kim. Julqu’alors la phùofophié avoit été
morale ; voici maintenant dé la mctaphyfique , des fe fies &
des troubles. Confucius ne'paroit pas avoir cultiyè'béaucoup
cette demiere philofophie:‘Cé que.l'es Chinois racontent fur
ce philofophe..Honneurs qu’on.lui rend. U paroit qu’il s’appliqua
davantage - à l’.étude de l’homme 8c des'moeurs » qu’à
celle de la nature 8c de fés eau fes. Ibid. 343 . a. Mencius
paffe pour l’avoir emporté en éloquence fur Confucius ,
mais lui avoir beaucoup cédé par l’innocence dés moeurs.
La plupart des écrits, brûlés , 8c. les favans perfécutés par
Xî-noam-ti. Comment on recouvra dans la fuite un exemplaire
à demi-pourri de Confucius. Renouyellement des lettres
, troifieme période de la philofophie chinoife. Se&e de
Foë , avec laquelle fe répandirent l’idolâtrie , l’athéifme 8c
les fuperftitions. Sefte des Quiétiftes trois fîecles après Jefus-
Chrift. Selle d’Epicuriens nommés Fanchin dans le cinquième
ficcle. La philofophie chinoife du moyén âge commence aux
dixième 8c onzième fiecles, fous les deux pltilofophes Chcu-cu
& Chim-ci. Selle dès lettrés qui a divifé l’empire fous le nom
de Ju-kiào , avec les feâes Foë-kiao 8c Lao-kiao. Ibid. b. Principes
des philofophes Chinois du moyen âge b des lettres de celui-
ci. r. En quoi confifte le devoir du philofophe. a. La fciénce
eft, ou antécédente 8c s’occupe de l’être & de la fubftance
du premier principe , du lieu, du mode , de l'opération des
caufes premières conlidérées en pùiffance ; ou fubféquente,
8c elle traite de l’influence des principes immatériels dans
les cas particuliers ; de l’application des forces aôives, pour
augmenter., altérer »diminuer; des ouvrages ; des chofes
de la vie civile ; de l’adminiftration de l’empire , bc. Science
antécédente expofée en 29 propofidons. Ibid. 344. a. Métaphy-
fique de îa felte de Taoçu. Science fubféquente. Ses inventeurs.
Ibid. b. Principes de cette fcience, contenus aufli en vingt-
neuf arricles. Ibid. 343. a. ¿.Chacun voit dans cette expofition
ou l’àthéifme,ou le déifme, ou le polythéifme, ou l’idolâtrie,
félon le fens qu’il attache aux mots. Si ce fÿftême eft aufli
ancien qu’on le prétend, on ne peut qu’être étonné de la
multitude furprenante.d’expreflions abftraites dans lefquelles
il eft conçu. Arrivée des Européens à la Chine, époque de la
philofophie moderne des Chinois. L’admiration qu’on eut
pour eux ne nous donne pas une haute idée des connoiffan-
ces des lettrés de la Chine. Sort de nos millionnaires fous les
régnés de Cham-hy, de fon fils Yong-lching, 8c du fils de celui-
ci , Kien-long. Pour_foire connoitrc la philofophie pratique
des Chinois, on donôe ici quelques fentences morales de ce
Conmctus, dont un homme qui afpire à la réputation de
lettre doit fovoir paf coeur au moins quelques ouvrages entiers.
txpolè de cette morale en trente-cinq propofitions.
M •*/£* rP Peut confulter Bulfinger, fur les maximes
y Mi am ‘ -?S«U62uv,ern2ment de H famille, des fondions
de la raagÆaturc & de l’àdmVnUtrSnbS de l'empire.
O b f i r v a u m , f , r U, Chinois: la L e de leur
emp,re eft tres-vo.fme du déluge; g l’imperfeffion de la
langue d un peuple a qrn l'on attribue tant iefprit eft Inconcevable
; 3». ils ne font YraifemblaUement ni grinds orateurs
C H I
ni grands poëtes; 40. imperfection de leurs drames; 5°.
lâtrie de ce peuple.' Cara&eres de cette idolâtrie. Ibid. a
Vengeance qu’ils exercent fur Jeurs idoles, lorfqu’ils.ne s’eii
croient pas exaucés. .6°. .Parmi les religions étrangères ht
chrétienne y tient le premier rang. Piété des Chinoifos converties.
Les .Chinois n’ont pas embraffé le chriftianifine eiï
aveugles. Obje&ion d’un èmpereur, réponfe des miflionnaires.
70. Si les Chinois dans leurs ouvrages excellent par la matière,
ils pechent abfolument par le goût 8c la forme: l’e£
prit d’orient. eft plus pareffeux» moins avide de nouveauté
que l’efprit d’occident. Ibid. 347. b. Permanence qiû en ré-
fulte dans le gouvernement» & les ufages. Il n’eft pas ¿ton^'
nant que quoique les Chinois foient les plus anciens, nous
les. ayons, dévancés de fi loin. Ouvrages à consulter. Ibid
34SSa. ;
C h in o is , {de la littérature des) une des raifons qui ont
retardé le progrès des fciences à là Chine » c’èft le peu d’encouragement
qu’on y a toujours eu pour les cultiver. Suppl:
II. 401. ¿. Mais cette raifon eft infuffilante. L’étude de la philofophie.
ne fut jamais chez les Grecs le chemin de la fortune,
8c cependant combien les . fciences ne leur doivent-
elles pas? Et parmi nous peut-on refhfer à la plupart de
ceux.quife jettent dans la carrière des lettres le mérite du
défintereflement , 8c même du .mépris des richeffes? Si donc
les progrès des Chinois- ont. été fi lents-,: c’eft principalement
foute de ce génie inventeur qui diftingiie particulièrement
les Grecs, 8c qui femble être propre depuis quelque
tems aux Européens. C’eft aufli l’effet naturel de ce refpeft
extrême qu’ils ont pour- leurs ancêtres, de cette vénération
qui ne leur permet plus de foire un pas au-delà de ceux qui
ont déjà été foits. Ibid, 402. a.
Chinois. i°. Antiquité, de cette nation. Celle qu’ils -s’attri-r
buent. I. 785. a. VIIL 221. a , b. Recherches de M. Frerec
fur la chronologie chinoife. IV. 981. b. Cette chronologie
ramenée à la nôtre. III. 393. b. Probabilité d’une tranfmigra-,
tion des Chinois en Amérique. Suppl. I. 361 .b.
,_.2°. De là langue b de l’écriture chinoife. Les Chinois ont
ayec les Japonois des carafteres communs , par lefquels ils
s’entendent, fans parler cependant le même langage. II. 646;'
a. Qbfervation fur les lettres 8c les mots de la langue'chi-
noife. IV. C4. a. Vttye^ quelques exemples de leurs cara&ercs
dans le vol. II. des planch. article Caraflere-, pl. 25. Crfrdes
nouées qui teiioient lieu d’écriture aux Chinois. 211. a. Comment
ils gravoient leurs carafteres. VII. 890. a. D’où vient
la grande difficulté de la langue chinoife pour les étrangers.
Comment on concilie le petit .nombre -de mots de cette
langue, avec la prodigieule quantité de carafteres chinois.
Nature de l’écriture chinoife.-Monotonie de cette langue.
VIII. 283. a. Carafterequi lui eft propre. IX. 262. ¿.Écriture^
chinoife. V. 360. a , b. Combien il nous conviendroit de cultiver
cette langue. 916. b. Langue fayante des Chinois. X.
12. a.
3°- Du gouvernement. Influence dû gouvernement paternel
des empereurs de la Chine fur les moeurs. IX. 359. a.
Comment le légiflateur donne à la Chine des preuves de fa
bienveillance envers les peuples. 360. b, Défaut dans l’objet
de.la légiflarion de la Chine. 362. a. Pourquoi les légiflateurS
chinois ont lié enfemble les moeurs, les loix 8c les maniérés.
X. 36. a. SagefTe des loix de la Chine fur l’agriculture. Suppl.
II. 186. a. Stabilité des.lobc de la Chine. XETI. 94. a. Maxime
que fuit le gouvernement , lorfqu’il s’élève des altercations
entre le peuple 8c les gouverneurs des provinces. V. 340. b.
Nul Chinois ne peut être mis à mort , ü fa fentence n’a été
fignée par l’empereur. VHI. 210. a. Les . Chinois feperfua-
dent qu’en changeant de fouverain, ils fe conforment à la
volonté du cieL lV . 888. a. De la taille des gardes-du-corps
de l’empereur. Suppl. III. ïo i. b. Titre qu’on donne aux fils
des empereurs. XlV. p . a. Nobles Chinois. XI. 174. b. Mandarins.
X. 11. b. 12. a. Tribunaux mi-partis , depuis l*invafion
de la Chine par les Tartares. Ibid. a. Tribunal chargé dû
département de la guerre. XII. 640. b. Tribunal deffiné à
veiller fur les affaires de religion. XIV. 302. a. Tribunal dont
la jurifdiétio.n s’étend fur tout le militaire de la cour de l’empereur.
XVII. 671. a. Efpece d’infpeéleur fur tous les tribunaux.
III. 621. b.
4°. De la religion.-Temples. XVI. 82. b. Dieu des Chinois;
319. a. Tribunal deftiné à veiller fur les affaires de la religion.
XIV. 302. a. Jeûnes établis chez les Chinois. VIII. 542. ¿.
SagefTe avec laquelle la fuperftition eft combattue. IX. 359-
7 Revénus de l’état que le facerdoce abforboit , lorfque
l’empereur Tchuen-Hio fe fit rendre compte du nombre
des prêtres répandus dans l’empire. XVII. 865. a. Trois principales
feéles dans l’empire. L 800. a. Seâe nommée lançu.
IX. 240. a. Sefte nommée lao-kiun. 281 . a. XV. 046* b:
Religion de Xaca établie à la Chine. III. 3. ¿. Idole de Foë.
VI. 640. b. Bonzes chinois. IL 3*88. a. De l’athéifine parmi les
Chinois. I. 800. a , b. IX. 53. b. \
5^. Des moeurs b ufages. Defcription des Chinois. VIrl;
345, a. Pourquoi les peuplades chinoifes 8c égyptiennes ont
C H I C H î 307
.,1 Je-très-bonne heure plus de confonmté que les aiitres
avec les anciens habimos de Chjldée. IX. 154. h. Influence .
du eouvemement lut les moeurs. .339. a. Longues barbes
aimfes des Chinois. II. 71. a. Leurs bonnets. 314. 4. Petits
niés des femmes chinoifes. XII. 335. 4. Beautés chinoifes. I
Suppl. II. 546. <*. Des yeux des Chinois : des fenêtres de leurs
maifons. Beaucoup d’aveugles à la Chine. Suppl, III. n . ¿. ;
On dit que les Chinois engraiffent lés crocodiles pour les
manger. IV. 501. ¿. Biere dont ils font ufage. XV. 903. a.
Caufo de l’amour que les enfons des Chinois ont pour leurs
parens. X. 35. a. Regles de civilité parmi les Chinois. III.
497. ¿. Il n’y a point d’argent monnoyé à la Chine. Argent
dont on fe fert pour payer la taille. XIII. m .b . Paflión des
Chinois pour le jeu. VIH..884. b. Fêtes établies parmi eux.
VI. 565. a. Fête des lanternes. IX. 278. ar Funérailles dos
Chinois. VII. 37a. a , ¿. Leur fépulture. XV. 76. a.
6°. Des arts b des fciences. Eftime qu’on fait de la fcience
à la Cliine. H. 232. ¿. Des lettrés chinois. IX. 433. <*, ¿. Cérémonie
que pratique l’empereur »pour infpirer àfes fujets
le goût de l’agriculture. 1. 184. a. Commencement de 1 annee
chez les Chinois. 39Lfc¿. Papier des Chinois. XI. 851. ¿. — ;
853. a. Tachygraphie chinoife. XV. 818. b. Flottes chinoifes.
VI. 879. b. Vaifleaux marchands 8c de guerre dés Chinois.
Quelques obfervations fur leur marine. XV. 266. ¿. 3^9*
XVI. 805. b. La gloire de l’invention de l’imprimerie ne
peut four appartenir. VIII. 608. a. Langue fovante des Chinois
X. 12. ¿.Leuf arithmétique. 1. 674. ¿. État de l’aftronç-
mie parmi eux. 789. a. Leur ignorance en géographie. Suppl.
I. 344. a. Leurs connoiffances phyfiologiques. Suppl. IV. 348.
b. Antiquité de la médecine chez les Chinois. Leurs con-
noiffances è'n cet art. X. 263. b. Obfervations. fur les médecins
& la médecine des Chinois, 8c en particulier fur leur
do&rine fur le pouls. XIII. 221. ¿. — 228. a. Leur fÿftême
de mufique, vol. VII. des plane. Mufiauc,. pl. 16. bis. Monceau
de mufique chinoife. X. 902. a. Air chinois, vol. VII.
des planch. Mufique , pl. 3. Rapport que les Chinois ont
établi entre la mufique , la foience des nombres 8c l’aftro-
nomie. Suppl. IV. 705. ¿. De leur peinture. XII. 277. a. 278.
a. Leurraient à broder des fleurs à l’aiguille. Suppl. III. 50.
a t b. 51 . a , b. De leur porcelaine. XÏII. 106. ¿, 8cc. Jongleurs
chinois. XV. 946. b. Volumes chinois dépofés dans la
Bibliothèque du roi. II. 239. a. Énigme chinoife que M.
Léibnitz crut avoir découverte. 257. b. L’opinion du plioenix
reçue chez les Chinois. XII. 500. a. Tambours 8c violons
des Chinois. Suppl. IV. 930. a. 988. b. — Foyer O r ie n t a u x .
CHLNTILA, ( Hifl.d’Efpagne) roi des Vifigoths.Defcrip-
tion de fon regne. Suppl. 11. 402. a.
CHIO, voye^ Scio. Elle fe vantoit d’être la patrie d’Ho-
mere. XV. 245. a. Marbre de Chio. XVTI. 763. a. Vins de
Chio. 299. a , b. Diane de Chio. III. 326. a. Bon mot de
Cicéron aux habitans de cette ifle. XVI. 317. a. *
CHIONANTHUS , ( Botan. ) noms de cette plante en
différentes langues. Son caraâere générique. Suppl. II. 402.
a. Defcription 8c culture de deux efpeces renfermées
dans ce genre. lieux où elles croiffent naturellement. Ibid.
403 - '?■ , 1 ■
Chionauthus. Cette plante greffée fur le frêne. Suppl. m.
259. b.
CHIONE , ( Myth. ) fille de Dédalion. Ses aventures.
Suppl. -II. 403. b.
CHIOURME, voyc{ G a l e r e , G a l e r ien .
CHIPPER les peaux , ( Turin. ) leur donner l’apprêt. Maniere
de chipper. III. 348. a.
CHIQUÉ, infeâe des pays chauds de l’Amérique , fem-
blable à la puce , mais plus petit. Lieux où il fe rencontre*
Incommodités qu’il caufe. Danger de le négliger dans l’endroit
oii il s’eft fixé. Préfervatif contre les chiques.QI. 348^. Foye^
K ig u a , T o n b T u n g .
CHIQUITOS , peuples de l’Amérique méridionale. Comment
ils remédient aux maladies contagieufes qui font fréquentes
parmi eux. III. 348. ¿.
CHIRAC, ( Pierre) médecin. Ses ouvrages anatomiques.
Suppl. ,I. -401. b. Obfervations fur le chiracifme. IV. 480.
a , ¿. Doélrine de ce médecin fur lescrifes, Ibid. fur la nature
du fang, fur les caufes de la fievre 8c des inflammations. VIII.
711. a.
CHIRAGRJE, ( Médec. ) goutte aux mains. Étym< du mot.
Ou elle a fon fiege. Chiragre en fauconnerie. Signes de cette
maladie , 8c remedes. III. 348. ¿.
CHIRBI. Obfervation Air cet article de l’Encyclopèdie<
Suppi. n. 403. b.
CHIRCHA , empereur du Mogol. X. ¿13. a.
CHIRIMOYA, fruit du Pérou, de l’cfpece qu’on nomme
fomme de cannelle. Avantage de celui-ci, même fur l’ananas,
defcription de ce fruit 8c de fo fleur. III. 349. a.
CHIROGRAPHAIRE , ( Jurifpr. ) dette 8c créancier
tonde feulement fur un billet ou promefle fous fignature
pnvée. Diftinétion établie par,, les loix romaines entre les
reanciers hypothécaires 8c les chirographaires. Préférence
donnée auxpremiers en pays de droit écrit, éi en’ quelques’
coutumes. Difpofitiorfs du droit commun 8c général du pays
coutumicr fur ce fujer. Loix à confulter. III. 349. a.
Chirographairc » créance. IV. 437. ¿.
CHIROGRAPHE , ( Jurifpr. ) a£lc qui demandoit ; p'àr fi
nature, d’être fait double^ Comment cela fe foifoit. III. 349. a.
Etym. du mot. Le chirographe eft aufli appellé dividendc$rzm\tt
ufage de cet afte en Angleterre. Diftinétiqn du fyngraphe 8c
du chirographe. Autres fens dè ce mot. Ibid. b.
CHIROMANCIE, ( Divination} étymologie du mot. Auteurs
qui ont écrit de cet art. Ce qù’enfeigné M. de la
Chambre fur les principes de la chiromancie. Delrio en
.diftihgue'deux fortes , luné phÿfiqùe. qu’il admet, Tautr.e
aftrologique qu’il condamne. Lés anciens étoient fort adonnés
à cétte derniere. C’eft pat elle qué ces ùnpofteurs, connus
fous les noms dé bohémiens ou égyptiens, abufont le peuple.
III. 349. ¿. Raifons de ne les pas toléren Autre chiromancie,
qui s’exerce par l’infpeétion des ongles, /¿/¿, 35o. a.
Chiromancie. Son origine. IV. 1072. ¿.r ‘ “
CHIRON, fes taleñs en médecine 8c chirurgie. Eleves
qu’il forma. X. 262. b. Il inventa le zodiaque. XVII. 722.
a I b. Explication de la fable allégorique de Chiron. Suppl.
III: 376. a. . . .
CHIRONIEN , ( Chirurg. ) ulceres malins 8c invétérés.'
Leurs cara&eres. Parties qu’ils attaquent. Origine du nom
qu’on leur donne. On les nompieauflî téléphiens. III. 350.a.
CHIRONOMIE , ( Hifi. dnc. ) mouvement fort ufité parmi
les comédiens. Signe dont on ufojtavec les enfons, bc. Un des
exercices1 de la gymnaftique. III. 3 50. <z.
CHIROTOnIE , ( Théol. ) impofition des mains. Étymologie
du mot. Chez lés Grecs & les Rçmains l’éleétion des
magiftrats’s’appelloit de ce nom. Deux fens de ce mot dans
les écrits dés apôtres.* Théodore de Beze a abufé dé cette
équivoque. III. 3 50. a. Dans les auteurs eccléfiaitiques, ce
mot fignifie proprement une çonfécration particulière qui
imprime- caraftere. Ibid. b. Foyc^ Im p o s it io n .
C H IR V A N , ( Gcogr.) voye{ ALBANIE.
CHIRURGICAL. Maladies chirurgicales. IX. 936. ¿. A
quoi il fout particulièrement foire attention dans leur traite- .
ment. XI'. 497. a , b. Opérations chirurgicales. 496. ¿. 497.
a , b. 498. a. Chaife chirurgicale , voyc{ C h a ise .
CHIRURGIE. Etymologie du mot. L'es maladies chirurgicales
font rangées fous cinq claffes. Avantages de la chirurgie
fur la médecine , félon Qiambers. Elle eft plus ancienne
que la médecine. Quels font les premiers qui fe font occupés
de chirurgie. Ce que Pline rapporte touchant Arcagathus ,
le premier chirurgien qtii s’établit à Rome. Médecins 8c philofophes
qui. là cultivèrent. Traité de chirurgie de M. Wife-
man, cliirurgien-majôr du roi d’Angleterre Charles II. III;
350. ¿. La chirurgie fe divife en fpéculative 8c en pratique*
. Là théorie fe divife en générale oc particulière. La tliéorie
générale n’eft autre chofe que la fcience de la médecine
même ; mais outre la fcience ; il fout encore l’habileté d’appliquer
les regles de cette fcience aux maladies; 8c.c’eft par
l’exercice qu'on l’acquiert. L’anatomie , la phyfiologie , la
pathologie,lafémeiotique, l’hygienne 8clà thérapeutique font
en médecine 8c en chirurgie les fources des connoiffances
générales, Ibid. 351. a. mais elles ne doivent être regardées
que comme des préludes ou des préparations néceffaires;
Connoiffances particulières que doit acquérir le chirurgien.
Ibid. b. Notice des auteurs les plus célebres en chirurgie.
- Il ne s'agit pas ici feulement des auteurs fur les principes do
l’art ; un feul de ces livres fuffit à un commençant ; mais de
ceux d’entre les anciens 8c les modernes qui ont donné les
meilleurs ouvrages généraux de chirurgie.
Ægineta ( Pauli ) opera, 8cc. Remarques fur l’auteur ,
fur fon oqvrage, 8c fur les éditions qui en ont été faites.
Ætii ( Amideni) opera, 8cc. Obfervations du même genre.'
Chaque ouvrage cité eft accompagné d’obfervations à-peu-
près femblables.
1 Caùliaco ( Guido de ) chirurgica tra flatus feptem.VH. 35z. a.
. Celfi ( Aurel. Comel. ) de re medicâ, libri oflo.
Chirurgie feriptores optimi veteres b recentiores in unum con-
junfli volumen , operâ Gefneri Comeïii.
Thefaurus chirurgie continens prefiantijfimorum autorum opera
chirurgica.
Cruce y ( Johan. Andr. à ) venetus. Chirurgie univerfalis opiti
abfolutum , cum fig.
Dionis y cours d’opérations de chirurgie.
Fabricii (Hierçn. ab Aquapendente) opera chirurgical
Fallopii ( Gabriel ) chirurgia. Ibid. b.
Fienus ( Thomas ) libri chirurgici duodecim.
Garengeot, traite des opérations de chirurgie;
Glandorpii opera omnià chirurgica.
Gortcr, chirurgia rtpurgata.
Guillemcaù, oeuvres de. chirurgie.
Héifieri, infiitutiones chirurgice : le meilleur ouyrage çojjv*
plet de chirurgie qui ait paru jufqu’à.ce jour,
Hildanus , opera chirurgica,