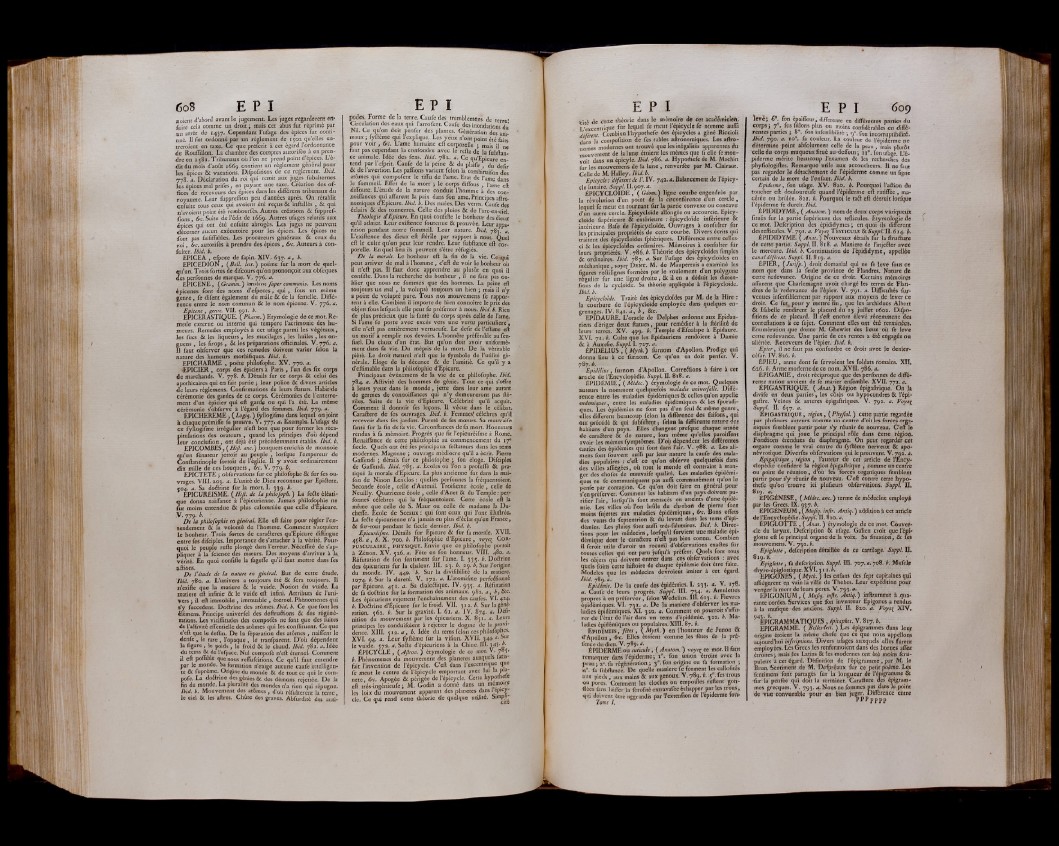
6o8 E P I E P I
noient d'abord avant le jugement; Les juges regardèrent en*
fuite cela comme un droit ; mais cet abus fut réprimé par
un arrêt de 1437* Cependant l’ufcge des épices fut continué.
Il fut ordonné par un règlement de 1 302 qu’elles entretient
en taxe. Ce que preicrit à cet égard l’ordonnance
de Roufltilon. La chambre des comptes autorifée à en prendre
en 1581. Tribunaux où l’on ne prend point d’épices, L’é-
dit du mois d’août 1669 contient un règlement général pour
les épices 8c vacations. Diipofitions de ce règlement. Ibid.
778. a. Déclaration du roi qui remit aux juges fubalternes
les épices mal prifes, en payant une taxe. Création des offices
de receveurs des épices dans les différons tribunaux du
royaume. Leur fuppreifion peu d’années après. On rétablit
enfuite tous ceux qui avoient été reçus & installés , 8c qui
n’avoient point été rembourfés. Autres créations 8c fuppref-
fions, bc. Suite de l’édit de 1669. Autres ufages relatifs aux
épices qui ont été enfuite abrogés. Les juges ne peuvent
décerner aucun exécutoire pour les épices. Les épices ne
dont pas faifilTables. Les procureurs généraux 8c ceux du
ro i, bc. autorifés à prendre des épices , bc. Auteurs à con-
fùlter. Ibid. b.
EPICEA , eipece de fâpin, XIV. 637. a , b.
EPICEDION, (Bell. leu. ) poème fur la mort de quel- 3u’un. Trois fortes de difeours qu’on prononçoit aux obfeques
es perfonnes de marque. V. 776. a.
EPICENE, ( Gramm.) hriHbiriç fuper commuais. Les noms
épicenes font des noms d’efpeces, qui, fous un même
genre, fe difent également du mâle 8c de la femelle. Différence
entre le nom commun 8c le nom épicene. V. 776. a.
Epicerie , genre. VII. <91. b.
EPICERASTIQUE. ( Pharrn. ) Etymologie de ce mot. Re-
mede externe ou interne qui tempere l’acrimonie des humeurs.
Remedes employés à cet ufage parmi les végétaux,
les fucs 8c les liqueurs , les mucilages, les huiles, les on-
?,uens , les firops, 8c les préparations officinales. V . 776. a.
I faut obferver que ces remedes doivent varier félon la
nature des humeurs morbifiques. Ibid. b.
EPICHARME , poète phuofophe. XV. 770. a.
•EPICIER 9 corps des épiciers a Paris , l’un des fix corps
de marchands. V. 778. b. Détails fur ce corps 8c celui des
apothicaires qui en fait partie ; leur police 8c divers articles
de leurs réglemens. Confirmations de leurs ftatu ts. Habit*de
cérémonie des gardes de ce cotps. Cérémonies de l’enterrement
d’un épicier qui eft garde ou qui l’a été. La même
cérémonie s’obferve à l’égard des femmes. Ibid. 779. a.
EPICHEREME, ( Logiq. ) fyllogifme dans lequel on joint
à chaque prémiffe fa preuve. V. 777. a. Exemple. L’ufage de
ce fyllogifme irrégulier n’eft bon que pour former les récafiitufations
des orateurs, quand les principes d’où dépend
eur conclufion . ont déjà été précédemment établis. Ibid. b.
EPI COMBES, ( Hift. anc.) bouquets enrichis de monno ie
qu’un fénateur jettoit au peuple , lorfque l’empereur de
Conftantinople lortoit de légliie. Il y avoit ordinairement
dix mille de ces bouquets , bc. V. 775). b.
EPICTETE ; obfcrvations fur ce philofopbe 8c fur fes ouvrages,
VIII. 203, a. L’unité de Dieu reconnue par Epiâete.
«04. a. Sa doârine fur la mort. I. 339. b.
EPICUREISME. (Hijl. de laphilofoph.) La feûc éléati-
que donna naiffance à l’épicurienne. Jamais philofophie ne
fut moins entendue 8c plus calomniée que celle d’Epicure.
,V. 779. b. *
De la philofophie en général. Elle eft faite pour régler l’entendement
8c la volonté de l’homme. Comment s acquiert
le bonheur. Trois fortes de caraâeros qu’Epicure difbngue
entre fes difciples. Importance de s’attacher à la vérité. Pourquoi
le peuple refie plongé dans l’erreur. Néceffité de s’appliquer
à la fcience des moeurs. Des moyens d’arriver à la
vérité. En quoi confifle la fagefTe qu’il faut mettre dans fes
«étions.
De l’élude de la nature en général. But de cette étude.
Ibid. 780. a. L’univers a toujours été 8c fera toujours. Il
n’exifte que la matière 8c le vuide. Notion du vuide. La
matière efl infinie 8c le vuide eft infini. Attributs de l’univers
; il eft immobile, immuable , éternel. Phénomènes qui
s’y (uccedent. Doârine des arômes. Ibid. b. Ce que font les
élémens. Principe univerfel des deftruâions 8c des régénérations.
Les viciffitudes des compofés ne font que des luites
de l’aâivité effemielle des atômes qui les conftituent. Ce que
c’eft que le deftin. De la féparation des atômes, naiftent le
denfe , le rare , l’opaque , lé tranfparent. D’où dépendent
la figuré, le poids , le froid 8c le chaud. Ibid. 781 .a. Idée
du tems 8c de l’efpace. Nul compofé n’eft éternel. Comment
il eft poffible que nous refTufcitions. Ce qu’il faut entendre
par le monde. Sa formation n’exige aucune caufe intelligente
8c fupréme. Origine du monde 8c de tout ce qui le com-
pofe. La doârine des génies 8c des démons rejettée. De la
fin du monde. La pluralité des mondes n’a rien qui répugne.
Ibid. b. Mouvement des atômes, d’où réfultercnt la terre
le ciel 8c les aftres. Chute des graves. Abfurdité des antipodes.
Forme de la terre. Caufe des tremblcmens de terre4
Circulation des eaux qui l’arrofent. Caufe des inondations du‘
Nil. Ce quon doit penfer des plantes. Génération des ani
maux ; fyftême qui l’explique. Les yeux n’ont point été faits
pour voir, bc. L’ame humaine eft corporelle j mais il
faut pas cependant la confondre avec le refte de la fubftan-
ce animale. Idée des fens. Ibid. 78a. a. Ce qu’Epicure entend
par l’efprit. Caufe de la peine 8c du plaifir , du defir
8c de l’averfion. Les paillons varient félon la combinaifon des
arômes qui compofent le tiffu de l’ame. Etat de l’ame dans
le fommeil. Effet de la mort , le corps diffous , l’ame eft
difToute, L’étude de la nature conduit l’homme à des con-
noifTances qui affurent la paix dans fon ame. Principes aftro*
nomiques d Epicure. Ibid. b. Des nuées. Des vents. Caufe des
éclairs 8c des tonnerres. Celle des pluies 8c de l’arc-en-ciel.
Théologie if Epicure. En quoi confifte le bonheur des dieux
qu’il admet. Leur exiftence foutenue 8c prouvée. Leur apparition
pendant notre fommeil. Leur nature. Ibid. 783, a.
L’exiftence des dieux eft ftérile par rapport à nous. Quel
eft le culte qu’on peut leur rendre. Leur fubftance eft corporelle.
En quel lieu ils peuvent s’être réfugiés.
De la morale. Le bonheur eft la fin de la vie. Ce- qui
peut arriver de mal à l’homme, c’eft de voir le bonheur où
il n’eft pas. Il faut donc apprendre au plutôt en quoi il
cenfifte. Dans la recherche du bonheur, il ne faut pas oublier
que nous ne femmes que des hommes. La peine eft
toujours un mal, la volupté toujours un bien ; mais il n’y
a point de volupté pure. Tous nos mouvemens fe rapportent
à elle. Combien il importe de bien connoître le prix des
objets fous lefquels elle peut fe préfenter à nous. Ibid. b. Rien
de plus précieux que la fanté du corps après celle de l’ame.
Si lame fe porte avec excès vers une vertu particulière',
elle n’eft pas entièrement vertueufe. Le defir de l’eftime eft
un motif a remplir nos devoirs. L’honnête préférable au fen-
fuel. Du choix d’un état. But qu’on doit avoir uniformément
dans fa vie. Du mépris de la mort. De la véritable
piété. Le droit naturel n’eft que le fymbole de l’utilité générale.
Eloge de la décence 8c de l’amitié. Ce qu’il y a
d’eftimable dans la philofophie d’Epicure.
Principaux événemens de la vie de ce philofopbe. Ibid.
784. a. Aâivité des hommes de génie. Tout ce qui s’offre
a leurs yeux dans le monde, jette dans leur ame autant
de germes de connoiffances qui n'y demeureront pas fté-
riles. Suite de la vie d’Epicure. Célébrité qu’il acquit.
Comment il donnoit fes leçons. Il vécut dans le célibat.
Caraâere de fes ouvrages. Ibid. b. Femmes! célébrés qu’il’
recevoit dans fes jardins. Pureté de fes moeurs. Sa mauvaife
fanté fur la fin de fa vie. Circonftances de fa mort. Honneurs
rendus à fa mémoire. Progrès que fit l’epicuréifmc à Rome.
RenaifTance de cette philofophie au commencement du 17*
fiecle. Quels ont été les principaux feâateurs dans les tems
modernes. Magnene ; ouvrage médiocre qu’il a écrit. Pierre
GafTendi ; détails fur ce phiiofophe ; fon éloge. Difciples
de Gaffendi. Ibid. 785. a. Ecoles où l’on a profeffé & pratiqué
la morale d’Epicure. La plus ancienne fut dans la mai-
fon de Ninon Lenclos : quelles perfonnes la fréquentoient.
Seconde école, celle d’Auteuil. Troifieme école, celle de
NeuiUy. Quatrième école, celle d’Anet 8c du Temple : perfonnes
célébrés qui la fréquentoient. Cette école eft la
même que celle de S. Maur ou celle de madame la Du-
cheffe. Ecole de Sceaux : qui font ceux qui l’ont illuftrée.
La feâe épicurienne n’a jamais eu plus d’éclat qu’en France,
8c fur-tout pendant le fiecle dernier. Ibid. b.
Epicuréijme. Détails fur Epicure 8c fur fa morale. XVII.
458. a , b. X. 700. b. Philofophie d'Epicure, voye{ Corpusculaire
, physique. Envie que ce phiiofophe portoit
à Zénon. XV. <26. a. Fête en fon honneur, VIII. 480. a.
Réfutation de fen fentiment fur l’ame. I. 335. b. Doârine
des épicuriens fur la chaleur. III. 23. b. 39. b. Sur l’origine
du monde. IV. 440. b. Sur la divifibilité de la matterc.
1074. b. Sur la dureté. V. 17a. a. L’atomifme pcrfeâionné
par Epicure. 431. a. Sa dialeâique. IV. 933. a. Réfutation
de fa doârine fur la formation des animaux. 982. a, b, 8cc.
Les épicuriens rejettent l’enchaînement des caufes. VI. 4*4»
b. Doârine d’Épicure fur le froid. VII. 31a .b. Sur la génération.
362. b. Sur la gravité. I. 61. a. IV. 874. a. Définition
du mouvement par les épicuriens. X. 831. a. Leurs
principes les conduifoient à rejetter le dogme de la providence.
XIII. 512. a , b. Idée au tems félon ces philofophes.
XVI. 04. a. Leur fyftême fur la vifion. XVII. 344- tf* ~ur
le vuidé. 37a. a. Seâe d’épicuriens k la Chine. Ifl. 343* £'
ÉPICYCLE , ( Ajlron. ) étymologie de ce mot. 7 .3*
b. Phénomènes du mouvement des plancres auxquels latis-
fait l’invention de l’épicyclc. C’eft dans l’excentrique que
fe meut le centre de l’épicÿde emportant avec lui la planète,
bc. Apogée 8c périgee de l’épicycle. Cette hypothele
eft très-ingénieufe ; M. Godin a donné dans un mémoire
les loix du mouvement apparent des planètes dans lepicy-
clc. Ce qui rend cette théorie de quelque utilité. Sunpu-
E P I
fc’té de dette théorie dans le mémoire (te cet académicien.
L’excentrique fur lequel fe meut l’épicycle fe nomme àu'fli
défirent. Combien i’hypothcfc des épiçyclcs a gêné Riccioli
dans Ja compofition de fes tables aftronomiques. Les aftro-
nomes modernes ont trouvé que les inégalités apparentes du
mouvement de la lune étoient les mêmes que fi elle fe mou-
voit dans un épicyle. Ibid. 786. a. Hypotbefede M. Machin
fur les mouvemens de la lune , renverfée par M. Clairaut.
Celle de M. Halley. Ibid. b.
EpicycU : 'défèrent de T. IV. 74a. a. Balancement de l’épicy-
clc lunaire, Suppl. II. 907.4.
ÉPICYCLOIDE , ( Géom. ) ligne courbe engendrée par
la révolution d’un point de la circonférence aun cercle,
lequel fe meut en tournant fur la partie convexe ou concave
d’un autre cercle. Epicycloïde allongée ou accourcie. Epicycloïde
fupérieure 8c extérieure ; épicycloïde inférieure 8c
intérieure. Bafe de l’épicydoïdc. Ouvrages à confulter fur
les principales propriétés de cette courbe. Divers écrits qui
trairent des épicycloïdes fohériques. Différence entre celles-
ci 8c les épicycloïdes ordinaires. Mémoires à confulter fur
leurs propriétés. V. 786. b. Théorie des épicycloïdes fimples
8c ordinaires. Ibid. 787. a. Sur l’ufage des épicycloïdes en
méchanique, voye[ Dent. M. de Maupertuis a examiné les
figures rcâilignes formées par le roulement d’un polygone
régulier fur une ligne droite, 8c il en a déduit les dimen-
fions de la cycioïdc. Sa théorie appliquée à l’épicycloïde.
Ibid.b.
Epicycloïde. Traité des épicycloïdes par M. de la Hire :
la courbure de l’éplcydoïae employée dans quelques engrenages.
IV. 841. a, b , 8cc.
EPIDAURE. L’oracle de Delphes ordonne aux Epidau-
riens d’ériger deux ftatues, pour remédier à la ftérilité de
leurs terres. XV. 499. b. Temple d’Efcolape à Epidaure.
XVI. 71. b. Culte que les Epidauriens rendoient à Damie
8c à Auxefic. Suppl. 1. 727. a.
ÉPIDÉLIUS, ( Myth. ) furnom d’Apollon. Prodige qui
donna lieu à ce furnom. Ce qu’on en doit penfer. V.
787. b.
Epidélius, furnom d’Apollon. Correâions à faire à cet
article de l’Encyclopédie. Suppl. Q. 818. a.
ÉPIDÉMIE, ( Médec. ) étymologie de ce mot. Quelques
auteurs la nomment quelquefois maladie univerfelle. Différence
entre les maladies épidémiques 8c celles qu’on appelle
endemiaues, entre les maladies épidémiques 8c les fporadi-
ques. Les épidémies ne font pas d’un feul 8c même genre,
elles différent beaucoup félon la différence des faifens, qui
ont précédé 8c qui fubfifterjt, félon la différente nature des
habitans d’un pays. Elles changent prefque chaque année
de caraâere oc de nature, lors même qu’elles paroiffent
avoir les mêmes fymptômes. D’où dépendent les différentes
caufes des épidémies qui font dans l’air. V. 788. a. Les ali-
mens font fouvent aulfi par leur nature la caufe des maladies
populaires : c’eft ce qu’on obferve quelquefois dans
des villes aifiégécs, où tout le monde eft contraint à manger
des choies de mauvaife qualité. Les maladies épidémiques
ne fe communiquent pas auff» communément qu’on le
penfe par contagion. Ce qu’on doit faire en général pour
s’enpréferver. Comment les habitons d’un pays doivent purifier
l’air, lorfqu’ils font menacés ou atteints d’une épidémie.
Les villes où l’on brûle du charbon de pierre font
moins fujettes aux maladies épidémiques, bc. Bons effets
des vents du feptentrion 8c du levant dans les tems dépi-
démies. Les pluies font aufli très-falutaircs. Ibid. b. Directions
pour les médecins, lorfqu’il furvient une maladie épidémique
dont le caraâere n’eft pas bien connu. Combien
Il feroit utile d’avoir tin recueil d’obfervations cxaâes fur
toutes celles qui ont paru jufqu’à préfent. Quels font tous
les objets qui doivent entrer dans ces observations : avec
quels foins cette hiftoire de chaque épidémie doit être faite.
Modelés que les médecins devroient imiter à cet égard.
Ibid. 789. a.
Epidémie. De la caufe des épidémies. I. 233. a. V. 178.
a. Caufe de leurs progrès. Suppl. III. 734- a- Amulettes
n rcs à en préferver, félon wedelius. lll. 613. b. Fievres
¿iniques. VI. 731. a. De la maniéré d’obfcrvcr les maladies
épidémiques. XI. 320. a. Comment on pourroit s’affu-
rer de l’état de l’air dans un tems d’épidémie. 322. b. Maladies
épidémiques ou populaires. XIH. 87. b.
Epidémies , fêtes., ( Myth. ) en l’honneur de Junon &
d’Apollon, bc. Elles étoient comme les fêtes de ja prt-
fence du dieu. V . 789*
ÉPIDERMEou cuticule, ( Anatom. ) voye^ ce mot. Il faut
remarquer dans répiderme; i p. fon union étroite avec la
peau ; 2°. fa régénération ; 3P.fon origine ou fa formation j
4°. fa fubftance. De quelle manière le forment les callofités
aux pieds, aux mains 8c aux genoux. V . 789. b. 3^. fes trous
ou pores. Comment les cloches ou empoulcs relient gonflées
fans laiffer la férofité extravafée échapper par les trous,
qui doivent être nggrandis par l’cxtenfion de répiderme fou»-
Tome I,
E P I 6 0 9
levé; S*, fon épaiffeur, différente en différentes parties du
corps ; 70. les filions plus ou moins confidérables en différentes
parties ; 8 . fon infenfibilité ; 90. fon incorruptibilité.
Ibid. 790. a. 10 . fa couleur. La couleur de l’épiderme ne
détermine point abfolument celle de la peau , mais plutôt
celle du corps muqucüx firué au-deffousj 11°. fonufaee. L’épiderme
mérite beaucoup l’examen 8c les recherches des
phyfiologiftes. Remarque utile aux accoucheurs. Il ne faut
pas regarder le détachement de l’épiderme comme un figne
certain de la mort de l’enfanr. Ibid. b.
Epiderme, ,fon ufage. XV. 820. b. Pourquoi l’aâion du
toucher eft douloureufe quand l’épiderme eft ratiffée , macérée
ou brûlée. 821. b. Pourquoi le taâ eft détruit lorfque
l’épiderme fe durcit. Ibid.
ÉPIDIDYME, ( Anatom. ) nom de deux corps variqueux
fitués fur la partie fupérieure des tefticules. Etymologie de
ce mot. Dcfcription des épididymes ; en quoi ils différent
des tefticules. V, 701. a. Voyer T esticule b. Suppl.’\\. 614. b
ÉPIDIDYME. ( Anat. ) 1 Nouveaux détails fur la ftruâure
de cette partie. Suppl. II. 818. a. Manière de Pinjcâer avec
le mercure. Ibid. b. Continuation de l’épididyme, appeliéc
canal déférent, Suppl. II. 819.«.
ÉPIER, (Jurifp.) droit domanial qui ne fe leve fous ce
nom que dans la feule province de Flandres. Nature de
cette redevance. Origine de ce droit. Certains mémoires
affurent que Charlemagnë avoit chargé les terres de Flandres
de la redevance tie l’épier. V. 791. a. Difficultés fur-
venues infenfibiement par rapport aux moyens de lever ce
droit. Ce fut, pour y mettre fin, que les archiducs Albert
& Ifabelie rendirent le placard du 13 juillet 1602. Difpo-
firions de ce placard. Il s*eft encore élevé récemment des
conteftations h ce fujet. Comment elles ont été terminées.
Enumération que donne M. Ghewiet des lieux oh fe leve
cette redevance. Une partie de ces rentes a été engagée ou
aliénée. Receveurs de l’épier. Ibid. b.
Epier, il ne faut pas confondre ce droit avec le denier-
céfar. IV. 826. b.
ÉPIEU, arme dont fe fervoient les foldats romains. XIL
616. b. Arme moderne de ce nom. XVil. 786. a.
ÉPIGAMIE, droit réciproque que des perfonnes de différente
nation avoient de fe marier enfemble. XVII. 771. a.
ÉPIGASTR1QUE. ( Anat. ) Région épigaftrique. On la
divife en deux parties, les côtés ou hypocondres 8c l’épi-
gaftre. Veines 8c arteres épigaftriques. V. 792. a. Voyet^
Suppl. II. 637. a.
Epi Gastrique , région, ( Phyfiol.) cette partie regardé«
par plufieurs auteurs comme un centre d’où les forces organiques
femblent partir polir s’y réunir de nouveau, Ceft le
diaphragme qui joue le principal rôle dans Cette régioi).
Fonâions ¿rendues du diajjtiragme. On peut regarder cet
organe comme le vrai centre au fyftême nerveux 8c apo-
nêvrotique. Diverfes obfcrvations qui le prouvent. V. 792. a.
Epigaftrique, région , l’auteiir de cet article de 1 Encyclopédie
confidere la région épigaftrique , comme un centre
ou point de réunion, d^>ù les forces organiques fembieht
partir pour s’y réunir de nouveau. C’eft contre cette hypo-
thefe qu’on trouve ici plufieurs obfcrvations. Suppl. IL
819. a.
EPIGÉNESE, ( Médec. anc. ) terme de médecine employé
par les Grecs. IX. 937. b.
EPIGÉNEUM, \ MuftqAnftr. Antiq.) addition II cet article
de l’Encyclopédie. Suppl. il. 820. a.
ÉPIGLOTTE, ( Anat. ) étymologie de ce mot. Couvercle
du larynx. Defcript.ion & ufage. Gaiien croit que l’épf-
glotte eft le principal organe de la voix. Sa fituatipn, 8c tes
mouvemens. V. 79a. b.
Epiglotte, description détaillée de ce cartilage. Suppl. IL
619. b\
Epiglotte, fa defeription. Suppl, III. 707. a. 708. b. Mufcle
thyro-épiglortiquc. X y l. i if lv i
EP1O0 NES, ( Myth. ) les cnfàns des fept capitaines qui
afiiégerent ep vain la ville de Thebes. Leur expédition pour
venger la mort de leurs peres. V. 793. a.
EPIGONIUM, ( Mufiq. inftr. Antiq. ) inftrument & quarante
cordes. Services que fon inventeur EpigonuS a rendus
à la imifique des anciens. Suppl. IL 820. a- Voyc[ XIV.
941piGRAMMATIQÜES , Ipmph's. V. * 17. b.
EPIGRAMME. ( pelles-ieti. ) Les épigrammes dans leur
origine étoient la même chofe que Ce que nous appelions
aujourd’hui ïnferiptions. Divers ufages auxquels «liés furent
employées. Les Grecs les renfermoient dans des bornes aSea
étroites, mais tics Latins 8c les modernes ont été moins feru-
julcux à cet égard. Définition de l’épigramme, par ,M. le
Jrun, Sentiment de M. Deiprèanx fur ce petit po/ime. Les
fentimens font partagés fur la longueur dé l’épigramme oc
•fur la penfée qui doit la terminer. Caraâere des épigram-
mes grecques. V . 793. 4. Nous nefommes pas dans fe point
de vue convenable pour en bien juger. Différence entre
pPPpppp