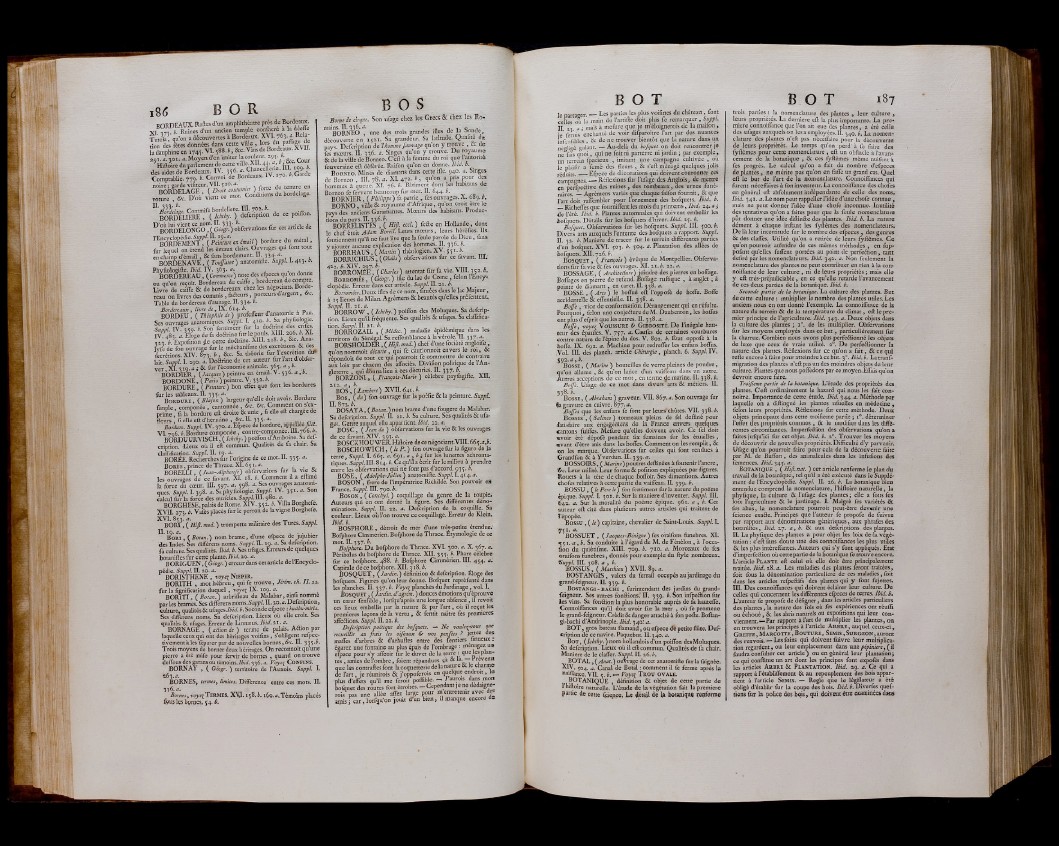
i8 6 BOR BORDEAUX. Ricfles d’un amphithéâtre près de Bordarax.
XI S7t. 4. Ruines d’un ancien temple confacrè à la déeffe
Tutela, qu’on a découvertes à Bordeaux. XVI. 763.«. Relation
des fêtes données dans cette ville , lors du Paffa| ev i e
fa dauphine en . 74î ■ VI. ,88.4 , &c.Vms de Bordeaux. XVU.
soi.n.301. a. Moyen d’en imiter la couleur, „
Hiftoire du parlement de cette vdle.XU. 4 4 - u . K .
des aides de Bordeaux. IV . 35«. <1. Çl'a” c* " a; ^
Comptablie. 77?. *■ C<>"TOi de Bordeaux. IV. 170.4. Garde
i g a ie" rom m , S o 5 où’ v\en.ce mot. Conditions du bordelage. ^I^ÉjÉÉ|ââ8 * « 11 D obfervations fur cet article de
bordure du métal,
fur lequel on étend les émaux clairs. Ouvrages qui font tout
en champ d’émail I & farts bordement. II. 334. a- . ,
BORDEN A V E , ( Touffaint) anatomifte. Suppl. l. 4 *3- *•
PhÊoî^EREAU ^(Commerce) ilote des efpeces qu’on donrie
ou qu’on reçoit. Bordereau de caiffe, bordereau de compte.
Livre de caiffe & de bordereaux chez les negocians. Bordereau
ou livres des commis, fa&eurs, porteurs d argent, c.
Table du bordereau d’aunage. II. 334-
Bordereaux, livre de, IX. 614. b. . , D I
BORDEU, (Théophile de) profefleur d anatomie à Fau.
Scs ouvrages anatomiques. Suppl. I. d10- ^ ^ a phyfiologie.
Suppl. IV. 3,9. 4. Son fentiment fur la doärine des cnfes.
IVV483. n. Eloge de fa doôrine fur le pouls. XIII. ao6. 4 XI.
.23. 4. Expofmon ¡le cette doilrme. XIII. 228. 4 , &c. Ana-
fyft de fon ouvrage fur le méchamfme des excrétions & des
fecrétions. X IV. 873. 4 , 8cc. Sa théorie fur lexcrénon d#
lait. Suppl. I. 290. 2. Doûrine de cet auteur fur 1 art d obfer-
v e r , i a 319.2 ; 8c fur l’économie animale. 365.2,4.
BORDIER, (,Jacques) peintre en émail. V. 530. a , b.
BORDONE, ( Paris ) peintre. V . 332. ¿.
BORDURE, (Peinture) bon effet que font les bordures
fur les tableaux. U. 335.0. .
B o rd u r e , ( Blafon ) largeur qu elle doit avoir. Bordure
fimple, componée, cantonnée , bc. frc. C om m en tg g ijj
prime, fi la bordure eft droite 8c urne, fi elle eft chargée de
fleurs, fi elle eft d’hermine ,& c . » 335- *• ... 8 5
Bordure. Suppl. I V . 370. fl.Efpece de bordure, appellée i/et.
V I. 706. ¿.Bordure componée, contre-componée. ILI.766.b.
BORDUURVISCH, ( lchthy. ) poiffon d’Ambome. Sa def-
cription. -Lieux où il eft commun. Qualités de fa chair. Sa
daflificätion. Suppl. II. 19. a.
BORÉE. Recherches fur l’origine de ce mot. 11. 335*a-
Borée , prince de Thrace. XI. 651. a. ,
BORELLI, ( Jean-Alphonfe ) obfervations fur la vie 8c
les ouvrages de ce (avant. XI. 18. b. Comment il a eihme
la force du coeur. 1U. 597- 598- *• Ses ouvrages anatomiques.
Suppl. I. 398. a. Saphyfiologie. Suppl. IV. 331. *. Son
<alcul fur la force des mufcles. Siwpl. m . 98? - D .
BORGHESE, palais de Rome. XIV. 352. b. Villa Borghefe.
XVII. 273. b. Vafes placés fur le perron de la vigne Borghefe.
XVBOr¥ ; ( Hiß. mod. ) trompette militîùre des Turcs. Suppl.
ü . 19. a. . . . . . . R
B o r i , (Botan.) nom brame, d’une efpece de jujubier
des Indes. Ses différens noms. Suppl. II. 19. a. Sa defcription.
fa culture. Ses qualités. Ibid. b. Ses ufages. Erreurs de quelques
botaniftes fur cette plante. Ibid. 20. a. ... '*
BORIGUEN, ( Géogr. ) erreur dans cet article de 1 Encyclopédie.
Suppl. H. 20. a.
BORISTHENE , voyez Nieper. #
BORITH , mot hébreu, qui fe trouve, Jerem. ch. II. 22.
fur la fignification duquel , voyez IX. 109. a.
BORlTI, ( Botan. ) arbriffeau du Malabar, amfi nommé
par les brames. Ses différens noms. Suppl. II. 20. a. Defcription,
culture, qualités 8c ufages.Ibid. b. Seconde efpece :kudhu-miris.
Ses différens noms. Sa defcription. Lieux où elle croit. Ses
qualités 8c ufages. Erreur de Linnaius. Ibid. 21 .a.
BORNAGE , ( aflion de ) terme de palais. Aftion par
laquelle ceux qui ont des héritages voifins, s’obligent refpec-
tivement aies iéparer par de nouvelles bornes, II. 335-^-
Trois moyens de borner deux héritages. On reconnoît qu’une
pierre a été mife pour fervir de bornes , quand on trouve
IrlpA/IlIC I1B8 (1878118 Ail tlmAÎne TUi/t nr.fi. 7 jVoye^ ^^ONFINS.
p ie r r e a tu . m u e p o u r îc r v i r a e o o rn e s , q u a i
deffous des garans ou témoins. Ibid. 336. a. Voyez
BORNAY , ( Géogr. ) territoire de l’Auxc
l’Auxois. Suppl. I.
4■63O'.j0.a..
BORNES, termes, limites. Différence entre ces mots. II,
336- à.
Bornes, voyez T ermes. XXI. 1 58. b. 160. a. Témoins placés
fçus les bornes, 54. b.
B O S
Borne de cirque. Sonufage chez les Grecs 8c cher, les Ro-
, une des trois grandes Ules de la Sonde,
découverte en 1,21. Sa grandeur. Sa latitude. Qualité du
pays. Defcription de l’homme fauvage qu on y trouve , ec de
fes moeurs. II. 336. 2. Singes qu’on y trouve. Du royaume
8c de la viUe de Borneo. C’eft à la femme du roi que 1 autorité
fouveraine eft déférée. Raifon qu’on en donne. Ibid. 4.
Bornéo. Minés de diamanS dans cette me. 940. a. Singes,
de Borneo , 111. 78. a. XI. 47* * . qu’on a pris pour des
hommes à queue. XI. 76. 4. Bâtiment dont les habttans de
Bomeo fé fervent beaucoup fur mer. II. 644. 4.
BORNIER, ( Philippe ) fa patrie , fes ouvrages. X. 609.4.
BORNO ville & royaume d’Afrique, qu’on croit être le
pays des anciens Garamantes. Moeurs des habitans. Productl0BORMUST^
st ( Hiß. ecet. ) feile en Hollande, dont
le chef êtoit Adam Boreil. Leurs moeurs, leurs héréftes. Ils
fotttiennent qu’ü ne fout lire que la feule parole de Dieu, fans
y ajouter aucune explication des hommes. 11. 330. 4.
BORRHAUS, ( Martin ) théologien. XV. , 51. 4.
BORRICHIUS, (Olaiis) obfervanons fur ce lavant. III.
422. 4. X IV. 297.4. . . . ,-rrr .
BORROMÉE, ( Charles) attentat fur fa vie. VIII. 3152.4.
B orromÉe , ( Géogr. ) ifle du lac de Corne, félon 1 tncy-
clopédie. Erreur dans cet article. Suppl. II. 21.4.
Borromles. Deux ifles de ce nom, «tuées dans le lac Majeur,
à I , lieues de Milan. Agrémens 8c beautés qu’eUes préfentent.
S ‘PBOBÀOw \ ( lchthy.) poiffon des Moluques. Sa defcription.
Lieux qu’il fréquente. Ses qualités 8c ufages. Sa claffifica-
tion. Suppl. II. 2i. b. # . - ¡â
BORROZAIL , ( Médec. ) maladie épidémique dans les
environs du Sénégal. Sa reffemblance à la vérole.II. 337. a.
BORSHOLDÉR ,(Hift. mod.) chef d’une focieté angloife ;
qu’onnommoit décurie , qui fe cäutionnoit envers le roi, &
répondoit de tout ce qui pourroit fc commettre de contraire
aux loix par chacun, des affociés. Divifion politique de l’Angleterre
, qui d&nna lieu à tes décuries. II. 337. __T
BORZONI, ( François-Marie ) célébré payfagifte. XII.
^ BO S , (-Lambert) X V I I .6 4 1 - .
Bos, (du) fon ouvrage fur la poefie 8c la peinture.Suppl.
n .872 .b. I I i i j s H
BOSAYA, (Botan.) nom brame d une fougere du Malabar.
Sa defcription. Suppl. II. 21. b. Sa culture. Ses qualités 8c ufages.
Genre auquel elle appartient. Ibid. 22. a.
BOSC, ( Jean du ) obfervations fur la Yie 8c les ouvrages
de ce favant. XIV. 393. a.
BOSCKHOU WER.Hiftoire dece négociant.VIII. 66‘¡.aß.
BOSCHOWICH, (le P .) fon ouvrage fur la figure de la
terre, Suppl. I. 665. a. 601. a , b ; fur les lunettes achromatiques.
Suppl. III. 814 .b. Ce qu’il a écrit fur le milieu à prendre
entre les obfervations qui ne font pas d’accord. 93 ç. b.
BOSE, ( Adolphe-Julien ) anatomifte. Suppl. 1.414. a.
BOSON , frere de l’impératrice Richilde. Son pouvoir en
France. Suppl. IIÏ. 790. b.
Boson , ( Conchyl. ) coquillage du genre de la toupie.
Auteurs qui en ont donné la figure. Ses différentes dénominations.
Suppl. IL 22. a. Defcription de la coquille. Sa
couleur. lieux où l’on trouve ce coquillage. Erreur ae Klein.
Ibid. b. I , ,
BOSPHORE, détroit de mer d’une tres-petite étendue;
Bofphore Cimmerien. Bofphore de Thrace. Étymologie de ce
mot. II. 337. b.............................................
Bofphore. Du bofphore de Thrace. XVI. 300. a. X. 367. <x.
Péribolus du bofphore de Thrace. XII. 3 55. b. Phare célébré
fur ce bofphore. 488. b. Bofphore Cimmérien. III. 454. a.
Capitale de ce bofphore. XII. 318. b.
BOSQUET, (Jardin.) définition 8c defcription. Éloge des
bofquets. Figures qu’on leur donné. Bofquet repréfente dans
les planches. II. 337. b. Voye{ planches du Jardinage, vol. I.
BOSQUET, ( Jardin, d'agrém. ) douces émotions qu’éprouve
un coeur fenfible, lorfqu’après une longue abfence, il revoit
ces lieux embellis par la nature 8c par l’art, où il reçut les
premières leçons de la vertu, 8c fentit naître fes premières
affrétions. Suppl. II. 22. b.
Defcription poétique des bofquets. — Ne voulez-vous que
recueillir au frais les oifeaux & vos penfées ? jettez des
maffes d’arbres 8c d’arbuftes entre des fentiers finueux :
égarez une fontaine au plus épais de l’ombrage : ménagez un
elpace pour s’y affeoir fur le duvet de la terre : que les plantes
, amies de l’ombre, foient répandues çà 8c la., Prévenu
que les contraftes font la coquetterie de la nature 8c le charme
de l’art, je réunirois 8c j’oppoferois en quelque endroit, le
-plus d’effets qu’il me feroi poffible. - / “ rots dans mon
bofimet des routes fort étroites. - Cependant ,e ne dedatgne-
rols pas une allée affez large pour m entretenir avec des
aqiis ; car, lorfqu’on jouit d’un Bien, il manque encore ne
■
BOT BOT 1 8 7
le partager. — Les parties les plus voifines du château , font
celles ou la main de l’artifte doit plus fe remarquer, Suppl.
II 23. a ; mais à mefure que je m’éloignerais de la maifon,
je ferais ^enchanté de voir difparoître l’art par des nuances
infsnfibles , & de ne trouver bientôt que la nature dans un
négligé galant. — Au-delà du bofquet on doit rencontrer je
ne fais quoi, qui ne foit ni parterre ni jardin ; par exemple,
un terrein fpacieux , imitant une campagne cultivée , où
le plaifir a femé des fleurs , 8c s’eft ménagé quelques jolis
réduits. — Efpece de décorations qui doivent couronner ces
campagnes. *— Réflexions fur l’ufage des Anglois, de mettre
en perfpeôive d,es ruines , des tombeaux, des urnes funéraires.
— Agrémens variés que chaque faifon fournit, $c que
l’art doit raffembler pour 1 ornement des bofquets. Ibid. b.
— Richeffes que fourniffent les moiS'du printems, Ibid. 24. a ;
de l’été. Ibid. b. Plantes automnales qui doivent embellir les
bofquets. Détails fur les bofquets d’hiver. Ibid. 25. b.
Bofquet. Obfervations fur les bofquets. Suppl. III. 500. b.
Divers arts auxquels l’entente des bofquets a rapport. Suppl.
II. 32. b. Maniere de tracer fur le terrein différentes parties
d’un bofquet. XVI. 503. b. 504. a. Plantation des allées de
bofqjuets. XH. 726. b. _
B osquet , (François) évêque de Montpellier.Obfervations
fur fa vie 8c fes ouvrages. XI. 21. b. 22. a.
BOSSAGE, ( ArchiteElure) joindre des pierres enboffage.
Boffagcs en pierre de refend. Boffage ruftique , à anglet ¿ à
pointe de diamant, en caret. II. 338. a.
BOSSE, ( Arts ) le boffué eft l’oppofé de boffu. Boffe
accidentelle 8c effentielle. II. 3 3'8. a.
Boffe , vice de conformation. Dérangement qui en réfulte.
Pourquoi, félon une conjefture de M. Üaubenton, les boffus
ont plus d’efprit que les autres. H. 3 38. a.
Boffe, voyer VOUSSURE & G ibbosité. De l’inégale hauteur
des épaules. V. 757. a. Caufes de certaines courbures
contre nature de l’épine du dos. V. 802. b. État oppofé à la
boffe. IX. 692. a. Machine pour.redreffer les enfans boffus,
.Vol. III. des planch. article Chirurgie, planch. 6. Suppl. IV.
,592. a,b.
B osse , ( Marine ) bouteilles de verrepleines de poudre,
qu’on allume , 8c qu’on lance d’un vaifleau dans un aHtre.
Autres acceptions ae ce mot, en terme dé marine. II. 338 .b.
Boffe. Uiage de ce mot dans divers arts 8c métiers. II.
338. b.
Bosse , ( Abraham ) graveur. VU. 867. a. Son ouvrage fur
la gravure en cuivre. 877. d.
Boffes que les enfans fe font par leurs"chûtes. VII. 338. b.
B osses , (Salines) tonneaux pleins de fel deftiné pour
dfatisfaire aux engagemens de la France envers quelques
cantons fuiffes. Mefure qu’elles doivent avoir. Ce fel doit
«voir été dépofé pendant fix femaines fur les étuailles,
«vant d’être mis dans les boffes. Comment on les remplit, 8c
©n les marque. Obfervations fur celles qui font rendues à
Grandfon 8c à Yverdun. II. 339. a.
BOSSOIRS, ( Marine) poutres deftinées à foutenir l’ancre,
&c. Leur utilité. Leur forme 8c pofition expliquées par figures.
Rouets à la tête de chaque boffoir. Ses dimenfions. Autres
chofes relatives à cette partie du vaiffeau. H. 339. b.
BOSSU, (le Pere le ) fon fentiment fur la nature du poëme
épique. Suppl. I. 301.0. Sur la maniere d’inventer. Suppl. III.
642. a. Sur la moralité du poëme épique. 961. a , b. Cet
auteur eft cité dans plufieurs autres articles qui traitent de
l ’épopée.
Bossu, ( le) capitaine, chevalier de Saint-Louis. Suppl. I.
■yçx. a.
BOSSUET , (Jacques-Bénigne) fes oraifons fúnebres. XI;
Î'çi .a , b. Sa conduite à l’égard de M. de Fénélon, à l’occa-
ion du quiétifme. XHI. 709. b. 710. a. Morceaux de fes
oraifons fúnebres, donnés pour exemple du ftyle nombreux.
Suppl. III. 308. a , b.
BOSSUS, ( Matthieu ) XVII. 89. a.
BOSTANGIS, valets du ferrail occupés au jardinage du
grand-feigneur. II. 339. b.
Bo stangi - b a ch i , furintendant des jardins du grand-
feigneur. Ses autres fondions* II. 329. b. Son infpedion fur
les vins. Sa fondion la plus honorable auprès de la hauteffe.
Connoiffances qu’il doit avoir fur la mer , où fe promene
le grand-feigneur. Crédit 8c danger attaché à fon pofte.Boftan-
gi-bachi d’Andrinople. Ibid. 340.* a.
BO T , gros bateau flamand, ou efpece <fe petite flûte. D efcription
de ce navire. Paquebot. II. 340. a.
Bo t , (lchthy. ) nom hollandois d’un poiffon des Moluques.
Sa defcription. Lieux -où il eft commun. Qualités de fa chair.
Maniere de le daffer. Suppl. II. 26. b.
BOTAL , (Anat.) ouVrage de cet anatomifte fur la faignée.
XIV. 304. a. Canal de Botal : comment il fe ferme après la
nai(Tance. VII. 5. b. — Voyez T ro u o v a le.
BOTANIQUE , définition 8c objet de cette partie de
1 hiftoire naturelle. L’étude de la végétation fait la première
partie de cette fçie/ice, Le détail de la botanique renferme
trois parties : la nomenclature des plantes , leur Culture ,
leurs propriétés. La derniere eft la plus importante. La première
connoiffance que l’on ait eue des plantes ¿ a été celle
des ufages auxquels on les a employées.11. 340. b. La nomenclature
des plantes n’eft pas nèceffairc pour la découverte
de leurs propriétés. Le temps qu’on perd' à fe faire des
fyftêmes pour cette nomenclature, eft un obftacle à l’avan-*
cernent de la botanique , 8c ces fyftêmes même nuifent à.
fes progrès. Le calcul qu’on a fait du nombre d’efpeces
de plantes, ne mérite pas qu’on en faffe un grand cas. Quel
eft le but de l’art de la nomenclature, Connoiffances qui
furent néceffaires à fon inventeur. La connoiffance des choies
en général eft abfolument indépendante de celle des noms;
Ibid. 341. a. Le nom peut rappeller l’idée d’une chofe connue,
mais ne peut donner l’idée d’une chofe inconnue. Inutilité
des tentatives qu’on a faites pour que la feule nomenclature
pût donner une idée diftinâe des plantes. Ibid. b. La nature
dément à chaque inftant les fyuêmes des- homenclateurs;
De là leur incertitude fur le nombre des efpcces, des genres
8c des claffes. Utilité qu’on a retirée de leurs fyftêmes. Ce
qu’on pourroit attendre de ces mêmes méthodes , en fup-
pofant qu’elles fuffent portées au point de perfeâion, tant
defiré par les nomenclateurs. Ibid. 342. a. Non feulement la
nomenclature des plantes ne peut contribuer en rien à la connoiffance
de leur culture , ni de leurs propriétés ; mais elle
y eft très-préjudiciable, en ce qu’elle retarde l’avancement
de ces deux parties de la botanique. Ibid. b.
Seconde partie de la botanique. La culture des plantes. But
de cette ciuture : multiplier le nombre des plantes utiles. Les
anciens nous en ont donné l’exemple. La connoiffance de la
nature du terrein 8c de la température du climat, eft le premier
principe de l’agriculture. Ibid. 343. a. Deux objets dans
la culture des plantes ; x°. de les multiplier. Obfervations
fur les moyens employés dans ce but, particulièrement fur
la charrue. Combien nous avons plus perfectionné les objets
de luxe que ceux de vraie utilité. 20. De perfectionner la
nature des plantes. Réflexions fur ce qu’on a fait, 8c ce qui
refte encore à faire pour atteindre à ce but. 30. Ibid. b. La tranf-
migration des plantes n’eft pas un des moindres objets de leur
culture. Plantes que nous poffédons par ce moyen. Êffais qu’on
devrait encore faire.
Troifieme partie de la botanique. L’étude des propriétés des
plantes. C’eft ordinairement le hazard qui nous les fait con-
noitre. Importance de cette étude. Ibid. 344. a. Méthode par
laquelle on a diftingué les plantes ufuelles en médecine ,
fclon leurs propriétés. Réflexions fur cette méthode. Deux
objets principaux dans cette troifieme partie ; x°. déterminer
l’effet des propriétés connues , 8c le modifier dans les différentes
circonftances. Imperfection des obfervations qu’on a
faites jufqu’ici fur cet objet. Ibid. b. 20. Trouver les moyens
de découvrir de nouvelles propriétés. Difficulté d’y parvenir.
Ufage qu’on pourroit faire pour cela de la découverte faite
par M. de Buffon, des animalcules dans les infufions des
femences. Ibid. 34<. a.
Bo tanique , (Hifi.nat. ) cet article renferme Je plan du
travail de la botanique, tel qu’il a été exécuté dans le Supplément
de l’Encyclopédie. Suppl. II. 26. b. La botanique bien
entendue comprend la nomenclature, l’hiftoire naturelle, la
phyfique, la culture & l’ufage des plantes; elle a fous fes
loix l’agriculture 8c le jardinage. I. Malgré fes variétés 8c
fes abus, la nomenclature pourroit peut-être devenir une
fcience exaâe. Principes que l’auteur fe propofe de fitivre
par rapport aux dénominations génériques, aux phrafes des
botaniftes, Ibid. 27. a, b. èc aux descriptions des plantes.
II. La phyfique des plantes a pour objet les loix de-la végétation
: c’eft fans doute une des connoiffances les plus utiles
& les plus intéreffantes. Auteurs qui s’y font appliqués. Etat
d’imperfeCtion où cette partie de la botanique fe trouve encore.
L’article Plante eft celui où elle doit être principalement
traitée. Ibid. 28. a. Les maladies des plantes feront traitées,
foit fous la dénomination particulière de ces maladies, foit
dans les articles refpeftifs des plantes qui y font fujettes.
III. Des connoiffances qui doivent éclairer leur culture. De
celles qui concernent les différentes ¿(peces de terres. Ibid. b•
L’auteur fe propofe de défigner, dans les articles particuliers
des plantes, la nature des fols ou fes expériences ont réufli
ou échoué, & les abris naturels ou expqiitions qui leur conviennent.—
Par rapport à l’art de multiplier les plantes, ou
en trouvera les principes à l’article A r b r e , auquel ceux-ci,
G r e f f e , M a r c o t t e , B o u tu r e , Semis , S u r g e o n , auront
des renvois. — Les foins qui doivent fuivre leur multiplication
regardent, ou leur emplacement dans une pépinière, ( il
faudra confuí ter cet article) ou en général leur plantation;
ce qui conititue un art dont les principes font expofés dans
les articles A r b r e 8c P la n t a t io n . Ibid. 29. a. Ce qui a
rapport à l’établiffement 8c au repeuplement des bois appartient
à l’article Semis. — Regle que le légiflateur a été
obligé d’établir fur la coupe des bois. Ibid. b. Diverfes quef-
tions fur la police des bois, qui doivent être examinées dans