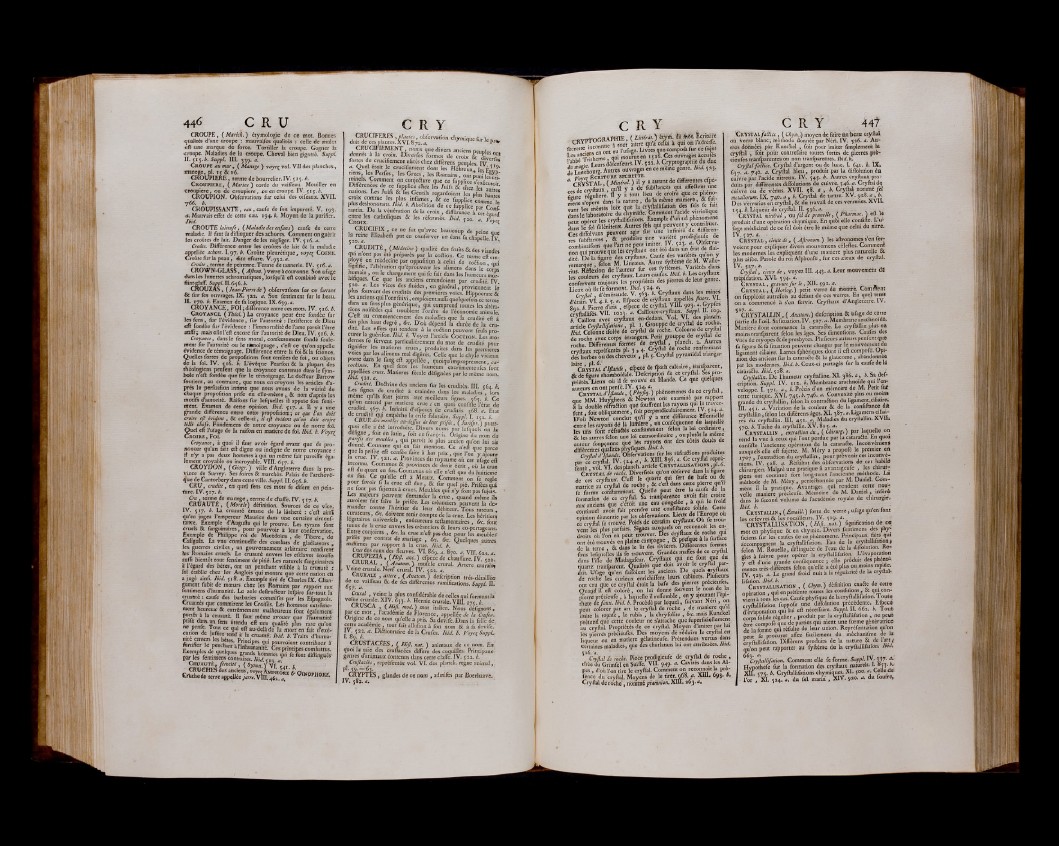
4 4 6 CRU CROUPE, ( Marich.) étymologie de ce mot. Bonnes
qualité* d’une croupe : mauvaises qualité* : celle de mulet
eft -une marque de force. Tortiller la croupe. Gagner la
croupe. Maladies de la croupe. Cheval bien gigotté. Suppl.
II. Cl5. b. Suppl. 111. 339. a.
C r o u p e au mur, ( Manege y voyez vol. VII des planches,
manège, pl. i< 8c 16.
CROUPIERE, terme de bourrelier. IV. 51 y. b.
C r o u p i e r e , ( Marine ) corde du vaifleatj. Mouiller en
'croupiere, ou de croupiere, ©ucn croupe. IV. 313. é.
CROUPION. Obfervations fur celui des oifeaux. XVII.
y66. b.
CROUPISSANTE, eau, caufe de fon impureté. V. 193.
a. Mauvais effet de cette eau. 194. b. Moyen de la purifier.
Ibid.
CROUTE laiteufe, (Maladie des enfantr) caufe de cette
maladie. II faut la aiftinguer des achorcs. Comment on guérit
les croûtes de lair. Danger de les négliger. IV. <16. a.
Croûte. Différence entre les croûtes de lait oc la maladie
oppellée aehore. 1. 97. b. Croûte plcurétique, voye^ C o e n k ,
Croûte fur la peau, dite efeare. ».93 a. a.
Croûte, terme de peinture. Terme de tannerie. IV. 516. a.
CROWN-GLASS, ( AJhon. ) verre à couronne. Son ufaee
dam les lunettes achromatiques , lorfqu’il cil combiné avec le
éHnt-gfafF. Suppl. II. 6 5 6. b.
_ CROUZAS, ( Jean-Pierre de ) obfervations fur ce favanr
et fur fes ouvrages. IX. 30a. a. Son fentiment fur le beau.
II. t7Q. b. Examen de fa logique. IX. 639. a.
CROYANCE, FOI ; différence entre ces mots. IV. 31 6. b.
C r o y a n c e . ( Théol.) La croyance peut être fondée fur
les fens, fur l’évidence, fur l’autorité : l’exiftencc de Dieu
eft fondée fur l’évidence : l’immortalité de l’ame parolt l’ôtre
aoflr; mais elle l’cft encore fur l’autorité de Dieu. IV. 516. b.
Croyance, dans le fens moral, confentement fondé feulement
fur l’aurorité ou le témoignage , c’eft ce qu’on appelle
évidence de témoignage. Différence entre la foi & la fcience.
Quelles fortes de propofitions font cenfées de foi, ou objets
de la foi. IV. 516. b-, L’évêque Pcarfon & la plupart des
théologiens penfent que la croyance conrenuc dans le fym-
bole n eft fondée que for le témoignage. Le doéteur Barrow
foutient, au contraire, que nous en croyons les articles d’a-
prés la perfuafton intime que nous avons de la vérité de
chaque propofitton prife en clle-méme, 8c non d’après les
motifs d autorité. Raifons for lefquelles il appuie fon ferfti-
menr. Examen de cette opinion. Ibid. 317. a. Il y a une
grande différence entre cette propofirion ; ce que l‘on doit
croire eft' ivident , 8c celîe-cr, il ejl ¿vident qu’on doit croire
telle choie. Fondemens de notre croyance ou de notre foi. 8|ud eu l’ufage de la raüfoni en maricre de foi. Ibid. b. Foyer
r o i r e , Foi.
Croyance, à quoi il faut avoir égard avant que de prononcer
qu’un fait eft digne ou indigne de notre croyance :
H n’y a pas deux hommes à qui un même fait paroiffe également
croyable ou incroyable. VIÜ. 6 <7. b.
CROYIjON, (Geoer. ) ville d'Angleterre dans la province
de Surrey. Scs foires 8c marchés. Palais de Parchcvê-
que de Cantorbery dans cette ville. Suppl. II. Cq6. b.
CRU, crudité, en quel fens ces mots fe difent en peinture.
IV. 3 17. b. r
Cru, terme de manege, terme de chaffe.IV. c i7 .b.
CRUAUTÉ, (Morale) définition. Sources de ce vice.
Iv; S?7* h- La cruauté émane de la lâcheté : c’eft airtfi
qu’en jugea 1 empereur Maurice dans une certaine circonf-
tancc. Exemple d Auguftc qui le prouve. Les tyrans font
cruels 8c ûngmnaircs, pour pourvoir à leur confcrvation.
Exemple de Philippe roi de Macédoine , de Tibcre de
Càlfgula. La vue continuelle des combats de gladiateurs
les guerres civiles , un gouvernement arbitraire rendirent
tes Romains cruels. La cruauté envers les efclaves étouffe
aufii bientôt tout fentiment de pitié. Les naturels fanguinaircs
2 l’égard des bêtes, ont un penchant vifiblc à la cruauté ; .
foi établie chez les Anglois qui montre que cette nation en
a jugé ainfi. Ibid. 318. a. Exemple tiré de Charles IX. Changement
fubit de moeurs chez les Romains par rapport aux
fentimens d’humanité. Le zele deftrufleur infpirc fur-tout la
cruauté : caufe des barbaries commifes par les Efpagnols.
cruautés que commirent les Croitës. Les hommes extrêmement
heureux & extrêmement maJhcutcux font également
KwÎ5a! cr“auti‘ 11 f«ut môme avouer que l’humanité
El nÆ * étcnd“ cft «ne qualité plus rare qu’on
¡ïriEn£ ISi!, CC au'dclàdc la mort en fait iexé-
Ï Ï Ï ÏL tSJ?foce tend à la cruanté. Ibid. b. Traits d’huma-
¿ . ’¡ferlé ¿ ¡ C i n g j r R°“ rroicn. comriW ï
Exemples Je q u c l o u e s ^ ‘S*?""/-
f jr les tèmiàhi.con trS .
ÇRUAUTb, fincto , (Synon.Yvi 'Al t.
_ CRUCHES des anciens, vîn^Amphme a Oivr»«trAn.»
Crttih.de terre
C R Y
CRUCIFIEMENT, noms que divers anciens peuples on,
donnés i la croix. Dlvcrfcs formes de croix & E J 2 ■
fortes de crttcificnoem tifités chez différens peuple, IV, ,
x. Quel ¿tort le crucifement dont les Hébreux
tiens, lesPerfes, les Grecs, les lUnalusToo^uu &
mugis. Comment on çonjeflurc que ce fuppllce Vexécuiob
Différences de ce fuppllce chez les Juif, ¿ ‘ chez les au,™
nations, tes Juifs & les Gentils regardoient les plus haute,
crou: comme les pins infâmes, & ce fuppllce comme fe
plusdesliondrahr. Ibid. ¿.Abolition de ce fuppllce „ „ r j r
tamm. De la vénération delà croix, différence à ceté™5
C iio ix * C î “cs & lcs ,éfoTmis- md- jio . a. /¡¡y t
CRUCIFIX, ce ne fut qu'avec beaucoup de peine eue
520 ° put en coiifcrvcr un dans fa chapelle. IV
CRUDITÉ, (Médecine ) qualité des fruits 8cdes viande*
qui n ont pasj été préparés par lu coflion. Ce terme eft ein-
pioyt en médecine par oppofition à celui de coélion, oui
lignifie, 1 altération qu’éprouvent les alimens dans le corta
humain, ou le changement qui fc fait dans les humeurs mor-
ninqucs. Ce que les anciens entendoient par crudité. IV.
Ï20, f- Les vices des fluides, en général, proviennent le
plus fouvent des crudités des premières voies. Hippocratc 8c
les anciens qui l’ont fnivi, emploient aufli quelquefois ce terme
dans un fens plus générique, qui comprend toutes les altérations
nuifiblcs qui troublent 1 ordre de l’économie animale:
îr' au commencement des maladies que la crudité eft à
fon plus haut degré , dre. Doù dépend la durée de la crudité.
Les effets qui tendent à la coétion peuvent fculs procurer
la guérifon. Ibid. b. Voyez l’article CocnoN. Lcs mo-
dernes fc fervent particulièrement du mot de crudité pour
lignifier les matières crues, produites dans les premières
voies par les alimens mal digérés. Celle que le chyle vicieux
porte dans le fang eft appeftée , quoiqu improprement, cat
cochtnne. En quel fens les humeurs cxcrémcnteufes font
l l jÉ lp f *rc* ^ca^c àéGgnées par le même nom.
Crudité. Doélrine des anciens fur les crudités. III. <64. b.
Les fignes de crudité i craindre dans les maladies, lors
meme qu ils font joints aux meilleurs fignes. <Ô<. b. Ce
qu on entend par matière «rue ; en quoiconftftc l’état de
crudtré. 567. b. Infinité d’cfpcccs de crudités <68. a. Etat
S J ' I 1 cm(,fichc la crife falutaire. Suppl. I i<i. b.
CRUE des meubles aitrdejfus de Uur prifée, ( Jurifpr.) pour-
quoi clic a été introduite. Divers noms par Jcfqucls on J»
défigne , foit en latin, fott en fnnçnh. Origine du nom de
panjfîs aes meubles , qui paroit le plus ancien qu’on lui ait
donné. Coutume qui en fait mention. Ce n’eft que parce
qnc la pnféc eft ccnfée fa.te à bas prix, que l’on y ajoute
la crue. IV. qu. a. Provinces du royaume où cet filage eft
inconnu. Coutumes & provinces de droit écrit, où la crue
Î? r l qiCn *"• n** C«u,!unJ“ où c,Ic n’cÉ que du huitième
en fus. Ce quelle eft à Mcaux. Comment on fc rcgle
pour favoir ff la crue eft duc, & fur quer nié. Prifécsqui
ne font pas fujettes à crues. Meubles qui n’y font pas fujets. ■
Les majeurs peuvent demander la crue, quand même ils
« 3 « » .K Prii%f- Les créanciers peuvent la demander
contre l’héritier de leur débiteur. Tous tuteurs.
curateurs, 6>c. doivent tenir compte de la crue. Lcs héritiers
légataires fimvcrfels, exécuteurs tcftamcntaircs , C/e. font
tenus de la crue envers les créanciers & leurs co-psrtaacans.
Entre conjoints , Crc. la crue n’eft pas due pour les meubles
prifés par contrat de mariage , &c. &c. Quelques autres
ma*imcs par rapport à la crue. Ibid. b.
f. 870. x. v ir. i , , . x.
rRrrnA? anî ’ ) clpcccdc chauffure.IV. <n.
-,vV , (Anatom.) mufcle crural. Artère crurale«
Veine crurale. Nerf crural. IV. <22. a.
» a0rleTf defeription très-détaillé»
| ^ 7 <JVa Cau fcs dl®rcntcs ramifications. Suppl. II.
I tvcTrJ? Ç,us confidérablc de celles qui forment la
rnrïclr if' % ? crD,c Cruralc* VIIÎ. 17c. b.
™ A », mod.) mot italien. Nous défignons,
| pjr. c.cm° t » 1 académie de Florence, appclléc de la Crufca.
Or.gmc de ce nom qu’elle a pris. Sa « f e . Dans la (bile de
cette académie , tout fait aUirfion à fon nom & à fa devife.'
1 8 *2t" a' ‘” 10nnairc d« la Crufca. Ibid. b. Voyt[ Suppl..
CRUSTACÊES, ( Hift. nat. ) animaux de ce. nom. En
quoi la taie des cruftiacécs diffère des coquilles. Principaux
genres d animaux contenus dans cette claftc. IV. fia. b.
Crujlacéés, représentés vol. VL des plancb. regne animal,
CRYPTES y glandes de ce nom , admifos par Boerhaave.
IV. sZ%.a.
C R Y I »n ont eu l’ufage. Livres que compofa fur ce fuiet
v'^STrithctnc, qui ttldurut eh IS >6.Ces ouvrages acciifis
 a e ï Leurs difenfeurS. IV. Sl l . b. Cryptographie du duc
d° Lunèbourg. Autres ouvrages en ce mime genre. lb,J. 5z j . I
4 c r Î I tA L ” M i S " ) 1! y a autant de différentes cfpè- I
J.rrvfeux uu'll V i de fubfeuces qui äffe Sent une
S Î e réguVtere. S y a tou. lieu de crol?e que ce phéno-
«ene s'opère feris la nature , de la même manière, & fut - I
. L e marnes loi* (lue la crÿftallifattoh des fels fe fait |
dM le laboratoire du âiymllte. Comment l'acide vitriolique
5 obérer les cryftaUiiatiolts. Exemple d’un tel phénomène 1
Sans le fel féléniteux. Autres (fels qbt Pîl" ei ' / / 0Î f f i . 1
Ces diffolvans peuvent agir Air une infinité de dtfféren- I
re, ftibflances , 8t nroduire une varjété Pr0^8g“ f'
rion^^prottveque lesïîySfàdV“ ‘nt été dans un état de fltfe I
S a t e S ?
confervent toujours les propriétés des pierres de leur genre.
T ierii oïl ils fc formcfit. Ibid. 524. a. . . . . . i
C M , d'éméraude. V. b. Çryltaux dans les mmes
d’étatn. v i. 4. b. 5. x. Efitccc dé cryftaux apnellés fluors. VI.
«9». b. Pierre d’iris , elpcce tic cryil.il. VIIL 903. a. Gypfcs
eruftalllfés VII. 1011. x. Cailloux-ctyltaux. Suppl. II. 100.
¿ Caillou avec ayAaux eu-dcdans/vol. VI /es plauei.
article Cryflallifution, pl. r. Grouppe de cryltal de roche.
lbii. Colonne ifoléc de cryllal fe roche. Colonne de crvftal
de roche avec corps étrangers. Pent grouppe de cryllal de
roche. Différentes formes de cryffaf, planch. a. Autres
cryfbtux repréfentés pl. 3 . d- Cryltal de roche renfermant
des herbes où des cheveux , pl. 3. Cryllal pyramidal trtangu-
U CÙm t r i l lu l t d . , efpece de IjWtH üaléaire, tranfparent,
& de figure rhomboidale. Deferlpnon dé eé cryffal. hes propriétés.
Lieux oit il fe trouve en Mande. Ce que quelques
auteurs en ont penfé. IV. 5 24. a. , ..a^i
C rvs tal d 'E d e , ( Phyjiq. ) phértoificnes de ce cryllal,
ouc MM. Huyghens & Newton ont examiné par rapport
5 la double râraaion que fouffrCnt les rayons qui le traver-
fent, foi. Obliquement, foit perpendiculairement. IV.^¡M-x
D'Oïl Newton conclut qu'if y a une différence iffemu. 0
entre les rayons de la Iumlere , en confêquence de laquelle
les uns font réfraftés contournent félon la 01‘ orfenatre,
6 les antres félon une loi extraordinaire , ou plutôt le même
ïi.e" r foupSonnc que le. rayons on, de. côté. doué, de
m r c e c r y lta l. IV. ( a e - x , ¿. X1IL 836. x. C e c r y fla l repré-
f tm é v o l. VI. d es planch. article CrTsTALlisatious ,ot.6. I
CR VSTAL dr rocht. D lv c r f ité s qu on o b fe rv e dans la figure t
d e c e s c r y fia ü x . C e f f le quartz q u i fe rt de b afe o u de I
m t t ric e au c t y l b l f e r o c h e , & c 'e i l dans ce t te p ie r re un il
f c fo rm e conltamment. Q u e l le p eu t ê t r e la cau fe de la |
forma tion de c e c rv fta l. Su v au fp d rene e >vo ,t fatt c t o u e
a u x anciens q u e c ’é fô it une e au con g e lé e , i qui le f ro d
con tinu e l a v o lt fait prendre u n e conftftance foM e . C e t te
ouiUton démentie par le s o b fe rv an ons . U C tB f e E u r o p e o u 2cP c t v M fe tro uvh . Po id s de c e r ta in , c ty fta u x . O u fe t ro u v
e n t les plus parfaits. Signes auxqu els o n reconno it les cn-
d ro itt ûii l’o n cn p êu t . S i v e r , Ô e . c r y f la u x f e r jK h e qiu
ont été trouvés en pleine campagne , & prefque à la futfcce
de la terre , & dans le lit des nviete. Différentes >on” c‘
fous lefquelles ili fe ttouvetu. Grandes maffes de:ce cry^ftal
dans l'iffe de Madacrfcar. Cryftaux qui ne font que fe
quartz tranfparent. Qjtalités que doit avoir le cryllal oar-
Ait. Ufage qu’en faiioient les anciens. De qucU eryftaux
de roche les curieux enriehdfent leurs cabtueU. Plufteurs
ont cru qfie ce cryftal étoit la bafe des pierres précieufes.
Quand il eft coloré, oh lui donne fouvent le nom de la
rtTcfre précicùfc, & laquelle il reffcmble, en y ajoutant 1 èpi-
thctc de faux. Ibid. b. Procédé par lequel, fuivant Nén, on
peut colorer par art le cryftal de roche , de manière qu il
imite la topaie , le rubis , la chryfolite , 6rc. mais Kunckel
prétend que cette couleur ne s’attache que fuperficiellemcnt
au cryftal. Propriétés de ce cryftal. Moyen d’imiter par lui
lé< pierres précieufes. Des moyens dé réduire le cryftal en
liqueur ou en matière gélatineufe. Prétendues vertus dans
certaines maladies, que des charlatans lui ont attribuées. Ibut.
<a6 'a ’
Cnfolie roche. Picce prodigieufe de'cryftal de roche,
tirée du Grimfel cn Suïfte. VII. 909. x. Csvt.és dans es Alpes
, d'où l'on tire le cryftal. Comment on rcconnoit la pré-
fencc du cryftal. Moyens de le tirer. 068. <*. Aill. 693. b.
Cryftal de roche , rioiinné pfainnion. XIII. 203* 0,
C R Y 447
CrYSTAL fahicc , i Chym.) moyen de faire tin'beau cryftal
ou verre blanc; méthode donnée par Nérî. IV. 526. a. Autres
données pir Kunckcl, foit pour imiter Amplement le
cryftal -, foit poiir corttrcfairc toutes fortes de pierres pré?;
cieufes tràniparcnres ou non tranfparefites. Ibid. b.
Cryllalfaflicc. Cryftal d’argent ou de lune. 1. 641. b. IX.
637. a. 740. «». Cryftal bleu, produit par la diffolmion dtt
cuivre par l’acide nitreux. IV. 345* 1 Autres cryftaùx produits
par différentes diffolutions de cuivre. 346.«. Cryftal de
cuivré ou de véiius. XVII. 38. a , b. Cryftal nommé fel
metallorum. IX. 740. a , b. Cryllal de tartre. XV. 920.it , b.
Des verreries en cryftal, 8c du travail de ces verreries. aVIL
134. Liqueur de cryflal. IL <36. a. \ /1 i*.
C R V s t a l minéral, Ou fel Je prunelle, ( Phamac.) d t 1«
produit d’une opération chymiquc. En qubi elle conufte. L u-
faee médicinal de 'ce fel doit être lé môme que celui du mtre.
Iv. 327.«. ,. j, . .... • -, i
C rŸs tàl <, deux de -, ( Âflronom. ) les allronomes s cn 1er-
Voient pour expliquer divers mouvemens céleftes. Comment
les modernes les cxpliquént d’une manière plus naturelle«
plus aifée. Parole du roi Alphonfe, fur ces jcieux de cryftal.
IV. 327. à. ■ u j «
Cryllal -, deux de >. voyez III. 443. a. Leur mouvement d?
trépidation:. XVI. 594. a.
C r y s t a l , gravure fur le, XII. 39a. a. .
C r y s t a l , | Horlog. ) petit verre de montre. Comment
oh fuppléoit autrefois au défaut de ces verres. En quel tems
on a commencé à s’en fervir. Cryftaux d’Angleterre. IV.
5 ’ gRYSTALLIN , ( Anatom. ) dcfctipiioo & lifago dé eilte
Karfie de l'oeil. Safituation. IV. 317. x. Membrane arachnoïde,
lanière dont commence la cataraéle. Le cryft*lhn plus ou
1 moins tranfparent félon les âges. Ses dimenfions. Caufcs des
vues dé myopes 8cde presbytes. Plufteurs auteurs penfent quô I fa figure 8c fa fituation peuvent changer par lé mouvement dû
I liganient ciliaire. Lames fphériques dont il eft compofé. üpi-
I mon des anciens fur la cataraéle 8c le glaucome, abandonnée
I par les modernes. Ibid. b. Ceux-ci partagés fur la caufe de la
I cataraéle. Ibid. 528. a. ... . . i .
Cryflallin. De l’humeur crvftallihe. XI. I 386. ’i \ o. Sa del- cription. Suppl. IV. 112. b. Membrane arachnoïde qui 1 cn-
II veloppc. I. 371. a . b. Précis d’un mémoire de M. Petit lui cette tunique. XVI. 743. b. 746. a. Convexité plus ou moins II gIIrIa.n 4de3 1d. ua c.r yVfatrailaltinio,n f édloe nl al ac coounletruaré l8ioc nd de ul ali gcaomncftnftt.acnüciea irdeit. I cryftallin, félon les différens âges. XI. 387. a. Ligamenscilui- I res du cryftallin. III. 451. a, Maladies du cryllalhn. XVlit II <70C. rby. Ts taachllei ndu , c reyxfttraaldliino.n X dVu., 8(1 5C.h iaru.rgb) par laquelle on
I rend la vue à ceux qui l’ont perdue par la cataraéle. En quo*
i confifte l’ancienne opération de la cataraéle. Inconvémens
auxquels clic eft fujette. M. Méry a propofé le premier en
1707, l’extraélion du cryftallin, pour prévenir ces mcorrvé-
niens. IV. 328. a. Réfultat des obfervations de cet habild
cliirureicn. Malgré une pratique ft avantageufe , les chiriif-
eiens ont continué fort long-tcms l’ancienne méthode. La
méthode de M. Méry, perfeélionnée par M. Daniel. Comment
il la pratique. Avantages qui rendent cette nou4
vcUc manière prècieufc. Mémoire de M. Damel, inféro
dans le fécond Volume de l’académie royale de chirurgie*
^ C r y s t a l l i n , ( Émaill. ) forte de verre » ufage qu’en font
les orfèvres 8c les rocailleurs. IV. 3 29 .a.
CRYSTÀLLISAT10N, (Hift. nat.) figmfication de cq
mot cn phyfique 8c en chymie. Divers fentimens des phy*
fteiens for les caufcs de ce phénomène. Principaux feus qui
accompagnent la cryftallifetion. Eau de la cryilalhfation#
félon MTRouelle, diftinguée de l’eau de la diflolunon. Règles
à foivre pour opérer la cryftalhfatiôn. L évaporation
v eft d’une grande confêquence ; elle prôduit des phémA
mènes très-différens félon qu’elle a été plus ou moins rapide.
IV. 329. a. Le grand froid nuit à la régularité de la crÿftab
C r i s t a l l i s a t i o n , ( Chym.) définition exaéle de cettq
opération , qui en préfente routes les conditions, 8c quicon-
vient à tous les cas. au fe phyfique de la cryftallifetion. Toute
cryftallifetion foppofe une diffolution précédente. Efoccè
1 d’évaporation qui lui eft néceffairc. Suppl. U. 662. b. Toub
corps folidc régulier , produit par la cryftalhfation , ne pevfc
être compofé que de parties qui aient une forme généramee
de la forme qui réfultc de leur union. Repréfentatton quon
peut fe procurer, affez facilement du mêchanifme de br
crvftallifarion. Différens produits de la nature 8c de l’art /
qifon peut rapporter au fyftême de la cryftallifatidm Ibid*
¿ryjlallifaùon. Comment cllé fe forme. SuppLVJ. 337. a*
I Hvpothefe for la formation des cryftaux naturels.
XlL 373. b. Cryftallifations chymiques. XI. 500. a. Çclle do
| l’or 7 % 324. U. du fel marin , XIV. p i i du foufre,