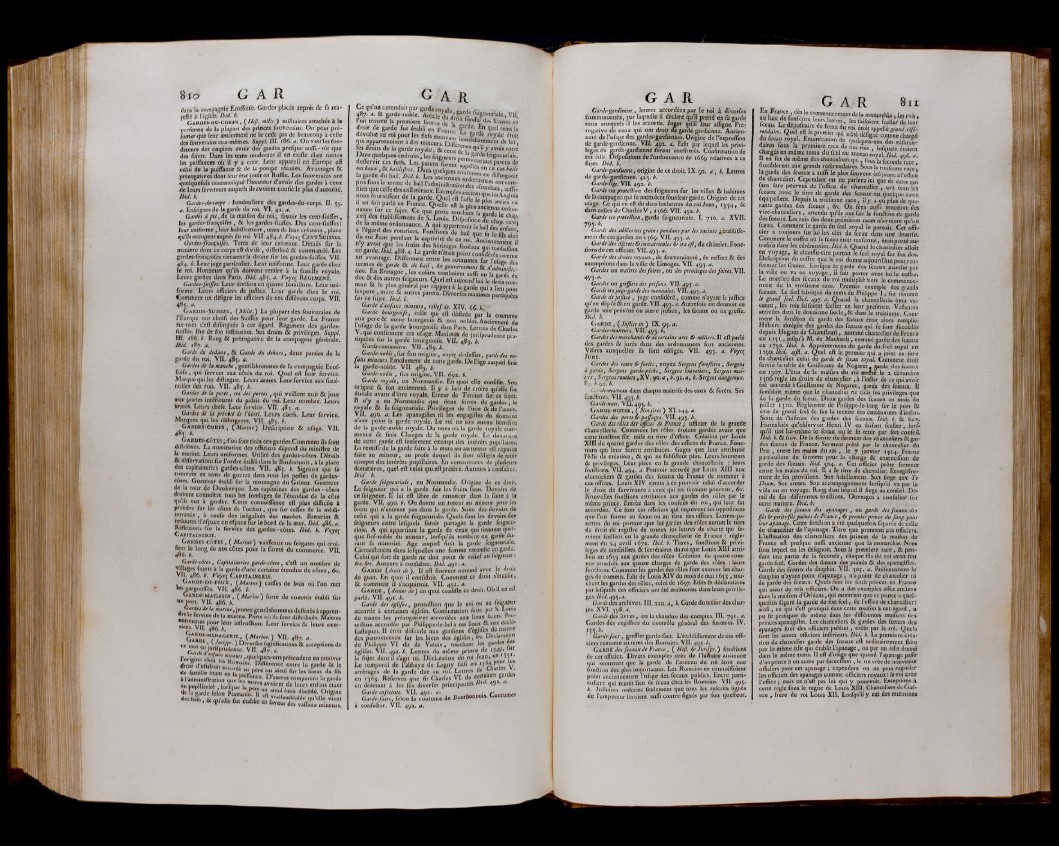
8 io G A R
dam là compagnie Ecoffolfe. Garde» placée auprès de la ma-
jefté â FM ffc Ibid. Ü.
GAHBU'DU-CORPf , Ç M m wW ;j < militaires attaché« k la
verfotmé de la plupart des princes fouverains. On peut préfumer
que leur ancienneté ne le cede pas de beaucoup â celle
de« fouverains eux-mêmes. Suppl. II I 18& a. O n voit les fondateur
« des empires avoir de« gardes prefque suffi - tôt que
des fujett. Dans les rems modernes il en exifle chez toutes
les puiffiwcc* oh H y a cour. Leur appareil en Europe cil
celui de la puiffiince 6c de la ponipe réunies. Avantages 6c
prérogatives dont leur état jouit en Ruffie. Les fouverains ont
Quelquefois communiqué' l'iionnetir d’avoir des gardes & ceux
e leurs Cerviteurt auquel« ils avoient confié le plus d'autorité.
Jbîd. b,
Gardet-du-corps : bandoulière des gardes-du-corps. II. 59.
a. Enfeignes de la garde du roi. V I . 42. a.
Garder A p ié , de la maifbn du roi ; fa voir les cent-fuifies,
les gardes-lrançoifes, & les gardes-fui/lé«. Des cent-fuifTcs t
leur uniforme , leur habillement, rems d e leur création, place
qu'il# occupent auprès du roi. VII. 484./-. Voye^ C enTS ujîses .
Gardes-p’anÇoifes. Tetris de leur création. Détails fur la
maniéré dont ce corps efl d ivifé, diftribué 6c commandé. Les
gardes-françolfés tiennent la droite fur les gardés-fuiifes. VII.
484, b. Leur juge particulier. Leur uniforme. Leur garde chez
le roi. Honneurs qu'ils doivent rendre a la famille royale.
Leurs gardes dans Paris. Jbîd, 485. a. Pvÿ fy Régimen t.
Gardes-fuiffes. Leur divlfiOn en quatre bataillons. Leur uniforme.
Leurs officiers de juflice. Leur garde chez le roi.
Comment on défigne les officier# de ces dm'érens corps. V IL
48«. a.
Garde s -Svis ses , ( Milit. ) La plupart des fouverains de
l'Europe ont eltoifi des SuifTcs pour leur garde. La France
fur-tout «'efl dirtinguée s cet égard. Régiment des gardes*
fuifics, But de fon miiituiion. Ses droits 6c privilèges. Suppl.
III. 186. b. Rang & prérogative de la compagnie générale.
Ibid. 18 7. a.
Garde du dedans , 6c Garde du dehors, deux parties de la
garde du roi. VII, 483. a,
foife , qui fervent aux côtés du roi. Qu e l e (i leu r fer vice.
Marque qui les diflingue. Leurs armes. Leur fervice aux funérailles
des rois. VII, 485, b.
Gardes de la por te, ou de/portes, qui veillent nuit 6c jour
tux portes intérieure« du palais du roi. Leur nombre. Leurs
armes, Leurs chefs. Leur fervice, VII. 485, a.
Garde t de la prévôté de l'hôtel, Leurs chefs. Leur fervice.
Marques qui les diftinguent. VII, 483. é,
G a rdm -C o rp i , ÇMarine ) Description 6c tifage. V IL
48^ b.
Garde#«c<Vfes ; d’oh font tirés ces gardes.Comment ils font
diftribliés. La nomination des officiers dépend du miniflre de
* mArinc' ^e,,r* uniformes. Utilité des gardes-côtes. Détails
oc obfervatlorts fur l'ordre établi dans le Ooulonnois, à la place
des caoitaineries i?:irdi*s î/Wdes capitaineries gardes-côte«s. VVIII!. 4A8Îlc, . bI. . Signaux „q.u.ti Afe»
trouvent en réms de guerre dans tous les polios de gardes-
côtes, Guetteur établi fur la montagne du Grinez. Guetteur
de la tour de Dunkerque. Les capitaines des gardes - côtes
doivent connoître tous les fondages de l’étendue de la côte
qu ils ont k garder. Cette connoiffiince efl plus difficile k
prendre fur les côtes de l'océan, que fur celtes de la médi-
terranée, k caufe des inégalités des marées. Batteries 6c
redoutes d'efpace en cfpace fur le bord de la mer. Ibid. 486. a.
Kéflexions fur le fervice des gardes-côtes. Ibid. b. Foyer
C a p i t a i n e r i e , ' 1
G a rd e s - c ô te s , ( Marine") vaifTeauxou frégates qui croi-
fenr le long de no# côtes pour la fureté du commerce. VII.
486. b.
Garde-côtes, Capitaineries garde-côtes, c’c fl un nombre de
^ l « f u j e t s à la garde d'une certaine étendue de côtes, d>c.
V il, 486, b. Voye^ C a p i t a i n e r i e ,
G au d e -d e -p eu xt 1 M a n n e ) calife# de bols oh l’on met
les gargouffes, VII, 486, b.
» a n u i-m a g a s in , ( Marine) forte de commis établi fur
nn port, V IL 486. b.
d! % WÏÉm i*un« gentiUhomme* deilinés à amrcn-
■m le fervice de b marine. Pore oii Ils font diftribué». Maître»
«kes VU p f ¡f “ r lnftr4,âior>- Iktlir fervice 8c leur, e*er-
’ i*®“ 1* * , ( Marin,. ) VU, 487. a .
ee mot.» i . ) D lv.rft» lignifications 8c acception» de
VU, 487. a. ‘
l’orlelnc c l i i l | i f e r f i i 8uclqite»nn» prétendent en trouver
drolîd'ufufrÔH“le’& ' i l ' 5' i B l l f e la Bardc & lo
de famille étant en { I S I p l ais,d ® *«» l)l0" ‘ du *1«
« l'adminlflratlon tpte '» '"8 “™"' !» 8»rde
en miplllarifé, lorfque I. Mrt oî. St. ,'c‘lc, l6il/ f1,Jî iaJÎ f ,anI
tic 1. garde fefon Pontnnii». H q S S é i S f ,d|^ .d. f ,v S Î # " e
de» dot», & j•u léllé f ,„ établie ye»n |»»vSelu oeS» vaSflaux " m" tin ve,ucrnst.
G A R
C e qu’on entendoit par garde ro va l. i a
487- -*• & garde-noble. Article d u ^ l T a I Ï T ^ [ c^ rt-
I on trouve ia première fouree de i i I ^ Saxons on
droit de garde fut établi en France 7 ' fl] M lents le
dévolue au roi pour le» fiefs mouvant i v f i é,oi<
qui appartenoient b de» mineur» de lu i,
le» droit» de la garde royale, 6c ceux d^'f0 , “»oit entre
f)an» quelques endroit», les feigneur» u L m f ,eii " curlalc.
dcfTervir ces fief*. W p a ÿ e n s furent^tityéiïli,fs '',il’vaf eÔd do
■ Ü l *............. ; Dans 6,1 cc ca* ém/»
la garde du bail, k ii l i b. Les ancienne» * diflingue..
pris fous le terme de bail l’adminiftration des afeend ü CT
bien que celle des collatéraux, Excmide* a i ic ïn i m? .**'14i aufli"
du rot Jean pendant 1a captivité de cc roi Ancien». i
e“Ju igaïroZe. iklual. l48Ÿ0. a'.T La dgacr‘ di e' i nr ié: :tio«ict' p «o?in*dt »ciown uq udiM t o* »u>« I L 1
f »''»■'»8». différence entre le.
terme, de gerd, 8c i b M , de (w, „ r , „ m m S S | I I
rio/i. En Bretagne, les etifans tomboient aufit eu la gardo du
mmtVle Bl"?S ¡Vf""'Qu'16(1 k A cotn- muji 8c le plu» général par rapport i la garde qui a lieu pour
f e j èT/bÉ r ct pareo'' nivcrf"maximc‘ «¡fel
Garde d'enfant mineurst r elie f de. XIV, 66. b.
Garde bourgeoife. celle qui cft déférée par la coutume
aux pere 6c mere bourgeois 6c non nobles. Ancienneté da
1 ufage de la garde bourgeoife dans Paris, Lettres de Charles
v .q u t confirment cet ufage. Maximes de jurifprudencc pu-
tiquées fur la garde bourgeoife. V IL 489. b.
Gardi'coutumiere. VII, 489. b.
Garde-noble . f u t fon origine, veyrç ci-deffiis, garde des entons
mineurs. Emolument de cette garde. De l'Age auciud finit
la garde-noble. VII, 480, b.
Garde-noble , fou origine. VII. 60%, b.
Garde royalet en Normandie. En quoi elle confifle. Son
origine 6c fon ancienneté. Il y a lieu de croire qu’elle fut
ducale avant d'étre royale. Erreur de Terrien fur ce fujer.
It it’v a en Normandie que deux forte» de garde# , la
royale & la fcigueuriale. Privilèges de rime 6c de l'autre.
V IL 490. a. Les apanngifles ni Tes engagiftes du domaine
n ’ont point la garde royale. Le roi ne tire aucun bénéfice
de la garde-noble royale. Du teins oh la garde royale commence
& finit. Charges de la garde royale. Le donata’uo
de cette garde efl feulement exempt des intérêts pupillaires,
La remife de la garde faite à la mere ou au tuteur efl réputée
faite au mineur, au profit duquel ils font obligés de tenir
compte des intérêts pupillaires. Eu concurrence de pluficurs
donataires, quel efl celui qui efl préféré. Auteurs k confulter.
Ibid. b.
Garde ftigneuriale, en Normandie. Origine de c e droit.
L e feigneur qui a la garde fait les fruits tiens. Devoirs de
ce feigneur. II lui efl libre de renoncer dans la fuite à la
garde. VII. 490. b. On donne un tuteur au mineur pour les
biens qui n'entrent pas dans la garde. Suite des devoirs du
celui qui a la garde feigneurialc. Quels font les devoirs des
feigneurs entre lefquels ferait partagée ia garde feigneii*
riale. A qui appartient la garde de ceux qui tiennent quelque
fief-noble du mineur, lorfqu'ils tombent en garde durant
fa minorité. Age auquel finit la garde feigneuriale.
Circonflances urcomtanccf dans leiquclles lefquelles une rem femme me retourne retombe en garde.guruv.
Celui Celui oui qui fort da de <garde rar<la ne n a doit noinr point da de raiicf relief ail fciftllCUr feigneur i
:
&ire.C.(
dre. Auteurs à confulter. Ibiu. 491. a.
G a r d e ( droit d e ) . Il efl fou vent nommé avec le droit
de guet. En quoi il confiflolt, Comment cc droit s établir,
6c comment il s'acquittoit. VII. 491. a. .
G a r d e , ( denier de ) en quoi confifle ce droit. Ou n en eu
parlé. V II, 491. b.
Garde des églifes, proteélion que le roi ou un Jeigiiciir
accorde k certaines églifes. Confirmation faite p«r S* Louis
de toute# les prérogative# accordées aux lieux taints. 1 rq-
rcltion accordée par Philippc-lc-bcl k c e t lieux fit aux ecclc-
fiafliques. Il étolt défendu aux gardiens d'églnes de mettre
des pannonccaux fur les bien# des églifes, dre. Déclaraiioi
de Philippe V I dit de Valois 4 touchant les garde# «
églifes. VIL 491. b. Lettres du même prince de Od9*
le furet dont il s’agit ici. Déclaration du roi Jean, en 3 î •
Le rcmyorcl de F eb k y e de Lsgny.Inlli * ’; / # , ' „ i . , y ,
arrérages de la garde due nu roi. Lettres «0 r ' „„..i--
en i l Réferves que fit Charles VI. de ,
en donnant h fes fils diverfes principauté#* Je • d )
S Æ t J U Z m . de B o u r b o n m , Comume»
h confulter, VII. 491, a.
G A R
Garde-gardienne, lettres accordées par le roi k. diverfes
Communautés, par laquelle il déclare qu’il prend en fi» garde
ceux auxquels il les accorde. Juges qu'il leur affigne. Prérogative
ue ceux qui ont droit de gardé gardienne. Ancienneté
de l’ufage des gardes-gardiennes. Origine de i’expreffion
de garde-gardienne. VII. A92. a. Edit par lequel les privilège
« de garde-gardienne furent confirmés. Confirmation de
cet édit. Difpofitioni de l’ordonnance de 1660 relatives à cc
fujer. Ibid, b.
('jrdfgardienne y origine de ce droit. IX. 92. a t b. Lettres
de garde-gardienne. 423. b.
Garde-lige, VII. 492. b.
Garde ou proteflion de# feigneurs fur les villes 6c habitans
de la campagne qui te mettoientfôusleur garde. Origine de cet
ufage. Ce qui en cA dit dans les lettres «lu roi Jean, 13 54, Ôc
dans celles de Charles V , 1366. VII. 492. b.
Garde ou proteflion, garde feigneuriale. I, 710. a, XVII.
79f . b.
Garde des ablies ou grains pendans par les racines ¿étabiifie-
meiu de ces gardes en 1369. V IL 49 t. a.
Garde des décrets dr immatricules dr t/a eflt'd u chétclet. Fonctions
de cet officier. V II. 493. a.
Garde des droits royaux, du fouveraineté, de refiort 8c des
exemptions dans la ville de Limoges. V i l . 493. a.
‘ Gardes ou maîtres des fo ire s , ou des privilèges des fo ire s .V II.
493-a-
Gardes ou greffiers des prifons. VII. 493, a.
Garde ou juge-garde des monnoies. V il, 493. a.
Garde de jullice , juge confidéré, comme n’ayant la juflice
qu'en dépôt « e n garde. VII. 493. «t. Autrefois ondonnoit en
garde une prévôté ou autre juflice, lcsfceaux ou un greffe.
Ibid. b.
G a r d e , (Juflice en ) IX. 93. a.
Gardes-maneurs. v u . 491. e.
Gardes des marchands dr de certains arts dr métiers. Il cil parlé
des gardes & jurés dans de# ordonnances fort anciennes.
Vifires auxquelles ils font obligés. V i l . 493. a, Voyeç
J v r û .
Gardes des eaux & forê ts , voyez Sergens fortfliers , Se r gens
à garde, Sergens gardc-piche, Sergens louveticrs, Sergens mat-
t>ft, Sergens routiers, X V . 90, a , b. 91. a , b. Sergent dangereux.
8'j. b, 92. b.
(-..nde-marteau dans chaque maitrife des eanx 6c forêts. Ses
fonélions. V IL 403. é.
Garde-note. v i l . 492.b.
G a r d e - n o t e s , f Notaires ) XI. 244. «.
Gardes des ports v paffages. V IL 493. b.
Garde des rôles des offices de France ,* officier de la grande
chancellerie. Comment les rôles étoient gardés avant que
cette fonélion fût mjfe en titre d’office. Création par Louis
XIII de quatre cardes des rôles des offices de France. Fonctions
qui leur turent attribuées. Gages que leur attribuoit
l'édit de création, & qui ne fiibfiflcnt plus. Leurs honneurs
Ôc privilèges. Leur place en la grande chnncelleiic ; leurs
fonélions. v i l . 494. a. Pouvoir accordé par Louis XIII aux
chanceliers 6c gardes des fceaux de France de nommer ü
ces offices. Louis XIV ajouta & ce pouvoir celui d’accorder
le droit de furvivancc à ceux qui en i croient pourvus, dre.
Nouvelles fonélions attribuées aux gardes des tôles par le
même prince. Entrée dans les confeils du roi, qui leur fut
accordée. Ce font ces officiers qui reçoivent les oppofitions
que l'on forme au fceau ou au titre des offices. Lcttrcs-pa-
tente# du roi portant que les gardes des rôles auront le tiers
du droit de regiflre de toute# les lettres de charte qui fc-
r«lient iceilées eu la grande chancellerie de France : règlement
du 24 avril 1672. Ibid. b. Titres, fondions 6c privilèges
de confeillcri ôc fecrétaircs du roi que Louis X 1IL attribua
en 1Ô39 at>x g<wdcs des rôles. Création de quatre commis
attachés aux quatre charges de garde des rôles : leurs
fonéiious. Comment les gardes des rôles font exercer les charges
de commis. Edit de Louis X IV du mois de mai 16< 3 , touchant
les gardes des rôles, celui de 1697. Edit» Ôc déclarations
par lefquds ces officiers ont été maintenus dans leurs privilèges.
////«/, 493.4.
Garde des archives. III. 220. a , b. Garde du tréfor des chartes.
XVI. 398. a.
Garde des livres, en la chambre des comptes. III. 791. a.
Gardes des rcglflrcs du contrôle général des finances. IV.
' Garde-facs, greffier garde*facs. L’établificment de ces officiers
remonte au teins des Romains. VII. 493. b.
GARDE des fceaux de France, ( Hifl. dr furifpr, ) fondions
de cet officier. Divers exemples tirés de l’hiftoire ancienne
qui montrent que la garde de l’anneau du roi était mie
fonélion des plus importantes. Les Romains ne connoiffoient
point anciennement Village des fceaux publics. Encre particulière
qui tendit: lieu de fceau chez les Romains. VU. 49«.
b. /iiflinien ordonna feulement que tous les referirs lignés
de l’empereur feroient auffi contrc-fignés par fon quefteur.
G A R 8it
d“ ^ commencement de I . monarclilc, les ro i,.
W l t ó f e K le. falfoiem fe lU r dpTeur
fceau; Le diuoliuirc du fceau du roi ítoli apnelii , w y M -
m d a rn . Que efl le premier | u j a été défîgtÎS.comme cli.reé
du fceau royal, Enumérauon de tiuclqucf-un, des riftrén-
îh ïU l iÉ l S É Pfom 'c ç w c tic 1101 roi» , lequel» Broient
charges co même tema du feel ou antteau royal, ¡bid. 406. a.
S M g a i f f lM f cliancelicr» qui, fou» la féconde race,
fuecidcrent aux grand» référendaire». Sous 1, trolficine race,
la garde des fceaux a auffi le p|u» fouvent été joimc à l'office
de eliancclicr. Cependant on ne parlera Ici que de ceux nui
fans être pourvu» de l’office de chancelier, ont tenu les
fceaux avec le titre de garde de» fceaux ou quelque autre
équipollcm. Depuis la troifieme rq c c , il y a eu plu» de qna-
rante gardes de» fceaux, 6/c. On fera auffi mention de»
vicc-chancchcri, attendu qq’ils ont fait la fonction de garde
des fceaux. Les rois des deux.premieres races n’avoicnt-qu’im
fceau. Comment le garde du fccl royal le portoit. C e t offi*
mer a louiour» fur lui les clés du fceau dan» une bourfe.
Comment le coffre oh le fceau étoit renfermé, étoitporté autrefois
dans les cérémonies. Ibid. b. Quand le chancelier alloit
en voyage, le climffe-cire portoit Te fccl royal fur fon do».
Defcripuon du coffre que le roi donne aujourd'hui pour reiii
fermer, les fceaux. Lorfque le garde des fceaux marché par
la ville ou va en v o y a g e , il fait porter avec lui le coffre»
Le nombre des fceaux du roi multiplié vers lecommcnce-
ment de la troifieme race. Premier exemple des grands
fceaux. Le fccl fabriqué du tems de Philippe I , fut nommé
le grand fccl. Ibid. 497. a. Quand la chancellerie étoit vacante
, les rois faifoient fcelTcr en leur prcfcncc, Vadanccs
arrivées dans, le douzième fiecle, & dans le treizième. Comment
la fon&on de garde des fceaux étoit alors remplie.
Hiftqirc abrégée des gardes des fceaux qui fc font fuccédés
depuis Hugues de Chamflcuri, nommé chancelier de Franco
en 1 1 3 1 , mfqu’i M. de Machault, nommé garde des fceaux
en 1730. Ibid, b. ADpointemen# du garde du fccl royal en
1290. Ib/d. 498, a. Quel efl le premier qui a joint au titre
de chancelier celui de garde de fceau royal. Comment étoit
ferviè la taille de Guillaume de Nogarct. garde des fceaux
en n o 7. L’état de'1a maifon du roi arrêté le 2 décembre
1300 règle les droits du chancelier, & l’inflar de ce qui avoir
été accordé à Guillaume de Nogarct, garde des fceaux. U
Asmbloit même que le chancelier ne tirât fes privilèges que
de (a garde du fceau. Deux gardes des fceaux au mois de
juillet 1320. Règlement de Philippe-le-long fur le port Ôc
état du grand. Ceci ôc fur la recette des émolumens d’icclui»
Suite de l’hifloire des gardes des fceaux. Ibid. b. ôc fuiv.
Formalités qu’obfcrvoit Henri IV en faifant fcoller, lorf-
qu’il tint lui-méme le fceau ou le fit tenir par fon confciL
Ibid, b. Ôc fuiv. D e la forme du forment des chanceliers 6c gardes
fceaux de France. Serment prêté par le chancelier du
Prat, entre le# mains du roi , le 7 janvier 1314. Forme
particulière du ferment pour la charge ôc commiffion de
garde des fceaux. Ibid. <04. a. Ce ; officier prête ferment
entre les mains du roi. Il a le titre de chevalier. Enregifirc-
ment de fes provifions. Son habiflomcnr. Son fiege aux Te
Deum. Scs armes. Son accompagnement lorfqu’il va par la
ville ou en voyage. Rang dans lequel il fiege au confeti. Dé*
tail de fes différentes fondions. Ouvrages à confulter fur
cette matière. Ibid. b.
Garde des fceaux des apanages , ou garde des fceaux des
fils d> petits-fils puînés de France, dr premier prince du fang pour
leur apanage. Cette fonâion a été quelquefois féparcc de celle
de chancelier de l'apanage. Titre que prennent pes officiers.
L'inflitution des chanceliers des princes de la maifon de
France efl prefque auffi ancienne que la monarchie. Nom
fous lequel on les défignoir. Sous fa première race, 6c pendant
une partie de la fécondé, chaque fils du roi avoir fon
gardc'fccl. Gardes des fceaux des puînés ôc de« apariaglfics.
Garde des fceaux du dauphin. VIL 303. a. Préfemcinem le
dauphin n’ayant point d'apanage, n’a point de chancelier ni
de garde des fceaux. Quels font les fculs princes en France 3ni aient de tels officiers. On a des exemples afiez anciens
ans la maifons d'Orléans, nui montrent que ce prince a quelquefois
féparé la gafde de ton fccl, de l'office de chancelier:
amfi, ce qui s'eft pratiqué dans cette maifon k cet égard, a
pu fe pratiquer de même dans les différentes, maifons des
princes apanngifles. Les chanceliers ôc gardes des fceaux de#
apanages font des officiers publics, créés par le roi. Quels
font les autres officiers inférieurs. Ibid. b. La première-créa*
tion du chancelier garde des fceaux cil ordinairement faire
par le même édit qui établit l’apanage , ou par un édit donné
dans le méine tems. Il cil d’ufnge que quand l'apanage paffo
d'unprince if un autre par fuccemon , le roi crée ue nouveaux
officiers pour cet apanage ; cependant on ne peut regarder
les officiers des apanages comme officiers royaux ; le roi crée
l'office ; mais ce n'efl pas lui qui y pourvoir» Exceptions it
cette règle fous le règne de Louis Xu l. Chanceliers de Gaf-
ton , frere du roi Louis X ll. Lorfqu'il y eut des imitations