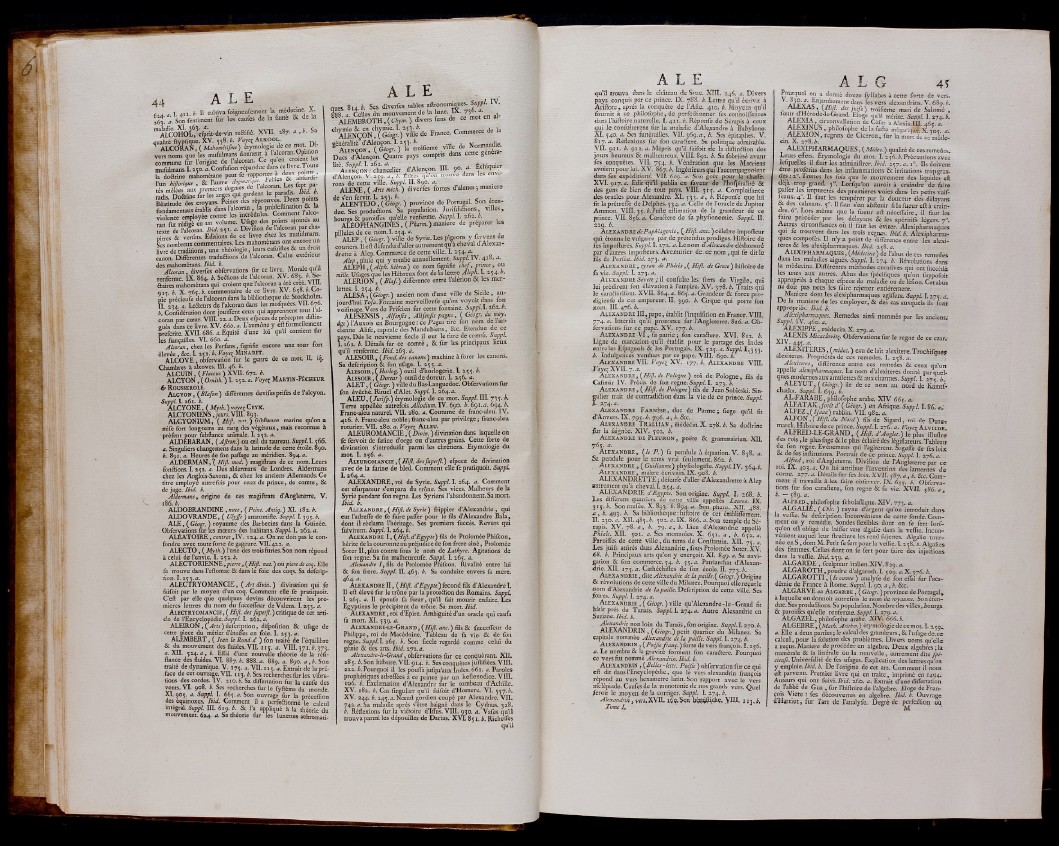
44 A L E
m A L C Ó H Ó Í% fo r i t -d e -v in reâifiè. XVH. 187. n .b . Sa
qualité ftyptique. XV. 558. b. Voyi{ A l.K O O L .
H ALCORAN, ' ' " | E | 1------ 1" ”” A
,C.A T •S W >v.r -------- --------- n .
, ( Mahométifme ) étymologie de ce mot. Ui-
: les mufulmans donnent à l’alcoran. Opinion
r i é S l H « Ce qu'en ^croient les
muMmans. I.ato. Iconfidion répandue dans | S | f § f
la do&ine mahométane peut P P » j 5 J 5 3 g ! B
Béttimdf d« croyans^eines ¿ 1 réprouvés. Deux points
« u fû rédTgé en un volume. Ufage des points ajoutes au
tmcte de l’alcoran. M Ê É & l D '"’ifion I e 1 alcoran | S ch“‘
oitres & verfets. Editions de ce livre chez les mufulmans.
Ses nombreux commentaires. Les mahométans ont encore un
livre de traditions, une théologie, leurs cafuiftes & un droit
canon. Différentes traductions de l’alcoran. Culte extérieur
des mahométans. Ibid. b. ■ _x • .
Alcoran, diverfes obfcrvations fur ce livre. Morale qu il
renferme. IX. 864. b. Seftions de l’alcoran. X V .6 8 3 .L S e -
aaires mahométans qui croient que 1 alcoran a été créé. V n i.
01 <. b. X. 763. b. commentaire de ce livre. XV. ô^.b.^o-
pie précieufe de l’alcoran dans la bibliothèque de StocWiolm.
fi. 234. a. Lefteurs de l’alcoran dans les mofquées. VII. 676.
L Confidération dont jouiffent ceux qui apprennent tout: 1alcoran
par coeur. VIII. 22. a. Deux efpeces de préceptes diffan-
eués dLis ce Üvre. XV. 660. a. L’aumône y eft formellement
preferite. XVIL 686. a. Equité d’une loi qu’il contient lur
les fiançailles. VI. 660. a.
Alcoran, chez les Perfans, fignifie encore une tour fort
élevée, &c. I. 251.' ¿. Voyt{ M in a r e t . _ ...
A LCO V E , obfervation fur le genre de ce mot. II. uj.
Chambres à alcôves. HL 46. b.
ALCUIN, ( Flaccus ) XVII. 67a. b.
A LC YO N, ( Omïih. ) I. 25a. a. Voyc1 M a r t in - P ê c h e u r
. 6» R o u s s e r o le .
A l c y o n , ( Blafon) différentes devifespnfes de 1 alcyon.
Suppl. I. 261. b.
ALCYONE, ( Myth. ) voyji C e y x .
ALCYONIENS,jours.VÛI. 893.
ALCYONIUM, ( Hiß. nat.) fubftance marine quon s
mife fort long-tems au rang des végétaux, mais reconnue «
préfent pour fubftance animale. I. 252. a.
ALDEBARAN, ( Aflron.) ou oeil du taureau. SuppLl. «66.
a. Singuliers changemens dans la latitude de cette étoile. 890.
b. 891. a. Heures de fon paffage au méridien. 894.a.
ALDERMAN,*( Hiß. mod. ) magiftrats de ce nom. Leurs
fonctions. I. 252. a. Des aldermans de Londres. Aldermans
chez les Anglois-Saxons, 8c chez les anciens Allemands. Ce
titre employé autrefois pour ceux de prince, de comte, &
de juge. Ibid. b.
Aldermans, origine de ces magiftrats d’Angleterre. V.
186. 9
ALDOBRANDINE, noce, ( Peint. Antiq.) XI. 182. b.
ALDOVRANDE, ( Ulyffe ) anatomifte. Suppl. 1. 395. b.
A LE , (Géogr. ) royaume des Barbecins dans la Guinée.
Obfervations lur les moeurs; des habitans. Suppl. I. 262. a.
ALÉATOIRE, contrat , 1V. 124. a. On ne doit pas le con*
fondre avec toute forte de gageure. VII. 422. a.
ALECTO, ( Myth.) l’une des trois furies. Son nom répond
à celui de l’envie. I. 252 .b.
ALECTORIENNE, pierre , (Hiß. nat.) ou piere de coq. Elle
fe trouve dans l'eftomac & dans le foie aes coqs. Sa defeription.
1 .233. a.
ALECTRYOMANCIE, (Art divin.) divination qui fe
faifoit par le moyen d’un coq. Comment elle fe pratiquoit.
C’eft par elle aue quelques devins découvrirent les premières
lettres au nom au fucceffeur de Valens. 1. 253. a.
ALECTRYOMANCIE, ( Hiß. des fuperft.) critique de cet article
de l’Encyclopédie. Suppl. L 262. a.
ALE1RON, ( Arts ) defeription, difpofition & ufage de
cette piece du métier d’étoffes en foie. I. 2 " -
ALEMBERT, ( Jean le Rond d‘ ) fon trait! de l’équilibre
îc du mouvement des fluides. VIL 11c. a. VÏÏI. 371^.373.
a. XII. 524.4, b. Effai d’une nouvelle théorie de la réuftance
des fluides. VI. 887. b. 888. a. 889. a. 890. a , b. Son
traité de dynamique. V. 175. 4. VII. 115.,,. Extrait de la préface
de cet ouvrage. VIL 113. b. Ses recherches fur les vibrations
des cordes. IV. 210. b. Sa differtation fur la caufe des
vents. VI. 908. b. Ses recherches fur le fyftême du monde.
XL 905. 4. Suppl. I. 665.4. Son ouvrage fur la préceffion
des équinoxes. Ibtd. Comment il a perfectionné le calcul
intégral Suppl. III. 619. b. & l’a appliqué à la théorie du
mouvement 624. a. Sa théorie fur les lunettes achromati-
EÄAÄLEiriS,”. ALEMBROTH, ( Chjm. ) divers fens de ce mot en al
' b & ç Ô N Â Â France. Commerce de la
gèS t o dNA1( la' troifieme ville de Normande.
Ducs d’Alençon. Quatre pays compris dans cette g n
tENçoN ’ cfoincelier d’Alençon. IH.
d’Alençon. V .a jo . a , S. ÉtiîSs qu’on trouve dans les envi
rons de cette ville. Suppl. IL 890. u.
ALENE, ( Arts mich. ) diverfes fortes dalenes; manière
de s’en fervir. I. aç j. b. ,
A L E N T E J O , ( Géogr. ) province de Portugal, bon étendue.
Ses produSions. Sa population. Jurifdlölons, vides,
bourgs & pareilles qu’eUe renferme. Suppl. L 16i . b.
AliOPHANGINES ,{Pharm.) maniéré de préparer les
pillules de ce noht.1.154. u.
ALEP, ( Géogr. ) ville de Syrie.Les pigeons y fervent de
couriers. Il eft défendu d’aller autrement quTà cheval d Alexan-
drette à Alep. Commerce de cette ville. I. 254. 4.
Alep, pluie qui y tombe annuellement. Suppl. IV. 410. a.
ALEPHAAlph. hébreu) ce nom fignifie chef, prince, ou
mille. Ufages que les Hébreux font de la lettre Aleph. I. 254. b.
ALERlON, (Piaf.) différence entre l’alérion & les mer-
lettes. I. 254. b.
ALESA, (Géogr. ) ancien nom d’une ville de Sicile , aujourd’hui
Tofa. Fontaine mierveilleufe qu’on voyoit dans fon
voifinage. Vers de Prifcien fur cette fontaine. Suppl. 1. 262. b.
ALESENSIS , Alfenfts , Alifenfis pagus, ( Géogr. du moy.
âge ) l’Auxois en Bourgogne : ce Pagus tire fon nom de 1 ancienne
Alife, capitale des Mandubiens, &c. Etendue de ce
pays. Dès le neuvième fiecle il eut le titre de comté. Suppl.
1.262. b. Détails fur ce comté , & fur les principaux lieux
qu’il renferme. Ibid. 263. a.
ALESOIR, (Fond, des canons) machine à forer les canons.
Sa defeription 8c fon ufage. I. 255. a.
A l e s o ir , ( Horlog.) outil d’horlogerie. L 255. L
A l e s o ir , (Doreur ) outil de doreur. I. 256. -a.
AT.F.T | ( Géogr. ) ville du Bas-Languedoc. Obfervations fur
fon évêché. Rituel d’Alet. Suppl. I. 264. a.
ALEU, ( Jurifp.) étymologie de ce mot. Suppl. IH. 73 5. L
Terre appellée autrefois AUodium. IV. 690. b. 691.4. 694. b.
Franc-aleu naturel. VII. 280. a. Coutume de franc-aleu. IV*
416. b. Franc-aleu noble; franc-aleu par privilège; franc-aleu
roturier. VII. 280'. a. Voye[ A l l e u .
ALEUROMANCIE, ( Divin. ) divination dans laquelle on
fe fervoit de farine d’orge ou d’autres grains. Cette forte de
divination s’introduifit parmi les chrétiens. Etymologie du
mot. I. 256. 4.
A l e u r o m a n c i e , (Hifii des fuperfi.) efpece de divination
avec de la farine de bled. Comment elle fe pratiquoit. SuppL
L 264.4.
ALEXANDRE, roi de Syrie. Suvpl. I. 264. a. Comment
cet ufurpateur s’empara du trône. Ses vices. Malheurs de la
Syrie pendant fon regne. Les Syriens l’abandonnent. Sa mort.
Ibid. b.
A l e x a n d r e , ( Hift. de Syrie ) frippier d’Alexandrie, qui
eut l’adreffe de fe faire paffer pour le fils d’Alexandre Bala,
dont il réclama l’héritage. Ses premiers fuccès. Revers qui
fuivirent. Suppl. 1. 264. b.
A l e x a n d r e I , (Hift. d’Egypte) fils de Ptolomée Phifcon,
hérite de la couronne au préjudice de fon frere aîné, Ptolomée
Soter II,plus connu fous le nom de Lathyre. Agitations de
fon regne. Sa fin malheureufe. Suppl. I. 265. a.
Alexandre /,fils de Ptolomée Phifcon. Rivalité entre lui
& fon frere. Suppl. H. 463. b. Sa conduite envers fa mere.
4^4- n.
A l e x a n d r e I I , ( Hift. d’Egypte,) fécond fils d’Alexandre I.
Il eft élevé fur le trône par la protection des Romains. SuppL
I. 265. 4. Il époufe fa foeur, qu’il fait mourir enfuite. Les
Egyptiens le précipitent du trône. Sa mort. Ibid.
A l e x a n d r e , roi d’Epire. Ambiguité d’un oracle qui caufa
fa mort. XI. 539. 4.
A l e x a n d r e -l e -G r a n d , (Hift. anc.) fils 8c fucceffeur de
Philippe, roi de Macédoine. Tableau de fa vie» 8c de fon
regne. Suppl.l. 265. b. Son fiecle regardé comme celui du
génie 8c des arts. Ibid. 272.4.
Alexandre-le-Grand, obfervations fur ce conquérant. XII.
285. b. Son hiftoire. VII. 914. b. Ses conquêtes juftifiées. VIII.
222. ¿.Pourquoi il les poufla jufqu’aux Indes. 661. a. Paroles
prophétiques adreffées a ce prince par un hellenodice. VIII.
106. b. Exclamation d’Alexandre lur le tombeau d’Achille.
XV. 182. b. Cas fingutier qu’il faifoit d’Homere. VI. 5.57. L
XV. 244. b. 245.4. Noeud gordien coupé par Alexandre. VII.
742.4. Sa maladie après s’être baigné dans le Cydnus. 328.
b. Réflexions fur la viftoire diffus. VIII. 930. 4. Vafes qu’il
trouva parmi les dépouilles de Darius. XVl. 851. b. Riclielfes
qu’il
ALE qu’il trouva dans le château de Suze. XIII. 246. a. Divers
pays conquis par ce prince. IX. 788. b. Lettre qu’il écrivit à
Ariftote, après la conquête de l’Afie. 410. b. Moyens qu’il
fournit à ce philofophe, de perfectionner fos connoiftances
dans l’hiftoire naturelle. I. 411. b. Réponfo de Sérapis à ceux
qui le confultercnt fur la maladie d’Alexandre à Babylone.
Xi. 540. 4. Ses funérailles. VU. 369.4, b. Ses épitaphes. V.
817. 4. Réflexions fur fon cara&ere. Sa politique admirable.
VII. 911. b. 912.4. Mépris qu’il faifoit ae la diftinCtion des
jours heureux 8c malheureux. VIII. 89a. b. Sa fobriété avant
les conquêtes. VII. 754. b. Vénération que les Macriens
avoientpour lui. XV. 867. b. Ingénieurs qui l’accompagnoienr
dans fos expéditions*. VII. 609. a. Son goût pour, la challe.
XVI. 917.4. Edit qu’il publia en faveur de l’hôfpitalité 8c
des gens de bien de tout pays. VUI. 315. 4. Complaifance
des oracles pour Alexandre. XI. 533. 4 , b. Réponfo que lui
fit la prêtreflê de Delphes. 534 .a. Celle de l’oracle de Jupiter
Ammon. VIII. 35. ¿. Jufte euimation de la grandeur de ce
prince. VII. 856.4. Caraftere de fa phyfionomie. Suppl. II.
¿129. b. ,
A l e x a n d r e de Paphlagonie, (Hift. anc.) célebre impofteur
qui étonna le vulgaire par de prétendus prodiges. Hiftoire de
les \mpoftmzs. Suppl. 1. 272. a. Le nom $ Alexandre déshonoré
par d’autres impolteurs. Aventurier de. ce nom, qui fe dit le
fils de Perfée. Ibid. 273. 4¿
A l e x a n d r e , tyran de Phérès, ( Hift. de Grece ) hiftoire de
fa vie. Suppl. I. 273.4.
A l e x a n d r e Sévere ; il confulte les forts de Virgile, qui
lui prédirent fon élévation à l’empire. XV. 378. b. Traits qui
le caraClérifont. XVII. 864. a. 865. a. Grandeur 8c force pro-
digieufo de cet empereur. II. 390. b. Cirque qui porte fon
nom. III. 476. b.
A l e x a n d r e III, pape, établit l’inquifition en France. VIII.
774 .4. Interdit qu’il prononce fur l’Angleterre. 816. a. Obfervations
fur ce pape. XV. 177. b.
A l e x a n d r e V I , fa patrie; fon caradere. XVI. 812. b.
Ligne de marcaiion qu’il établit pour le partage des Indes
entre les Efpagnols 8c les Portugais. IX. 325.4. Suppl.I.fîj'i.
b. Indulgences vendues par ce pape. VIÍI. 690. b.
A l e x a n d r e VII. Voye^ XV. 177. b. A l e x a n d r e VIII.
sVoye^ XV Ü. 7.4.
A l e x a n d r e , (Hift. de Pologne ) roi de Pologne, fils de
Cafimir IV. Précis ae fon regne. Suppl. I. 273. b.
A l e x a n d r e , ( Hift. de Pologne ) fils de Jean Sobieski. Singulier
trait de contradiction dans la vie de ce prince. Suppl.
I. 274.4.
A l e x a n d r e F a r n è s e , duc de Parme; fiege qu’il fit
d’Anvers. IX. 795. b. 796. a , b. 8cc.
A l e x a n d r e T r a l l i a n , médecin. X. 278. b. Sa doClrine
fur la faignée. XIV. 502. b.
A l e x a n d r e d e Pl e u r o n , poète 8c grammairien. XII.
765. 4.
A l e x a n d r e , (le P .) fa pendule à équation. V . 8ç8. 4.
Sa pendule pour le tems vrai feulement. 862. b.
A l e x a n d r e , ( Guillaume) phyfiologifte. Suppl. IV. 3 64. b.
A l e x a n d r e , maître écrivain. IX. 908. b.
ALEXANDRETTE; défenfo d’aller d’Alexandrette à Alep
autrement qu’à cheval.I. 254. a.
ALEXANDRIE d’Egypte. Son origine. Suppl. I. 268. b.
Les différens quartiers de cette yille appelles Laures. IX.
315. b. Son mufée. X. 803. ¿.804.4. Son phare. XII. 488.
a , b. 493. b. Sa bibliothèque : hiftoire de cet établiflement.
H. 230. 4. XII. 485^. 502.4. IX. 866. 4. Son temple de Sérapis.
XV. 78. 4 , b. 79. 4, b. Lieu d’Alexandrie appellé
Pkiale. XII. 501. 4. Ses monnoies. X. 651. 4 , b. 652. 4.
Paroiffes de cette v ille , du tems de Conftantin. XII. 75. 4.
Les juifs attirés dans Alexandrie , fous Ptolomée Soter. XV.
j68. b. Principaux arts qu’on y exerçoit. XL 849. a. Sa navigation
8c fon commerce. 54. b. 55.4. Patriarchat d’Alexandrie.
XII. 175.4. Cathéchiftes de fon. école. II. 773. ¿.
A l e x a n d r i e , Uto Alexandrie de la païlle.( Géogr.) Origine
8c révolutions de cette ville du Milanez. Pourquoi elle reçut le
«om d’Alexandrie de la paille. Defeription de cette ville. Ses
foires. Suppl. I. 274. a.
A l e x a n d r ie , ( Géogr. ) ville qu’Alexandre - le - Grand fit
bâtir près du Tanaïs. Suppl. I. 274. a. Autre Alexandrie en
Suziane. Ibid. b.
Alexandrie non loin du Tanaïs, fon origine. Suppl.1. 270. b.
ALEXANDRIN, (Géogr.) petit quartier du Milanez. Sa
capitale nommée Alexandrie de la paille. Suppl. I. 274. b.
A l e x a n d r in , (Poéfte franç.)(orte devers françois. 1. 256.
4. Le nombre 8c la gravité forment fon caraCtere. Pourquoi
ce vers fut nommé Alexandrin. Ibid. b.
A l e x a n d r in , (Belles-lettr. Poéfte ) obforvation fur ce qui
eft dit dans l’Encyclopédie, que le vers alexandrin françois
répond au vers hexametre latin. Son rapport avec le vers
afelépiade. Caufes de la monotonie de nos grands vers. Quel
feroit le moyen de la corriger. Suppl. I. 274. b.
Alexandrin, yCtt.XVII. IÔQ.SqiI h&JÙftche, YUI, u-i,b.
J'orne /» *
A L G 4ï
Pourquoi on a donné douze iyllabes à cette forte de vers.
’ i i r v i l'Hjambement dans les vers alexandrins. V. 689. b.
r ,,u , ’ V; Jl’ des juifs) troifieme mari de Salomé ,
ï rT w r T de‘ le‘Graiî?- El°Se É P "^¡te . Suppl. I. 274. 1
AT PYT^TTcirC0L.yaÿ atf0n Çéfa* à Alexia.HI. 465.4.
A L g m U S , ptalofophe d e là fe a c m è p r iq S x . jo j . ■£
AU iX iU N , regrets de Cicéron, for la mort de ce méde-
cin. X. 278. b.
ALEXIPHARMAQUES, ( ÀfcWic.).qualité de ces remedes.
Leurs effets. Etymologie du mot. I. 2.^6. b. Précautions avec
lefquelles il faut les adminiftrer. lbïd. 257. 4. i°. Ils doivent
être proforits dans les inflammations 8c irritations tropgran-
des :xu. Tontes les fois que le mouvement des liquides eft
trop grand. 30. Lorfqu’on auroit à craindre de faire
palier les impuretés des premières voies dans les petits vaii-
feaux. 40. Il faut les tempérer par la douceur des délayans
oc des caïmans. 50. Il faut s’en abftenir fi la fueur eft à craindre.
6 . Lors même que la fueur eft néceffaire, il faut les
taire précéder par les délayans 8c les apéritifs légers. 70.
Autres circonftances où il faut les éviter. Alexipharmaques
qui fe trouvent dans les trois régnés. Ibid. ¿, Alexipharmaques
compofés. Il n’y a point de différence entre les alexi-
teres oc les alexipharmaques. Ibid. 258. a. ,
A l e x i p h a r m a q u e s , (Médecine) de l’abus de ces remedes
dans les maladies aiguës. Suppl. I. 274. b. Révolutions dans
la medecine. Différentes méthodes curatives qui ont fuccédè
les unes aux autres. Abus des fpécifiques qu’on fuppofoit
appropriés à chaque efpece de maladie ou de léfion. Cet abus
ne doit pas nous les faire rejetter entièrement.
Maniéré dont les alexipharmaques agiffent. Suppl. 1. 275.4.
De la maniéré de les employer, 8c des cas auxquels ils font
appropriés. Ibid. b.
Alexipharmaques. Remedes ainfi nommés par les anciens«'
Suppl. IV. 460. 4.
ALEXIPPE, médecin. X. 279. a.
_ALEXIS Micaclovit^. Obfervations fur le regne de ce czarJ
XIV. 445. a.
ALEXlTERES, (mêdec.) eau de lait alexitere. Trochifquey
alexiteres. Propriétés de ces remedes. I. 258. 4.
Alexiteres, différence entre ces remedes & ceux qu’oit
appelle alexipharmaques. Le nom d’alexiteres donné par quelq
u e modernes aux amulettes 8c aux charmes. Suppl. I. 275. b.
A LE YU T , ( Géogr. ) île de ce nom au nord de Kamtf-
çhatka. Suppl. I. 639. b.
AL-FARABE, pnUofophe arabe. X IV 665. a.
ATAK-, forêt d’ (Géogr. ) en Afrique. Suppl. 1. 86. ai
ALFEZ, ( Ifaac) rabbin. V il. 982. a.
ALFO N, ( Hift. du Nord) fils de Sigard, roi de Dane-;
marck. Hiftoire de ce prince. Suppl. 1. 276. a. Vover A lv i i d f
ALFRED-LE-GRAND, (Hift. d’Angle t. ) le plus illuftre
des rois, le plus fage 8c le plus éclairé des légiflateurs. Tableau
« i° ! r re8ne* Evénemens qui l’agitcrent. Sagefle de fos loix
8c de fos inftitutions. Portrait de ce prince. Suppl. I. 276. a.
Alfred, roi d’Angleterre. Divifion de l’Angleterre par ce
roi. IX. 403.4. On lui attribue l’invention des lanternes de
corne. 277.4. Détails fur fos loix.XVII.e8y. a , b. &c. Comment
il travailla à les faire obferver. IX. 633. b. Obfervations
fur fon caraftere, fon regne 8c fa vie. XVII. 586. a ,
b. — 589. 4.
A l f r e d , plùlofophe fcholaftique.3 8V. 773.4.
ALGALIÉ, ( Chir. ) tuyau d’argent qu’on introduit dans
la vefiie. Sa defeription. Inconvéniens de cette fonde. Com-
îpent on y remédie. Sondes flexibles dont on fo fort Iorf-
qu’on eft obligé de laiffer une algalie dans. la veflie. Inconvénient
auquel leur ftruûure les rend fujettes. Algalie tournée
en S , dont M. Petit fe fort pour la velfie. 1. 258. b. Algalies
des femmes. Celles dont on fe fort pour faire des injedions
dans la veflie. Ibid. 259. 4.
ALG ARDE , fculpteur italien. XIV. 829. 4.
ALG ARO TH , poudre d’algaroth.I. 509. a, X. 376. b.
ALG AROTTI , (le comte ) analyfe de fon effai fur l’académie
de France à Rome. Suppl. 1. 90. 4, ¿. 8cc.
ALGARVE ou A l g a r b e , (Géogr. ) province de Portugal,
à laquelle ©n donnoit autrefois le nom de royaume. Son étendue.
Ses productions. Sa population. Nombre des villes, bourgs
8c paroiffes qu’elle renier me. Suppl. L 279. a.
ALGAZEL, philofophe arabe. XIV. 666. b.
ALGEBRE, (Math. Arithm.) étymologie de ce mot. 1. 259«
4. Elle a deux parties ; le calcul des grandeurs, 8c l’ufage de, ce
calcul, pour la folution des problèmes. Divers noms qu’elle
a reçus. Maniéré de procéder en algèbre. Deux algebres ; la
numérale 8c la littérale ou la nouvelle, autrement dite fpé-
cieufe. Univerfalité de fos ufages. Explication des lettres qu’on
y emploie. Ibid. b. De l’origine de cet art. Comment il nous
eft parvenu. Premier livre qui en traite, imprimé en 1494«
Auteurs qui ont fuivi. Ibid. 260. a. Extrait d’une differtation
de l’abbé de Gua , fur l’hiftoire de l’algebre. Eloge de François
Viete : fos découvertes en algèbre. Ibid. b. Ouvrage
d’Harriot, fur l’art de l’analyfe. Degré de perfection où
M