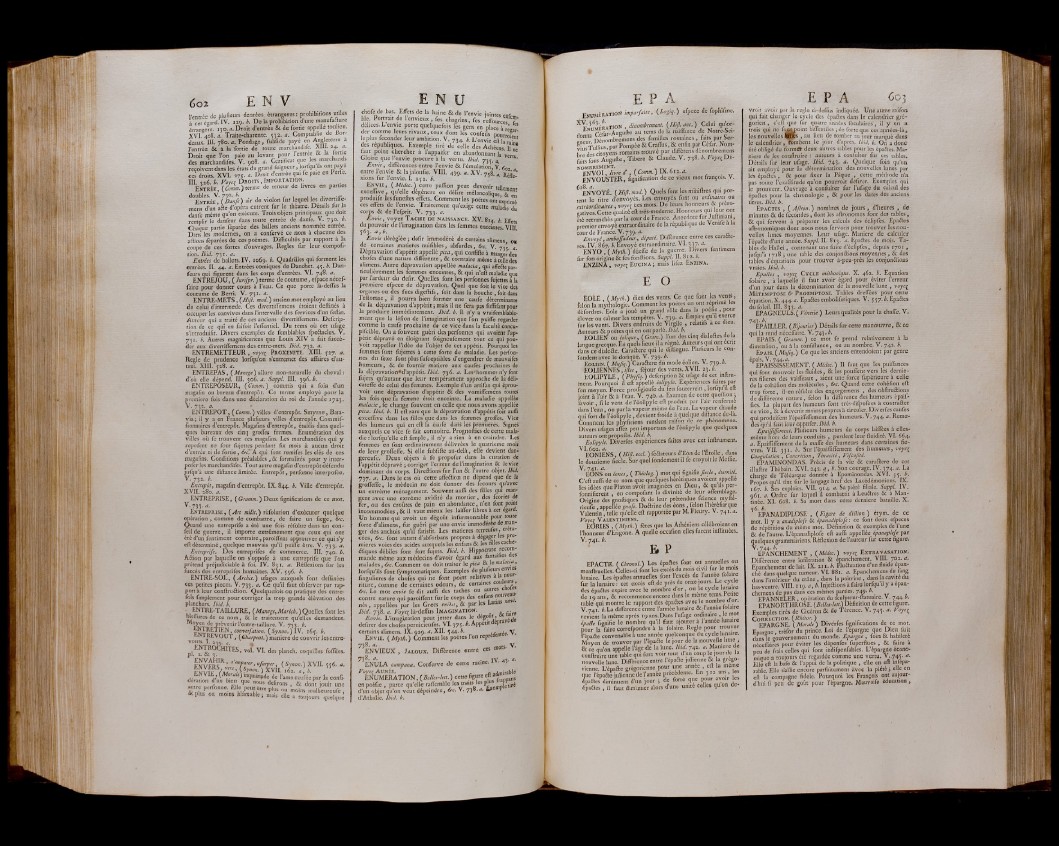
6o2 E N V E N U
l'entrée île plufieurs denrées étrangères: prohibitions utiles
à cet égard. IV. 119. b. De la prohibition d’une manufacture
étrangère. 130. a. Droit d’entrée 8c de fortie appellé tonlieu.
XVI. 408. a. Traite-charente. 331. a. Comptablie de Bordeaux.
III. 780.«. Pondage, fubfide payé en Angleterre à
l’entrée & à la fortie de toute marchandée. A l i x . 24. a.
Droit que l’on paie au levant pour 1 entrée oc a or 1
des marchandifes. V. 908. n. Certificat quelles, « «
reçoivent dans les états du grand feigneur, orfqu ils ontpayé
ces droits. XVI. « e . e. Droit d'entrée qui fc paie en Perle.
III. aa6. t. Vom D r o i t s , Im p o r t a t i o n .
Entrée, {¿mm.) terme de teneur de livres en parues
loanfi ) air de violon fur lequel les divertiffe-
mens d’un aÔe d’opéra entrent fur le théâtre. Détails fur la
danfc même qu’on exécute. Trois objets principaux que doit
remplir le danfeur dans toute entrée dç danfc. V. 730. b.
Chaque partie féparée des ballets anciens nommée entrée.
Dans les modernes, on a confervé ce nom à chacune des
a ¿lions féparées de ces poëmes. Difficultés par rapport à la
coupe de ces fortes d’ouvrages. Règles fur leur compofi-
tion. Ibid. 731. a.
Entrées de ballets. IV. 1069. % Quadrilles qui forment les
entrées. II. 44. a. Entrées comiques de Danchet. ¡ p b. Dan-
feurs qui figurent dans les corps d’entrées. VI. 748. a.
ENTREJOU, ( Jurifpr. ) terme de coutume, cfpacc nécef-
faire pour donner cours à l’eau. Ce que porte là-deffus la
coutume de Berri. V. 731. a.
ENTRE-METS, moi.') ancien mot employé au lieu
de celui d'intermede. Ces divcrtiiTemens étoient deAinés à
occuper les convives dans l’intervalle des fcrviccs d’un feilin.
Auteur qui a traité de ces anciens divertiflemens. Dcfcrip-
tion de ce qui en faifoit l’e/Tenticl. Du tems où cet ufage
s’introdiiifit. Divers exemples de fcmblables fpeétacles. V.
731. b. Autres magnificences que Louis XIV a fait fuccé-
der aux divcrtiiTemens des entre-mets. Ibid. 73 a. a.
ENTREMETTEUR, voyez P r o x e n e t e . XIII. 327. a.
Réglé de prudence lorfqu on s’entremet des affaires d’autrui.
XIII. <28. a.
ENTREPAS, {Manege) allure non-naturelle du cheval:
d'où elle dépend. III. 300. a. Suppl. III. 3 96. b.
ENTREPOSEUR, ( Comm. ) commis qui a foin d’un
ou bureau d’entrepôt. Ce terme employé pour la
première fois dans une déclaration du roi de l’année 1723.
ENTREPOT, (Comm.) villes d’entrepôt. Smyrne, Batavia;
il y a en France plufieurs villes ({’entrepôt. Commif-
fionnaircs d’entrepôt. Magafins d’entrepôt, établis dans quelques
bureaux des cinq greffes fermes. Enumération des
villes où fc trouvent ces magafins. Les marchandifes qui y
repofent ne fonr fujettes pendant fix mois à aucun droit
d'entrée ni de fortie, bcTÀ qui font remifes les clés de ces
magafins. Conditions préalables, & formalités pour y interpoler
les marchandifes. Tout autre magafin d’entrepôt défendu
jufqu’â une di/lancc limitée. Entrepôt, perfonne interpofée.
V. 732. b. ■
Entrepôt, magafm d’entrepôt. IX. 844. b. Ville d’entrepôt.
XVII. 280. a.
ENTREPRISE, ( Gramm. ) Deux lignifications de ce mot.
E n t r e p r i s e , {Art milit.) réfolution d’exécuter quelque
opération , comme de combattre, de faire un fiege, bc.
Quand une entreprife a été une fois réfolue dans un con-
feil de guerre, il importe extrêmement que ceux qui ont
été d’un, fentiment contraire, paroiffent approuver ce qui s’y
eA déterminé, quelque mauvais qu’il puiffe être. V. 733. a.
Entreprife. Des entreprifes de commerce. III. 740. b.
Aétion par laquelle on soppofe à une entreprife que l’on
prétend préjudiciable à foi. IV. 831. a. Réflexions fur les
fuccés des entreprifes humaines. XV. 396. b.
ENTRE-SOL, (Arc/iit. ) ufàgcs auxquels font deftinées
ces petites pièces. V .733. a- W& CIU’^ &ut obferver par rapport
à leur conAruâion. Quelquefois on pratique des entre-
fols Amplement pour corriger la trop grande élévation des
planchers. Ibid. b.
ENTRE-TAILLURE, ( Manège, Marich. ) Quelles font les
Mcffurcs de ce nom, & le traitement qu elles demandent,
prévenir l’cntre-taillure. V . 733. b.
ENTRP ’ converf atton- {Synon.) IV. 163. b.
vouts j VOUT, {Charpcnt.) manière de couvrir lescntrepl£
2N & 3 HÏtES»Vo1- tf| i dcs planch. coquilles foffilcs.
t t n n s . im ,. 1» u* m 'd "aqumictpl aSeé dTe 1r a me c■ a*u’f!é*e ’p ar l1a confiIdération
du., bien que dc„ rom & dJ S une
Mi.ru perfonne. Elle peut être plus „ „ ’moim malbcureufc,
8c plus on rao.ni blamablc; niais elle , (0„j„u„ quelquê
chofede bas. Effets de la haine 8c de l’envie ioimesmf
Me. Portrait de 1 envieux, fes chagrins, fus, rcflburccs T
dil,ces. L envie porte quelquefois les gens en place à . ’ “
der comme leurs rivaux,ceux dont les confeils noiîlp®
Icplus féconder leur ambition V 734. b. L’envie cA ]a S
des républiques. Exemple tiré de celle des Achéens TU
faut point chercher à l’appaifer en abandonnant la É S I
Gloire que 1 envie procure à la vertu. Ibid, 73 <,
Envie, différences entre l’envie 8c l’émulation V
entre l’envie 8c lajaloufie. VIII. 439. a. XV. 7<8. J É P I
xions fur l’envie, I. 252. b. cnc‘
E n v i e , ( Médec.) cette paAion peut devenir tellcmf.nf
exccffive, quelle dégénère en délire mélancolique & e
produife les funcAcs effets. Comment les poètes ont exprimé
CCS effets de l'envie. Traitement qu'exige cette mala& du
corps 8c de rcfprit. V. 733. a.
Envie, voyez T a c h e d e n a i s s a n c e . XV. 814. b. Effets
du pouvoir de l’imagination dans les femmes enceintes. VIII
563. a , b.
Envie déréglée ; dofir immodéré de certains alimens ou
de certaines matières nuifiblcs, abfurdcs, bc. V. a
Dépravation d’appétit appellé pica, qui conftAe à manger des*
chofcs d’une nature différente, 8c contraire même à celle des
alimens. Autre dépravation appellée malacia, qui affcâe particulièrement
les femmes enceintes, 8c qui n’eil maladie que
par l’ardeur du defir. Quelles font les perfonnes fujettes à la
première cfpcce de dépravation. Quel que foit le vice des
organes ou des fucs digeAifs, foit dans la bouche, foit dans
rcflomac, il pourra bien former une caufc déterminante
de la dépravation d’appétit ; mais il ne fera pas fuffifantpour
la produire immédiatement. Ibid. b. Il n’y a vraifemblablc-
ment que la léfion de l’imagination que l’on puifTc regarder
comme la caufe prochaine dé ce vice dans la faculté concu-
pifciblc. On a fouvent guéri des perfonnes qui avoient l’appétit
dépravé en éloignant foigneufement tout ce qui pou-
voit rappcller l’idée de l’objet de cet appétit. Pourquoi les
femmes font fujettes à cette forte de maladie. Les personnes
du fexe font plus fufceptibles d’engendrer de mauvaifes
humeurs, 8c de fournir matière aux caufes prochaines de
la dépravation*d’appétit. Ibid. 736. a. Les'hommes n’y font
fujets qu’autant que leur tempérament approche de la déli*
c a te f fe de celui des femmes. Exemple d’un artifan qui éprou-
voit une dépravation d’appétit 8c des vomiffemens toutes
les fois que la femme étoit enceinte.. La maladie appellée
malade, f c change fouvent en celle que nous avons appellée
pica. Ibid. b. Il eA rare que la dépravation d’appétit foit auffi
cxceAive dans les Ailes que dans les femmes groffes. Vice
des humeurs qui en cA la caufe dans les premières. Signes
auxquels ce vice fe fait connoitrc. PrognoAics de cette maladie
: lorfqu’cllc cA Ample, il n’y a rien à en craindre. Les
femmes en font ordinairement délivrées le quatrième mois
de leur groffeffe. Si elle fubfiAc au-delà, elle devient dan-
gereufe. Deux objets à fe propofer dans la curation de
Fappétit dépravé ; corriger l’erreur de l’imagination 8c le vice
dominant du corps. Directions fur l’un 8c l’autre objer. Ibid.
737. a. Dans le cas où cette affeétion ne dépend que de la
groffeffe, Je médecin ne doit donner des lecoiirs qu’avec
un extrême ménagement. Souvent auffi des Ailes qui ^ mangent
avec une extrême avidité du mortier, des feories de
fer, ou des croûtes de pain en abondance, n’en font point
incommodées, 8c il vaut mieux les laiffer libres à cet égard.
Un homme qui avoit un dégoût infurmontable pour toute
forte d’alimens, fut guéri par une envie immodérée démanger
des anchois qu’il fatisAt. Les matières tetreufet, crétacées,
bc. font autant d'abforbans propres à dégager les premières
voies des acides auxquels les enfans 8c les filles cacne-
¿tiques débiles font fort fujets. Ibid. b. H ippo cra tc recommande
même aux médecins d’avoir égard aux fantaiites
malades, bc. Comment on doit traiter le pica 8c le malac‘ *
lorfqu’ils font fymptomatiques. Exemples de plufieurs envi
fmgulicrcs de chofes qui ne font point relatives a la n
ri turc, comme de certaines odeurs, de certaines coule *
bc. Le mot envie fe dit auffi des taches ou autres
contre nature qui paroiffent furie corps des enfans non ^ _
nés, appellées par les Grecs #w/A»/,8c parles La
Ibid. 738. a. Voyc{ là-dcAilS IM AG IN AT IO N . .
Envie. L’imagination peut jetter dans le dégoût, , ,
defirer des choies pernicicufes. VI. 375. E Appétit dép
certains alimens. IX.929. a. XII. 544.b. Unate V.
E n v i e . ( Myth. ) Comment les poètes 1 on reprcicn 738. a. , H
ENVIEUX , J a l o u x . Différence entre, ces mou.
a. . |tr .» g,
ENULA campana. Coufcrvc de cette racrae.
Voyez A vnûe.
ENUMERA"!^MERATION, 1UN, (IJJelles- BclUi-lttt.tett.) ) ccnc c e t t e nBu.figure v c il É
f oanS
cnpoéAc , parce qu’elle raffcmblc les traits les P.^çflJp|ctiré
d’un objet au'on veut dépeindre, bc. V . 73®* a‘
d’Athahc. ibid. b.
E P A E P A
E n u m é r a t io n mp^fM., (Lopq.) ofpccc de fophifme.
^'¿mÉRATION , dènombrtmcnt. ( MJl.anc. ) Celui qu’or-
riftr-Auculle au tems de lu uaiffanee de Notrc-Set-
8 «E:^ra|ïrbm8S des familles romaines, faits par SSg
^ /« citoyens romains trouvé par différons dinombremens
t e fons AÎguAe, Tibere 8c CÎaude. V. ¡ ¡ g b. ^ D é n
o m b r e m e n t .
ENVOI, livre d , ( Comm. ) IX. 6 12. a.
ENVOUSTER, AgniAcation de ce vieux mot françois. V.
^ENVOYÉ. ( Hifl. tiiod. ) Quels font les mihiArcs qui portent
le titre d’chvôyés. Les envoyés font ou ordinaires ou
extraordinaires, voye^ tes mots. De leurs honneurs 8c prérogatives.
Cette qualité eA très-moderne. Honneurs qui leur ont
été retranchés parla cour de France. Anecdote fur JuAimam,
premier envoyé extraordinaire de la république de Vernie à la
cour de France. V. 739. a A
Envoyé, ambajadeur, député. Différence entre ces carafte-
rcs. IV. 867. b. Envoyé extraordinaire. VI. 337-a- .
ENYO , {Myth.) déeffe de la guerre. Divers lcntimens
fur fon origine 8c fes fondions. Suppl. II. 812. b.
ENZINA, voyei E u c in a ; mais lifcz E n z in a .
E O
ÊOLE, {Myth.) dieu des vents. Ce que font les vents,
îclon la mythologie. Comment les poètes en ont réprimé les
défordres. Eolc a joué un grand rôle dans la poélic, pour
élever ou calmer les tempêtes. V. 739. a. Empire qu il exerce
furies vents. Divers endroits de Virgile , relatifs a ce dieu.
Auteurs 8c poëtes qui en ont parlé. Ibtd.b.
EOLIEN ou éolique, (Gram.) l’un des cinq dialectes de la
langue grecque. Èti quels lieux il a régné. Auteurs qui ont écrit
dans ce dialcCte. CaraCtcre qui le diüinguc. Plufieurs le con-
fonderttaVec le doriqüê. V. 739. é.
E o l i e n . ( Mufiq.) CaraCtcre du modeéolicn. V . 729. b.
EOLIEN NES, ïfies, féjour des vents. XVII. 23. b.
EOLIPYLE, {Phyfiq.) defeription Sc ufàge de cet inAru-
ment. Poufquoi il eA appellé éoltpyle. Expériences faites par
fon moyen. Force prodigieufe du feu foutcrrcin, lorfqu il eft
joint à l’air 8c à l’eau. V. 740. a. Examen de cette qucAion ;
Tavoir, fi le vent de l’éolipyle eA produit par l’air renfermé
dans l’eau, du par la vapeur même de l’eau. La vapeur chaude
qui fort de l’éoiipylc, devient froide à quelque diAance dc-là.
Comment les phyficicns rendent raifon de Ce phénomène.
Divers ufages aAcz peu importai» de l’éolipyle que quelques
auteuriontpropofés. Ibid. b.
Eolipyle. Divcrfcs expériences faites avec cet infiniment.
EONIENS, ( fflfl. ceci. ) féClateurs d’Eôn de l’Étoile, dans
le douzième fietlc. Sur quel fondement il fc croyoit le Mcffic.
741.
k6nS o u éones, { Théolog.) mot q u i lig n ifié fiecle, éternité.
:’cA auffi de ce nom q iie quelques hérétiques avoient appellé
es idées que Platon avoit imaginées en Dieu, 8c qu’ils për-
bonnnntifniecrrcenntt,, eénn tcooimnypuoifaamnt la divinité de leur -a-f-fc--m--b-la-
Origine des gnoAiqucs 8c de leur prétendue fcicncc mylté-
icuTe, appellée gnofe. DoCtrine des éons, ftlon l’héréfiarque
/alcntin, telle qu’elle cA rapportée par M. Fleüry. V. 741. a.
'foyer V a l e n t x n ie n s . ,
EORIES , (Myth.) fêtes que les Athéniens célébraient en
’honneur d’Erigonc. A quelle occafion elles furent inAituécs.
/. 741. b.
B P
EPACTB. ( Chronol.) Les épafites font ou annuelles ou
ncnArucllcs. Celles-ci font les excès du mois civil fur le mois
unairc. Les épaftes annuelles font 1 excès de 1 année folâtre
ur la lunaire : cet excès eA de près de onze jours. Le cyc
les épaCtcs expire avec le nombre d’o r, ou le cycle lunaire
le 19 ans, 8c recommence encore dans le même tems. rente
:able qui montre le rapport des épaCtcs avec le nombre d or.
V.,741. b. La différence entre l'année lunaire & «l’année lolaire
revient la même après 19 ans. Dans l’ufagc ordinaire , le mot
ipafle Agnifie le nombre qu’il fiiut ajouter à l ’année lunaire
pour la faire corrcfpondrc à la folaire. Réglé pour trouver
l’épaéte convenable à une année quelconque du cycle lunaire.
Moyen de trouver par l’épaétc fe jour de la nouvelle lune,
8c ce qu’on appelle l’âge de la lune. Ibid 742. -». Manière de
conftruire une nble qui fora vo.r tout d un coup le IÇur cio la
nouvelle lune. Dlffirenee entre I ipafle juhenne & a gréjorienne.
L’ipaflc grégorienne pour une année , ell la méme
nue l'épaflc julienne de fannée “
vroir avoir par la réglé ci-deffus indiqué«!, t/ne autre raifon
qui fait changer le cycle des épaétes dans le calendrier grégorien
, c’elt que fur quatre années féculaircs, il y en a
trois qui ne f<mu>oint biffcxtilcs ; de forte que ces années-là,
les nouvelles ifflps , au lieu de tomber au jour marqué dans
le calendrier, rombent le jour d'après, Ibid. b. On a donc
été obligé de formât deux autres tables pour les épaites. Manière
de les conAruire : auteurs à consulter fur ces tables.
Détails fur leur ufage. Ibid. 743. a. Quelque foin qu’on
ait employé pour la détermination des nouvelles lunes par
ie's épaétes , 8c pour fixer la Pâquc , cette méthode n’a
pas toute l’cxaélitude qu’on pourrait defirer. Exemples qui
le prouvent. Ouvrage à confulter fur l’ufage du calcul des
épaétes pour la chronologie , 8c pour les dates des anciens
titres. Ibid. b.
Epa c t e s , ( Ajlron. ) nombres de jours , d’heures , de
minutes 8c de fécondes, dont les aAronomcs font des tables,
& qui fervent à préparer les calculs des éclipfes. Epaétes
aAronomiques dont nous nous fervons pour trouver les nouvelles
lunes moyennes. Leur ufage. Manière de calculer
l'épaétc d’une année. Suppl. II. 813. a. Epaétes de mois. Tables
de Hallci, contenant une fuirc d’éclipfcs, depuis 1701,
jtifqu’à 1718; une table des conjonétions moyennes, 8c des
tables d’équatiorts pour trouver à-peu-près les conjonétions
Vraies. Ibid. b.
Epaétes , voyei C Y C L E méthoniqite. X. 46a. b. Equation
folaire, à laquelle il faut avoir égard pour éviter l’erreur
d’un jour dans la détermination de la nouvelle lune , voyez
M é î e m p t ô s e b P r o e m p t o s e . Tables dreffées pour cette
équation. X. 444. a. Epaétes cmbolifmiques. V. Ç 57. b. Epaétes
du foleil. III. 833. a.
EPAGNEULS. ( Vénerie ) Leurs qualités pour la chaffc. V .
743. b.
EPAILLER. {Bijoutier) Détails fur cette manoeuvre, 8c ce
qui la rend néceffairc. V. 743. b.
EPAIS. ( Gramm. ) ce mot fe prend relativement à la
dimenfion. ou à la confiAance, ou au nombre. V. 742. b.
E p a i s . {Mufiq.) Ce que les anciens crttendoicnt par genre
épais. V. 744. a.
EPAISSISSEMENT. ( Midec. ) Il faut que les puiffances
’dut font ihoüvoir les fluides. 8c les pouffent vers les dernières
filicres des vaiffeaux , aient une force fupérieure à celle
de la cohéfion des molécules, bc. Quand cette cohéfion eA
trop forte, il- en réfulte des cngorgeniens , des obAruétions
de différente nature, félon la différence des humeurs epaiffies.
La plupart des humeurs font très-difpofées à contraélcr
ce vice, &............................... a devenir moins spropi propres |
à circuler. Divcrfcs caufcs
qui l’èpaiffiffement des qu’il faut leur oppofer. Ibid. b.
produifent répaiffiffement des
humeurs. V. 744. a. Rcme-
Epaiffijfement. Plulieurs humeurs du corps laiffées à cllcs-
méme hors de leurs conduits , perdent leur fluidité. VI. 664.
a. Epaiffiffemcnt de la maffe des humeurs dans certaines fie-
vrcsi VII. 331. b. Sur l’épaiffiffemcnr des humeurs, voyez
Coagulation, Concrétion , Ténacité, Vifcofité.
EPAMINONDAS. Précis de la vie 8c caraétcre de cet
illuArc Thébain. XVI. 242. a, b. Sbn courage. IV. 374. a. La
charge de Téléarque donnée à Epaminondas, XVI. 35. b.
Propos qu’il tint fur le langage bref des Lacédémonicns. IX.
167. b. Scs exploits. VII. 9x4- a- Sa piété filiale. Suppl. IV.
961. a. Ordre fur lequel il combattit à Leuétres 8c à Man-
tinée. XI. 608. b. Sa mort dans cette dernicre bataille. X.
<6. b. M
EPANAD1PL0 SE , ( Figure de diflion ) étym. de ce
mot. Il y a anadiplofe 8c épanadiplofe : ce font deux efpçces
de répétition du même mot. Définition 8c exemples de l’une
8c de l’autre. L’épanadiplofe eA auffi appellée épanaplefe par
quelques grammairiens. RéAexion de l’auteur fur cette figure.
B r a n c h em e n t , {Médec.) voyez e x t r a v a s a t i o n ,
Différence entre infiltration 8c épanchemcnt. VIII. 702. a.
Epanchcment de lait. IX. 211. b. Fluâuation d un fluide épan-
ch£ dans quelque tumeur, VI. 88t. a. Epanchcmcns du fang
dans l’intérieur du crüne, dans la poitrine, dans la cavité d u
bas-ventre. VIII. 119. | , é. Injefllons à faire lorfqu il y a épan-
chcmcns de pus dans ces mêmes parties. 749. é.
EPANNELER, opération du fculnteur-flatuaire. V. 744.4.
EP ANORTHROSE. (ffr«e,-/r«A Définition de cette figure.
Exemples tirés de Cicéron & de Térencc. V. 745. a. V. j p
C o r r e c t i o n . (/UAer.) .
EPARGNE. (Moral.) Dtvdrfes fignificattons de ce mot.
Epargne, tréfor du prince. Loi de l’épargne que Dieu fuit
dans le gouvernement du monde. Epargne , foin 8c habileté
néceffaires pour éviter les dépenfes fuperflues , 8c faire à
tllc Clt la Daic Ot i appui ue tel puuu^ue , vue «> v« ——r-
rable. Elle s'-allic encore parfaitement avcc la piété ; elle en
cA la compagne fidele. Pourquoi les François ont aujourd’hui
fi peu de goût pour l’épargne. Mauvalfe éducation,