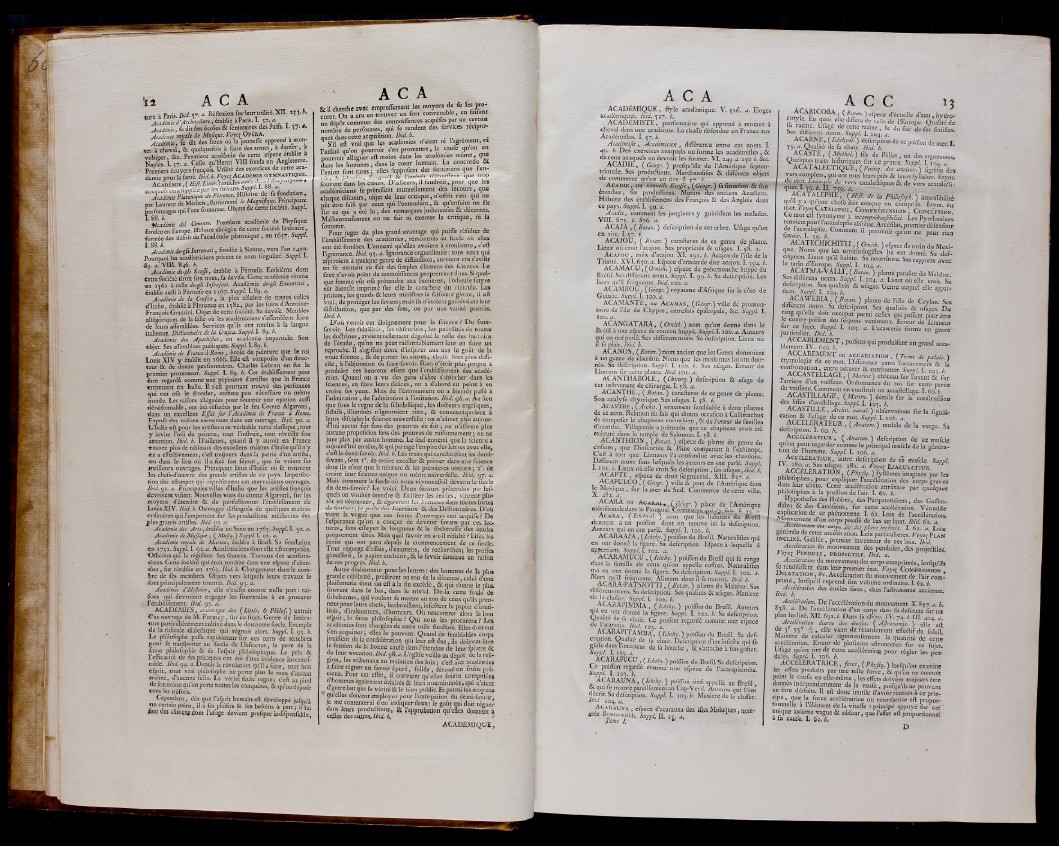
b û ACA
¡¡¡¡¡si
1 2
mre à Paris. lb il Ç7- «• Ré t o n fur leur iiriïtè.Xn. »53- *•
Académie d'ArchiuOurt, établie à Paris. *• S7* *•
Académie, fe dit des écoles & fémmaires des Juifc. I. 57.
■ Académie royale de Mufique. Voye[ OPERA.
Académie, le dit des lieux ou la jeuneffe apprend à monter
à cheval, & quelquefois à faire des armes, à danier, a
voltieer, &c. Première académie de cette efpece établie a
Naples. I. «57. a. Celle gu’Henri VIII fonda en Angleterre.
• Premiers écuyers françois. Utilité des exercices de cette académie
pour la fanté. Ibid. b. royrçACADÉMi
Académie , ( Uift. Litter.)âmSéSk articles j * gg 4
mmsei^Æd^par Laurent de Médicis, furnommè U Magnifique. Principaux
l ^erfonnages qui l’ont foutenue. Objets de cette fociété. SuppL Académie del Cimento. Première académie de Phvfique
fondée en Europe. Hiftoire abrégée de cette fociété littéraire ,
formée des débris de l’académie platonique, en 1657. SuppL
^Académie de-gli Intronati, fondée à Sienne, vers l’an 1450.
Pourquoi les académiciens prirent ce nom lingulier. SuppL I.
$9.a. v m . 846. b. _ m S
Académie de-gli Scojfi, établie à Péroufe. Emblème dont
«ette fociété tiroit fon nom,fa devife. Cette académie réunie
■en 1361 à celle de-gli Infenfati. Académie de-gli Excentrici,
établie auffi à Péroufe en 1567. SuppL 1. 89. a.
Académie de la Crufca, la plus célébré de toutes celles
d’Italie, établie à Florence en 1582, par les foins d’Antoine-
FrançoisGrazzini. Objet de cette fociété. Sa devife. Meubles
allégoriques de la falle où les académiciens s’affemblent. Lieu
de leurs affemblées. Services qu’ils ont rendus à la langue
-italienne. Diélionhaire de la Crufca. Suppl. I. 89. b.
Académie des Apathifies, ou académie impartiale. Son
•objet. Ses affemblées publiques. Suppl. 1. 89. b.
Académie de France à Rome, école de peinture que le roi
Louis XIV y établit en 1666. Elle eft compofée d’un directeur
& de douze penfionnaires. Charlès Lebrun en fut le
premier promoteur. Suppl. I. 89. b. Cet établifiement peut
être regardé comme une pépinière d’artiftes que la France
entretient en Italie. Il s’eil pourtant trouvé des perfonnes
qui ont ofé le fronder, comme peu néceffaire ou même
inutile. Les raifons alléguées pour loutenir une opinion auffi
déraifonnable, ont été réfutées par le feu Comte Algarotti,
dans un excellent Ejfai fur VAcadémie de France à Rome.
Expofé des raifons contenues dans cet ouvrage. Ibid. 90. a.
L ’Italie eft pour les artiftes une véritable terre claffique ; tout
y invite l’oeil du peintre, tout l’inftruit, tout réveille fon
attention. Ibid. b. D’ailleurs, quand il y auroit en France
-encore plus de tableaux des excellens maîtres d’Italie qu’il n’y
•en a effectivement, c’eft toujours dans la patrie d’un artifte,
ou dans le lieu où il a fixé fon féjour, que fe voient fes
meilleurs ouvrages. Principaux lieux d’Italie où fe trouvent
les chefs-d’oeuvre des grands artiftes de ce pays. Imperfection
des eftampcs qui repréièntent ces merveilleux ouvrages.
Jbid.yi.a. Principales villes d’Italie que les artiftes françois
devraient vifiter. Nouvelles vues du comte Algarotti, fur les
moyens § d’étendre & de perfectionner l’établiflèment de
Louis XTV. Ibid. b. Ouvrages diftingués de quelques maîtres
-ordinaires qui l’emportent fur les productions médiocres des
' ¿>lus grands artiftes. Ibid. 02. a.
■ Académie des Arts, établie en Saxe en 1765. Suppl. I. 92. a.
Académie de Mufique , ( Mufiq.) Suppl. I. 92. a.
Académie royale de Marine, établie à Breft. Sa fondation
pn| 1752. Suppl. I. 92. a. Académiciens dont elle eft compofée.
Officiers qui la régiffent. Sesféances. Travaux des académiciens.
Cette fociété qui étoit tombée dans une efpece d’aban-
xlon, fut rétablie en 1769. Ibid. b. Changement dans le nombre
de fes membres. Objets vers lefquels leurs travaux fe
font principalement tournés. Ibid. 93 .a.
Académie d"Hifioire, elle n’exifte encore nulle part: raifons
qui devraient engager les fouverains à en procurer
Tétabliffement. Ibid. 93. a.
ACADÉMIES, avantages des ( Littér. & Philof. ) extrait
<Tun ouvrage de M. Formey, fur ce fujet. Genre de littérature
particulièrement cultivé dans le douzième fiecle. Exemple
de la ridicule dialeCtique qui régnoit alors. Suppl. I. 93. b.
L e philofophe paffe rapidement fur ces tems de ténèbres
pour fe tranfporter au fiede de Defcartes, le pere de la
faine philofopltie & de Tcfprit philofophique. Le prix &
3 efficacité de fes préceptes ont été d’une évidence incontestable.
Ibid. 94. à. Depuis la révolution qu’il a faite, tout bon
.efprit, tout vrai philofophe ne porte plus le nom d’aucun
maître, d’aucune feâe. La vérité feule regne; c’cft au pied
de fon trône qu’onporte toutes les conquêtes, & qu’on déuofe
tous les tréfors.
Cependant, dès que l’efprit humain eft développé jufqu’à
un certain point, il a fes plaifirs & fes befoins à part ; il lui
£ut des alimçqj ¿ont l’ufage devient prefque indifpenfajjle
A C A US z -.s s r e a ssE un dépôt commun des connoiflances acquifes par un certain
nombre de perfonnes, qui fe rendent des fernces réciproques
dans cette acquifmon. Ibid. b. .
S’il eft vrai que les académies n aient ni 1 agrément, m
l’utilité qu’on pourrait s’en promettre, la caufe qu on en
pourrait alléguer eft moins dans les académies meme, que
dans les hommes, dans le coeur humain. La concorde &
l’union font rares ; elles fuppofent des fentimens que 1 en-
>ïc J.i -asBmPf & l’intérêt n’êroiiffent que trop
fouvent dans les coeurs. D ’ailleurs, il faudrait, pour que les
académiciens fe prêtaffent mutuellement des fecours, que
chaque difcours, objet de leur critique, n’offrît rien qui ne
pût être faifi par ceux qui l ’entendent, & qu’enfuite on fit
fur ce qui a été lu , des remarques judicieufes & décentes.
Malheureufement on ne fait ni exercer la critique, ni la
foutenir. . . „ . . .
Pour juger du plus grand avantage qui puilie réfulter de
l’établiffement des académies, remontons au fiecle où elles
ont été fondées. L’ennemi qu’elles avoient à combattre, c’eft
l’ignorance. Ibid. 95. a. Ignorance orgueilleufe : tous ceux qui
afpiroient à quelque genre de diftinction, auraient cru s’avilir
en fe mettant au fait des fimples élémens des fciences. Le
fexe n’avoit point de connoiffances proprement dites. Si quelque
femme eût ofé prétendre aux lumières, l’odieufe fatyre
eût bientôt imprime fur elle le cara&ere du ridicule. Les
princes, les grands & leurs miniftres fe faifoient gloire, il eft
vrai, de protéger les favans ; mais ils n’étoient guidés dans leur
diftribution, que par des fots, ou par une vanité puérile.
Ibid. b.
D ’où venoit cet éloignement pour la fcience ? Du faux-
favoir. Les fubtilités, les obfcurités, les puérilités de toutes
les doftrines, avoient tellement dégoûté le refte des humains
de l’étude, qu’on ne peut raifonnablement leur en faire un
reproche. Il s’agiffoit donc d’infpirer aux uns le goût de la
vraie fcience, & de porter les autres, çliofe bien plus difficile
, à l’abjuration du faux-favoir. Rien n’étoit plus propre à
produire ces heureux effets que l’établiffemerit des. académies.
Quand on a vu des gens d’élite .s’abforber dans les
fciences, en faire leurs délices, on a d’abord eu peine à en
croire fes yeux. Mais de l’étonnement on a bientôt paffé à
l’admiration, de l’admiration à l’imitation. Ibid. 96. a. Au lieu
que fous le regne de la fcholaitique, les doâeurs angéliques,
/ubtils, illuminés n’ignoraient rien, & communiquoient à
leurs difciples la fcience univerfelle : on n’admet plus aujourd’hui
aucun fait fans des preuves de fait ; on n’affirme plus
aucune propofition fans des preuves, de raifonnement ; on ne
jure plus par aucun homme. Le feul ennemi que la fcience a
aujourd’hui en tête, & qui partage l’empire des lettres avec elle,
c’eft le demi-fayoir. Ibid. b. Les traits qui caraélérifent les demi-
favans, font i°. de croire exceller & primer dans une fcience
dont ils n’ont que la teinture & les premières notions ; 20. de
croire leur fcience unique ou même univerfèlle. Ibid. 97. a.
Mais comment le fiecle où nous vivons eft-il' devenu le fiecle
du demi-favoir? Le voici. Deux fecours prétendus par lefquels
on vouloit étendre & faciliter les études, vinrent plutôt
en détourner, & égârerent ies hommes dans toutes fortes
de fentiers j je pvrle *1*»:-Journaux & des Dictionnaires. D’où
vient la vogue que ces fortes d’ouvrages ont acquife? De
l’efperance qu’on a conçue de devenir favans^ par ces lectures,
fans effuyer la longueur 8c la féchereffe des études
proprement dites. Mais qijel favoir en a-t-il réfulté ? Liféz les
écrits qui ont paru depuis le commencement de ce fiecle.
Tout regorge deffais, d’examens, de recherches; les preffes
gémiffent, le papier enchérit , & le favoir diminue en raifoa
de ces progrès. Ibid. b.
Autre déshonneur pour les lettres : des hommes de la plus
grande célébrité, préfèrent au ton de la décence, celui d’une
plaifanterie dont on eft à la fin excédé, & qui donne le plus
, Jpuvent dans le bas, dans le trivial. De-là cette foule de
fubalternes, qui voulant fe mettre au ton de ceux qu’ils prennent
pour leurs chefs, barbouillent, infeélcnt le papier d’umd-
î p l ! d’indécences, d’horreurs. Où rencontrer dors le. bon
G! ja * • >a*ne phdofophie ? Qui nous les procurera ? Les
académies font chaînées de cette utile fonflion. Elles doivent
s en acquitter; elles le peuvent. Quand de femblables corps
joument dç la confidératjon qui leur eft due, ils doivent'être
le loutien de la bonne caufe dans l’étendue de leur fphere &
de leur vocation. Ibid. 98. a. L’églife veille au dépôt, de.la reli-
gion, les tribunaux au maintien des loix; c’eft aux. académies
a faire régner un favoir épuré, folide, fécond en fruits pré?
cieux. Pour cet effet, il convient qu’elles foient compofées
d hommes également éclairés & bjen intentionnés > qui n’aient
d autre but que la vérité & le bien public. Et parmi les moyens
quelles doivent employer pour l’extirpation du demi-favoir,
je me contenterai den indiquer deux.: le goût qui doit régner
dans leurs produaions, & l’approbation qu’eûes donnent à
celles des autres« Ibid, b<
ACADÉMIQUE,
ACA ACADÉMIQUE, ftyle académique. V. 326. a. Eloges-
académiques. Ibid. 327. b.
ACADÉMISTE, penfionnaire qui apprend à monter à
cheval dans une acàdéinie. La chaffe défendue en France aux
Académiftes. I. 37. b.
Académifle, Académicien , différence entre ces noms. I.
49. b. Des exercices auxquels on forme les académiftes , &
de ceux auxquels on devrait les former. VI. 240 a. 230 b. & c.
. A C A D IE , I Géogr. I prefqu’ifle de l’Amérique fepten-
trionale. Ses productions. Marchandiies & différens objets
de commerce qu’on en rire. I. *7. A
A c a d ie , ou nouvelle EcojJ'e Géogr. ) fa fitùatîon & fort
étendue, fes produétions. Moeurs des anciens Acadiens.
Hiftoire des établiffemens des François & des Artglois dans
ce pays. Suppl. I. 99.77.
Acadie, comment les jongleurs y guériffent les malades,
v n i . 873. b. 876. «7.
A C A JÂ , (Botan. ) defeription de cet arbre. Ufage qu’on
en tire. I. 37. b.
ACAJOU, ( Botan. ) cara&eres de ce genre de plante.
Lieux où croit l’acajou. Ses propriétés & ufages. I. 38. a.
A c a jo u , noix d’acajou XI. 191. h. Acajou de Tifie de la
Trinité. XVI. 630. a. Efpece d’anacarde dite acajou. I. 394. b.
A CAM A CU , (OmitA. ) efpece de gobemouche huppé du
Bréfil. Ses différens noms. Suppl. I. 99. b. Sa defeription. Les
Deux qu’il fréquente. Ibid. 100. a.
ACAMBOÜ, (Géogr.) royaume d’Afrique furia côte de
Guinée. Suppl. I. 100. a. '
ACAMANTE, ou A cam a s, ( Géogr.) ville 8c promontoire
de l’ile de Chypre, autrefois épifcopale, 8cc. Suppl. I.
100. a. .
A CAN GATARA, | Ornith. ) nom qu’on donne dans le
Bréfil à une efpece de coucou huppé. Suppl. 1. 100. a. Auteurs
qui en ont? parlé. Ses différens noms. Sa defeription. Lieux où
ü fe plaît. Ibid. b.
ACANOS, (Botan.) nom ancien que les Grecs donnoient
à un genre de chardon. Noms que les modernes lui ont donnés.
Sa defeription. Suppl. I. 100. b. Ses ufages. Erreur de
Linnæus fur cette plante. Ibid. 101. a.
ACANTHABOLE, (Chirurg.) defeription 8c ufage de
cet infiniment de chirurgie. I. 30. a.
ACAN THE , ( Botan. ) caraéleres de ce genre de plante.
Son analyfe chymique. Ses ufages. I. 38. b.
A c a n th e , (Archit. ) ornement femblable à deux plantes
de ce nom. Relation du fait qui donna occafion a Callimachus
de compofer le chapiteau corinthien, 8c de l’orner de feuilles
d’acanthè. Villapande a prétendu que ce chapiteau avoit été
I exécuté dans le temple de Salomon. I. 38. b.
ACANTHION, (Botan. ) efpece de plante du genre du
ciffium, que Diofcoride 8c Pline comparent à l’echinope. I
C ’eft à tort que Linnæus l’a confondue avec les chardons.
Différens noms fous lefquels les auteurs en ont parlé. Suppl.
I. 101. a. Lieux -ou elle croit. Sa defeription, íes ufages, ibid. b. I
ACAPTE , efpece de droit feigneurial. XIII. 837. a.
1 ’ ( Géogr.) ville Ôcpprt de l’Amérique dans I
v 5xi<l ue » ff,r la mer du Sud. Commerce de cette ville. I
A . 402. a.
A C A R A ou A c a r a i , { ÇAffr. ) place de l’Amérique
méridionale dans le Paraeuai. C o m m e r c é 1. ^ I
A c a r a , (Ichthyol.) nom que les habitâhT du Brefil I
donnent à un poiffon dont on trouve ici la defeription. I
Auteurs qui en ont parlé. Suppl. I. 10ï. b.
ACARAAJA, ( Ichthy. ) poiffon du Brefil. Naturaliftes qui I
en ont donné la figure. Sa defeription. Efpece à laquelle il I
appartient. Suppl. 1. 102. a. |
ACARAMUCU, | Ichthy. ) poiffon du Brefil qui fe range
dans la famille de ceux qu’on appelle coffres. Naturaliftes
qui en ont donné la figure. Sa defeription. Suppl. I. 102. a.
Mci’s qu’il fréquente. Alimens dont il fe nourrit. Ibid. b.
CARA^-PAtSJOTTI , ( Botan. ) plante du Malabar. Ses
, ,rens noms. Sa defcriptidn. Ses qualités 8c ufages. Manière
de laelaffer. Suppl. I. 102. b. '
CARAPINIMA, ( Ichthy. ) poifion du Brefil. Auteurs
qui en ont donné la figure. Suppl. I. X02. b. Sa defeription.
uaiite de fa chair. Ce poiffon regardé comme une efpece
*^°?raaja- Ibid- 103* ï.
ACARAPITAMBA, | Ichthy. ) poiffon du Brefil. Sa def-
cripnon. Qualité de fa chair. Defeription d’un infefte qui fe
ghffe dans 1 intérieur de fa bouche , oc s’attache à fon gofier.
Suppl. 1. 103. a. ■ " ; \
r AC4ÇAPvJCU , ( Ichthy.) poiffon du Brefil. Sa defeription.
Ce poiffon regardé comme-une efpece de l’acarapitamba.
Suppl. I. 103. b. r j
ACARAUNA, (Ichthy.) poiffon ainfi appellé au BrefilI
oc qui le trouve pareillement au Cap-Verd. Auteurs qui l’ont
décrit. Sa defeription. Suppl. I. ,103. b. Maniere de le claffer. J
ibid. 104. a. !
A carauna , efjjece d’acarauna des iftes Mduques, nom- I llllill Suppl‘
A C C 13
I c A u A? ICO®A ï, ( } efP'ce Q u e l le d'eau , liydroft
Racine" S » Jü f 1re Ae. cdle de Europe. Qualité de
c ¡ P P g<! decclte fK in Ses différens noms. Suppl. 1. ioa4.. &a. du fuc de fes rfeeuuiiluleess,.
ACARNE , (fchthyol. ) defeription de ce poiffon de mer. I,
S9; “■ Qualité de fa chair. Ibid. b.
ACASTE , ( Mylhçl. ) fils de Pélias, un des argonautes!
” /iSi'2 î rai'?Jl'fton<Cles ® ce prince. Suppl. 1 . 104 a
A CATALECTIQUE, ( Poiùq. du anc J I ) flguMe ¿es
vers complets, qui ont tous leyrspiés 8c leurs fyllabes. Etym*
vers câtaleétiques 8c de vers acataleéti-
ÇUes- 1- 1 <J- b. 11. 7K<). a.
^A CA TA LE P S ffi (Hifl. d, U Philofoph.') impoflibilité
qu d y a qu une chofe foit conçue ou comprife. Etvm. du
mot. VoynC a ta le p s ie , C o m p r éh e n s io n , C o n ce pt io n .
Ce mot eft fynonyme à mcomprihcnjlbiliti. Les Pyrrhoniens
tenoientpour 1 acatalepfieabfolue. Arcéftlas, premierdéfenfeur
&vôir I. o i. ment ' Prouvoit qu’on ne peut rien
. •’ i | w ^ efPKe i ê tarin du Mexi-
I que. Noms que les ornithologiftes lui ont donné. Sa def-
I cnption. Lieux quil habite. Sa nourriture. Ses rapports avec
I le tarin d’Europe. Suppl. L 104. a. S B l
« ACATS/A-VALLI , {Botan. ) plante paraftte du Malabar
Ses différens noms. Suppl. I. io 4. a. Lieux où elle croit. Sa
defeription. Ses qualités & ufages. Genre auquel elle appartient.
Suppl. I. 104. ¿. t r r u
d ERIAI ) Êïnté de l’iile de Ceylan. Ses
dtfferens noms. Sa defeription. Ses qualités & ufages. Du
rang qu elle doit occuper parmi celles qui paffent pour être
Je contre-poifon des ferpens venimeux. Erreur de Linnæus
p a r t i e ? , I l S U" S
b l e m e S ^ V ^ o Y | W produifenI ™ S rand
ACCAREMENT vu a c c a r ia t io n , {.Terme de puluis.)
étymologie de ce mot. Différence entre i’accarement 8c la-
controntauon , entre accarcr 8c confronter. Suppl I io< h
.CCASTELLAGE, (Marine) c h â t e a u f i i i f y M l i i r
1 arriéré d ^un vaiffeau. Ordonnance du roi fur cette partie
du vaifleau. Comment WÊÊSi on conftmit un accafteUage.11 1. 60. b.
des a hffes ivr d acaftillage.aÎ? ’ Suppl. I. 103.détails b. k confiruétion
ACAST1 LLÉ, Archit. naval. ) obfervations fur la fienifi-
Catl.°ü W g e de ce mot. Suppl. I. 106. a.
ACCÉLÉRÂTEUR, (Anatom.) mufcle de la verge. Sa
defeription. I. 60. b. °
A c c élé rat eu r , ( Anatom. ) defeription de ce mufcle
qu on peutçegarder comme le principal mufcle de la génération
de l’homme. Suppl. I. 106. a. 0
T\rACSELER oTEU^ ’ autre dei'cript‘on de ce mufcle. SuppL
. ? : bes ufages. 282. a. Vovez E ja c u la t f i t r
1 N ’ ( P fy fl- ) fyfiémes imaginés par les
philofophes , pour expliquer l’accélération dés ôorps graves
u"iS f e . ‘f ’ tte accéIérarion attribuée par quelques .
philofophes a la preflion de l’air. I. 66. b.
Hypothefes des Hobbes, des Péripateticiens, des Gaffen--
diftes 8c des Cârtéfiens, fur cette accélération. Véritable
explication de ce phénomène. I. 61. Loix de l’accélération,
gouvernent d un coips pouffé de bas en haut. Ibid: 61. a.
Accélération des corpsJjj^Jfis plans inclinés. I. 62. a. Loix
genwrale de cette accélération. Loix particulières. Voyez Pl aH
incline. Galilée, premier inventeur de ces loix. Ibid.
Accélération du mouvement des péndules, des proieétiles i
Voyez Pendule , pro je c t ile . Ibid. a.
r Aa cet v n l0n JU mouvement des corps comprimés, lorfqu’ils
le retabhffent dans leur premier état. Voyez C ompression ,
u il a t a t ïON , &c. Accélération du mouvement de Pair corn*
primé, lorfqu il reprend fon volume ordinaire. 1 .62. b.
Accélération des étoiles fixes, daûs l’aftronomie ancienne.
ibid. b.
Accélération. De l’accélération du mouvement. X. 837. a. bï
Y .a‘ .. f accelération d’un coips dans fa defeente fur uà
plan incliné. XII. 692. b. Dans là chute. IV. 74. b. III. 404. a.
Accélération diurne des étoiles. ( Aftronomie. ) elle eft
df 3/ §5?v r z , elle vient du retardement effectif du foleih
Mamere de calculer rigoureufement la quantité de cette
accélération. Erreur de plufieurs aftronomes fur Ce fuiet
Ufage .qu’on rire de cette accélération pour régler les pe*
dules. Suppl. I. 106. b. o r
ACXÉLÉRATRICE, force, ( Phyfiq. ) lorfqu’on examiné
les effets produits par une telle force, & qu’on ne connoîr
point la caufe en elle-meme , les effets doivent toujours être
donnés indépendamment de la caufe, puifqu’ilsne peuvent
en etre déduits. Il eft donc inutile d’avoir fecours à ce prin-
c.'Pe » que la force accélératrice ou retardatrice eft proportionnelle
à 1 élément de la vîreffe : principe appuyé fur cet''
unique axiome vague & obfeur, que l’effet eft proportionnel
a fa caufe. I. 62, bt
D