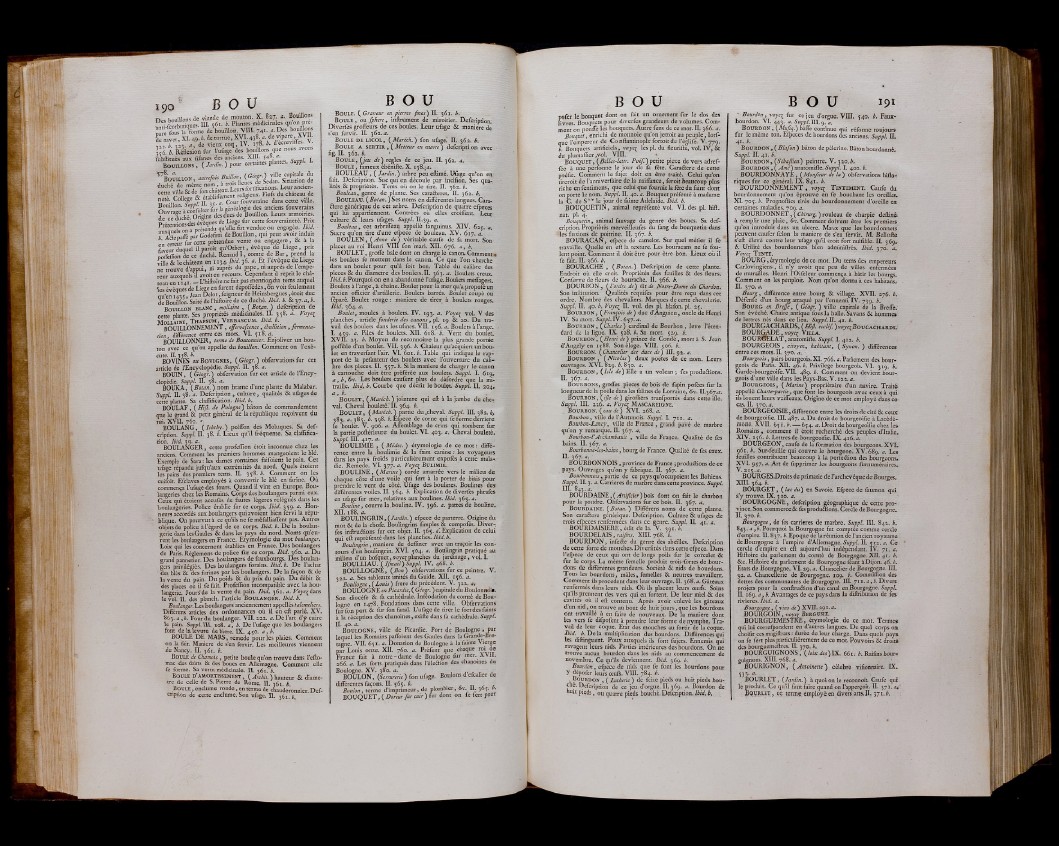
190 B O U PS®! flÉiwBp SM S U d^bouiUon. VIII. «»■ I« g§Hg|
Se navet, XI. 49- de tortue, X VI. W\ a' V
122 b. 121. cl, de vieux coq, IV. 178. b. décreyiiies, ^
3p ¿. Réflexion fur l’ufage des bouillons que nous avons
fubftitués aux tifanes des anciens. XIII. 54* *• , j
B o u i l lo n s , ( jardin.) pour certaines plantes, àuppi.
B O U
^ B o u il lo n , -autrefois Bullion ville capitale du
ledan. Situation de
duché de Leurancien-
S S V w S » religieux.,Fieft du château de
neté. collège ^ Cour fouveraine dans cette ville.
Ouvrage âTonlhlterlur la généalogie des anciens Couverait,s
de cexiuchè. Origine des Jucs de îomllon. Leurs armoirtes.
Prtodonsdesévêques de L,ege fur cette fouverauieté. Prix
a orétendu qu’elle fut vendue ou engagée. Ibid. -
p£ Godefroi.de BouUlon, qui peut avoir induit
en erreur fur cette prétendue vente ou engagere , & a la
faveur duquel il paroît qu’Otbert, évêque de Liege , prit
poffeflion de ce duché. RenaudI, comte de Bar, prend la
ville & le château en 1134- WÈ 36' a- Et. 1 eve?u<j M W M
ne trouve d’appui, ni auprès du pape, m auprès de 1 empereur
auxquels U avoiteu recours. Cependant d reprit le château
en 1141. — L’hiftoire ne fait pas menno^du tems auquel
les évêques de Liege en furent dépoffédés, on voit feulement
qu’en 143 3, Jean Delot, feigneur de Heinsbergues, étoit duc
de Bouillon. Suite de l’hiftoire de ce duché. Ibid. b. & 37.4,
B o u illo n b la n c , mollaine , (Bot^tn.) defcription de
cette plante. Ses propriétés médicinales. IL 338. a. Voyez
M o lla in e , Thapsum, V erb a s cum . Ibid. b.
BOUILLONNEMENT, cjfervefccnce, ébullition , fermentation
différence entre ces mots. VI. 318. 4.
BOUILLONNER, terme de Boutonnier. Enjoliver un bouton
avec ce qu’on appélle 'du bouillon. Comment on l’exécute.
IL 338. ¿*
BOVINES ou Bovignes, ( Géogr. ) obfervations fur cet
article de l’Encyclopédie. Suppl. IL 38. a.
BOUIN, ( Géogr.) obfervation fur cet article de l’Encyclopédie.
Suppi. n. 38. 4.
BOUKA, (Botan. ) nom brame d’une plante du Malabar.
'Suppl. H. 38. 4. Defcription , culture, qualités & ufages de
cette plante. Sa claifification. Ibid. b.
BOULAF, (Uijl- Je Pologne) bâton de commandement
que le grand & petit général de la république reçoivent du
roi. XVII. 760. 4.
BOULANG, (Ichthy.) poiflon des Moluques. Sa defcription.
Suppl. II. 38. b. Lieux qu’il fréquente. Sa clafliflca-
üon. Ibid. 39. a.
BOULANGER, cette profeflion étoit inconnue chez les
anciens. Comment les premiers hommes mangeoient le blé.
Exemple de Sara : les dames romaines fàifoient le pain. Cet
■ufage répandu jufqu’aux extrémités du nord. Quels étoient
les pains des premiers tems. II. 3 bm Comment on les
cuifoit. Efclaves employés à convertir le blé en farine. Où
commença l’ufage des fours. Quand il vint en Europe. Boulangeries
chez les Romains. Corps des boulangers parmi eux.
Ceux qui étoient accufés de fautes légères relégués dans les
'boulangeries. Police établie fur ce corps. Ibid. 339. a. Honneurs
accordés aux boulangers quiavoient bien fervi la répu-
• blique. On pourvut à ce qu’ils ne fe méfalliaffent pas. Autres
•objets de police à l’égard ae ce corps. Ibid. b. De la boulangerie
dans les Gaules & dans les pays du nord. Noms qu’eurent
les boulangers en France. Etymologie du mot boulanger.
Loix qui les concernent établies en France. Des boulangers
de Paris. Réglemens de police fur ce corps. Ibid.x6o. 4. Du
grand pannetier. Des boulangers de fauxbourgs. Des boulange
« privilégiés. Des boulangers forains. Ibid. b. De l’achat
' des blés & des farines par les boulangers. De la façon & de
la vente du pain. Du poids & du prix du pain. Du débit &
des places où il fe fait. Profeflion incompatible avec la boulangerie.
Jouride la vente du pain. Ibid. 361. 4. Voyez dans
le vol. II. des planch. l’article B o u la n g e r . Ibid. b.
BoulangtrX.es boulangers anciennement appellés talemeliers.
TMèrens articles des ordonnances où il en eft parlé. XV.
S63.4, b. Four du boulanger. VII. 222. a. De l’art d’y cuire
le pain. Suppl. III. 108. 4 , b. D e l’ufage que les boulanger:
font de la levure de biere. IX. 430. a , b.
BOULE DE MARS, remede pour les plaies. Comment
on la fait. Maniéré de s’en fervir. Les meilleures viennent
de Nancy. D. 361. b.
Boule de Chamois , petite boule qu’on trouve dans l’efto-
mac des dains & des boucs en Allemagne. Comment elle
fe forme. Sa vertu médicinale. II. 36 t. b.
B o u le d amortissement , ( Archit. ) hauteur & diamètre
de celle de S. Pierre de Rome. II. 361 b
Boule , enclume ronde, en terme de cLuderonuicr. Def-
cnption de cette enclume, Son ufage. II. 36t. b.
BOULE. ( Graveur en pierres fines) II. 361. b.
B o u le , ou fphere, infiniment de miroitier. Defcription;
Diverfes grofleurs de ces boules. Leur ufage & maniéré de
’en fervir. II. 362.a.
B oule de l ic o l , (Maréch.) fon ufage* II. 362. b.
B o u le a s e r t i r , ( Metteur en oeuvre) defcnpti on avec •
fig. II. 362. b. *
B o u l e , (jeu de) réglés de ce jeu. II. 362. a.
B o u le , fameux ébénifte. X. 138.54.
BOULEAU, ( Jardin. ) arbre peu eftimé. Ufage qu’on en
fait. Defcription. Suc qui en découle par incifion. Ses qua-;
lités & propriétés. Tems où on le tire. II. 362. b.
Bouleau, genre de plante. Ses caraâeres, II. 362. b. .
B o u le a u . (Botan. ) Ses noms en différentes langues. Cara-
âere générique de cet arbre. Defcription de quatre efpeces
qui lui appartiennent. Contrées où elles croiflent. Leur
culture & leurs ufages. Suppl. II.39. a-
Bouleau, cet arbriffeau appelle languinus. XIV. 623. 4.
Sucre qu’on tire d’une efpece de bouleau. XV. 617. 4.
BOULEN, (Anne de) véritable caufe de fa mort. Son
placet au roi Henri VIIl fon mari. XII. 676. a, b.
BOULET, grofle baie dont on charge le canon» Comment*
les boulets fe mettent dans le canon. Ce que l’on cherche
dans un boulet pour qu’il foit bon. Table du calibre des
pièces & du diametre des boulets. U. 363. a. Boulets creux.
Ibid. b. Pourquoi on en a abandonné l’ufage. Boulets mefiagers.
Boulets à l’ange, à chaîne. Boulet pour la mer qu’a propofé un
ancien officier d’artillerie. Boulets barrés. Boulet coupé ou
féparé. Boulet rouge : maniéré de tirer à boulets rouges.
Ibid. 364. 4.
Boulety moules à boulets. IV. 193. 4. Voyez vol. V des
planches, article fonderie des canons, pl. 19 & 20. Du travail
des boulets dans lesuftnes. VH. 136.4. Boulets à l’ange. /
I. 439. 4. Piles de boulets. XII. 618. b. Vent du boulet.
XVII. 23. b. Moyen de reconnoître la plus grande portée
poffible d’un boulet. VU. 396. b. Chaleur qu’acquiert un boulet
en traverfant l’air. VI. ooi. b. Table qui indique le rapport
de la pefanteur des boulets avec l’ouverture du calibre
des pièces. II. 337. b. Si la maniéré de charger le canon
à cartouche doit être préférée aux boulets. Suppl. I. 619,
4 , b, &c. Les boulets caufent plus de défordre que la mitraille.
Ibid,. b. Courbe que décrit le boulçt.' Suppl. U. 204.
a y b. .
B o u l e t , (Maréch.) jointure qui eft à la jambe du cheval.
Cheval bouleté.TI. 364. b. .
B o u l e t , (Maréch.) partie du .cheval. Suppl. III. 382.4.
383. 4. 383. b. 398. b. Efpece de corne qui fe forme derrière
le boulet. V . 900. 4. Aflemblage de crins qui tombent fur
la partie poftérieure du boulet. VI. 403. a. Cheval bouleté.
Suppl. III. 417.4.
BOULIMIE , (Médec.) étymologie de ce mot: différence
entre la .boulimie oc la faim canine : les voyageurs
dans les pays froids particulièrement expofés à cette mala-
die. Remede. VI. 377. a. Voyez Bulimie.
BOULINE, (Marine) corde amarrée vers le milieu de
chaque côte d’une voile oui fert à la porter de biais pour
prendre le vent de côté. Ufage des boulines. Boulines des
différentes voiles. II. 364. b. Explication de diverfes phrafes
en ufage fur mer, relatives aux boulines. Ibid. 363. a.
Bouline y courre la. bouline. IV. 396. a. pattes de bouline.
XH. 188. 4.
BOULINGRIN,(Jardin.) efpece de parterre. Origine du
mot & de la chofe. Boulingrins fimples & compofés. Diverfes
inftruétions fur cet objet. II. 363. a'. Explication de celui
qui eft repréfenté dans les planches. Ibid. b.
Boulingrin, maniéré de defliner avec un traçoir les contours
d’un boulingrin. XVI. 304. a. Boulingrin pratiqué au
milieu d’un bofquet, voyez planches du jardinage, vol. I.
BOULLIAU. (Ifmaël) Suppl. IV. 468. b.
BOULLOGNE, (Bon) obfervations fur ce peintre. V.
322. 4. Ses tableaux imités du Guide. XII. 136. a.
Boullogne, ( Louis) frere du précédent. V . 122. a,
BOULOGNE en Picardie, ( Géogr. ) capitale du Boulonnôif.
Son diocèfe & fa cathédrale. Inféodation du comté de Boulogne
en 1478. Fondations dans cette ville. Obfervations
fur fon port & fur fon fanal. L’ufage de tirer le fort des faints
à la réception des chanoines,exifte dans fa cathédrale. Suppl.
H. 40- ci.
B o u lo g n e , ville de Picardie. Port de Boulogne , par
lequel les Romains paffoient des Gaules dans la Grande-Bretagne.
-VII. 631. 4. Donation de Boulogne à la fainte Vierge
par Louis onze. XII. 760. a. Préfent que chaque roi de
France fait à notre - dame de Boulogne fur >ner. XVII.
266. 4. Les forts.pratiqués dans l’éleétion des chanoines de
Boulogne. XV. 380. a.
BOULON, (Serrurerie) fon ufage. Boulons defeaher de
différentes façons. II. 363. b. . . . . . ,
Boulon, terme d’imprimeur, de plombier, etc. 11. 363. b.
BOUQUET, ( Doreur fur cuir ) ter dont on fe fert pour
B O U B O U 191
pofer le bouquet dont on fait un ornement fur le dos des
livres. Bouquets pour diverfes grandeurs de volumes. Comment
on pouffe les bouquets. Autre fens de ce mot. II. 366.4.
Bouquet, enrichi de monnoie qu’on jettoit au peuple, lorf-
que l’empereur de Co nftantinople fortoit de l’églife. V. 779.
b. Bouquets artificiels, voyez les pl. du fleurifte, vol. IV, oc
du plumaflier,vol. VIII.
Bo u q u e t, (Belles-lettr. Poéf.)petite piece devers adref-
fée à une perlonne le jour de fa fête. Caraftere de cette
poéfle. Comment le fujet doit en être traité. Celui qu’on
tireroit de l’anniverfaire de la naiffance, feroit beaucoup plus
riche en fentimens, que celui que fournit la fête du faint dont
on porte le nom. Suppl. H. 40. a. Bouquet préfenté à madame
la C. de S** le jour de fainte Adélaïde. Ibid. b.
BOUQUETIN, animal repréfenté vol. VI. des pl. hift.
nat. pl. 4. ^ ri/i •
Bouquetin, animal fauvage du genre des boucs. Sa defcription.
Propriétés merveilleufes du fang de bouquetin dans
'les fluxions de poitrine. II. 367. b.
BOURACAN, efpece de camelot. Sur quel métier il fe
travaille. Quelle en eft la texture. Les bouracans ne fe foulent
point. Comment il doit être pour être bon. Lieux où il
fe fait. II. 366. b.
BOURACHE , (Botan.) Defcription de cette plante.
Endroit où elle croît. Propriétés des feuilles & des fleurs.
Conferve de fleurs de bourache. II. 366. b.
BOURBON, (Tordre de) dit de Notre-Dame du Chardon.
Son inftitution. Qualités requifes pour être reçu dans cet
ordre. Nombre des chevaliers. Marques de cette chevalerie.
Suppl. II. 40. b. Voyez II. vol. des pl. blafon. pl. 23.
B o u r b o n , (François de) duc d’Anguien, oncle de Henri
IV. Sa mort. Suppl. IV. 637. a.
B o u r b o n , (Charles) cardinal de Bourbon, leve l’étendard
de la ligue. IX. 328. b. Sa mort. 329. b.
B o u r b o n , ( Henri de ) prince de Conde, mort à S. Jean
d’Angely en i<88. Son éloge. VIII. 306. b.
BOURBON. (Chancelier des ducs de) III. 92. 4.
B o u r b o n , (Nicolas) deux poètes de ce nom. Leurs
ouvrages. XVI. 829. b. 830. 4.
B o u r b o n , (Isle de) Elle a un volcan ; fes productions.
II. 367. 4.
B o u r b o n s , grofles pièces de bois de iàpin pofées fur la
longueur de la poêle dans les falines de Lorraine, 6*c. II.367.4.
B o u r b o n , (ifle de) girofliers tranfportés dans cette ifle.
Suppl. III. 226. 4. Voyer M a s c a r e ig n e .
B o u r b o n , (eau de) XVI. 268. 4.
Bourbon, ville de l'Autuuois. Suppl. I. 711. 4.
Bourbon-Lancy, ville de France, grand pavé de marbre
qu'on y remarque. II. 367. 4.
Bourbon-TArchambault , ville de France. Qualité de fes
bains. U. 367. a.
Bourbonnë-Ies-bains, bourg de France. Qualité de fes eaux,
n. 367. a.
BOURBONNOIS, province de France j productions de ce
pays. Ouvrages qu’on y fabrique. II. 367. a.
Bourbonnoïs, partie de ce pays qu’occupoient les Bohiens.
Suppl. II. 3. 4. Carrières de marbre dans cette province. Suppl.
III. 843.4.
BOURDAINE, ( Artificier ) bois dont on fait le charbon
pour la poudre. Obfervations fur ce bois. II. 367. a.
B o u r d a in e . (Botan.) Différens noms de cette plante.
Son caraftere générique. Defcription. Culture & ufages de
trois efpeces renfermées dans ce genre. Suppl. U. 41. 4.
BOURDAISIERE, édit de la. V. 391. ¿.
BOURDELAIS, rai fins. XIII. 768. b.
BOURDON, infeCte du genre des abeilles. Defcription
de cette forte de mouches. Diverfités dans cette efpece. Dans
l’eipece de ceux qui ont de longs poils fur )e corcelet •&
fur le corps. La même femelle produit troisffortes de bourdons
de différentes grandeurs. Société & nids de bourdons.
Tous les bourdons, mâles, femelles & neutres travaillent.
Comment ils procèdent dans leur ouvrage. II. 368. a. Gâteaux
renfermés dans leurs nids. Où ils placent leurs oeufs. Soins
qu’ils^prennent des vers qui en fortent. De leur miel & des
cavités ou il eft contenu. Après avoir enlevé les gâteaux
d’un nid, on trouvé au bout de huit jours,que les bourdons
ont travaillé à en foire de nouveaux. De la maniéré dont
les vers fe difpofentà prendre leur forme de nymphe. Travail
de leur coque. Etat des mouches au fortir de la coque.
Ibid. b. De la multiplication des bourdons. Différences qui
les diftineuent. Poux auxquels ils font fujets. Ennemis qui
ravagent leuris nids. Parties intérieures des bourdons. On ne
trouve aucun bourdon dans les nids au commencement de
novembre. Ce qu’ils deviennent. Ibid. 369. b.
Bourdon, efpece de nids que fe font les bourdons pour
Y dépofer leurs oeufs. VIII. 784. b.
■ B o u r d o n , ( Lutherie ) de feize pieds ou huit pieds bouché.
Defcription de ce jeu. d’orgue. II. 169. a. Bourdon de
huit pieds, ou quatre pieds bouché. Defcription. Ibid, b.
* Bourdon, voyez fur CQ jeu d’orgue. VIII. 340. b. Faux-
bourdon. VI. 443. 4. Suppl. n i. 9 .4.
B ourdon , (Mufiq.) baffe continue qui réfonne toujours
fur le même ton. Efpeces de bourdons des anciens. Suppl. H.
41. b.
B o u rd o n , ( Blafon ) bâton de pèlerine. Bâton bourdonné.
Suppl. II. 41. b.
B o u r d o n , (Sébaftien) peintre. V. 320. b.
B o u r d o n , (Amé)zmtomiâc.Suppl. I. 400.b.
BOURDONNAYÉ ,(Monfieur delà) obfervations hifto-
riques fur ce général. IX. 841. b.
BOURDONNEMENT , voyez T in tem en t. Caufe du
bourdonnement qu’on éprouve en ie bouchant les oreilles.
XI. 703. b. Prognoftics tirés du bourdonnement d’oreille en
certaines maladies. 709. a.
BOURDONNET, ( Chirurg. ) rouleau de charpie deftiné-
à remplir une plaie, &c. Comment doivent être les premiers
qu’on introduit dans un ulcere. Maux que les bourdonnets
peuvent caufer félon la maniéré de s’en fervir. M. Bellofte
s’eft élevé contre leur ufage qu’il croit fort nuiflble. II. 369.
b. Utilité des bourdonnets bien adminiftrés. Ibid. 370. a.
Voyez T ente.
BOURG, étymologie de ce mot. Du tems des empereurs
Carlovineiens, il n’y avoit que peu de villes enfermées
de murailles. Henri l’Oifeleur commença à bâtir les bourgs.
Comment on lespeuploit. Nom qu’on donna à ces habitans» .
H. 370. 4.
Bourg, différence entre bourg & village. XVII. 276. b.
Défenfe d’un bourg attaqué par l’ennemi. IV. 739. b.
B o u r g en BreJJe, ( Géogr. ) ville capitale de la Brefle.
Son évêché. Chaire antique fous la halle. Savans & hommes
de lettres nés dans ce lieu. Suppl. II. 41. b.
BOURGACHARDS, ( Hifi. cccUf ) voyer B o u c a c h a r d s .-
BOURGADE, voyez V i l la .
BOURg E L A T , anatomifte. Suppl. I. 412. b.
BOURGEOIS, citoyen, habitant, ( Synon. ) différences
entre ces mots. II. 370.4. •
Bourgeois, pairs bourgeois. XI. 766. a. Parlement des bourgeois
de Paris. XII. 46. b. Privilège bourgeois. VI. 319. b.
Garde-bourgeoife. VII. 489. b. Comment on devient bourgeois
d’une ville dans les Pays-Bas. V. 122.4.
B o u r g e o is , (Marine) propriétaire d’un navire. Traité
appellé Charte-partie, que font les bourgeois avec ceux à qui-
ils louent leurs yaiffeaux. Origine-de ce mot employé dans c e
cas. II. 370.4.
BOURGEOISIE, différence entre les droits de cité & ceux.
de boutgeoifie. III. 487. 4. Du droit de bourgeoiiie à Lacédé-
mone. XVII. 631. ¿.— *634. 4. Droit de bourgeoifie chez les
Romains, comment il étoit recherché des peuples d’Italie.
XIV. 136. b. Lettres de bonrgeoifle. IX. 416.4.
BOURGEON, caufe de la formation des bourgeons. XVI.
961. b. Sur-feuille qui couvre le bourgeon! XV. 689. a. Les
feuilles contribuent beaucoup à la perleétion des bourgeons.
XVL 937.4. Art de fupprimer les bourgeons furnuméraires.
V. 21 3 .4 .
BOÜRGES.Droits de primatie de l’archevêque de Bourges.
XIII. 364. b.
BOÜRGET,. ( lac du) en Savoie. Efpece de foumon qui
s’y trouve. IX. 310. a.
BOURGOGNE, defcription géographiq ue de cette province.
Son commerce 8c fes productions. Cercle de Bourgogne,
lï. 370. b.
Bourgogne, de fes carrières de marbre. Suppl. III. 842. b.
843. a y b. Pourquoi la Bourgogne fut comptée comme cercle
d’empire. H. 837. b. Epoque de la réunion de l’ancien royaume
de Bourgogne à l’empire d’Allemagne. Suppl. II. 532.4. Ce *
cercle d’empire en en aujourd’hui indépendant. iV. 71. a.
Hiftoire du parlement du.comté de Bourgogne. XII. 41. b.
&c. Hiftoire du parlement de Bourgogne féant à Dijon. 46. b.
Etats de Bourgogne. VI. 29. a. Chancelier de Bourgogne. III.
92.4 . Chancellerie de Bourgogne. 109. b. Commimon des
dettes des communautés de Bourgogne. III. 711. a,b. Divers
projets pour la conftru&ion d’un canal en Bourgogne. Suppl.
II. 169. a, b. Avantages de ce pays dans la diftribution de les
rivières. Ibid. 4.
Bourgogne, ( vins de ) XVII. 291. ci.
BOURGOIN, voycz_Bergusie.
BOURGUEMESTKE, étymologie de ce mot. Termes
qui lui correfpondent en d’autres langues. De quel corps on
choifit ces magiftrats : durée de leur charge. Dans quels pays
on fe fert plus particulièrement de ce mot. Pouvoirs & droits
des bourguemeftres. II. 370. b.
BOURGUIGNONS , (loix des) YK. 661. b. Raifins bour*
guignons. XIII. 768. a.
BOURIGNON, ( Antoinette ) célébré vifionnaire. IX»
i3BOÙRLET, (Jardin.) à quoi on le reconnoît. Caufe qui
le produit. Ce qu’il fout foire quand on l’apperçoit. II. 371.4/
BQURU.T, ce terme employé en divers arts. II. 371. b.