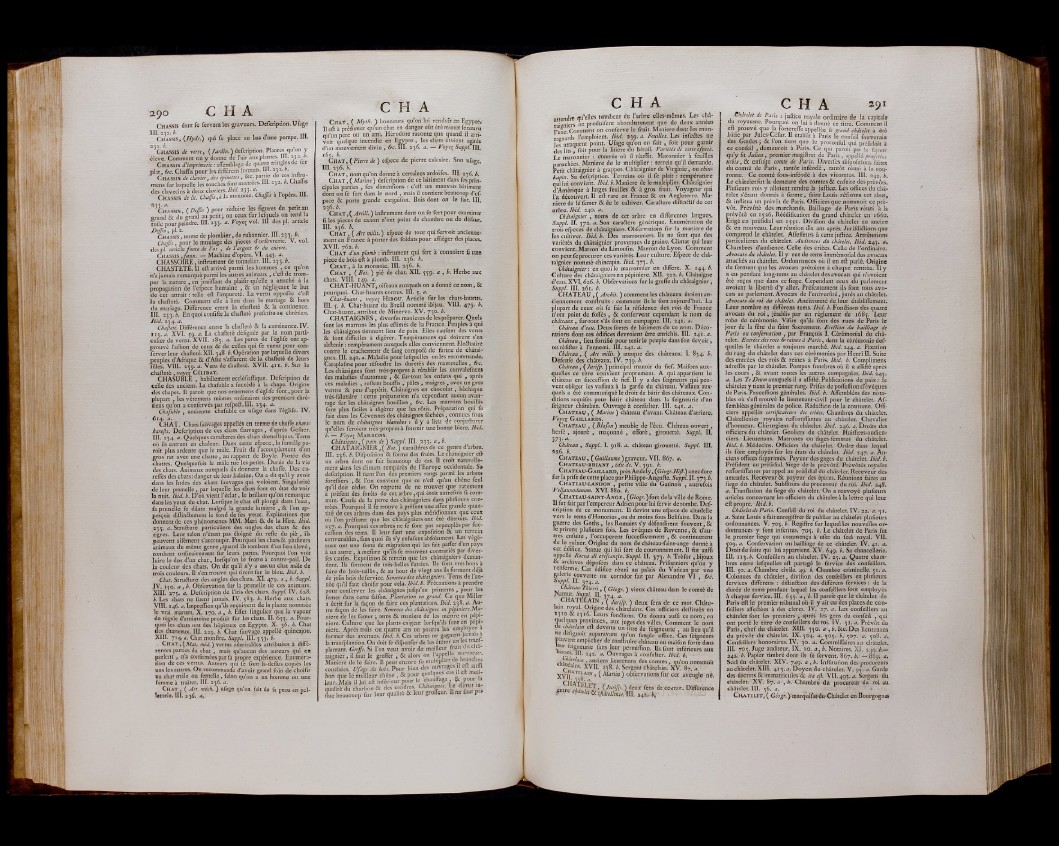
290 C H A C H A
Châssis dont fe fervent les graveurs. Defeription. Ufage
Châssis, (Hydr.) qui fe place au bas d’une pompe. III.
212. b. ‘ • ---'77 ->2 . . « ,
C h â ss is de verre, ( Jardin. ) defeription. Plantes qu on y
¿leve. Comment on y donne de Pair aux plantes. III. 232.
C hâssis d'imprimerie : aflemblagc de quatre tringles de ter
plat, Grc. Chaflis pour les différens formats. III. 23a» b.
C hâssis i 4»/«««, &c. parue de ces mftnimens
fur laquelle les touches font montées.UL 232. b. Chaflis
des clavecins à deux claviers. Ibid. i^ya.
C hâssis de lit. Chaffis, à la monnoie. Chafa à 1 opéra. III.
•^ h  s s is , ( D'Jfr ) pour réduire les figures du petit a i
grand & du grand au petit; ou ceux fur iefouels on tend a
Toile pour peindre. III. ¿33- g voL 111 des g mide
Delfín, pl. 2. ttt i 1
C h â s s i s , terme de plombier, de rubannicr. III. 233. b.
Chafa, pour le moulage des pièces d’orfévrerie. V. vol.
des pl. article, fonte de l'or , de l'argent & du cuivre.
Châssis ,faux. — Machine d’opéra. VI. 443. <x.
CHASSOÍRE, inftrument de tonnelier. III. 233. b.
CHASTETÉ. 11 eft arrivé parmi les hommes , ce qu’on
n’a jamais remarqué parmi les autres animaux, c eft de tromper
la nature , en Jouiffant du plaiiir qu’elle a. attaché à la
propagation de l’efpcce humaine , & en négligeant le but
de cet attrait : telle eft l’impureté. La vertu oppoféc c’eft
la chafteté. Comment elle a lieu dans le mariage & hors
du mariage. Différence entre la chafteté & la continence.
III. 233. b. En quoi confifte la chafteté preferitoau chrétien.
Ibid. 234. a.
Chafteté. Différence entre la chafteté & la continence. IV.
113. a. XVI. 59. a. La chafteté défignée par le nom particulier
de vertu. XV JI. 185. a. Les peres de l’églife ont approuvé
l’aétion de ceux 8c de celles qui fe tuent pour con-
ferver leur chafteté. XII. 348 b. Opération par laquelle divers
peuples d’Afrique 8c d’Afie s’affurent de la chafteté de leurs
filles. VÔL 259. a. Voeu de chafteté. XVII. 411. b. Sur la
chafteté »voy*? C élibat.
CHASUBLE , habillement eccléfiaftique. Defeription de
celle des anciens. La chafuble a fuccédé à la chape. Origine
des chapes. Il paroît que nos ornemens d’églife font,pour la
plupart , les vêtemens mêmes ordinaires des premiers chrétiens
qu’on a confervés par refpeél.lll. 234. a.
Chafuble , ancienne chafuble en ufage dans l’églife. IV.
614. a.
CHAT. Chats fauvages appellés en terme de chaffe chats-
harefls. Defeription de ces chats fauvages , d’après Gefner.
III. 234. a. Quelques caraéleres des chats domeltiques.Tems
où ils entrent en chaleur. Dans cette efpece, la femelle paroît
plus ardente que le mâle. Fruit de 1 accouplement d’un
gros rat avec une chatte, au rapport de Boy le. Portée des
chattes. Quelquefois le mâle tue les petits. Durée de la vie
des chats. Animaux auxquels ils donnent la challe. Des ca-
reffes des chats: danger de leur haleine. On a dit qu’il y avoit
dans les Indes des chats fauvages qui voloient. Singularité
de leur prunelle, par laquelle les chats font en état de voir
la nuit. Ibid. b. D’où vient l’éclat, le brillant qu’on remarque
dans les yeux du chat. Lorfque le chat eft plongé dans l’eau,
fa prunelle fe dilate malgré la grande lumière , & l’on ap-
perçoit diftin&ement le fond de fes veux. Explications que
donnent de ces phénomènes MM. Meri & de la Hire. Ibid.
235. a. Strufture particulière des ongles des chats & des
tigres. Leur talon n’étant pas éloigné du refte du pié , ils
peuvent aifément s’accroupir. Pourquoi les chats & plufieurs
animaux du même genre, quand ils tombent d’un lieu élevé,
tombent ordinairement fur leurs pattes. Pourquoi l’on voit
luire le dos d’un chat, lorfqu’on le frotte à contre-poil. De
la couleur des chats. On dit qu’il n’y a aucun chat mâle de
trois couleurs. Il s’en trouve qui tirent fur le bleu. Ibid. b.
Chat. Struàure des ongles des chats. XI. 479. a , b. Suppl.
IV. 150. a , b. Obfervation fur la prunelle de ces animaux.
'XIII. I73. a. Defcriptidn de l’iris des chats. Suppl. IV. 628.
b. Les chats ne fuent jamais. IV. 383. b. Herbe aux chats.
VIII. 146. a. Impreflion qu’ils reçoivent de la plante nommée
le vrai marum. X. 170. a , b. Effet fingulier que la vapeur
du régule d’antimoine produit fur les chats. II. 653. a. Pour- 2uoi les chats ont des hôpitaux en Egypte. X. 36. b. Chat
es chartreux. Ilj. 223. b. Chat fauvage appcllé quincajou.
XIII. 714.a. Chat monftre. Suppl. III. 333. b.
C hat , ( Mat. méd. ) vertus admirables attribuées à différentes
parties du chat , mais qu’aucun des auteurs qui en
parlent, n’a confirmées par fa propre expérience. Enumération
de ces vertus. Auteurs qui fe font là-deffus copiés les
uns les autres. On recommande d’avoir grand, foin de choifir
un chat mâle ou femelle, félon qu’on a un homme ou une
femme à traiter. III. 236. a.
C hat , ( Art mich. ) ufage qu’on fait de fa peau en pelleterie.
III, 236. aK
C H A T , ( Myth. ) honneurs qu’on lui rendoît en Egypte;
Il eft à préfumer qu’un chat en danger eût été mieux fccouru
qu’un pere ou un ami. Hérodote raconte que quand il arri-
voit quelque incendie en Egypte, les chats étoient agités
d’un mouvement divin , Grc. III. 236. a. — Voye{ Suppl. IH.
16 3 . b.
C h a t , (Pierre de) efpece de pierre calcaire. Son ufage.
III. 236. b.
Ch a t , nom qu’on donne à certaines ardoifes. III. 236. b.
C h a t , ( Marine ) defeription de ce bâtiment dans fes principales
parties , fes dimemions : c’eft un mauvais bâtiment
dont on fe fert dans le nord , mais il contient beaucoup d’ef-
pace 8c porte grande cargaifon. Bois dont on le fait. III.
236. b.
C h a t , ( Artill. ) inftrument dont on fe fert pour examiner
fi les pièces de canon n’ont point de chambre ou de défaut.
III. 236. b.
C hat , ( Art milit. ) efpece de tour qui fervoit anciennement
en France à porter des foldats pour afliéger des places.
XVII. 762. b. m ‘ A '
C h a t d’un plomb : inftrument qui fert à connoitre fi une
piece de bois eft à plomb. III. 236. b.
C h a t , à la monnoie. III. 236. b.
C ha t , ( Bot. ) pié de chat. XII. 339. a , b. Herbe aux
chats. VIII. 149. a.
CHAT-HUANT, oifeaux auxquels on a donné ce nom, &
pourquoi. Chat-huants cornus. IH. 3. a.
Chat-huant , voye[ Hibou. Article fur les chats-huants,
m . 3. b. Chat-huant du Brefil nommé ibijau. VIII. 479. b.
Chat-huant, attribut de Minerve. XV. 730. b.
CHATAIGNES, diverfes maniérés de lespréoarer. Quels
font les marrons les plus eftimés de la France. Peuples à qui
les châtaignes tiennent lieu de pain. Elles caufent des vents
& font difficiles à digérer. Tempéramens qui doivent s’en
abftenir : tempéramens auxquels elles conviennent. Elcâuaire
contre le crachement de fang compofé de farine de châtaignes.
IU. 240. a. Maladie pour lefqucllcs on les recommande.
Cataplafme pour réfoudre les duretés des mammclles, Grc.
Les châtaignes font très-propres à rétablir les convalefccns
des maladies d’automne , & fur-tout les enfans qui , après
ces maladies , relient bouffis , pâles, maigres , avec un gros
ventre & peu- d’appétit. Châtaignes en chocolat, béchique
très-falutaire : cette préparation n’a cependant aucun avantage
fur les châtaignes bouillies , Grc. Les marrons bouillis
font plus faciles à digérer que les rôtis. Préparation qui fe
fait dans les Cévcnnes des châtaignes féchées, connues fous
le nom de châtaignes blanches : il y a lieu de conjeéhirer
qu’elles feroient très-propres à fournir une bonne bicre. Ibid.
b. — Voye^ MARRONS.
Châtaignes, (pain de ) Suppl. III. 233. a, b.
CHATAIGNIER, ( Bot. ) caraélères de ce genre d’àrbre.
III. 236. b. Difpofition & forme des fruits. Le châtaignier eft
un arbre dont on fait beaucoup de cas. Il croît naturellement
dans les climats tempérés de l’Europe occidentale. Sa
defeription. Il tient l’un des premiers rangs parmi les arbres
foreftiers , 8c l’on convient que ce n’eft qu’au chêne feul
qu’il doit céder. On regrette de ne trouver que rarement
à préfent des forêts de cet arbre, qui étoit autrefois fi commun.
Caufe de la perte des châtaigniers dans plufieurs contrées.
Pourquoi il le trouve à préfent une affez grande quantité
de ces arbres dans des pays plus méridionaux que ceux
où l’on préfume que les châtaigniers ont été détruits. Ibid.
, 237. a. Pourquoi ces arbres ne fe font pas repeuplés par fuc-
ccffion tles tems. 11 leur faut une expofition 8t un terrein
convenables, fans quoi ils s’y refufent abfolumcnt. Les végétaux
ont une forte de migration qui les fait paffer d’un pays
à un autre, àmefure qu’ils fe trouvent contrariés par diverfes
caufes. Expofition 8c terrein que les châtaigniers^ demandent.
Us forment de très-belles futaies. Us font très-bonsà
faire du bois-taillis, 8c au bout de vingt ans ils forment déjà
de jolis bois defcrvice. Semence des châtaigniers. Tems de l’année
qu’il faut choifir pour cela, lb’td. b. Précautions à prendre
pour confcrvcr les châtaignes jufqu’au printems , pour les
femer dans cette faifon. Plantation en faraud. Ce que Miller
a écrit fur la façon de faire ces plantations. Ibid. 238. a. Autre
façon de les faire. Semence des châtaignes en pépinière. Maniéré
de les femer ; tems 8c maniéré de les mettre en pépinière.
Culture que les plants exigent lorfqu’ils font en pépinière..
Après trois ou quatre ans on pourra les employer a
former des avenues. Ibid. b. Ces arbres ne gagnent jamais»
la tranfplantion. On doit fe difpcnfcr de les éteter en les traiil-
plantant. Greffe. Si l’on veut avoir de meilleur fruit < u c r -
taignier , il faut le greffer , 8c alors on l’appello maronnter.
Maniéré de le faire. U peut encore fe multiplier e ran les
couchées. Ufage du bois. Pour bien des ouvrages 1
bon que le meilleur cMnc , & pour q.iclqucs cas fi eft meilleur.
Mais il lui eft inférieur pour le «ttauffage , & P°ur “
qualité du charbon 8c des cendres. Châtaignes. Le climat in
Sue beaucoup fur leur qualité & leur groîeur. Il ne faut pa»
CHA CHA *2* attendre qu’elles tombent de l’arbre elles-mêmes. Les châtaigniers
ne produifent abondamment que de deux années
l’une. Comment on confcrve le fruit. Maniéré dont les montagnards
l’emploient. Ibid. 230. a. Feuilles. Les infeftes ne
les attaquent point. Ufage qu’on en fait , foit pour garnir
des lits, foit pour la liticre du bétail. Variétés de cette efpece.
Le maronnicr : cbntrée où il réuffir. Maronnier à feuilles
panachées. Maniéré de le multiplier : terrein qu’il demande.
Petit châtaignier à grappes. Châtaignier de Virginie, ou chin-
kapin. Sa defeription. Terreins où il fe plaît : température 3ni lui convient. Ibid. b. Maniéré de le multiplier. Châtaignier
’Amérique à larges feuilles 8c à gros fruit. Voyageur oui
l ’a découvert. U eft rare en France 8c en Angleterre. Maniéré
de lé femer 8c de le cultiver. Caraétere dminétif de cet
arbre. Ibid. 240. a.
Châtaignier , noms de cet arbre en différentes langues.
Suppl. IL 372. a. Son caraélcre générique. Enumération de
trois elpcces de châtaigniers. Obfervations fur la maniéré de
les cultiver. Ibid. b. Des marronniers. Us ne font que des
variétés du châtaignier provenues de graine. Climat qui leur
convient. Marron du Limoufin. Marron de Lyon. Comment
on peut fe procurer ces variétés. Leur culture. Efpece de châtaignier
nommé chincapin. Ibid. 373. b.
Châtaignier : en quoi le marronnier en différé. X. 144. b.
Culture des châtaigniers en pépinière. XII. 322. b. Châtaigne
d’eau. XVI, 626. b. Obfcrvations fur la greffe du châtaignier,
Suppl. III. 261. b.
CHATEAU, ( Archit. ) comment les châteaux étoient anciennement
conftruits : comment ils le font aujourd’hui. La
plupart de ceux où fe fait la réfidencc des rois de France
n’ont point de foffés , 8c confervent cependant le nom de
châteaux, fur-tout s’ils font en campagne. III. 241. a.
Château d'eau. Deux fortes de bâtimens de ce nom. Décorations
dont ces édifices devroient être enrichis. III. 241. a.
Château, lieu fortifié pour tenir le peuple dansfon devoir,
ou réfifter à l’ennemi. 111. 241. a.
Château, ( Art milit. ) attaque des châteaux. 1. 834. b.
Défenfe des châteaux. IV. 73'9. b.
Château, ( Jurifp. ) principal manoir du fief. Maifons auxquelles
ce titre convient proprement. A qui appartient le
château en fucceflion de nef. 11 y a des feigneurs qui peuvent
obliger les vaffaux à la garde du château. Vaffaux auxquels
a été communiqué le droit de bâtir des châteaux. Conditions
requifes pour bâtir château dans la feigneurie d’un
feigiieur châtelain. Ouvrage à confulter. III. 241. a.
C hate au , ( Marine ) château d’avant. Château d’arriere.
Voye{ G aillards.
C hateau , ( Blafon) meuble de l’écu. Château ouvert,
herfé, ajouré , maçonné , efforé, girouetté. Suppl. II.
373: a.
Château , Suppl. I. 918. a. château girouetté. Suppl. III.
226. b.
C ha te au , (Guillaume)graveur. VIL 867. a.
C hateau-br ian t , ¿dit de. V. 301. b.
C hateau-Gaillard, près Andeiy *(Géogr.HiJl.) anecdote
fur laprife de cette place par Philippe-Augufte. Suppl. II. 373.A.
C hateau-landon , petite ville du Gatinois , autrefois
Vellaunodunum. XVI. 880. b.
C hateau-saint-Ange , (Géogr. ) fort de la ville de Rome.
U fut fait par l’empereur Adrien pour lui fervir de tombe. Defeription
de ce monument. 11 devint une efpece de citadelle
vers le tems d’Honorius, ou du moins fous Belifaire. Dans la
guerre des Goths, les Romains s’y défendirent fouvent ; 8c
le prirent plufieurs fois. Les évêques de Ravcnne, 8c d’autres
enfuite, l’occuperent fuccefltvement , 8c continuèrent
de le ruiner. Origine du nom de château-faint-ange donné à
cet édifice. Statue qui lui fert de couronnement, il fut auffi
appcllé Rocca di crefcenfto. Suppl. II. 373. b. Tréfor, bijoux
oc archives dépofées dans ce château, rrifonniers qu’on y
renferme. Cet édifice réuni au palais du Vatican par une
galerie couverte ou corridor fait par Alexandre VI ,
SuppL II. 374.
Château-Thierri, ( Géogr. ) vieux château dans le comté de
Namur. Supnl. II. ¡ p | \
CHATELAIN, ( j urifp. ) deux fens de ce mot. Châtelain
royal. Origine des châtelains. Ces officiers deftitués en
1310 esc 1316. Leurs fondions. On donna àuffi ce nom,'en
quelques provinces, aux juges des villes. Comment le nom
•e . e“ devenu un titre de feigneurie , au lieu qu’il
ne defignoit auparavant qu’un fimple office. Ces feigneurs
peuvent empêcher de conftruire château ou maifon forte dans
w J ^ T eune fans/i eiIr Perm'ffion. Us font inférieurs aux
narorts. ni. 242. a. Ouvrages à confulter. Ibid. b. ■
des comtes, qu’on nommoit
ejains. XVII. 238. b. Sergent châtelain. XV. 87, a.
X v n A^(EgAIN» ( Martin ) obfervatioris fur cet aveugle né.
’ ( Jur‘fl’- ) deux fehs de ceynor. Différence
¿ntre m 'lm ty â tW Î ie : i II. 242^, ' • '
Chatelet de Paris : juftice royale ordinaire de la capitale
du royaume. Pourquoi on lui a donné ce titre. Comment il
eft prouvé oue la fortereffe appellêe le grand châtelct a été
bâtie par Jules-Céfar. U établit à Paris le confcil fouverain
des Gaules ; 8c Ion tient que le proconful qui préfidoit à
ce confeil , demeuroit à Paris. Ce qui paroît par le féjour
qu’y fit Julien, premier magiftrat de Paris , appcllé prcefcHus
urbis, 8c enfuite comte de Paris. Diverfes dilpofitions faites
du comté de raris, tantôt inféodé , tantôt réuni à la couronne.
Ce comté fous-inféodé à des vicomtes. III. 242. b.
Le châteletfut la demeure des comtes 8c enfuite des prévôts.
Plufieurs rois y alloient rendre la juftice. Les offices du châ-
tclet s’étant donnés à ferme, faint Louis réforma cet abus,
8c inftitua un prévôt de Paris. Officiers que nommoit ce prévôt.
Prévôté des marchands. Bailliage de Paris réuni à la
Êrévôté en 1326. Réédification du grand chârelet en 1660.
rigé en préfidial en x 331. Divifion du châtelet en ancien
8c en nouveau. Leur réunion dix ans après. Jurifdiétions que
comprend le châtelet. Afteffeurs à cette juftice. Attributions
particulières du châtelet. Audiences du châtelet. Ibid. 243. a.
Chambres d’audience. Celle des criées. Celle de l’ordinaire.
Avocats du châtelet. U y eut de tems immémorial des avocats
attachés au châtelet. Ordonnances où il en eft parlé. Origine
du ferment que les avocats prêtoient a chaque rentrée. I l y
a eu pendant long-tems au châtelet des avocats qui n’avoient
été reçus que dans ce fiege. Cependant ceux du parlement
avoient la liberté d’y aller. Préfcntement ils font tous avocats
au parlement. Avocats de l’univerfité, jurés au châtelet.
Avocats du roi du châtelet. Ancienneté de leur établiftement.
Leur nombre en différens tems. Ibid. b. Fonctions des quatre
avocats du roi, [établis par un règlement de 1683. Leur
robe de cérémonie. Vifite qu’ils font des rues de Paris le
jour de la fête du faint Sacrement. Ereflion du bailliage de
Paris ou confervation , par François I. Cérémonial du châtelet.
Entrées des rois & reines à Paris, dans la cérémonie def-
quellcs le châtelct a toujours marché. Ibid. 244. a. Fixation
du rang du châtelct dans ces cérémonies par Henri II. Suite
des entrées des rois & reines à Paris. Ibid. b. Complimens
adreffés par le châtelet. Pompes fúnebres où il a affifté après
les cours , 8c avant toutes les autres compagnies. Ibid. 243.
a. Les Te Deum auxquels il a affifté. Pnblications de paix : le
châtelet y tient le premier rang. Prrfes depoffeffiond’évêques
de Paris. Proccffions générales. Ibid. b. Ailemblées des notables
où s’eft trouvé le lieutenant-civil pour le châtelet. Af-
femblées générales de police. Rédaélion de la coutume. Officiers
appellés certificateurs des criées. Chambres du châtelct.
Châtellenies royales reffortiffantes au châtelet. Chevalier
d’honneur. Chirurgiens du châtelet. Ibid. 246. a. Droits des
officiers du châtelet. Geôliers du châtelet. Huifficrs-audicn-
ciers. Lieutenans. Matrones ou fages-femmes du châtelet.
Ibid. b. Médecins. Officiers du châtelet. Ordre dans lequel
ils font employés fur les états du châtelet. Ibid. 247. a. Anciens
offices fupprimés. Payeur des gages du châtelet. Ibid. b.
Préfident au préfidial. Siège de la prévôté. Prévôtés royales
reffortiffantes par appel au préfidial du châtelet. Receveur des
amendes. Receveur & payeur des épices. Réunions faites au
fiege du châtelet. Subftituts du procureur du roi. Ibid. 248.
a. franflation du fiege du châtelet. On a renvoyé plufieurs
articles concernant les officiers du châtelet à la lettre qui leur
eft propre. Ibid.b.
Châtelet de Paris. Confeil du roi du châtelct. IV. 22. a. 31.
a. Saint Louis a fait enregiftrer Si publier au châtelet plufieurs
ordonnances. V. 703. b. Regiftre fur lequel les nouvelles ordonnances
y font inferites. 703. b. Le châtelct de Paris fut
le. premier fiege qui commença à ufer du fccl royal. VII.
309. a. Confervation ou bailliage de ce châtelet. IV. 41. a.
Droit de fuite qui lui appartient. XV. 649. b. Sa chancellerie.
III. 113. b. Confeillers au châtelet. IV. 23. a. Quatre chambres
entre lefquelles eft partagé l e . fervice des confeillers.
III. 30. a. Chambre civile. 49. b. Chambre criminelle. 31. a.
Colonnes du châtelet, divifion des confeillers en plufieurs
fervices différens : diftinétion des différens fervices : de la
durée de tems pendant lequel lc6 confeillers font employés
à chaque fervice. III. 633. b. U paroît que le châtelet de
Paris eft le premier tribunal oùll y ait eu des places de confeillers
affe&ées à des clercs. IV. 27. a. Les confeillers au
châtelet font les premiers , après les gens du conféil , qui
ont porté le titre de confeillers du roi. IV. 31. a. Prévôt de
Paris, chef du châtelet. XUI. 330. w, b. Sic. Des lieutenans
du prévôt du châtelet. IX. 304. a. 303. b. 307. a. 308. <i.
Confeillers honoraires. IV. 30. a. Commiffaires au châtelet.
III. 703. Juge auditeur. IX. 10. a, b. Notaires. XI. 240. b,—
242. b. Papier timbré dont ils fe fervent. 867. b. — 8Ó9: a.
Scel du châtelet. XIV. 749. a , b. Inftitution des procureurs
au châtelet;XIII. 413. a. Doyen du châtelet. V . 93. a. Garde
des décrets 8c immatricules«: itaeft. VII. 493. a. Sergens du
châtelet. XV. 87. a , b. Chambre du procureur du roi au
châtelet. 111. 36. a, . H'-.... ' ^ .r. ■ '
Chlatelet, ( Géogr.) mârquifafdu1 Châtejet en Bourgogne»