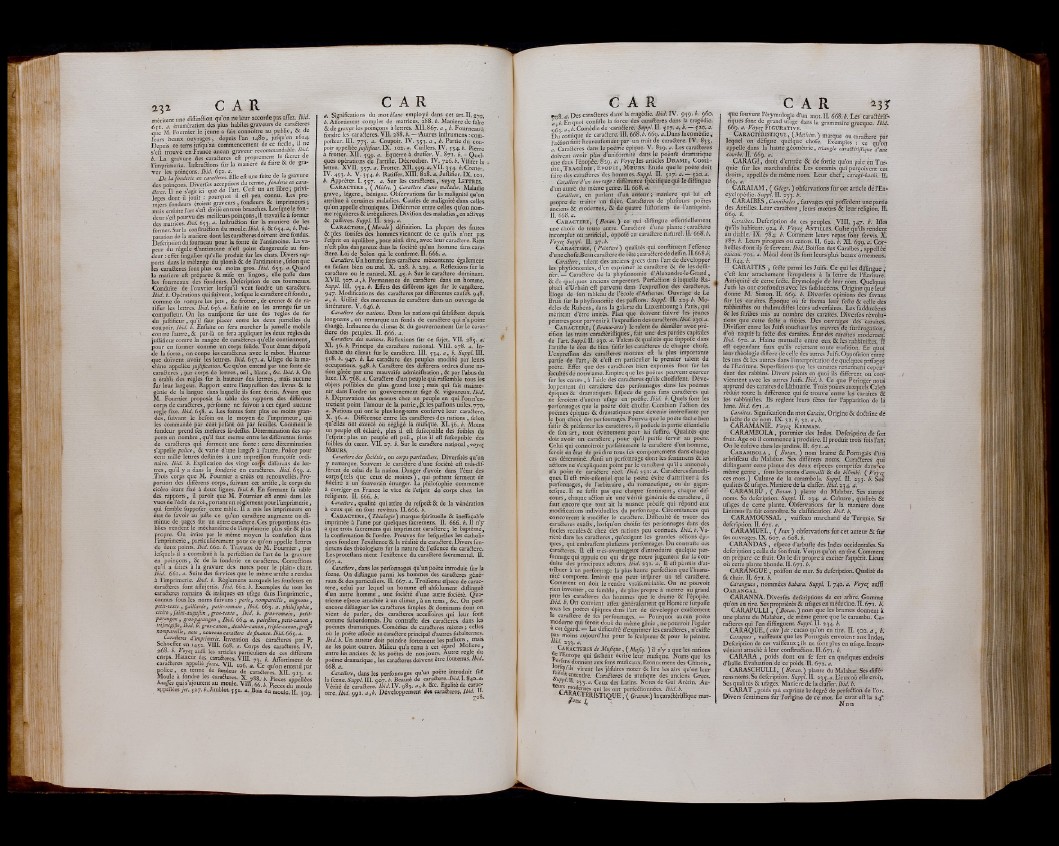
2 3 2 C A R
méritent une diftinâion qu’on ne leur accorde pas affez. Ibid.
6e x. a. énumération des plus habiles graveurs de cara&eres
que M. Fournier le jeune a fait connoître au public, & de
leurs beaux ouvrages, depuis l’an 1480, jufqu’en 1614.
Depuis ce tems jufqu’au commencement dece iiecle, il ne
s’eit trouvé en’France aucun graveur recommandable. Ibid.
b. La gravure des cara&eres ëft proprement le fecret de
l’imprimerie. Inftru&ions fur la maniere de foire « de graver
les poinçons. Ibid. 652. a.
De la fonderie en carattere». Elio eft «ne M !? g «™ *
des poinçons. Diverfes acceptions du tarma, fonderie en curatim
i lin o s'agit ¡d que de l’art. Celi un art libre; privilèges
dont il jouit : pourquoi d eft peu connu. Les premiers
fondeurs étoient graveurs, fondeurs & imprimeurs;
mais enfuite l’art s’eit divifé en trois branches. Lorfque le tondeur
s’eft pourvu des meilleurs poinçons,il travaille à former
des matrices. Ibid. 653. a. Inftru&ion fur la maniere de les
former. Sur la conftru&ion du moule. Ibid. b. &654.J, ¿.Préparation
de la matière dont les cara&eres doivent être fondus.
Defcriptiondufoumeau pour la fonte de l’antimoine. La vapeur
au régule d’antimoine n’eft point dangereufe au fondeur
: effet nngufier qu’elle produit fur les chats. Divers rapports
dans le mélange du plomb & de l’antimoine, félon que
les caraôeres font plus ou moins gros. Ibid. 655. a. Quand
la matière eft préparée &mife en lingots, elle paffe dans
les fourneaux des fondeurs. Defcripdon de ces fourneaux.
Conduite de l’ouvrier lorfqu’il veut fondre un cara&ere.
Ibid. b. Opérations qui fuivent, lorfque le cara&ere eft fondu,
comme de rompre les jets , de frotter, de crener & de ratifier
les lettres. Ibid. 656. a. Enfuite on les arrange fur un
compofteur. On les tranijporte fur une des réglés de fer
du juftifieur, qu’il fout placer entre les deux jumelles du
coupoir. Ibid. b. Enfuite on fera marcher la jumelle mobile
contre l’autre, & par-là on fera appliquer les deux réglés du
juftifieur contre la rangée de cara&eres qu’elle contiennent,
pour en former comme un corps folide. Tout étant difpofé
de la forte, on coupe les caraûeres avec le rabot. Hauteur
que doivent avoir les lettres. Ibid. 657. a. Ufage de la machine
appellée juftification. Ce qu’on entend par une fonte de
cara&eres , par corps de lettres, oeil, blanc, Ere. Ibid. b. On
a établi des réglés fur la hauteur des lettres, mais aucune
fur leur largeur. Rapport entre l’imprefiion des livres & le
génie de la langue dans laquelle ils font écrits. Avant que
M. Fournier proposât fo râble des rapports des différens
corps de caraâcres, përfonne ne fuivoit à cet égard aucune
regie fixe. Ibid. 658. a. Les fontes font plus ou moins grandes,
fuivant le befoin ou le moyen de l’imprimeur, qui
les commande par cent pefont ou par feuilles. Comment le
fondeur prend fes mefures là-deffus. Détermination des rapports
en nombre, qu’il fout mettre entre les différentes fortes
de cara&eres qui forment une fonte : cette détermination
s’appelle police, 8c varie d’une langufe à l’autre. Police pour
cent mille lettres deftinées à une imprefiion françoife ordinaire.
Ibid. b. Explication des vingt corps différens de lettres,
qu'il y a dans la fonderie en caraâeres. Ibid. 659. a.
.Trois corps que M. Fournier a créés ou renouvellés. Proportion
des différens corps, fuivant cet artifte, le corps du
cicéro étant fixé à deux lignes. Ibid. b. En formant fo table
des rapports, il paroit que M. Fournier eft entré dans les
vues de l’édit du roi, portant un règlement pour l’imprimerie ,
qui femble foppofer cette table. Il a mis les imprimeurs en
état de fovoir au jufte ce qu’un caraâere augmente ou diminue
de pages fur un autre cara&ere. Ces proportions établies
rendent le mêchanifme de l'imprimerie plus sûr & plus
propre. On évite par le même moyen la confùfion dans
l ’imprimerie, particulièrement pour ce qu’on appelle lettres
de deux points. Ibid. 660. b. Travaux de M. Fournier, par
lefquels il a contribué à la perfe&ion de l’art de la gravure
en poinçons, & de la fonderie en cara&eres. Correâions
qu’il a faites à la gravure des notes pour le plain - chant.
Ibid. 661. a. Suite des fervices que le même artifte a rendus
à l'imprimerie. Ibid. b. Réglemens auxquels les fondeurs en
cara&eres font affujettis. Ibid. 662. b. Exemples de tous les
cara&eres romains & italiques en ufage dans l’imprimerie,
connus fous les noms fuivans : perle, nompareille , mignonc ,
petit-texte , gaillarde, petit-romain , Ibid. 663. a. philofophie,
cicéro t fatnt-auguflin , gros-texte , Ibid. b. gros-romain, petit-
parangon , gros-parangon , Ibid. 664. a. palefline, petit-canon ,
trifmégific, Ibid. b. gros-canon, double-canon, triple-canon,grojfc
nompareille, nou , nouveau carattere de finance. Ibid. 66e;. a.
Caraûeres d’imprimerie. Invention des cara&eres par P.
Schoeffer en 1452. VIII. 608. a. Corps des cara&eres. IV.
268. b. Voyez auffi les articles particuliers de ces différens
coips. Hauteur des caraâeres. VIII. 7j. i. Aftbrtimeut de
caraâeres appelli fame VII. 106. ». t e entend par
police eu terme de fondeur de caraâeres. XII. 913. a.
Moule à fornire les caraâeres. X ,88.- b. Pieees appellées
W m qwsajoure"! au moule, j V * « pieces dlf moulc
appelkes jet. 517. i.. Jimhlet. ; î I. a. Bols du moule. II. 309.
CAR a. Significations du mot blanc employé dans cet art. II. 270,
b. Aflortiment complet de matrices. 288. b. Maniéré de foire
& de graver les poinçons à lettres. XII. 867. a , b. Fourneau à
fondre les cara&eres. VII. 288. b. — ‘Autres inftrumens : compofteur.
III. 775. a. Coupoir. IV. 353. a , b. Partie du coupoir
appellèejujlifieur. IX. 102. a. Cuillers. IV. 534. b. Pierre
à frotter. XII. 509. a. Equerre à dreffer. V. 871. b. - Quelques
opérations de l’artifte. Décrocher. IV. 726. b. Vifiter la
lettre. XVII. 357. a. Frotter. XII. 599. a. VII. 354. ¿.-Crener.
IV. 453. b. V. 354. b. Ratifier.XIII. 828. a. Juftifier. IX. toi.
b. Apprêter. I. ç 57. a. Sur Tes cara&eres, voye^ Lettres.
CARACTERE , ( Médec. ) CaraElere d’une maladie. Maladie
grave, légère, bénigne. Obfervations fur la malignité qu’on
attribue à certaines maladies. Caufes de malignité dans celles
qu’on appelle chroniques. Différence entre celles qu’on nomme
régulières & irrégulières. Divifion des maladies, en aôives
& paffives. Suppl. 11. 229. a.
C arac tère, (Morale) définition. La plupart des fautes
& (des fottifes des hommes viennent de ce. qu’ils n’ont pas
l’efprit en équilibre, pour ainfi dire, avec leur cara&ere. Rien
n’eft plus dangereux dans la fociété qu’un homme l'ans caraâere.
Loi de Solon qui le confirme. II. 666. a.
CaraElere. Un homme fans cara&ere mécontente également
en foifont bien ou mai. X. 228. b. 229. a. Réflexions fur le
cara&ere ©u le naturel. XL 45. b. Sur le cara&ere dominant.
XVII. 307. 4,3. Permanence du caraâere dans un homme.
Suppl. III. 952. b. Effets des différens âges fur le cara&ere.
947. Modifications des cara&eres par différentes caufes. 948.
a, b. Utilité des morceaux de cara&ere dans un ouvrage de
littérature. V. 646. b.
CaraElere des nations. Dans les nations qui ilibfiftent depuis
long-tems, on remarque un fonds de caraâere qui n’a point
changé. Influence du climat & du gouvernement fur le car a-'
âere des peuples. II. 666. a.
CaraElere des nations. Réflexions fur ce fujet. VII. 285. a.
XI. 36. b. Principe du cara&ere national. VIII. 278. a. Influence
du climat fur le cara&ere. III. 534. a, b. Suppl. III-
518. b. 947. b. Le cara&ere des peuples modifié par leurs
occupations. 948. b. Caraâere des différens ordres d’une nation
gâtée par une mauvaife adminiftration, & par l’abus du
luxe. IX. 768. a. Cara&ere d’un peuple qui raffemble tous les
objets poffibles du plus grand luxe ; mais qui foit maintenir
dans l’ordre un gouvernement fage & vigoureux. Ibid.
b. Dépravation des moeurs chez un peuple en qui l’on n’entretient
point l’amour de la patrie, pc les partions utiles. 770.
a. Nations qui ont le plus long-tems confervé leur caraâere.
X. 36. a. Différence entre les cara&eres des nations, félon
qu’elles ont exercé ou négligé la mufique. XI. 36. b. Moins
un peuple eft éclairé, plus il eft fufceptible des foibles de
l’efprit : plus un peuple eft poli, plus il eft fufceptible des
foibles du coeur. VIL 27. b. Sur le cara&ere national, voyez
Moeurs.
CaraElere des fociètis, ou corps particuliers. Diverfités qu’on
y remarque. Souvent le caraâere d’une fociété eft tres-dif-
férent de celui de la nation. Danger d’avoir dans l’état des
corps (tels que ceux de moines!, qui prêtent ferment de
fidélité à un fouverain étranger. La philofophie commence
à corriger en France le vice de l’eiprit de corps chez les
religieux. IL 666. b.
CaraElere, qualité qui attire du refpe&&de la vénération
à ceux qui en font revêtus. IL 666. b.
Carac tère, ( Théologie) marque fpirituelle & ineffaçable
imprimée à l’ame par quelques focremens. II. 666. b. U n’y
a que trois focremens qui impriment cara&ere; le baptême,
la confirmation & l’ordre. Preuves fur lefquelles les catholiques
fondent l’exiftence 8c la réalité du cara&ere. Divers fen-
timens des théologiens fur la nature & l’effence du cara&ere.
Les proteftans nient l’exiftence du cara&ere facramenteL II.
667. a.
CaraElere, dans les perfonnages qu’un poëte introduit iùr la
feene. On diftingue parmi les hommes des cara&eres généraux
& des particuliers. II. 667. a. Troifieme efpece de caractère
, celui par lequel un homme eft abfolument diftingué
d’un autre homme , une fociété d’une autre fociété. Quatrième
efpece attachée à un climat, à un tems , &c. On peut
encore dntinguer les cara&eres (impies & dominans dont on
vient de parler, des caraâeres acceffoires qui leur font
comme febordonnés. Du contrafte des cara&eres dans les
poëmes dramatiques. Comédies de cara&eres mixtes ; celles
où le poëte affocie au cara&ere principal d’autres fubalternes.
Ibid. b. Un auteur doit peindre fortement les partions, mais
ne les point outrer. Milieu qu’a tenu à cet égard Moliere ,
entre les anciens 8c les poètes de nos jours. Autre réglé dit
poëme dramatique, les cara&eres doivent être foutenus. Ibid*
668. a. . Ë ,
CaraElere, dans les perfonnages qu’un poëte introduit fut
la feene. Suppl. III. 907. b. Beauté de cara&ere../3id.I.840. a*
Vérité de cara&ere. Ibid. IV. 983. 4 ,3. &c. Egalité de caractère.
Ibid. 991. 4,3. Développement des cara&eres. Ibid. HCAR
•08 4. Des cara&eres dans' la tragédie. Ibid. IV. 959. b. 060,
4 3. En quoi confifte la force des cara&eres dans là tragédie.
©6va, 3. Comédiede cara&ere', Suppl.IL 517.4,3. — 520.4.
Du comique de cara&ere; III. 668.3.660. ¿.Dans la comédie,
f’a&ion fiiiit heureufemeht par un trait de càra&ere. IV. 833.
a. Cara&eres dans le poe'me épique. V . 829. a. Les cara&eres
doivent avoir phis d uniformité dans le poënft dramatique
que dans l’épopée. 829. al les articles D r am e , C omédie
T r ag éd ie, Épo p é e , Moeurs. Etude que le poète doit
faire’ des cara&èrcs des hommes. Suppl. II. 517. a. — 520. a.
CaraElere d’un ouvrage : différence lpécifiqüe qui te diftingue
d’un autre du même getire. IL 668.4.
CaraElere, en parlant d’urt aufeur ;• maniéré q'ûî lût eft
propre de traiter un fujet Caia&cïes de plufteurs poëtes
anciens & modernes, & de quatre hiftôriens de Tahtiqtrité.
H. 668. a. • -7 - • -
C arac tère, ( Botan. ) ce qui diftingue effentiellemént
une choie de toute autre. Cara&ere d’une plante : cara&e're
incomplet ou artificiel, ôppôfé au- eâra&ere naftirel. IL 668.3.
Voyez Suppl. II. 27.3. , „
CARACTERE, ( Peifilürè ) qualités qui conftituent l’effence
d’une çhofe.Beaucara&ere de têté jcara&eredôdèflîn. II.668.3;
CaraElere, talent des anciens grecs dans l’art de développer
les phyfionomies, d’en exprimer 16 cara&ere & de lesdeffi-
rier. — Cara&ere de la phyfionomie d’Alexandre-le-Gtarid,
8c de quelques anciens empereurs. Perfe&ion à laquelle RaÊhaël
d’Urbaiii eft parvenu dans l’expreffion des Cara&etes.
loge de fon tableau de l’éddle d’Athenes. Ouvragé de Le
Brun fur la phyfionomie des paffioris. Suppl. IL 229 3. Modèles
de Rubens, dans la galerie du Luxembourg à Paris, qui
méritent d’être imités. Plan que doivent iùivre les; jeunes
peintres pour parvenir à l’expreffion des cara&eres. Ibid. 23c?. 4.
CARACTERE,- ( Beaùx-àrts) le talent de démêler aVec pré-
cifion lés traits cài'a&ériftiqües, foit une des pairies capitales
de l’art. Suppl. II. 230. a. Taleiis & qualités que fuppofe dans
l’artifte le don de bien faifir les câra&eres de chaque chofe.
L’cxpreffion des câra&eres moraux eft la plus importante
partie dé l’art, & c’eft eh particulier le premier talent du
poëte. Effet que des cara&eres bien èxprimés font fur les
facultés de notre ame. Empire que les poëtes peuvent exercer
fur les coeurs, à l’aide des cara&eres qu’ils clioififfent. Développement
du cara&ere des-perfonnages dans les poëmes
épiques 8c dramatiques. Efpece de gens fans cara&eres qui
ne feraient- d’aucun ufage en poéfie. Ibid. 3. Quels font lés
perfonnages que le poëte doit ehoifir. Combien l’a&ion des
poëmes épiques & dramatiques peut devenir intéreffante par
le bon choix des perfonnages. Pourvu que le poëte foche bien
faifir 8c préfenter les cara&eres, il pofledé la partie effentieile
de fon art, tout événement peut lui fuffire. Qualités que
doit avoir un caraâere j pour qu’il puiffe fervir au poete.
Celui qui connoîtroit parfaitement le caraâere d’un homme,
ferait en état de prédire tous fes comporremens dans chaque
cas déterminé. Ainfi un perfonnàge dont-les fentimens &leS
a&ions ne's’expliquent point par le cara&ere qu’il a annoncé,
n’a point de cara&ére réel. Ibid. 231- a. Cara&eres fontâfti-
ques. Il eft très-effentiel que le poète évite d’attribuer à fes
perfonnages, de l’arbitraire, du romanefque, ou du gigan-
tefque.il ne fùfitt pas que chaque fentinient, chaque discours,
chaque a&ion ait une vérité générale de cara&ere, il
fout encore que tout ait la nuance précife qui répond ami
modifications individuelles du perfonnàge. Circonitances qui
Concourent à modifier le cara&ere. Difficulté de tracer des
cara&eres exa&s, lorfqu’on chôifit fes perfonnages dans des
fiecles reculés & chez des nations peu connues. Ib ïd .b .y a-
riété dans les cara&eres, qu’exigent lès grandes aâions épiques
, qui embraffent pluüeurs perfonnages. Du contrafte îles
cara&eres. Il eft très-avantageux d’introdnire quelque per-
fonnage qui appuie ou qui dirige notre jugement fur la conduite
des principaux a&ëùrs. Ibid. 232. a. Il eft pèritiis d’attribuer
à ùn perfonnàge la plus haute perfeâion que l’humanité
comporte. Intérêt que peut infpirer un tel cara&ere.
Comment on doit le rendre vraifemblable. On ne pouvoit
rien inventer, ce femble, de plus propre à mettre au grand
jour les caraâeres des hommes que le drame 8c l’épopée.
Ibid. b. On convient affez généralement qu’Homère furpaffe
tous les poëtes épiques dans l’art de développer exa&ement
le cara&ere de les pèrfonnages. — Pourquoi aucun poëte
moderne qui ferait doué du même génie, ne pourrait l’égaler
a cet égara. —- La difficulté d’exprimer les cara&eres, n’exifte
moins aujourd’hui pour le fculpteur & pour le peintre.
Ibid. 233.4.
. CARACTERES de Mufique, (Mufiq. ) il n’y a que leS nations
p 1 Europe qui fâchent écrire leur mufique. Noms que les
1 erian,f donnent aux fons muficaux. Etonnement des Chinois ,
onqu’ils Virent les jéfiiites noter 8c lire les airs qu’on leur
S* °1/ ! i tench'e- Caraâeres de mufique des anciens Grecs.
a33*<i‘ Ceux des Latins. Notes de Gui Arétin. Au-
/ a d 9l,i les ont perfe&ionnées. Ibid. 3.
^a c TÉRIST1Q U E , ( Çramm.) la çara&ériftique mar-
CAR *3?
«Jitéfouventl’dtymoioÿe d’im mot. H. 6Í8.Í. Les caraSérif-
tiques font de grand ulage dans la grammaire grecque, /tld.
669. 4. Voyez F ig u r a t iv e .
C a r a c t é r i s t iq u e , ( Mathém. ) marque Ou cara&ere bar
lequel On défigne quelque chofe. Exemples : ce qufon
appelle dans la haute géométrie, triangle caraElériflique d’une
cùurbii I I. 669. 4.
CARAGI, droit d’erttrée & de fortie qu’on paie en Turquie
fur les marchandifes. Les commis qui perçoivent ces
droits, appellés du même. nom. Leur chef ; càragi-bachi. II;
669. ai
CARAIAM, ( Géogr. ) obfervations fiir cet article dé l’Encyclopédie.
Suppl. II. 233. b.
CARAÏBES, Cannibales, fouvages qui poffedent une partie
des Antilles. Leur cara&ere ; leurs moeürs & leur religion. IL
669. 3. •
Caraïbes. Defcription de, ces peuples. VIII. 347. 3. IfleS
qu’ils habitent. 924. 3. Voye( A n t i l le s . Culte qu’ils rendent
àu diable.1 IX. 784: 3. Comment leurs repas font fervis. X.
18713. Leurs pirogues ou canots. II. 620. 3. XI. 699, al Cor-
beillès dont ilj fe fervent. Ibid. Boiffon des Caraïbes, appellée
ouicou. 702. 4. Métal dont ils font leurs plus beaux Omemehs;
II.644.3.
CARAITES , fcâe parmi les Juifs. Ce qui les diftingue
c’eft leur attachement lcrupuleux à la lettre de l’Ecriturè.
Antiquité de cette.fe&e. Étymologie de leur nom. Quelques
Juifs les ont Confondus avec les fodducéens. Origine que leuf
donne M. Simon. II. 669; 3. Diverfes opinions des favans
fur les' caraïtes. Époque où fe forma leur fe&¿ & celle des
rabbiniftes ou thalmuaiftes leurs adverfoires. Lés faddu'céenS
8c les feribes mis au nombre des caraïtës. Diverfes révolutions
que cette fe&e a fubies. Des ouvrages dés" caraïtes.
DiviftôH entre les Juifs touchant les oeuvres dç fùféf'pgation,'
d’où naquit la fe&é des caraïtes. État des caraïtes môaernés:
Ibid. 670. 4. .Haine mutuelle entre eux 8c les^rabbiniftes. Il
eft cependant foux qu’ils rejettent toute tradítibií. En qûoi
léur théologie diffère de celle des autres Juifs. Oppofirion entré
les uns « les autres dans l’interprétation de quelques paffageà
de l’Ecriture. Superftitions que les caraïtes retiennent cependant
des rabbins. Divers points eñ quoi Ü différent ou conviennent
avec les autres Juifs. Ibid. b. Ce que Peringer notó
apprend des caraïtes de Lithuanie. Trois points auxquels Caleb
réduit toute la différence qui fe trouve entre íes’ caraïtes 8¿
lès rabbiniftes. Ils règlent leurs fêtes for l’apparition de là
lune. Ibid. 671.a.
Caraïtes. Signification du mot Caraïte. Origine ¿C do&rine dè
la fe&e de ce nom. IX. 31. 3. 3 2.4 , 3.
CARAMANIE. Voyc{ K erman.
CARAMBOLA, pommier des Indes. Defcription de fon
fruit. Age où il commence à produire. Il produit trois fois l’an.1
On le cultive dans les jardins. IL 671.a.
C a ram bola , ( Botan, ) nom brame 8c Portugais d’uni
arbriffeau du Malabar. Ses différens noms. Cara&eres ùui
diftinguent cette plante des deux efpeces comprimes dahsfee
même genre , fons les noms à’amvalli & de bilimbi. (‘ Voyez
ces mots. ) Culture de la carambola. Suppl. H. 233. b. Ses!
qualités 8c ufages. Maniera de la dafier. Ibid. 234. a.
CARAMBU, ( Botan. ) plante du Malabar. Ses autre?
noms. Sa defcription. Suppl. IL 234. a. Culture, qualités 8t
ufages de cette plante. Obfervations for la maniere dont
Linrraus l’a fait connoître. Sa claffificatioti. Ibid: b.
CARAMOUSSAL , vaiffeau marchand de Turquie. Sa'
defcription. H. 671.4.
CARAMUEL, ( Jean ) obfervations for cet auteur 8c fut*
fes ouvrages. IX. 607. a. 608.3.
CARANDAS , efpece d’arbufte des Indes occidentales. Sa
defcription ; celle,de fon fruit. Verjus qu’on en tire; Comment
on prepare ce fruit. On le dit propre à exciter l’appétit. Lieux
où cette plante abonde. II. 671.3.
CARANGUE , poifton de mer. Sa defcription. Qualité de
fa chair. IL 671. b.
Carangues, nommée? babara. Suppl. I. 740. 4. Voyez auffi
O a r a n g a l .
CARANNA. Diverfes deferiptions de cet- arbre. Gomme
qu’on en tire. Ses propriétés 8c ufages en'médecine. II. 671. bl
CARAPULLI , (Botan. ) nom que les brames donnent 2
une plafite du Malabar, de même genre que le carambu. Cara&
eres qui l’en diftinguent. Suppl.I I. 234.3.
CARAQUE, (côte)de:cacao qu’on en tire. II. 500. 4 , 31
Caraques , vaiffeaux que les Portugais envoient aux Indes.
Defcription de ces vaiffeaux ; ils ne. font plus en ufage. Incon»
vénient attaché à leur conftru&ion. II. 671. 3.
C ARARA , poids dont on fe fert en quelques endroit?
d’Italie. Évaluation de ce poids. H. 672. a.
CARASCHULLI, ( Botan.) plante du Malabar. Ses différens
noms. Sa defcripdon. Suppl. II. 23 5.4. Lieux où elle'croît.
Ses qualités 8c ufages. Maniere de la claffer. Ibid. b.
CARAT , poids qui .exprime le degré de perfeâion de l’or.
Divers fentimens f e r l’origine de- ce mot. Le carat eft la 24*
Nnn