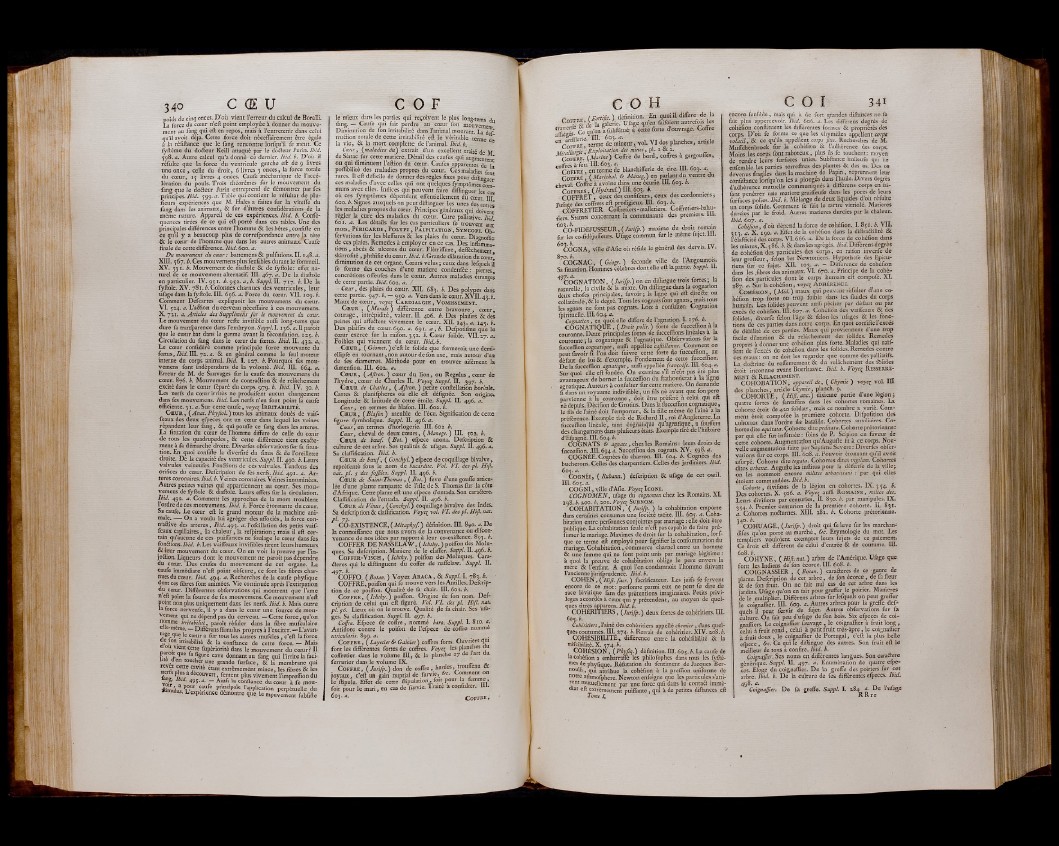
340 C <3E U C O F
poids de cinq onces. D ’où vient l’erreur du calcul de Borelli.
La force du coeur n’eft point employée à donner du mouvement
au iâng qui eft en repos, mais à l’entretenir dans celui
qu’il avoit déjà. Cette force doit nécessairement être égale
à la réfiftance que le fang rencontre lorfqu’il fe meut. Ce
fyftême du doéleur Keill attaqué par le doéleur Jurin. Ibid.
508. a. Autre calcul qu’a donné ce dernier. Ibid. b. D’où il
refulte que la force du ventricule gauche eft de 9 livres
une once, celle du droit, 6 livres 3 onces, la force totale
du coeur, 13 livres 4 onces. Caufe méchanique de l’accélération
du pouls. Trois théorèmes fur le mouvement du
fang que le doéleur Jurin entreprend de démontrer par fes
principes. Ibid. 399. a. Table qui contient le réfultat de plu-
fieurs expériences que M. Haies a faites fur la vîteffe du
fang dans les animaux, & fur d’autres coniidérations de la
même nature. Appareil de ces expériences, lbid. b. Confé-
quences tirées de ce qui eft porté dans ces tables. Une des
principales différences entre l’homme 8c les bêtes, confifte en
ce qu’il y a beaucoup plus de correfpondance entre la tête
& le coeur de l’homme que dans les autres animaux. Caufe
finale de cette différence. Ibid. 600. a.
Du mouvement du caur: bat remens & pu 1 fat ions. II. 148. a.
XIII. 367. b. Ces mouvemens plus fenfibles durant le fommeil.
XV. 331. b. Mouvement de diaftole 8c de fyftole: effet naturel
de ce mouvement alternatif. III. 467. a. De la diaftole
en particulier. IV. 951. b. 932. a,b. Suppl. II. 717. b. De la
fyftole. XV. 781.¿.Colonnes charnues des ventricules, leur
ufage dans la fyftole. III. 656. a. Force du coeur. VII. 109. b.
Comment Defcartes expliquoit les mouvemens du coeur.
VI. 324. a. L’aéfion du cerveau néceffaire à ces mouvemens.
X. 721. a. Articles des Supplèmehs fur le mouvement du coeur.
Le mouvement du coeur refte invifible aiiifi long-tems que
dure fa tranfparence dans l’embryon. Suppl. 1. 136. a. Il paroit
que le coeur bat dans le germe avant la fécondation. 123. b.
Circulation du fang dans le coeur du foetus, lbid. II. 432. a.
Le coeur confidéré comme principale force mouvante du
foetus, Ibid. III. 72. a. 8c en général comme le feul moteur
interne du corps animal. Ibid. ï. 127. ¿. Pourquoi fes mouvemens
font indépendans de la volonté, lbid. III. 664. a.
Erreur de M. de Sauvages fur la caufe des mouvemens du
coeur. 876. b. Mouvement de contraâion 8c de relâchement
excité dans le coeur féparé du corps. 979. b. Ibid. IV. 30. b.
Les nerfs du coeur irrités ne produifent aucun changement
dans fes mouvemens. Ibid. Les nerfs n’en font point la caufe
efficiente. 31 .a.Sur cette caufe, voyeç I r r it a b il it é .
Coeur, (Anat. Phyfiol.) tous les animaux doués de vaiffeaux
des deux efpeces ont un coeur dans lequel les veines
répandent leur fang, & qui pouffe ce fang dans les arteres.
La fituation du coeur de l’homme différé de celle du coeur
de tous les quadrupèdes, 8c cette différence tient exactement
à fa démarche droite. Diverfes obfervarionsfur fa fituation.
En quoi confifte la diveriité du finus & de l’oreiÜette
droite. De la capacité des ventricules. Suppl. II. 490. b. Leurs
valvules veineufes. Fondions de ces valvules. Tendons des
orifices du coeur. Defcription de fes nerfs. Ibid. 491. a. Arteres
coronaires, lbid. b. Veines coronaires. Veines innommées.
Autres petites veines qui appartiennent au coeur. Ses mouvemens
de fyftole & diaftole. Leurs effets fur la circulation.
Ibid. 492. a. Comment les approches de la mort troublent
l’ordre de ces mouvemens. Ibid. b. Force étonnante du coeur.
Sa caufe. Le coeur eft le grand moteur de la machine animale.
— On a voulu lui agréger des affociés, la force con-
traôive des arteres, Ibid. 493. a. l’ofdllation des petits vaiffeaux
capillaires, la chaleur, la refpiration ; mais il eft certain
qu’aucune de ces puiffances ne foulage le coeur dans les
fondions. Ibid. b. Les vaiffeaux invifibles tirent leurs humeurs
& leur mouvement du coeur. On en voit la preuve par l’in-
jedion. Liqueurs dont le mouvement ne paroît pas dépendre
du coeur. Des caufes du mouvement de cet organe. La
caufe immédiate n’eft point obfcure, ce font les fibres charnues
du coeur. Ibid. 494. a. Recherches de la caufe phyfique
dont ces fibres font animées. Vie continuée après l’extirpation
du coeur. Différentes obfervations qui montrent que l’ame
n eft point la fource de fes mouvemens. Ce mouvement n’eft
point non plus uniquement dans les nerfs, lbid. b. Mais outre
la force nerveufe, il y a dans le coeur une fource dè mouvement
qui ne dépend pas du cerveau. — Cette force ,• qu’on
irritabilité, paroît réfider dans la fibre mufculaire
e le-mème. — Différons ftimulus propres à l’exciter. — L’avan-
age que le coeur a fur tous les autres mufcles, c’eft la force
on irritabilité 8c la confiance de cette force. — Mais
narrtî7ICnt H Ü ^“P^orité dans le mouvement du coeur? Il
tut. JÉ P i r&ure cave donnant au fang qui l’irrite la faci-
*°'ack«r une grande furface, & la membrane qui
_-/• , ® cavité étant extrêmemént mince, les fibres & les
découvert, fentent plus vivement l’impreffion du
vcm J ' 1111 a‘ 7 “ k confiance du coeur à fe mou-
¿Siffm Pi°"r f " fe pri?Cipak l’aPPKcation perpétuelle du
»mute. L expérience démontre que lempuvemem fubftfte
le mieux dans les parties qui reçoivent le plus long-tems d
fang. — Caufe qui fait perdre au coeur fon mouvement
Diminution de fon irritabilité dans l’animal mourant. La def
truélion totale de cette irritabilité eft le véritable terme dè
la vie, 8c la mort complctte de l’animal. Ibid. b.
Caur, (maladies du) extrait d’un excellent traité de M
deSénac fur cette matière. Détail des caufes qui augmenten*
ou qui diminuent l’aélion du coeur. Caufes apparentes de 1
poffibilité des maladies propres du coeur. Ces maladies font
rares. Il eft difficile de donner des réglés fixes pour diftmeuer
ces maladies d’avec celles qui ont quelques fymptômes communs
avec elles. Indices qui peuvent faire diflinguer les cas
ou ces fymptômes dépendent effentiellement du coeur. III
600. b. Signes auxquels on peut diflinguer les unes des autres
les maladies propres du coeur. Principes généraux qui doivent
régler la cure des maladies du coeur. Cure palliative. Ibid.
601. a. Les détails fur les cas particuliers fe trouvent aux*
mots, Pé r i c a r d e , P o l y p e , Pa l p i t a t io n , Sy n c o p e . Obfervations
fur les bleflùres & les plaies du coeur. Diagnoflic
de ces plaies. Remedes à employer en ce cas. Des inflammations,
abcès & ulcérés du coeur. Flétriflùre, defféchement
skirrofité, phthifie du coeur. Ibid. ¿.Grande dilatation du coeur*
diminution de cet-organe. Coeurs velus; ceux dans lefquelsil
fe forme des couches d’une matière condenféé : pierres
concrétions ofTeufes dans le coeur. Autres maladies étranges
de cette partie. Ibid. 602. a. /
Coeur y des plaies du coeur. XII. 683. b. Des polypes dans
cette partie. 947. b. — 930. a. Vers dans le coeur. X v ll. 43. ¿.
Maux de coeur, voyer C a r d ia l g ie , V omis sem en t .
C oe u r , (Morale ) différence entre bravoure , coeur,
courage, intrépidité, valeur. II. 406. b. Des plaifirs 8c des
peines qui affectent vivement le coeur. XII. 143. a. 143. b.
Des plaifirs du coeur. 690. a. 691- a , b. Defpotifme que le
coeur exerce fur la raifon. 332. b. Coeur foible. VH. 27. a.
Foibles qui viennent du coeur. IbidA>.
C oe ur , ( Géomet. ) c’eft le folide que formerait une demi-
ellipfe en tournant, non autour de fon axe, mais autour d’un
de fes diamètres. Méthode pour en trouver aifément la
dimenfion. III. 602. a.
C oe u r , (Aftron.) coeur du lion, ou Regulus, coeur de
l’hydre, coeur de Charles II. Voye[ Suppl. II. 397. ¿.
C oe u r de Charles, ( Aftron. ) petite conflellation boréale.
Cartes & planifpheres où elle eft défignée. Son origine»
Longitude & latitude de cette étoile. Suppl. IL 496. a.
Coeur t en termes de blafon. III. 602. b.
C oe u r , ( Blafon) meuble de l’écu. Signification de cette
figure fymbolique. Suppl. ü . 496.' a.
Coeur, en termes d’horlogerie. HI. 602 b.
Coeur y cheval de deux coeurs, (Manege.) III. 302. b.
C oe u r de boeuf. (Bot. ) efpece anona. Defcription &
culture de cet arbre. Ses qualités & ufages. Suppl. II. 496. a.
Sa claffification. Ibid. b.
C oe u r de boeuf y ( Conchyl. ) efpece de coquillage bivalve,
repréfenté fous le nom de bucardite. Vol. VI. des pl. Hiß.
nat. pl. y 'des foffiles. Suppl. IL 496. b.
C oe u r de Saint-Thomas, (Bot.) feve d’unegouffearticulée
d’une plante rampante de p flg de S. Thomas fur la côte
d’Afrique. Cette plante eft une efpece d’entada. Son caraétere.
Claffification de l’entada. Suppl. II. 496. b.
C oe ur de Vénus, (Conchyl.) coquillage bivalve des Indes.
Sa defcription & claffification. Voyeç vol. VI. des pl. Hift. nat.
pl. 7 ?.
CÖ-EXISTENCE, ( Mètaphyf. ) définition, m. 890. a. De
la connoiffance que nous avons de la convenance ou difeon-
venance de nos idées par rapport à leur co-exiftence. 893. b.
COFFER DE NASSELAW, (Ichtky.) poiffon des Molu-
ques. Sa defcription. Maniéré de le daller. Suppl. II. 496. b.
C o f f e r - V is cH , ( Ichthy. ) poiffon des Moluques. Cara-
éleres qui le diflinguent du coffer de naffelaw. Suppl. II.
497. b.
COFFO. (Botan. ) Voyez A b a c a , & Suppl.I. 783. b. •
COFFRE, poiffon qui le trouve vers les Antilles. Defcription
de ce'poiffon; Qualité de fa chair. III. 602. b.
C o f f r e , (Ichthy?) poiffon. Origine de fon nom. Defcription
de celui qui eft figuré. Vol. VI. des pl. Hift. nat.
pl. $6. Lieux où on le trouve. Qualité jle fa chair. Ses 'ufages.
Sa claffification. Suppl. II. 497. b.
Coffre. Efpece de coffre, nommé baro. Suppl. I. 810. a.
Antidote contre le poifon de l’efpece de coffre nommé
utricularis. 899. a. , .
C o f f r e , ( Layetier 8 Gainier ) coffres forts. Ouvriers qui
font les différentes fortes de coffres. Voye[ les planches du
coffretier dans le volume III, & la planche 27 de lart du
ferrurier dans le volume IX . _ 0,
C o f f r e , (Jurifp.) don de coffre, bardes, trouffeau &
joyaux, c’eft un gain nuptial de furvie, 8c. Comment on
le flipule. Effet de cette flipulation, fret pour la femme,
foit pour le mari, en cas de furvie. Tratte à confulter. III.
“ ■ c o f f m ;
C O H COI 341 « (Eortifiç. ). définition. En quoi d t d i f e de la
¿ & d e la galerie. Ufa ge qtfen feifotent autrefois les
m g m C e qu’on a fubffifu^ m M t o n . d’ouvrage. C offre
— * TTT / q . ß
ä f i g g g i terme de miimuf » vol. VI des planches, article
a a w a B M B a w W w W «•««. p1,- 1 _
COFEM. (Afai-itie) Coffre de bord, coffres à gargouffes,
“ c o f f r e ! enrermede blancbtfferie de cire. III. 603. a-,
CÔÉÉRE, ( Marichal. & Maner.) en parlantdu ventre du
t-Feval Coffre à "avoine daps une écurie. III. 603. 4.
C o f fr e s , (Hydrant.) Ul. 603. i.
COFFRET, ceux des confifeurs, ceux des cordonniers;
l’nfage des coffrets ell prodigieuXi IIL 603. i,
COFFRETIER- Coffretiers - malleners. Coffretiers-bahu-
tiers. Statuts concernant la communauté des premiers. 111;
É0£o-FIDEJUSSEUR , ( Jurifp. ) maxime du droit romain
fur les co-fidéjuffeurs. Ufage commun fur le même fujet. III.
60£o GNA, ville d’Afie où réfide le général des dervis. IV.
^COGNAC, ( ôéogr. ) fécondé ville de l’Angoqmois;
Sa fituation. Hommes célébrés dont elle eft la patrie. Suppl. 11;
COGNATION, (Jurifp-) on en diftingtie trois fortes; la
naturelle, la civile & la mixte. On diftinguedans la çognation
deux chofes principales, favoir ; la ligne qui eft ^ireéle ou
collatérale, & le degré. Tous les cognats font agnats, jnais tous
les agnats ne font pas cognats. Loix à confulter; Çognation
fpirituelle. III. 604. a.
Cognation y en quoi elle diffère de l’agnation. 1. 176. b.
COGNATIQUE, (Droit polit.) forte de fucceifion à la
couronne. Deux principales fortes de fucçeffions finéales à la
couronne ; la cognatique & l’agnatique. Obfervations fur la
fucceifion cognatique, auffi appellée caßillanne. Comment on
peut favoir fi l’on doit fuivre cette forte de fucceifion, au
défaut de loi & d’exemple. Fondement de cette fucceifion;
De la fucceifion agnatique , auffi appellée françoife. III. 604. a.
Sur quoi elle eft fondée. On examine s’il n’eût pas été plus
avantageux de borner la fucceifion du ftathouderat à la ligne
agnatique. Auteurs à confulter fur cette matière. On demande
fi dans un royaume indivifiblè, un fils né avant que fonpere
parvienne à la couronne, doit être préféré à celui qui eft
né depuis. Décifion de Grotius. Dans la fucceifion cognatique,
le fils de l’aîné doit l’emporter, & la fille même de 1 aîné a la
préférence. Exemple tiré de Richard II, roi d’Angleterre.La
fucceifion linéale', tant cognatique qu’agnatique, a fouffert
des changemens dans plufieqrs états. Exemple tiré de l’hiftoire
d’Efoagne. III. 604. b.
COGNATS 6* agnats, chez les Romains : leurs droits de
fucceifion. .III. 694 a. SuccçflÎon des cognats. XV. 398. a.
COGNÉE. Cognées du charron. III. 604. b. Cognées des
bûcherons. Celles des charpentiers. Celles des jardiniers. /*/«/..
Coq. a. ■ " .1
C o g n é e , ( Rubaun. ) defcription & ufage de cet putil.
HI. 603.«.
COGNI, ville d’Afie. Voye{ I c ô n e .
COGNOMEN y ufage du cognomen chez les Romains. XI.
198. *. aoo. *. 201. Voye{ Su r n o m .
COHABITATION, ( Jurifp. ) la cohabitation emporte
dans certaines coutumes une fociété tacite. IU. 603. a. Cohabitation
entre perfonnes conjointes Dar mariage : elle doit être
publique. La cohabitation feule ri’eft pas capable de faire préfumer
le mariage. Maximes de droit for la cohabitation, lorf-
que ce terme eft employé pour fignifier la confommarion du
mariage. Cohabitation, commerce charnel entre un homme
& une femme qui ne font point unis par mariage légitime :
à quoi la preuve de cohabitation oblige le pere enyers la
mere & l’enfant. A quoi l’on condamnoit l’homm.e foivant
l’ancienne jiirifprudence. Ibid. b.
COHEN, (Hift. facrA facrificateur. Les juifs fe fervent
encore de ce mot : perionne parmi eux ne peut fe dire de
race lévitique fans des prétentions imaginaires. Petits privileges
accordés à ceux qui y prétendent, au moyen de quelques
titres apparens. Ibid. b.
COHÉRITIERS, (Jurifp. ) deux fortes de cohéritiers. ÏÏI.
603. *.
Cohéritiers, l’aîné des cohéritiers appellé chemier , dans quelques
coutumes. HL 274. *. Retrait de cohéritier. XIV. 208. *.
COHÉSIBILITÉ, différence entre la cohéfibàlité 3c la
mifcibiÎité. X. 374. b.
COHÉSION, ( Phypq. ) définition. HI. 603. *. La caufe de
la cohéfion a embarrafïe les philofophes dans tous les fyfiê-
mes de phyfique. Réfutation du fentiment de Jacques Ber-
noulli, qui attribue la cohéfion à la preflion uniforme de
notre athmofphere. Newton enfeigne que les particules s’attirent
mutuellement par une force qui dans le contait immédiat
eft extrêmement puiftante, qui à de petites diftances eft
Tome I,
encore fonfiblè, mais qui à de fort grandes diftances ne fe
fait plus appercevoir. lbid. 606. a. Les différons degrés de
cohéfion cçnflituent les différentes formes & propriétés des
corps- D’où fe forme ce que les chymilles appellent corp/t
volatil, ‘¡fc ce qu’ils, appellent corps fixe. Recherches de M.
Mufîcbenbroek fur la çoliéfion 8c l’adhérence des corps.
Moins les corps font raboteux, plus ils fe touchent: moyen
de rendre ieurs furfàces unies. Subftance huileufe qui lie
enfomble les parties terreftres des plantes 8c des os. Des os
devenus fragiles dans la machine de Papin, reprennent leur
confiftance lorfqu’on les a plongés dans l’huile. Divers degrés
d’adhérence mutuelle communiqués à différons corps en fai-
fant pénétrer titié matière graifleufè dans les pores de leurs
forfaces polies. Ibid. b. Mélange de deux liquides d’où réfulte
un corps folide. Comment fe fait le tartre vitriolé. Maueres
durcies par le froid. Autres matières durcies par la chaleur.
Ibid. 607. a. . r o i trrr
Cohéfion, d’où dépend la,force de cohéfion.. I. 831. b. Vil.
313. a. X. 190. a. Effet de la cohéfion dans la diftraélilité 8c.
l’élaflicité des corps. VI. 666. a. De la force de cohéfion dans
les mixtes, X. 386. *. 8c dans les agrégés, lbid. Différons degrés
de cohéfion des particules des corps, en raifon inverfe de
leur groffeur, félon les Newtoniens. Hypothefe des Epicuriens
fur ce fujet. XII. 103. a. - Différence de cohéfion
dans les .fibres des animaux. VI. 670. a. Principe de la cohéfion
des particules dont le corps humain eft compofé. XL
287; a. Sur la cohéfion, voye^ A dh é r e n c e . .
COHÉSION, (Méd.) maux qui peuvent réfulter dune cohéfion
trop forte ou trop foible dans les fluides du corps
humain: Les folides peuvent auffi pécher par défaut ou par
excès de cohéfion. III. 607. a. Cohéfion des vaiffeaux 8c des
folides, diverfe félon l’âge & félon les ufages 8c les fonctions
de ces parties dans notre corps. En quoi confifte l’exces
de débilité de ces parties. Maux qui proviennent d’une trop
facile dilatation 8c du relâchement des folides. Remedes
propres à donner une cohéfion plus forte. Maladies qui naif-
fent de l’excès de cohéfion dans les folides. Remedes contre
ces maux: on ne doit les regarder que comme des palliatifs.
La doRrine du refferrement 8c du relâchemènt des folides
étoit inconnue avant Boerhaave. Ibid. b. Voye| R esserrem
e n t 8c R e lâ ch em en t .
CÓHOBATION, appareil de, ( Chymie ) voyc^ vol. 111
des planches ; article Chymie-, planch. 9. . (
COHORTE, (Hift.anc.) dixième partie dune légion;
quatre fortes de fentaffms dans les cohortes romaines. La
cohorte étoit de 420 foldats, mais ce nombre a varié. Comment
étoit compofée la première cohorte. Difpofition des
cohortes dans l’ordre de bataille. Cohortes auxiliaires. Cohorte
dite e qui tata. Cohorte dite peditata. Cohorte prétorienne :
par qui elle fut inft’ituée : foins de P. Scipion en faveur de
cette cohorte. Augmentation qu’Augufte fit à ce corps. Nouvelle
augmentation faite par Septimc Severe: Diverfes obfervations
fur ce corps. HI. 608. a. Pouvoir étonnant qu’il avôit
ùfurpé. Cohorte dite togata. Cohortes dites vigilum. Cohortes
dites urbana. Augufte les inftitua pour la défenfe de la ville;
on les nommoit encore milites urbanitiani : par qui elles
étoient commandées. Ibid. b. (
Cohorte, divifibns de la légion en cohortes. IX. 334. b.
Des cohortes. X. 306. a. Voye[ auffi R o m a in s , milice des.
Leurs diyifions par centuries, II. 830. *. par manipules. IX.
334. *. Premier centurion de la première cohorte. II. 831.
a. Cohortes nofturnes. XHI. 281. *. Cohorte prétorienne.
340. *.
COHUAGE, (Jurifp.) droit qui fe leve fur les marchan-
difes qu’on porte au marché, &c. Etymologie du mot. Les
templiers vouloient exempter leurs fujets de ce paiement;
Ce droit eft différent de celui d’entrée & de coutume. IH.
! 608. *. '
COHYNE, (Hift-nat.) arbre de l’Amérique. Ufage que
- font les Indiens de fon écorce. III. 608. *.
COIGNASSIER , ( Botan. ) caraâeres de ce genre de
Í plante. Defcription de cet arbre, de fon écorce , de fa fleur
i & de fon fruit. On ne fait nul cas de cet arbre dans les
jardins. Ufage qu’on en fait pour greffer le poirier. Manieres
de le multiplier. Différons arbres furlefquels on peut greffer
le coignaffier. HI. 609. a. Autres arbres pour la greffe def-
quels il peut fervir de fujet. Autres obfervations fur fa
culture. On fait peu d’ufâge de fon bois. Six efpeces de coi-
enaffiers. Le coignaffier fàuvage , le coignaffier à fruit long,
celui à fruit rond, celui ài petit fruit très-âpre, le coignaffier
à fruit doux, le coignaffier de Portugal, c’eft la plus belle
efpece, 8c. Ce qui le diftingue des autres. Son fruit eft lé
meilleur de tous à confire. Ibid. b.
Coignaffier. Ses noms en différentes langues. Son caraôere
générique. Suppl. II. 497. a. Enumération de quatre efpeces.
Eloge du coignaffier. De la greffe des poiriers fur cet
arbre, lbid. b. De la ciftture de fes différentes efpeces. lbid*
498. a.
Coignaffier1 De fa greffe. Suppl. I. 284. u. De l’ufagc
i • R R r r