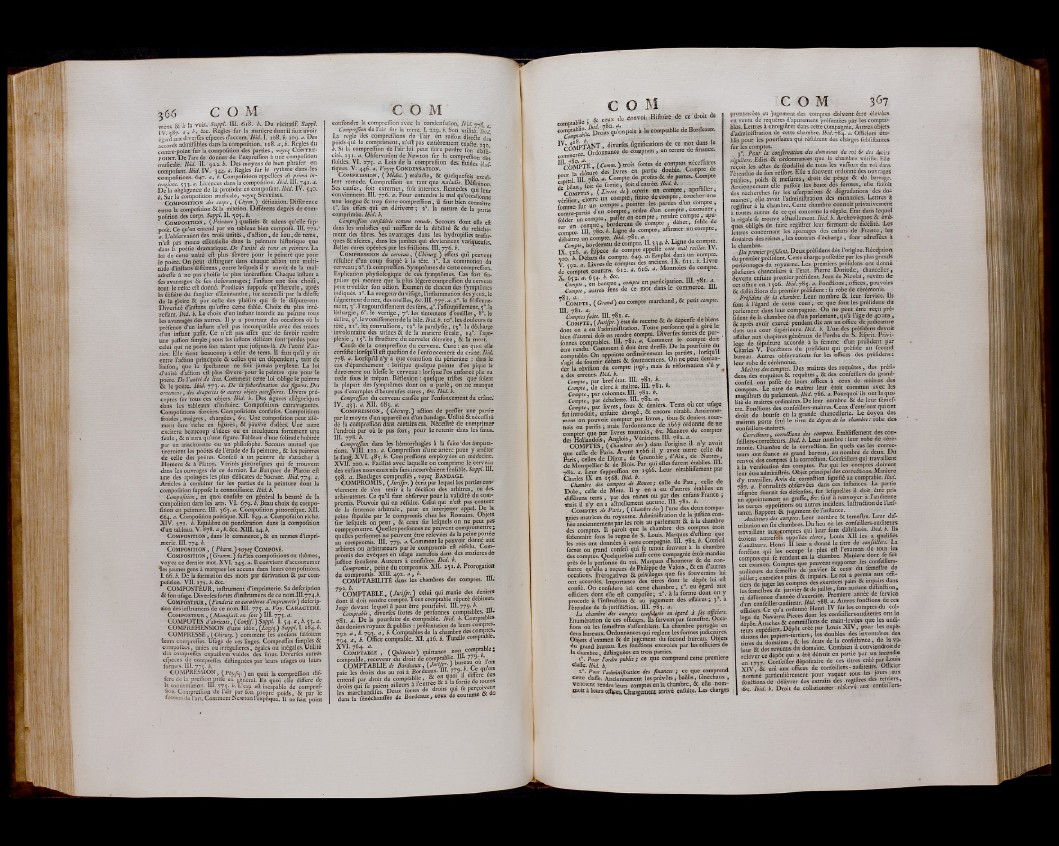
366 C O M
'■mens & à la Voix. Suppl. III. 618. b. Du récitatif. Suppl.
IV. 587. a , b, 8cc. Réglés fur la manière dont il faut avoir
égard aux diverfes efpeces d’acceiit^/é/r/. I. 108. b. 109. a. Des
accords admiifibles dans la compofition. 118. a, b. Réglés du
contre-point fur la compofition des parties, voyeç C o n t r e p
o in t . De l’art de donner de l’expreflion à une compofition j
muficaie. lbid. II. 921. b. Des moyens de bien phrafer en
compofant. Ibid. IV. 344- Réglés fur le rythme dans -les
comportions. 647. a, b. Compoiitions appellées di prima m-
tenzjone. 533. a. Licences dans la compofition. lbid. III. 741. a.
De la négligence de la profodie en compofant. lbid. IV. $40.
b. Sur la compofition muficaie, voyez Système.
* C om p o s i t io n des corps, ( Chymf) définition. Différence
entre la compofition 8c la mixtion. Différens degrés de compofition
des corps. Suppl. II. 505. b. •
• C o m p o s i t i o n , ( Peinture ) qualités & talens qu’elle fup-
pofé. Ce qu’on entend par un tableau bien compofé. III. 77a.*
a. L’obfervâtion des trois unités,- d’aftion, de lieu -, de tèms,
n’eft pas moins effentielle dans la peinture hiftorique que
■dans la poéfie dramatique. De l'imité de tems en peinture. La
loi de cette unité eft plus févere pour le peintre que pour
le poëte. On peut diftinguer dans chaque aâion une multi-
iude d’inftanS'difterens, entre lefquels il y auroit de la mal-
adreffe à ne pas choifir le plus intéreffant. Chaque infiant a
fes avantages 8c fes- défavantages ; l’infiant une fois choifi,
tout le rélte cil donné. Prodicùs fuppofe qu’Hercule, après
la défaite du fanglier d’Ërimanthe, fut accueilli par la déefle
de la gloire 8c par celle des plaifirs qui fe le difputerent.
Diverlué dlnftois qu’offre cette fable. Choix du plus inté-
Teffant. lbid. b. Le Choix d’un infiant interdit au peintre toi^s
les avantages des autres. Il y a pourtant des occafions où la
préfence d’un infiant n’eft pas incompatible avec des traces
d’un infiant paffé. Ce n’eft pas affez que' de favoir rendre
une paflîon fimple ; tous les infians délicats font'perdus pour
celui qui ne porte fon talent que jufques- là. De l’unité d’action.
Elle tient beaucoup à celle de tems. Il faut qu’il y ait
entre l’aftion principale & celles qui en dépendent, tant de
liaifon , que le fpeâateur ne foit jamais perplexe. La loi
d’unité d’a&ion cft plus févere 'pour le peintre que pour le
poëte. De-l’unité de lieu. Comment cette loi oblige le peintre
& le poëte. lbid. 773. a. De lifubordination des figures. Des
ornemens, des draperies & autres objets acceffoires. Divers préceptes
fur tous ces objets, lbid. b. Des figures allégoriques
dans les tableaux d’hiftoire. Compofitions extravagantes.
Compoiitions forcées. Compofitions cônfofes. Compofitions
froides, maigres, chargées, &c. Une cofnpofition peut aifé-
ment être 'riche en figures, & pauvre d’idées. Une autre
excitera beaucoup d’idées ou en inculquera fortement une
feule, & n’aura qu’une figure: Tableau d’une folitude habitée
par un anachorette ou un philofophe. Secours mutuel que
tireroient les poètes dé l’étude de la peinture, & les peintres
de celle des poètes. Cônfeil à un peintre de s’attacher à
Homere 8c à Platon. Vérités pittoresques qui fe trouvent
dans les ouvrages de ce dernier. Le banquet de Platon eft
une des apologies les plus délicates de Socrate. lbid. 774. a.
Articles à confulter fur les parties de la peinture dont la
compofition fuppofe la eonnoifiance. lbid. b.
Compofition, en quoi confifte en général la beauté de la
■compofition dans les arts. VI. 679. b. Beau choix de composition
en peinture. III. 263. a. Compofition pittorefque. XII.'
664. a. Compofition poétique. XII. 049. a. Compofition riche.
XIV. 271. b. Equilibre ou pondération dans la compofition
d’un tableau. V. 878. a, b. 8cc. XIII. 24. b.
C om p o s ition , dans le commerce, & en termes d’imprimerie.
III. 774 .b.
C ompos ition , ( Pharm. ) voyeç Composé.
Com p o s ition , ( Gramm. ) furies compofitions ou thèmes,
voyez ce dernier mot. XVI. 245. a. Il convient d’accoutumer
•les jeunes gens à marquer les accens dans leurs compofitions.
1. 66. b. De la formation des mots par dérivation & par compofition.
VII. 172. b. 8cc.
COMPOSTEUR, infiniment d’imprimerie. Sa defeription
& fon ufage. Diverfes fortes d’inftrumens de ce nom.IÏÏ.774.é.
C om p o steu r , (.Fonderie encaraileres dimprimerie") defeription
des inftrumens de ce nom. III. 775. a. Voy. C A R A C T ER E .
C omposteu r , (Manufail. en foie ) III. 775. a.
COMPOTES d’abricots, ( Confif. ) Suppl. 1. 54. a, b. 5 5. a.
COMPRÉHENSION d’une idée, (Lùgiq) Suypl. 1. 184. b.
COMPRESSE, | Chirurg. ) comment Iës anciens fàifoierit
leurs compreffes. Ufagé de ces linges. Compreffes fimples &
compofèes, unies ou irrégulières, égales ou inégales. Utilité
des compreffes expulfives vuides des finus. Diverfes autres
efpeces de compreffes difiinguées par leurs ufages ou leurs
formes. III. 775. b.
COMPRESSION, (Phyfîq. | en quoi la comprèflion différé
de la preffion prife eu général. En quoi elle différé de
la condenfarion. IH. 773. b. L’cap eft incapable de compref-
uon. Compreffion de l’air par fon propre poids, 8c par le
fecours de l’art. Comment Newton l’explique. 11 ne faut point
C O M
confondre la comprèflion avec la condenfarion. ïbid. 775, a-
Compreffion de l’air fur la terre. I. 229. b. Son. Utilité, lbid
La réglé 'des comprenions de l’àir en raifon diteâte des
p'oids qui le compriment, n’eft pas entièrement exafte.
b. Si la comprèflion de l’air lui peut faire perdre fon éfaifil
cité. 231. a. Obfervation de Newton fur la compreffion des
fluides. VI. 275. a. Loix dé là compreffion des fluides élaf-
tiques. V. 446. a. Voyez C o n d e n s a t i o n .
C o m p r e s s io n , ( Medec. ) maladie, 8c quelquefois excellent
remede. Compreffion en tant que maladie. Définition
Ses caufes, foit externes, foit internes. Remedes qui four
conviennent. III. 776. a. Pour entendre le mal qu’occafionne
une longue 8c trop forte compreffion , il faut bien connoitre
i°. les effets qui en dérivent ; 20. la nature de la partie
comprimée, lbid. b.
Compreffion confédérée comme remede. Secours dont elle eft
dans les maladies qui naiflent de la débilité 8c du relâchement
des fibres. Ses avantages dans les hydropifies anafar-
ques 8c afeites, dans les jambes qui deviennent variqueufes.
Belles cures opérées par les fnâions. III. 776. b.
C o m p r e s s io n du cerveau, ( Chirurg.) effets qui peuvent
réfulter d’un coup frappé à la tête. i°. La commotion dit
cerveau ; 20. fa compreffion. Symptômes de cette compreffion.
Explication phyfiologiqUe de ces fymptômes. Cas fort fin-
guÙer qui montre que là plus légère compreffion du cerveau
peut troubler fon aétiori. Examen de chacun des fymptômes
indiqués. t°. La rougeur du vifage, l’inflammation des yeux, le
faignement du nez, des oreilles, &c. III. 777. a. a°. lé frîflbhne-
ment, 30. l’engourdiflement des fens, 40. l’affoupiffement, <5°. la
léthargie, 6°.le vertige, 70. les tintemens d’oreilles, 8°. le
délire, 90. le vomiffement de la bile. lbid. b. 1 o°. lès douleurs de
tète , i i ° . les, convulfions, 120. la paralyfie, 13°. la décharge
•involontaire des urinés 8c de la matière fécale, 140. l’apoplexie
, i<°. la firufture du cervelet détruite, 8c la mort.
Caufe de la compreffion du cerveau. Cure: en quoi elle
confifte : lorfqu’il eft queftion de l’enfoncement du crâne, lbid.
778. a. Lorfqu’il n’y a que contufion du péticrâne : dans le
cas d’épanchement : lorfque quelque pointe d’os pique la
dùre-mere ou bleffe le cerveau : lorfque l’os enfonce plie ou
cede fous le trépan. Réflexion : quelque triftes que foient
la plupart des fymptômes dont on a parlé, on ne manque
pas d’exemples a’heureufes cures, 6>c. lbid. b.
Compreffion du cerveau cauféë par l’enfoncement du crâne.'
IV. 433. *.XII. 682. *.
C o m p r e s s io n , (Chirurg.) aftion de preflêr une partie
par le moyen d’un appareil ou d’un bandage. Utilité 8cnéceffité
dé la compreffion dans certains cas. Néceffité de comprimer
l’endroit par où le pus fort, pour le retenir dans les finus.
IH. 778: b.
Compreffion dans les hémorrhagies à là fuite‘des imputations.
V1U. 122. a. Compreffion d’une artere pour y arrêter
le fané. XVI. 485. b. Comprenions employées en médecine.
XVIL 200. a. Facilité avec laquelle on comprime lé cerveau
des enfans nouveaux nés fans inconvénient fenfiblè. Suppl. IH,
598. a. Bandages compreffifs, voye[ BAN D AG E.
COMPROMIS, ( Jurifpr. ) écrit par lequel les parties con-'
viennent de s’en tenir à la décifion des arbitres, ou des
arbitrateurs. Ce qu’il fout obferver pour la validité du compromis.
Pouvoir qui en réfulte. Celui qui n’eft pas content
de la fentence arbitrale, peut en interjetter appel. De la
peine ftipulée par le compromis chez les Romains. Objets
fur lefquels on peut, 8c ceux fur lefquels on ne peut pas
compromettre. Quelles perfonnes ne peuvent compromettre;
quelles perfonnes ne peuvent être relevées de la peine portée
au compromis. III. 779. u. Comment le pouvoir donné aux
arbitres ou.arbitrateurs parle compromis eft réfolu. Compromis
des évêques en Ufage autrefois dans des matières de
milice féculiere. Auteurs à confulter./¿/V. b.
Compromis, peine du compromis. XII. 251 .b. Prorogation
du compromis. XIII. 492. a , b.
COMPTABILITÉ dans les chambres des comptes. liL
^COMPTABLE, ( Jurifpr:) celui qui manie des deniers
dont il doit rendre compte. Tout comptable réputé débiteur.
Juge devant lequel il peut être pourfuivi. III. 779.^.
Comptable, diverfes fortes de perfonnes comptables, ni-
781. a. De la pourfuite du comptable. Ibid. b. Comptables
des deniers royaux 8c publics : prefentation de leurs comptes,
«02. a , b. 703. a . b. Comptables de la chambre des comptes.
Z A. a\ b. Office comptable. XI. 416. b. Tutelle comptable.
C o m p t a b l e , ( Quittance) quittance non comptable,
comptable, receveur du droit de comprabhe. lu? 779- •
COMPTABLIE de Bordeaux (Junffâ
paie les droits ^us.3 U & en quo? il differf des
entend par_droit de oempt^l e^ ? ,a ^ de t0UteS
dro!ts qui fe pment ^ u ^ l ent fc perçoivent
les marchandées.^Deux comiune & de
droits qui fe paient ailleurs
W S S m m m — I cou,u,ne
C O M
tablie ; & ccux do éonvoi. cHffiQirè dé cê'droit de
C°^Pt^I/i^DroIts<qu’ôn prie à la comptablie de Bordeaux.
^ A m p T A N T , diverfes fignifications de ce mot dans le
r* Ordonnance commerce. . de cbipptant, eh terme de finance.
f l l r a M E ( Coffim. ) trois fortes de comptes niceffaircs
iVclôture des livres en partie double. Coiràte de
p0U-„ m ïSo. e- Compte de profits* de pertes. Compte
V ftM P T E S , ¡livres dt) ouvrir un compte, apoWler,
vérifier, clorre m, compte, finito décompté, coucher une
domine fur un compte, pointer les parues d un compte ,
co n tre -p a rtie d’un compte, Ordre d’iut compte, examiner,
foltoTncompte, P » « " en compte, rendre. compte apu-
rer un compte, bordereau de compte , débet, folde de
compte- in. 780.fi. Ligne de compte, affirmer un compte,
bordereau de compte. IL 354-b- Li6ne <Ie
IX Ç2Ô. a. Efpece de compte appellé cote mal taillee. IV.
3oô. é Débats de compte. ¿49- u. Ëmplot t o tut compte^
V <02 a. Livres de comptes des anciens. IX. 611. b. Livre
de' ^mp^s courans. 6.2. u. 6.6. u. Monnotes de compte.
^Compte', en'banque , compte en participation. HI. 781. u.
; Compte, autres fens de ce mot dans le commerce. ÜI.
^Compte , ( Grani') ou compte marchand,& petitcomp/e.
III. 781. u.
c S m f M fp 7r .) i* t f c recette & ÿd ép en fe de biens
dont on a eu l’adminiftration. Toute perfonne qm a géré le
bien d'autrui doit en rendre compte. Diverfes fortes de per- .
fonnes comptables. III. 78'- "• comPK d“ '
être rendu. Comment il doit etre dreffé. De la pourfuite du
comptable. On appointe ordinairement 1« parues, lorfquil
s’agit de fournir débats & foutenemens. On ne peut deman-
der la révifion du compte jugé, mais fa réformauon s il y
a des erreurs. Ibid. b.
Compte, par bref état. III. 7®1* M ,
Compte, de clerc à maître, Ul. 781. b.
Compte, par colonnes.III. 781. b.
Compte, par échelette. III. 782. <r. I
Compte, par Uvres, fous 8c deniers. Tems ou cet ufage
fot introduit, enfuite abrogé, & encore rembh. Anaenne-
ment on pouvoit compter par hvres, fous 8c deniers tournois
ou parifis ; mais l ’ordonnance de 1667 ordonne de ne
compter que par livres tournois, 6*. Maniere de compter
des Hollandoîs, Anglois, Vénitiens. IH. 7 ^ a.
COMPTES, ( Chambres des) dans 1 origine il n y avoit
que celle de Paris. Avant 1566 U y avoit outre celle de
Paris, celles de Dijon, de Grenoble , dAix , de Nantes,
de Montpellier 8c de Blois. Par oui elles forent établies. III.
782. a. Leur fuppreffion en 1306. Leur rétabliffement par
Charles IX en 1368. Ibid. b. ,, ,
Chambre des comptes de Rouen; celle de Pau, celle de
Dole, celle de Metz. Il y en a eu d’autres établies en
différens tems, par des reines ou par des enfans trance ;
mais il n’y en a actuellement aucune. 111. 7f 2- / -
COMP-ras de Paris, (Chambre des) l’une des deux compagnies
matrices du royaume. Admimftration de la tuftice-confiée
anciennement par les rois au parlement 8c à la chambre
des comptes. Il paroît que la chambre des comptes étoit
fédentaire fous le regne de S. Louis. Marques deftune que
les rois ont données à cette compagnie. UL 782. *. ^onieu
fecret ou grand confeil qui fe tenoit fouvent à la chambre
des comptes. Quelquefois auffi cette compagnie étoit mandee
près de la perionne du roi. Marques d’honneur 8c de confiance
qu’elle a reçues de Philippe de Valois, 8c en d. autres
occafions. Prérogatives 8c privilèges que fes fouverains lin
ont accordés. Importance des titres dont le dépôt lui eit
confié. On confidere ici cette chambre, i°. eu égard aux
officiers dont elle eft compofée ; 20. à la forme dont on y
procede à linftruftion 8c aii jugemerit des affaires ; 3 . a
l’étendue de fa jurifdiftion. IH. 783. a.
La chambre des comptes confidgrée eu égard à fes officiers.
Enumération de ces officiers. Ils fervent par femeftre. Occà-
ftons où les femeftres s’aflèmblerit. Ta chambre partagée en
deux bureaux. Ordonnances qui règlent les formes judiciaires.
Objets d’examen 8c de jugement du fécond bureau. Objets
du grand bureau. Les fondions exercées par les officiers de
la chambre, difiinguées en trois parties.
i°. Pour l ’ordre public ; ce que comprend cette premiere
daffe. Ibid. b.
20. Pour l’adminiftration des finances ; ce que comprend
cette claffe. Anciennement les prévôts. Baillis, fénéchaux ,
venoient rendre leurs comptes en la chambre, 8c elle nommrm
Ì Iph« _____ - ->î,-Il .nllllff* T .P8 C
C O M 367
prononcées, au jugement des comptes doivent être élevées
- en vertu de requêtes d’apurement préfentées par les compta*-
bles. Lettres a enregiftrer dans cette compagnie. Autres objets
d’adminiftration de cette chambre. Ibid. 784. a. Officiers établis
pour les pourfoites qui réfultent des charges fubfiihmtes •
fur les comptes.
a0; Pour la confervâtion des domaines du roi 6* des droits
réguliers\ ¿dits & ordonnances que la chambre vérifie. Elle
reçoit les ades .de féodalité de. tous les vaflaux du roi, dans
l’étendue de fon reffort. Elle a fouvent ordonné des ouvrages
publics , poids & mefures , droit de péage .& de barrage.
Anciennement elle paflbit lés baux des fermes, relie_ faifoit
des rècherChes fur les ufurparions & dégradanons des d »
mai nés, elle avoit l’adminiftràtion des monnoies. Lettres à
regiftrer à la chambre. Cette chambre cônnoît privativement
à toutes autres de ce qui concerne la régale. Etat dans leaùel
la régale fe trouve aduellement. Ibid. ¿. Archevêques 8c évêques
obligés de foire regiftrer leur ferment de fidélité. Les
lettres conèernant les apanages des enfons.de France, les
douaires des reines, les contrats d’échange, font adreifées à
la chambre. ,. „ . . r> 1 t. •
Du premierpréfident. Deux préfidens des 1 origine. Réception
du premier préfident. Cette charge poffédée par les plus grands
perfonnages du royaume. Les premiers préfidens ont donné
plufieurs chanceliers à l’état. Pierre Doriode, chancelier,
devenu enfuite premier préfident. Jean de Nicolaï, revêtu de
cet office en 1506. Ib'id.783. a. Fonétions,.offices, pouvoirs
8c diftmâions du premier préfident : fa robe de cérémonie.
- Préfidens de la chambre. Leur nombre 8c leur fervice. Ils
font à l’égard de cette cour * ce que font les préfidens du
parlement dans leur compagnie. On ne peut être reçu préfident
de la chambre ou d’un parlement, qu’à l’âge de 40 ans,
& après aVoir exercé pendant dix ans un office de judicatnre
dans une cour fupérieure. Ibid. b. L’un des préfidens devoit
affilier aux chapitres généraux de l’ordre du S. Efprit. Privilège
de fépulture accordé à la femme d’un préfident par
Charles V. Fondions du préfident qui préftde au fecqnd
bureau. Autres obfervations fur les offices des préfidens t
leur robe de cérémonie. a
M a ître s des comptes. Des maîtres des requêtes, des preli-
dens des enquêtes 8c requêtes, 8cdes confeillers du grand-
confeil ont paffé de leurs offices à ceux de maîtres des
comptes. Le titre de maîtres leur étoit commun avec les
magiftrats du parlement. Ibid. 786. a. Pourquoi ils ont la qualité
de maîtres ordinaires. De leur nombre 8c de leur fémef-
tre. Fondions des confeillers-maîtres. Ceux d’entr eux qui ont
droit de bourfe en la grande chancellerie. Le doyen des
maîtres porte feul le titre de doyen de la chambre:robe des
confeillers-maîtres. '
CorreSeurs, concilions des comptes. Etabliffement des con-
feülers-corredeurs. Ibid. b. Leur nombre: leur robe de cérémonie.
Chambre de la corredion. En quels cas les correcteurs
ont féance au grand bureau, au nombre de deux. Du
renvoi des comptes à la corredion. Confeillers qui travaillent
à la Vérification des comptes. Par qui les comptes .doivent
leur être adminiftrés. Objet principal des corredions; Maniéré
d’y travailler. Avis de corredion ftgnifié au comptable. Ibid.
nin a Formalités obforvées dans ces inftances. La partie
aflmnée fournit fes défenfes, fur lefqùelles il doitêtre pris
un appointement au greffe, &c. fouf à renvoyer à 1 audience
les tierces oppofitions ou autres mcidens. Inftrudion de lmf-
tance. Rapport 8c jugement del’inftance. . '
Auditeurs des comptes. Leur nombre 8c lemeftre. Leur dif-
tribution en fix chambres. Du lieu où les confeiUe«-auditeurs
travaillent aux^omptes qui leur font diftnbués. lbid. b H*
étoient autrefois appellés clercs, Louis XH les a quahfiés
d’auditeurs. Henri H leur a donné le titre de confeillers. La
fondion qui les occupe le plus eft l’examen de tous les
comptes qui fe rendent en la chambre. Manière dont fe foit
cet examen. Comptes que peuyent rapporter les confeiUers-
auditeurs du femeftre de janvier & ceux du^ me^ reJ e
juillet : exercices pairs &.impairs. Le rot a pemus aux ofli
ciers de juger les comptes des eXeraces pairs & unpairs dans
lés femettrL de janvl« &de juillet, fans aucune dtftmfhon,
ni différence d’année d'exercice. Première année de fervice
(TunconfeiUer-audiieur. lbid. 78?. e Autres fonihous deces
officiers. Ce qu'a ordonné Henri IV fur ies comptes du col-
1° de Navarre. Pleces dont les confeiUer^audneurs ont le
dépôt. Attaches & commlffions de mainlevées que es audt-
,eurs expédient. Dépôt créé par Louis XIV, pbur les expé-
dirions de, papiers-terrlers, les doubles des myentmres des
titres du domaines, & les états de la conftftance | de la va-
leur 8c des revenus du domaine. Combien il conviçnaroitae
relever ce dépôt qui a été détmit en partie par un incendie
en 1737. Confeiller dépofitaire de ces titres créé par ^Dïuis
XrV 8c uni aux offices de confeillers -auditeilrs. Dfficier
nommé particuUirement pour vaquer rom
■fouftionsde délivrer