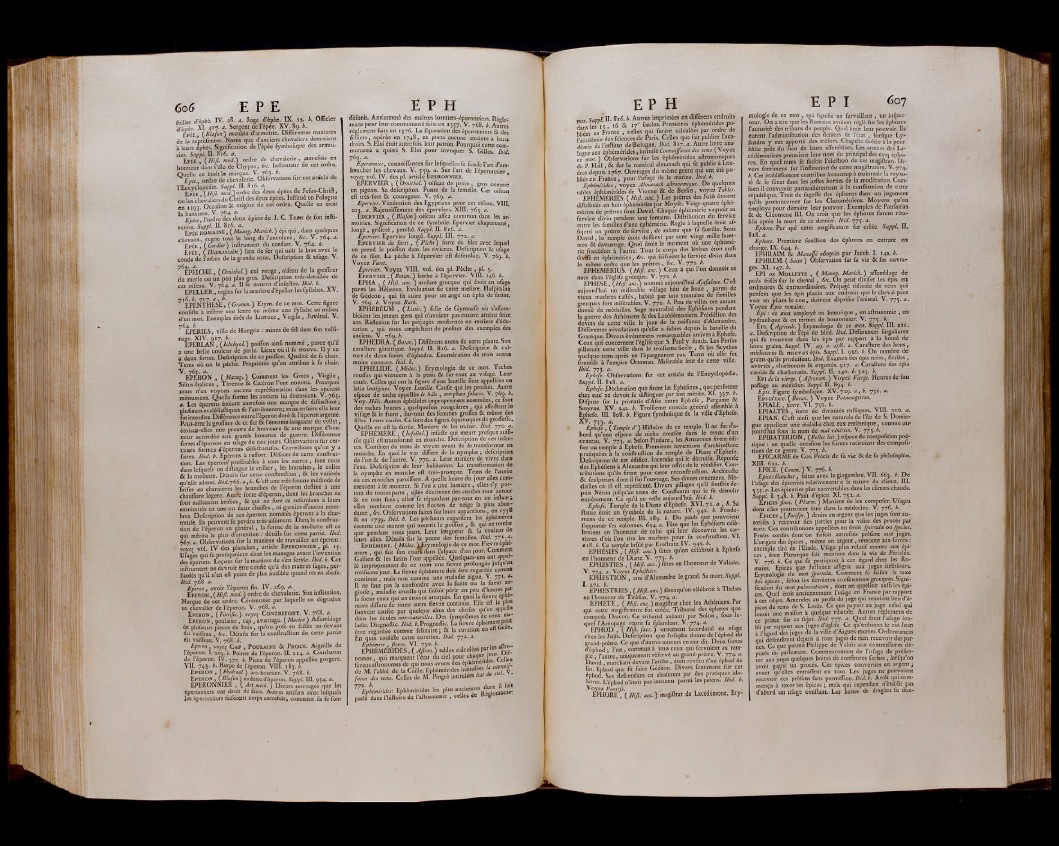
6 o 6 E P E E P H
feiller d’épéé. IV. 28. a. Juge d’épèe. IX. i l . t. Officier
il’épée. XI. 417* S Sergent de l’épéc. X V -% A
Epée., (-Blafon,) meuble d armoirie. Differentes manières
de la repréfenter. Noms que d’anciens chevaliers donnoient ,
à leurs épées. Signification de l’épée fymbolique des armoiries.
Suppl. II. 816. ». . . . c •
Epée , (Hiß. mod.) ordre de chevalerie-, autrefois en
honneur dans rifle de Chypre, *c. Inlti.ureur de cet ordre.
£p* 'ordre'de o S e À e . Obiervations fur cet aniclé de
VEe £ Â . S o î d r f t deux U m » Jefus-Chrift,
ou les chevaliers du Chrift des deux épées. Inftitué en Pologne
en 1193. Occafion & origine de cet ordre. Quelle en étoit ,
la banniere. V. 764. »• ■
Epies, l’ordre des deux épées de J. C. Tems de ion iniutution.
Suppi'. H* 816. ». . . , ,
Epée romaine, ( Maneg. Marich.) épi qui, dans quelques
chevaux, regne tout le long de l’encolure, b c .V . 764. ».
Epée, fCordier) inftrumcnt du cordier. V. 764. ».
Epée, t Diamantaire) lien de fer qui unit le bras avec le
coude de farfjrc de la grande roue. Dcfcription 6c ufage. V.
7 EPEICHE, ( Ornithol.) cul rouee, oifeau de la groffeur
du merle ou un peu plus gros. Deicription très-detaillee de ,
cet oifeau. V. 764. f I & nourrit d’infcftcs. lbid. b.
EPELLER, règles fur la maniéré d épeller les fyllabcs. A V.
716. b. 717. » , A - .
EPENTHESE, ( Gramm.) Etym. de ce mot. Cette figure
confiftc à inférer une lettre ou môme une fvllabe au milieu
d’un mot. Exemples tirés de Luercce, Virgile, Juvénal. Y.
7^EpÊr IES , ville de Hongrie : mines de fcl dans fon voifinaf;
PERLÀl$X,7( Ichthyol.) poiffon^ainfi nommé, parce qu’il
a une belle couleur de perle. Lieux où il fc trouve. Il y en
a deux fortes. Defcription de ce .poiffon. Qualité de fa chair.
Tems où on le pêche. Propriétés qu’on attribue à fa chair.
V '^ & O N , Î Maneg.) Comment les Grecs , Virgile, |
Silius-Italicus, Térence 6c Cicéron l’ont nommé. Pourquoi
nous n’en voyons aucune repréfentation dans les-anciens
mônumens. Quelle forme les anciens lui donnoient. V. 763.
a. Les éperons étoient autrefois une marque de diltinétion ;
pluficurs eccléfiaftiques fe ^attribuèrent; mais enfuite elle leur
futinterdite. Différence entre l’éperon doré 8c l’éperon argenté.
Peut-être la groffeur de ce fer 8c l’énorme longueur du collet,
étoicnt-cllcs une preuve de bravoure 6c une marque d honneur
accordée aux grands hommes de guerre. Différentes
fortes d’éperons en ufage de nos jours. Onfcrvations fur certaines
formes d’éperons défeélueufes. Corrections quon y a
faites. Ibid. b. Epérons à reffort. Défauts de cette- conftruc-
tîon. Les éperons* préférables à tous les autres , font ceux
dans lcfqucb on diftingue le collier, les branches, le collet
6c la mollette. Détails fur cette conftruflioji, 8c les variétés
qu’elle admet. Ibid.766. a ,b. C’eft une très-bonne méthode de
brifer en charnières les branches de l’éperon deftmé à une
chauffurfc légère. Autre forte d’éperon, dont les branches ne
•font nullement brifées, 6c qui ne font ni refendues a leurs
extrémité j en une ou deux châfles , ni garnies d aucun mem-
bret. Defcription de ces éperons nommés éperons a la char-
treufe. Ils peuvent fe perdre très-aifément. Dans la conltruc-
tion de l'éperon en général, la forme de la mollette eft ce
qui mérite le plus d’attention : détails fur cette partie. Ibid.
767 a Obfervations fur la maniéré de travailler un éperon :
voyez vol. IV des planches, article Eperonnier , pl. 15.
Ufages qui fe pratiquoient dans les manèges avant 1 invention
des éperons. Leçons fur la manière de s’en fervir. Ibid. b. Cet
inftrumcnt ne devroit être confié qu’à des maîtres fages, per-
fuadés qu’il n’en eft point de plus nuifiblc quand on en abufe.
lb id . 768 ». XT s
Eperon, avoir l’éperon fin. IV. 269. ».
Eperon , (Hiß. mod.) ordre de chevalerie. Son mltitution.
Marque de cet ordre. Cérémonie par laquelle on dégraqoit
un chevalier de l’éperon. V. 768. ».
Eperon , ( Fortifie.) voye{ C ontrefort. V. 768. ».
Eperon , poulainc, cap, avantage. ( Marine ) Affemblagc
de pluficurs pièces de bois, qu'on pofe en faillie au-devant
du vaiffeau , bc. Détails fur la conftruélion de cette partie
du vaiffeau. V. 768, b.
Eperon, voyc{ C a p , POULAINS 8c PROUE. Aiguille de
l’éperon. I. aoo. b. Pointe de l’éperon. II. 114. ». Courba ton
de l’éperon. IV. 377. b. Pièce de l’éperon appellée gorgere.
VII. 743- A Hcrpe de l’éperon. VIII. 183.1.
E peron , ( Hydraul.) arc-boutant. V. 768. b.
Epe ron , ( Blafon) molette d’éperon. Suppl. III. 0.(4:. <*•
EPERONNIER , ( A n mich. ) Divers ouvrages que les
éperonniers ont droit de faire. Autres artifans avec lefquels
les éperonniers faifoient corps autrefois; comment ils fe font
défunts. Ancienneté des maîtres lormiers-éperonnicrs. Régler
mens pour leur communauté faits en 13Ç7. V. 768. b. Autres
•réglcmcns faits en 1576. La féparation des éperonniers 8c des
fellicrs, opérée en 1748, ne .porta aucune atteinte à leurs
droits. S. Eloi étoit autrefois leur patron. Pourquoi cette communauté
a quitté S. Eloi ,pour invoquer S. Gilles. lbid.
769. ».
Eperonnier, connoiffanccs fur lefqucllcs fc fonde l’art d’emboucher
les chevaux. V. «59. ». Sur l’art de l’éperonnier
voyez vol. IV. des pl. article Eperonnier.
EPERVIER 5 ( Ornithol.') oifeau de proie , gros comme
un pigeon. Sa dcfcription. Ponte de la femelle. Cet oifeau
eft très-fort 6c courageux. V. 769. ».
Epervier. Vénération des Egyptiens pour cet oifeau. VIII.’
103. ». Rajcuniffemcnt des eperviers. XIII. 763. ».
E p e rv ie r , ( Blafon) oifeau affez commun dans les armoiries.
Signification de ce fymbole. Epervier chaperonné,
longé, grille té , perché. Suppl. II. 816. ».
Epervier. Epervier longé. Suppl. III. 77a. a.
Epervier du furet, ( Pêche ) forte de filet avec lequel
on prend le poiffon dans les rivières. Defcription & ulage
de ce filet. La pêche à l’épervièr eft défendue, V. 769. b.
"Voyez Furet.
Epervier. Voyez VIII. vol. des pl. Pêche, pl. 5.
Ep er v ier , (Botan.) herbe à l’épcrvier. VIll. 146. b.
EPHA , ( Hift. anc. ) mefure grecque qui étoit en ufage
parmi les Hébreux. Evaluation de cette mefure. Hofpitalité
de Gédeon , qui fit cuire pour un ange un épha de farine.
V.7C0. b. Voyez liât h.
EPHÉBÉUM , ( littir. ) falle de Qymnafe où s’affem-
bloicnt les jeunes gens qui n’avoient pas encore atteint feize
ans. Réflexion fur les préjugés modernes en matière d’éducation
, qui nous empêchent de profiter des exemples des
anciens. V. 760. b.
EPHEDRA. (Botan.) Différens noms de cette plante. Son
çaraélere générique. Suppl. II. 816. ». Defcription 8c culture
de deux fortes d’épnedra. Enumération de trois autres
moins connues, lbid. b.
EPHELIDE. (Midec.) Etymologie de ce mot. Taches
rouffes qui viennent à la peau 8c iur-tout au vifage. Leur
caufe. Celles qui ont la figure d’une lentille font appellées en
latin lentigines. Voyez Lentille. Caufe qui les produit. Autre
efpece de tache appellée le hále, morphaa fotaris. V. 769. b»
Voy. Hále. Autres éphélidcs improprement nommées, ce font
des taches brunes , quelquefois rougeâtres , qui affeftent le
vifage 8c le front, fur-tout des femmes greffes 8c même des
filles. Leurs caufes. Ce font des fignes équivoques de groffeffe. ,x
Quelle en eft la durée. Maniere de les traiter. lbid. 770. a.
EPHÉMERE , (lnfeilol.) infeûe qui meurt prcfquc auffi-
tôt qu’il eft transformé en mouche. Defcription de ces infectes.
Combien de tems ils vivent avant de fe transformer en
mouche. En quoi le ver différé de la nymphe ; dcfcription
de l’un 8c de l’autre. V. 770. a. Leur maniere de vivre dans
l’eau. Defcription de leur habitation. La transformation de
la nymphe en mouche eft très-prompte. Tems de l’année
où ces mouches paroiffenr. A quelle heure du jour elles commencent
à fe montrer. Si l’on a une lumière , elles s’y portent
de toutes parts , elles décrivent des cercles tout^ autour
8c en tout fens; clleffe répandent par-tout en un inftant;,
elles tombent comme les flocons de neige la plus abondante
, bc. Obfervations faites fur leurs apparitions, en 173»
8c en 1739. lbid. b. Les pêcheurs regardent les éphémères
comme une manne qui nourrit le poiffon , 8c qui ne tombe
que pendant trois jours. Leur longueur 8c la couleur ne
leurs ailes. Détails fur la ponte des femelles, lbid. 771* *•
Ephémere. ( Midec. LEtymologie de ce mot. Fieyreépné-
mere , qui fait fon cours dans l!elpace d’un jour. Comment
Gallicn 8c les latins l’ont appellée. Quelques-uns ont appel-
lé improprement de ce nom une fievre prolongée julquau
troifieme jour. La fièvre éphémère doit être regardée comme
continue, mais non comme une maladie aiguë. V. 77** a'
Il ne faut pas la confondre avec la fuete ou la fucur an-
gloife, maladie cruelle qui faifoit périr en peu d’heures par
la fucur ceux qui en étoient attaqués. En quoi la fievre éphémère
diffère de toute autre fievre continue. Elle clt le pu»
fouvënt caufée par quelque abus des chofcs qu on appeue
dans les écoles non-naturelles. Des fvmptômes de cette maladie.
Diagnoftic. lbid. b. Prognoftic. La fievre éphemerepe
être regardée comme falutaire ; 8c la curation en eit
En quoi confiftc cette curation, lbid. 772. ».
Ephimere. fievre. VI. 730. b. „ t-* affro-*
EPHÉM¿RIDES, ( Aflron.) tables calculées par les ^
nomes, qui marquent l’état du ciel pour chaquej ¿ cjûs
férens aftronomes de qui nous avons des épbémér ’ r
de M. l’abbí ¡ I I Câille. ^Eptómiride. in *u fe j | B |
fmet dei tems. Celles de M. Pin6rc md.ulics /ut du »cl.
77EMm/,idtf. Ephimérides les
parlé dans l’hiftoire de 1 aftronomie , celles de g
E P H E P I
Çim»/ H. S i6. b. Autres imprimées en différens endroits
rhn« les xi , 16 8c 170 fiecles. Premières éphéméndes publiées
en France , celles qui fuient calculées par ordre de
l’académie des fciences de raris. Celles que fait publier 1 académie
de l’inftitut delJBologne. lbid. 817. ». Autre hvre ana-
loeuc aux éphémérides, inntulé Connoipncedes tems (Voyez
ce mot. ) Obfervations fur les éphémérides aftronomiques
du P. Hall, 8c fur le nautical almanach qui fe publie à Londres
depuis 1767. Ouvrages du même genre qui ont été publiés
en France, pour l’ufage de la marine, lbid. b.
Ephémérides, voyez Almanach aftronomique. De quelaucs
tables éphémérides de Vienne 8c de Berlin, voyez Tables.
EPHEMÉRIES. ( Hift. anc. ) Les prêtres des Juifs étoient
diftribués en huit éphéméries par Moyfe. Vingt-quatre éphé-
méries de prêtres fous David. Chaque éphémérie vaquoit au
fcrvicc divin pendant une femaine. Diftribution du fcrvice
entre les familles d’une éphémérie. Règle à laquelle étoit ai-
fujetti un prêtre de fcrvice, de même que w famille, bous
David, le temple étoit deffervi par cent vingt mule nommes
8c davantage. Quel étoit le moment ou une épheme^
rie fuccédoit à Tautre. Tout le corps des lévites étoit auiü
divffé en éphéméries, bc. oui faifoient le fervicc divin dans
le même ordre que les prêtres, bc. V. 71} ' ° '
EPHEMÉRIUS. i Hift. anc.) Ceux à qui Ion donnoit ce
nom dans l’églife grecque. V. 772. b. .
EPHESE, (Hift. anc.) nommé aujourd hut Ajafaloue. L elt
aujourd’hui un miférable village bâti de bouc , parmi de
vieux marbres cafl’é s , habité par une trentaine de familles
grecques fort miférables. V. 772. b. Peu de villes ont autant
donné de médailles. Sage neutralité des Ephéfiens pendant
lit guerre des Athéniens 8c des Lacédémoniens. Prédiction des
devins de cette ville le jour de la naiffance d’Alexandre.
Différentes révolutions qu’elle a fubies depuis la bataille du
Granique. Divers événemens remarquables arrivés à Ephcfe.
Ceux qui concernent l’églife que S. Paul y fonda. Les Pcrfes
pillèrent cette ville dans le troifieme fiecle, 8c les Scythes
quelque-tems après ne l’épargnerent pas. Tems ou elle fut
ioumife à l’empire Ottoman. Miférable état de cette ville.
lbid. 773. ». ,,.
Ephcfe. Obfervations fur cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. II. 818. ».
Ephcfe. JDédaration que firent les Ephéfiens , queperfonne
chez eu*- ne devoit fe diftineuer par ion mérite. XL 337. b.
Difpute fur la primatie d’Afie entre Ephcfe, Pcrganje &
Smyrne. XV. zaz. b. Troifieme concile général affemblé à
t' t r ttt n.n > .I» ta wîH, rl'F.nhpfft. smyrne. a » . »41. o. x iu iu c i i»- vwnv..w
Ephefc. III. 808. b. Figure fymbolique de la ville dEphefe.
Èphtfc, “(Temple d‘) Hiftoire de ce temple. 11 ne fut Sur
bora qu’une efpece de niche uoru qu une cipcvc us nniiv cvr.»e«u.f»é»e dans le tronc d’un
ormeau. V. 773. ». Selon Pindare, les Amazones firent édifier
un temple à Ephcfe. Premières inventions^ d architcfturc
pratiquées a la conftruftion du temple de Diane d’Ephcfc.
Dcfcription de cet édifice. Incendie qui le détruifit. Réponfe
des Ephéfiens à Alexandre qui leur offrit de le réédifier. Contributions
qu’ils firent pour cette reconftruction. Architecte
8c fculptcurs dont il fut l’ouvrage. Scs divers ornemens. Médailles
où il eft repréfenté. Divers pillages qu’il fouffrit depuis
Néron jufqu’au tems de Conftantin qui le fit démolir
entièrement. Ce qu’il en refte aujourd’hui. lbid. b.
Ephcfe. Temple de la Diane d’Ëphcfe. XVI.71. » ; b. Sa
ftatuc étoit un fymbole de la nature. IV. 942. b. Fondc-
«nens de ce temple. III. 189. b. Du poids que pouvoient
fupporter fes colonnes. 634. ». Fête que les Ephéfiens célébraient
en l’honneur de celui qui leur découvrit les carrières
d’où l’on tira les marbres pour fa conftruCtton. Yl.
« 18. b. Ce temple brûlé par Eroftrate. IV. 94a. A t '
EPHÉSIES, (Hift. anc.) fêtes qu’on célébrait à Ephcfe
en l’honneur de Diane. V. 773. A ,r> ;
EPHESTIES , ( Hift. anc.) fêtes en 1 honneur de Vulcain.
.V.774. ». Voyez Epheftiies. 0 1
EPHESTION, ami d’Alexandre le grand. Sa mort. Suppl.
’ EPHES TRIES, ( Hifl. anc.) fêtes qu’on célébrait à Thebcs
en l’honneur de Tiréfias. V. 774. ».
EPHETE, ( Hift. anc. ) magiftrat chez les Athéniens. Par
qui cette magiftrature fut créce. Tribunal des éphetes que
compofa Dracon. Ce tribunal anéanti par Solon, fous lequel
l’Aréopage reprit fa fplcndeur. V . 774. ».
EPHOD , (Hill. facr.) ornement faccrdotal en ufage
chez les Juifs. Deicription que Jofephe donne de l’éphod du
grand-prêtre. Ce que d’dutres auteurs en ont dit. Deux fortes
d'éphod ; l’un , commun à tous ceux qui fervoient au temple
; l’autre, uniquement réfervé au grand-prétre. V. 774. a.
David, marchant devant l’arche, étoit revêtu d’un éphod de
lin. Ephod que fit faire Gédéon. Divers fentimens fur cet
éphod. Ses defeendans en abuferent par des pratiques idolâtres.
L’éphod n’étoit pas inconnu parmi les païens, lbid. b.
|Voyez Pontife. _ . .. « .
mologic de ce mot, qui fignific un furveillant, un inipcc-
teur. On a cru que les Romains ¿voient réglé fur les éphores
l’autorité des tribuns du peuple.^ Quel étoit leur pouvoir. Ils
eurent l’adminiftration des deniers de l’état , lorfquc Ly-
fandre y eut apporté des tréfors. Chapelle dédiée à la peur
bâtie prés du lieu de leurs affemblées. Les armées des La-
cédémoniens prenoient leur nom du principal des cinq épho-
rcs. En quel tems fe faifoit l’éledion de ces magiftrats. Divers
fentimens fur l’inftitution de cette magiftrature. V.774.
b. Cet établiffement contribua beaucoup à maintenir la royauté
8c le fénat dans les juftes bornes de la modération. Combien
il convcnoit particulièrement à la conftitution _ de cette
république. Trait de fageffe des éphores dans un jugement
qu’ils prononcèrent fur les Clazoménicns. Moyens quon
employa pour détruire leur pouvoir. Exemples de Pauianias
8c de Cléomene III. On croit que les éphores furent rétablis
après la mort de ce dernier. lbid. 773. ».
Ephore. Par qui cette magiftrature fut créée. Suppl. IL
:8. ».
Ephore. Première fonôion des éphores en entrant en
ch arec. IX. 644. b.
EPHRAIM 8c Manaffi adoptés par Jacob. I. 142. b.
EPHREM. ( Saint ) Obfcrvation fur fa vie 8c fes ouvrages.
XI. 147. b.
EPI ou M o l l e t t e , ( Maneg. Marich. ) affemblagc de
poils frifés fur le cheval, bc. On peut divifer les épis en
ordinaires 8c extraordinaires. Préjugé ridicule de ceux qui
penfent que les épis placés aux endroits que le cheval peut
voir en jpliant le cou, doivent déprifer l’animal. V. 773. ».
Voyez Epie romaine.
Epi : ce mot employé en botanique , en aftronomie, en
hydraulique 8c en termes de boutonnier. V. 773. b.
Ep i . ( Agricult. ) Etymologie de ce mot. Suppl. III. 221.
». Defcription de l’épi de bled. lbid. Différences fingulieres
qui fe trouvent dans les épis par rapport à la bonté de
leurs grains. Suppl. IV. 49. ». a- Caraéterc des bons,
médiocres 8c mauvais épis. Suppl. I. 916. A Du nombre de
grains qu’ils produifent. lbid. Examen des épis noirs, ftériles,
avortés, charbonnés 8c ergottés. 917. ». Caraôcrc des épis
carnés 8c charbonnés. Suppl. II. 240. A 323. A
Ep i de la vikrge. ( Aftronom.) Voyez Vierge. Heures de fon
partage au méridien. Suppl. II. 894! A
Epis. Figure fymbolique. XV. 729. » , A 731. ».
Epi-d’eau. ( Bot an. ) Voyez Potamogciton.
EPIALE, fievre. VI. 730. A
EPIALTES, forte de divinités mftiques. VIU. 210. ».
EPIAN. C’eft ainfi que les naturels de file de S. Domin-
gue appellent une maladie chez eux endémique, connue au*
tourdnui fous le nom de malviniricn. V. 773. A _
EPIBATERION, (Belles lett. ) efpece de compofition poétique
: en quelle occafion les Grecs recitoient des compofi-
tions de ce genre. V. 773. A
EPICARME de Cos. Précis de fa vie 8c de fa philofophie.
XIII. 62a. A
EPICE. ( Comm. ) V. 776. A
Epices blanches, faites avec le gingembre. VII. 663. A De
l’ufage des épiceries relativement à la nature du climat. III.
333.». Les épiceries plus convenables dans les climats chauds.
Suppl. I. 348. A Pain d’épice. XI. 732. ».
Epices/««. ( Pharm.) Maniéré de les comoofer.Ufages
dont elles pourraient être dans la médecine. V. 776. A
Epices , ( Jurifpr. ) droits en argent que les juges font au-
torifés à recevoir des parties pour la vifitc des procès par
écrit. Ces contributions appcllées en droit fponida ou fpecies.
Fruits confits dont on faifoit autrefois prêtent aux juges.
L’origine des épices , même en argent, remonte aux Grecs :
exemple tiré de l’Iliade. Ufage plus relatif encore aux épices
, dont Plutarquc fait mention dans la vie de Périclès.
V. 776. A Ce qui fe pratiquoit à cet égard chez les Romains.
Epices que Juftinien afligna aux jugçs inférieurs.
Etymologie du mot fportula. Comment fc faifoit la taxe
des épices, félon les dernières conftitutions grecques. Signification
du mot pulveraticum, dont on appclloit auffi les épices.
Quel étoit anciennement l’ufage en France par rapport
à cet objet. Amendes au profit du juge qui tenoient lieu d’é-
piccs du tems de S. Louis. Ce que payoït au juge celui qui
Iouoit une maifon à quelque ribaude. Autres réglemens de
ce prince fur ce fuiet. lbid. 777. ». Quel étoit 1 ufage établi
par rapport aux juges d’églife Ce qu’ordonna le roi Jean
à l’èeard qes juges de la ville d’Aiguës-mortes. Ordonnances
qui défendirent depuis à tous juges de rien recevoir des parties.
Ce que permit Philippe de Valois aux commiffaires députés
du parlement. Commencement de l’ufage de préfen-
ter aux juges quelques boites de confitures feenes, lorfqu’onr
avoit gagné un procès. Ces épices converties en argent ;
avant qu’elles entraffent en taxe. Les juges ne pouyoient
recevoir ces préfens fans permiflion. lbid. A Arrêt qui com-
mença à taxer les épices ; mais qui cependant n’établit pas
d’abord un ufage confiant. Les boites de dragées fe don