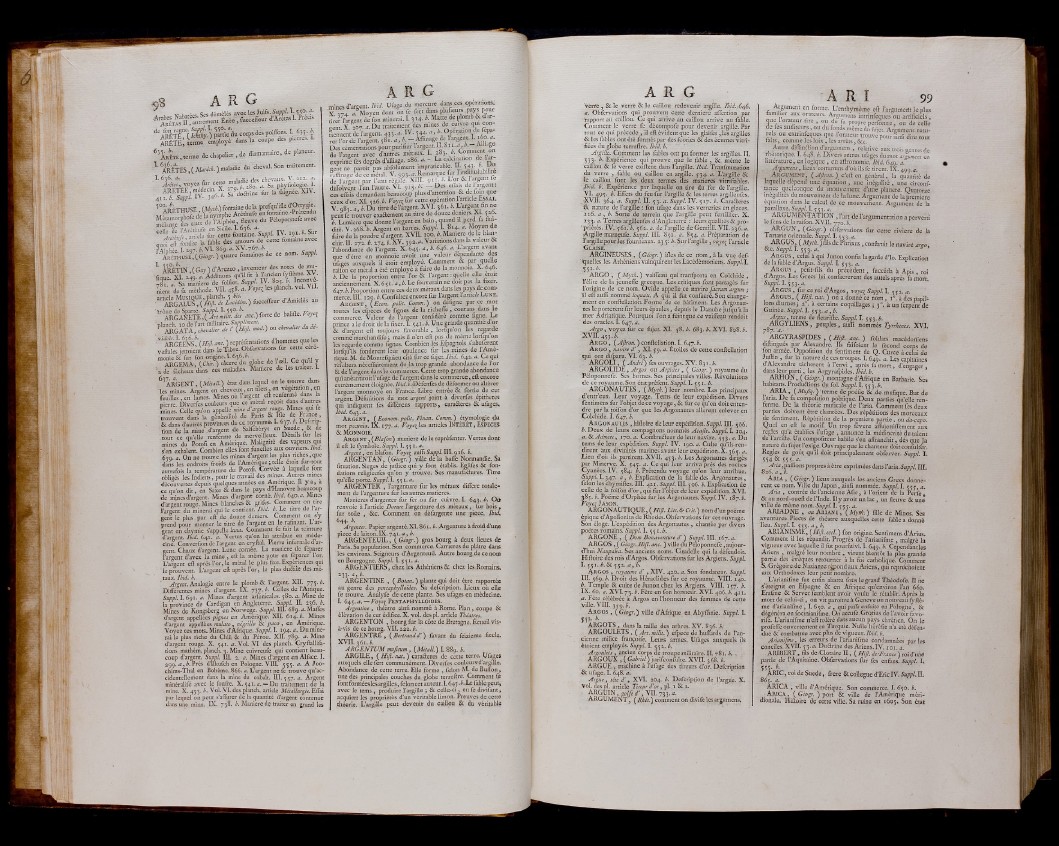
«8 A R G
* Æ t F ' î / S y . ) partie du corps des poiflons. I. d jV b-
B ë l I e æ P dans la coupe des prcrre, I.
6 ,X a llE , terme de chapelier , de diamantaire, de planeur.
1 P r ê t e s ,(A/uréciOmaladie du cheval. Son traitement.
1 M i voyez fur cette ^ “^ ¿ g l e . I. .
Sa^'doflrinè fur la q u é e .X IV .
Metamorphofe de g | g dll paoponnefe avec
mélange tu.» crtuA ... -r ¿..c .
' CeUj l l AS d e Cfur cette'fontaine. Suppl. 1 | S u r
u t i cdlndé'e ht fable des amours de cette fontameavec
l’Alohée I. 297. A. VI. 869. a. X V .767. b. .
Aréthuse,(Geogr.) quatre fontaines de ce nom. Suppl.
1 I S é T IN .C Guy) d’Arezzo , inventeur des notes de mu-
‘ fiaue XI 24Q. a. Additions qu’il fit a 1 ancien fy fteme. XV.
X ' u Sa m?niere de folfie?. Suppl. IV. 8o5. i Inconvénient
de fa méthode. VII. 4 $ fe j ^ les planch. vol. VU.
■art^ ( ^ ïù s ” (M " A£“" * ” '^fi!Cce<reur ™
^ARGANETÉ.^rtmi/teAr anc.) forte de balifte. Voyc^
'ulanch 10 de l’art militaire. Supplément.
ARGATA, chevalier de mod.) ou chevalier du devidoir\.
fy£ b. ^ repréfentadons d’hommes que les
yeffiües jettoient dans .le Tibre. Obfervations fur cette cere-
monie & fur fon origine. 1 .636. b.
ARGEMA, (chir?) ulcere du globe de loeiL Ce qutl y
ade acheux dmts ces maladies. Maniéré de les tratter. I.
ARGENT (MétalL) état dans lequel on le trouve dans
les mines. Argent en cheveux,en filets, en vègétatton, en
feuilles, en lames. Mines ou 1 argent eft renferm. dans la
pierre. Diverfes couleurs que ce métal reçoit dans dautres
mines. Celle qu’on appelle mine i argent raye
trouvent dans la généralité de Tans & Ified e France:,
& dans d’autres provinces de ce royaume. I. 637. b Delcnp-
tion de la mine .d’argent de Saliebênrt en Suede , & de
tout ce qu’elle renferme de merveilleux. Détails fur les
mines du Potofi en Amériqué. Malignité des vapeurs qui
s’en exhalent. Combien elles font funeïles aux ouvriers. Ibid.
630. a. On ne trouve les mines d’argent les plus nches.que
dans les endroits froids de l’Amérique ; telle étott fur-tout
autrefois la température du Potofl. Corvée a laquelle lont
obligés les Indiens, pour le travail des mines. Autres mines
découvertes depuis quelques années en Amérique. 11 y a, a
ce qu’on dit, en Saxe & dans le pays d’Hanovrebeaucoup
de mines d’argent. Mines d’argent corné. Ibid. 640. a. Mines
d’argent rouge. Mines blanches & grifes. Comment on tire
l’argent du minerai qui le contient..Ibid. A. Le titre de lar-
gent le plus pur g j de douze deniers. Comment on s y .
prend pour monter le titre de l’argent en le rannant. L argent
en chymie s’appelle luna. Comment fe fait la teinture
d’argent. Ibid. 641. a. Vertus qu’on lui attribue en médecine.
Converfion de l’argent en cryftal. Pierre infernale d’argent.
Chaux d’argent. Lune cornée. La maniéré de feparer
l’argent d’avec la mine , eft la même pour en féparer 1 or.
L’argent eft après l’or, le métal le plus fixe. Expériences qui
le prouvent. L’argent eft après l’or, le plus duftile des mé-
taux. Ibid. b.
' Argent. Analogie entre le plomb & largent. Ail. 775. b.
Différentes mines d’argent. IX. 737. b. Celles de l’Attique.
Suppl. I. 691. a. Mines d’argent arfénicales. 580. a. Mine de
la province de Cardigan en Angleterre. Suppl. H. 236. b.
Mines de Kongsberg en Norwege. Suppl. III. 689. a. Maffes
d’argent appellées pignes en Amérique. XII. 614. b. Mines
d’argent appellées mulato, négrïüo oC paco , en Amérique.
Voyez ces mots. Minés d’Afrique. Suppl. I. 194- ^ Du minerai
le plus riche du Chili & au Pérou. XIl. 789. a. Mine
d’argent rouge. X. 541. a. Vol. VI des planch. Cryftallifa-
tions mathém. planch. 3. Mine çuivreufe qui contient beaucoup
d’argent. Suppl. III. 2. a. Mines d’argent en Alface. I.
299. a , A. Près d’Ukufch en Pologne. VDI. <55. a. A Joo-
chims-Thal en Bohême. 866. a. L’argent ne fe trouve qu'accidentellement
dans la mine du cobalt. III. 557. a. Argent
minéralifé avec le foufre. X. <41. a. — Du traitement de la
mine. X. 433. b. Vol. VI. des planch. article Métallurgie. Effai
par lequel on peut s’aflurer de la quantité d’argent contenue
dans une. mine. IX. 738. b. Maniéré de traiter en grand les
À R G
firer l’areent de fon minerai. I. 3 * 4 -1 Marte de plomb & d argent
X 207. n. Du traitement dés mines de entvre qm confieraient
de l’argent. 433-«-,i v - m “ •
rer l’or de l’argent. •¡Si. a, t. — Affinage de l argei . .
Des cémentations pour purifier 1 argent.II. 811 .a,b. Allège
de l’argent avec d’autres métaux. I. ¡ g y i. Çÿmim« on
exprimí fes degrés d’alUage. z86 a - La crémation de lar
gent ne paroît pas abfolument impraticable. 11. g f e e H B
raffinage l e ce métal. V. 993. *• Remarque fur l’.ndt lolubihté
de largent par l'eau régílí. XIII. 9 -J .i. L’or St l’argent fe
dilfolvent .l’un l’autre. VI. 91 !■ § - ües.efia^de largent
ces effais demandent beaucoup plus d attennon & j j S Ê m ?
ceux d’or. XI. 316.b. royrffur cette openmonlaracle Es sai,
V . 983. a, b. Du titre de l’argent. XVI. 361. i. L argent fin ne
peut fe trouver exaftement au .titre de douze deniers. Ai. 5 20.
b. Lumière que donne l’argent en bain, quand .il .perd la fluidité.
V. 268. b. Argent en barres. Suppl. I 814. a. Moyen de
faire de la poudre d’argent. XVII. 100. b. Maniere de le blanchir.
H. 272. b. 274. b. XV. 392.4. Variations dans la valeur Sc
l’abondance de l’argent. X. 645. a, b. 646. 4. L’argent avant
que d’ètre en monnoie avoit un'e valeur dépendante des
ufages auxquels il étoit employé. Comment oc par quelle
railon ce métal a été employé à faire de la monnoie. A. 646.
b. De la proportion entre l’or p l’argent : quelle elle étoit
anciennement. X .6 ^ a sb. Le fouyerainne doit pas la fixer.
647.¿.Proportion entre ces deux métaux dans les paysae commerce.
III. 129. b. Coiifultez encore fur l’argent l article L une.
A rgent , f Econ. polit. Çomm. ) on défigne par ce mot
toutes les 'efpeces de fignes de la richeffe, couraus dans le
commerce. Valeur de l ’argent confideré comme ügne. Le
prince aie droit de la fixer. I. 341. ¿.Une grande quantité d or
& d’argent eft toujours favorable, lorfqu’on les regarde
comme marchandife; mais il n’en eft pas de même lorfqu on
les regarde comme fignes. Combien les Efpagnols s’abuferent
lorfqu’ils .fondèrent leur opulence fur les mines de l’Amérique.
M. de Montefquieu cité fur ce fujet. Ibid. 642. a. Ce qui
réfultera néceflairement de là trop grande abondance de l’or
& dé l’argent dans le commence. Cette trop grande abondance
qui anéantiroit l’ufage de l’argent dans le commerce, eft encore
extrêmement éloignée. Ibid. ¿.Défenfes de déformer ou altérer
l’argent monnoyè en Fiance. Libre entrée & fôrtie de cet
argent. Définitions du mot argent joint à diverfes épithetes
qui indiquent fes différçns rapports, caraôeres & ufages.
Ibid. 643. a.
A r g e n t , (Econom. polit. Finan. Comm.') étymologie du
mot pecunia. IX. 177. a. Voye{ les articles INTERET, ESPECES
& Monnoie.
A rgen t , (Blafon) maniere de le repréfenter. Vertus dont-
il eft le fymbole. Suppl. 1. 111. a.
Argent, en blafon. Voye%_ aufli Suppl. III. 916. ¿.
ARGENTAN, ( Geogr. ) ville de la bâtie Normandie. Sa
fituation. Sieges de juftice qiti y font établis. Eglifes & fondations
réligieufes qii’on y trouve. Ses manufactures. Titre
qu’elle porte. Suppl. I. 531. <1.
ARGENTER , l’argenture fur les métaux différé totalement
de l’argenture fur.lesautres matieres.
Manieres d’argenter fur fer ou fur cuivre. I. 643. b. Qo¡
renvoie à l’article' Dorure l’argenture des métaux, fur bois,
fur toile , &c. Comment on défargente une pièce. Ibid»
644. b.
Argenter. Papier argenté.XI. 861. b. Argenture à froid d’une
piece de laiton. IX. 741. , b.
ARGENTEUIL, ( Geogr.) gros bourg à deux lieues de
Paris. Sa population. Son commerce. Carrières de plâtre dans
Tes environs. Seigneurs d’Argenteuil. Autre bourg de ce nom
en Bourgogne. Suppl. I. 3 31. a.
ARGENTIERS, chez les Athéniens & chez les Romains.
233. <*, b.
ARGENTINE , ( Botan. ) plante qui doit être rapportée
au genre des pentaphylloïdes. Sa defeription. Lieux où elle
fe trouve. Analyfe de cette plante. Ses ufages en médecine.
I. 643. a. — Voyei PENTAPHYLLOÏDES.
Argentine 3 théâtre ainfi nommé a Rome. Plan , coupe &
élévation de cet édifice. X. vol. des pl. article Théâtres.
ARGENTON , bourg fur la côte de Bretagne. Écueil vis-
à-vis de ce bourg. VII. 222. ¿.
ARGENTRÉ , ( Bertrand d ') favant du feizieme fiecle.
x v n . 361. ¿.
ARGENTUM muficum t (Metall.) I. 889. b.
ARGILE, I Hiß. nat. ) caraileres de cette terre. Ufages
auxquels elle fert communément. Diverfes couleurs'd’argille.
Abondance de cette terre. Elle forme , félon M. de Buffon,
une des principales couches du globe terreftre. Comment ff
font formées les argilles, félon cet auteur. 1.643. ¿.Le fable peut,-
avec le tems , produire l’argille ; & celle-ci, en fe divifant,
acquiert les propriétés d’un véritable limon. Preuves de cette
théorie. L’argille peut devenir du caillou & du vérijablç
A R G
verie , & le verre & le caillou redevenir argtile. ïbid.>646.
a. Observations qui prouvent cette derniere aflertion par
■Rapport au caillou. Ce qui arrive au caillou arrive au fable.
Comment le verre fe décompofe pour devenir argUle. Par
tout ce qui précédé , il eft évident que les glaifes, les argilles
& les fables ont été formés par des feories & des écumes vitrifiées
du globe terreftre. Ibid. b.
Argille\ Comment les fables ont pu former les argilles. II.
333. b. Expérience qui prouve que le fable, & même le
caillou & le verre exiftent clans l’argille. Ibid. Tranfmutation
du verre y fahle pu caillou en argille. 534. a. L’argille 8c
le caillou font ¡es deux termes des matières vitrifiâbles.
Ibid. b. Expérience par laquelle on tire du fér de l’argille.
VI. 49 3^ b. Effets du .feu fur l’àrgille & les terres ärgilleufes.
.'XVII. 364. a. Suppl. II. 33. a. Suppl. IV. 317. b. Caraileres
& nature de l’argille : fon ufage dans les verreries en glaces,
a 16. a , b. Sorte de terrein que l’argiüe peut fertiliier. X.
133. a. Terres argilleufes d’Anelcterre :,leurs.qualités & propriétés.
IV. 56ïlb. 362.4. de.l argille deGentilli. VII. 236. a.
■Argille marneufe; Suppl. III. 831. à. 834. a. Préparation de
l’argille pour les fourneaux. 23 3: b. Sur l’argille, voye^ l’article
G laise.
ARGINEUSES , ( Géogr.) ifles de ce irbm, à la vue def-
‘ Quelles les Athéniens vainquirent les Lacédémoiiiëns. Suppl i .
AR G O , ( Myth. ) vaiffeaü qui tranfporta en Çolchide ,
l’élite de la jeuneffe grecque. Les critiques font partagés fur
l’origine de ce nom. Ovide appelle ce navire fàcram argum ;
îl èft aufli nommé loquax. A qui il fut confacré..Son change-
ment en conftellation. Forme de ce bâtiment. Les Argonautes
le portèrent fur leurs épaules, depuis le Danube jufqu’à la
mer Adriatique. Pourquoi l’on à feintque ce vaiffeàu rendoit
‘ des oracles. 1 .647. a.
'X V jf0 * 06 ^u/ct‘ 5?* ^ ^ 1 1 -^VI. 808. b.
A r g o , ( Àftroni | conftellation. I. 647. b.
A r g o -, navire d’ , XI. 39. à. Étoiles de cette conftellation
’ qui ont difoaru. VI. 63. b.
ARGOLI, ( Andre ) fes ouvrages. XV. 831. b.
ARGOLIDË, Argos ou Argides , ( Géogr. ) royaume du !
Péloponnefe. Ses bornes. Ses principales villes. Révolutions
de ce royaume. Son étatpréfent. Suppl. I. 3 31. b.
ARGONAUTES, (Myth. ) leur nombre. Les principaux ,
. d’entr’eux. Leur voyage. Tems de leur expédition. Divers
fentimens fur l’objet de ce voyage, & fur ce qu’on doit entendre
par la toifon d’or que les Argonautes allèrent enlever en
Colchidè. I. 647. ¿z
A rgo nautes , hiftoire de leur expédition. Suppl. III'. 306.
b. Deux de leurs compagnons nommés Acafie. Suppl. ï. 104.
a. & Admete, 170. a. Conftruéleur de leur navire. 553.4. Du
tems de leur expédition. Suppl. IV. 190. a. Culte qu’ils rendirent
àux divinités marines avant leur expédition. X. 365. a.
Lieu d’où ils partirent. XVII. 453. b. Les Argonautes dirigés
par Minerve. X. 545. a. Ce qui leur arriva près des roches
Cyanées. IV. 584: b. Prétendu voyage qu’on leur attribue.
Suppl. I. 347. a , b. Explication de la fable des Argonautes,
félon les chÿmiftes. m . 421. Suppl. III. 506. ¿. Explication de
celle dé la toifon d’o r, qui fut l’objet de leur expédition. XVI.
385. b. Poëm’e d’Orphée fur les Argonautes. 'Suppl. IV. 187. b.
roye{ Jà sÔN.
ARGONAUTIQUE, | Hiß. Litt. 6» Crit.) nom d’un poëme
épique d’Apollonius de Rhodes. Obfervations fur cet ouvrage.
Son éloge. L’expédition des Argonautes , chantée par divers
poëtés romains. Suppl. I. 5 51. ¿.
ARGONE , ( Dom Bonaventùre (T ) Suppl. III. 167. a.
ARGOS , {Géogr. Hiß. anc. ) ville du Péloponnefè aujourd’hui
Naupalia. Ses anciens noms. Citadelle qui la défendoit.
Hiftoire des rois d’Argos. Obfervations fur les Argiens. Suppl.
I. 551. b. & 552. 4 , '¿.
A r g o s , royaume d.' , XIV. 420.4. Son fondateur. Suppl.
III. 569. ¿. Droit dès Héraclides fur ce royaume. VIII. 140.
b. Temple & culte de Junoh chez les Argiens. VIII. 157. b.
IX. 60. 4. XVI. 73. b. Fête en fon honneur. XVI. 406. b. 411.
4. Fête célébrée à Areos en l’honneur des femmes de cette
Ville. VIII. 359: b.
A r g o s , (Géogr.) ville d’Afrique en Abyflinie. Suppl. L
552. b.
ARGOTS, dans la taille des arbres. XV. 836. b:
,■ ARGOULETS, ( Art. milit. ) elpece de htiflards de l’an-
.cienne milice françoifc. Leurs armes. Ufages auxquels ils
étoient employés. Suppl. I. 552 b.
Argoülets, ancien corps de troupe militaire.’ II. 781. b. »
ARGOUX ,.( Gabriel) jurifcohlulte. XVII. 36,8. b.
ARGUE , machine à l ’ufage des tireurs d’or. ÎDefcription
& ufage. I. 648. a.
Argue, tête d’ , XVI. 204. b. Defeription de Targtip. Xi
Yol. des pl. article Tireur d'or, pl. t & 2.
ARGUIN, golfe d’ , VII. 733.4.
ARGUMENT, ( Rhét.) comment on divife les argumens.
A R I 99
- c ^ S llmcnt en forme. L’enthÿmême eft l'argument le plus
tanuuer aux orateurs. Argumens lutrinfeques ou arttficiels",
oue l orateur ttre , ou de fa propre perfiune, ou de telle
de fes auditeurs, ou du fonds même du fujet. Argumens naturels
ou exmnfeques que l’orateur trouve pour ainfi dire tout
fans, comme les loix, les arrêts, &c.
Autre diftinélion d’argumens, relative aux trois gênresde
[heforique. I. 648. b. Divérs autres ufages du mot argument en
littérature , en logique, en aftronomie. Ibid. 649. 4.
Argumens, licux'communs d’où ils fe tirent. IX. 499-. a.
A rgum en t, ( Aflron. ) c’eft en général, la quantité de
laquelle dépend une équation , une inégalité , une çirconf*
tance quelconque du mouvement d’une planete. Quatorze
inégalités du mouvement dò la lune. Argument de la premiere
équation dans le calcul de ce mouvement. Argument de la
parallaxe. Suppl.I. 553.a.
. ARGUMENTATION , l’art de l’argumentation a perverti
le fens de la raifon. XVII. 770. ¿.
ARG UN, (Géogr.) obfervations fur cette riviere de là
Tartarie orientale. Suppl. 1. 5 5 3.4.
ARGUS, ( Myth. ) fils de Phrixus, conftruit le navirê àrgoi
&c. Suppl. I. 553. 4.
A rgu s , celui à qui Junon confia la garde d’Io. Explication
de la fable d’Argus. Suppl. I. 553 .a.
. A rgu s , petit-fils du précédent, fuccéda à Apis j roi
d’Argos. Les Grecs l.ui confacrerent des autels après fa mort
Suppl. I. 553. 4.
A r gu s , fur ce roi d’Argos , voye^ Suppl. I. 552. 4.
A rgu s , ( Hiß. nat. ) on a donné cé nòm, i°. à des papillons
diurnes; 20. à certains coquillages ; f t l à un ferpent de
Guinée. Suppl. I. 553.4, ¿.
Argus, terme de fleurifte. Suppl. I. 553. ¿.
ARGYLIENS, peuples, aufli nommés Tyrrhenes. XVL
787. a.- I •
ARGYRASPIDES , ( Hiß. arte. ) foldats macédoniens
diftingués par Alexandre. Ils faifoient le fécond corps de
fon armée. Oppofnion du fentiment de Q. Curce à celui de
Juftin , fur la nature de ces troupes. 1. 649. 4. Les capitaines
d’Alexandre tâchèrent à l’envi , après fa mort, d’engager
dans leur parti, les Argyrafpides. Ibid. b.
ARHON, ( Géogr.) montagne d’Afrique en Barbarie. Ses
habitaris.PrOduftions du fol. Suppl. I. 553.b.
1» (Mußq. ) ' terme de.poéfie & de. mufique. But de
l’aria. De fa compoütion poétique. Deux parties qa’elle renferme.
De la théorie muficale de l’arià. Comment fes deux
parties doivent être chantées. Des répétitions' des morceaux
de fentiment. Répétition de la premiere partie, ou da-capo.
Quel en^ eft le motif. Un trop févere affujettiffement aux
réglés qu a établies l’ufage , annonce la médiocrité du talent
de l’arrifte. Un compòfiteur habile s’en affranchir, dés que II
naturò du fujet l’exige. Ouvrage que le chanteur doit confultêr.
Réglés de goût; qu’il doit-principalement obferver. Suppl. L
554 &
Aria ,paffions propres à être exprimées dans l’aria. Suppl. III.
826.4 ,4 .
A r ia , ( Géogr. ) lieux auxquels les anciens Grecs donnèrent
ce nom. Ville dü Japon, ainfi nommée. Suppl. I. y r a.
Aria j contrée de l’ancienne Afie, à l’orient de la Perte,
& au nord-oueft de l’Inde. Il y avoit un lac , un fleuve & une
ville de même nom. Suppl. I. 535. a.
ARIADNE , ou A rian e , ( Myth-. ) fille de Minos. Ses
aventures-. Pièces de théâtre auxquelles cette fobie a donné
Meu.Suppl.i. 555. 4 , b.
ARIANISME, (Hiß. ceci|| fon origine; Sentimens d’Arius.
Comment il les répandit. Progrès de l’arianifme , malgré la
vigueur avec laquelle il fut pourfiiivi. I. 649. b. Cependantles
Ariens , malgré leur nombre , virent bientôt la plus grande
partie des évêques retourner à la foi catholique. Comment
S. Grégoire Te Nazianze répond aux Ariens, qui reprdchoient
aux Orthodoxes leur petit nombre;
L’arianifme fut enfin abattu foiis le grand Théodofe. Il ne
s’éteignit en Efpagne & en Afrique qu’environ l’an 660.
Erafnie & Servet femblent avoir voulu le rétablir. Après la
mort de celui-ci, on vit paroùre à Geneve un nouveau fyftê-
me d’ärianlfme ; 1. 650. a , ,qui pâflà enfuite en Pologfie, &
dégénéra on foçinianifme; On accufe-,Gratins .de l’avoir fovo-
rife. L’arianifme n’eft toléré dans aucun pays chrétien. On le
profeffe ouvertement en Turquie. Nulle héréfie n’a été défen-
dué & combattue avec, plus de vigueur. Ibid. b.
Aripnifnie, les erreurs de l’arianiime condamnées parles
Conciles. XVII. 53.4. Doûrine des Ariens. IV. 1 o.i. a. ’
■ ARIBERT, fus de.Clotaire I I , | Hiß. de ’France ) roi d’une
partie dé l’Aquitaine. Obfervations fur fes enfons. Suppl. L
$55- b'
ARIC, roi de Suede,- frere & collègue d’Eric IV; Suppl. II;
86<. a.
ARICA , ville d’Amériqüe. Son commerce. I. 6<(ô; ¿.
- A r ic a , ( Geogr. ) port 8c ville de l’Amérique méridionale;
Hiftoire de eetté ville. Sa ruine en 1605. Son état