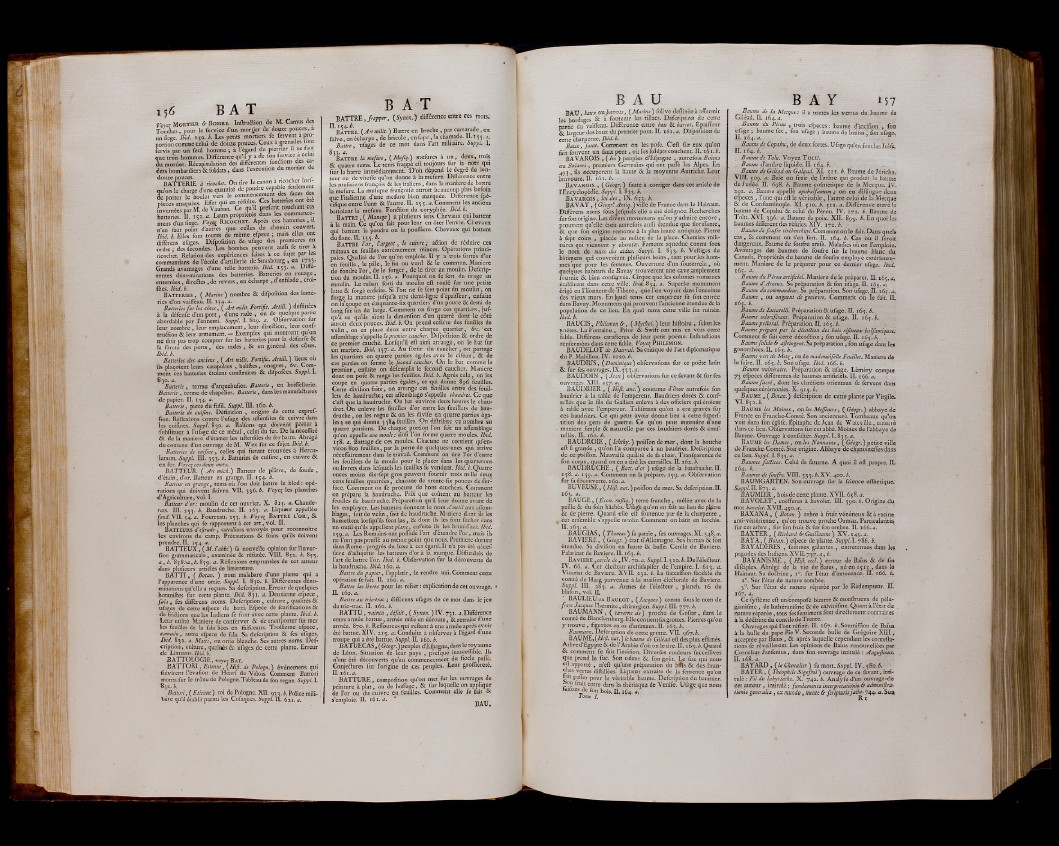
156 BAT Vova M o r t ie r Bo m b e . Inftniflion.de M . ‘Camus des
Touches, pour le iervlce d’un morÿer de'douze pouces,a
unfiege. IbU. 150. b. Les petit* morders fe fervent a pro-
pordon comme celui de douze pouces. Ceux à grenades lont
fervis par un feul homme ; à l ’égard du pierrier il ne tant
<me trois hommes. Différence qu’ify a de Ion fervtce a ce ut
du morder. Récapitulation des différentes fonihons des cadets
bombardiers &foldats, dans l’exécunon du mortier de
^ BA’ÎtERIE h ricocha. On tire le canon à ricochet lorf-
qu’on le charge d’une quantité de poudre capable feulement
de porter le bouler vers le commencement des faces des
pièces attaquées. Effet oui en réfulte Ces battenK ont été
inventées par M. de Vauban. Ce qn il prefent touchant^ces
batteries. II. 15Z-a. Leurs propriétés dans les commence-
mens d’un fiege. Voym R i c o c h e t Apres ces batteries, il
n’en faut point d’autres que celles du chemin couvert-
Ibid. b. Elles font toutes de même efpece ; mais elles ont
différens ufages. Difpofition &• ufage des premières en
■ordre ; des fécondés. Les bombes peuvent auffi fe tirer a
ricochet. Relation des expériences faites à ce fujet par les
commandans de l’école d’artillerie de Strasbourg , en J 75.3*
Grands avantages d’une telle batterie. Ibid. 153- Diftè-
rentes dénominations des batteries. Batteries en rouage ,
enterrées, direCtes, de revers, en écharpe , d enfilade, croi-
fées. Ibid. b. ■
B a t t e r ie s , ( Marine ) nombre & difponuon des batteries
d’un vaiffeau. H. 154. a.
Batteries fur ies côtes, ( Art milit. Fortifie. Arttll. ) deftinées
à la défenfe d’un port, d’une- rade , ou de quelque partie
abordable par l’ennemi. Suppl. I. 829. a. Obfervation fur
leur nombre , leur emplacement, leur direction, leur conl-
truâion & leur armement. — Exemples qui montrent qu on
ne doit pas trop compter fur les batteries pour la detenfe &
la furetc des ports, des rades , & en général, des côtes.
Ibid. b. ! ,
Batteries des anciens , (Art milit. Fortifie. Arttll.) lieux ou
Us plaçoient leurs catapultes , baliftes, onagres, Oc. Comment
ces batteries étoient conftruites & dilpofées. Suppl. I.
830. a. •<
Batterie, terme d’arquebulier. Batterie, en boiiTeUerie.
Batterie, terme de chapelier. Battirie, dans les manufactures
-de papier. II. 154. a.
Batterie, piece du fùfil. Suppl. în . 160. b.
Batterie de cuifine. Définition , origine de cette expref-
fion. Réflexions contre l’ufage des uftenfiles de cuivre dans
les cuifines. Suppl. 830. a. Raifons qui doivent porter à
fubftituer à l’ufage de ce métal, celui du fer. De la néceffité
& de la maniéré d’étamer les uftenfiles de fer battu. Abrégé
du contenu d’uii ouvrage de M. Wex fur ce fujet. Ibid. b.
Batteries de cuifine, celles qui furent trouvées à Hércu-
lanum. Suppl. IU. 353. b. Batteries de cuifine, en cuivre &
en fer. Voyercesdeux mots.
BATTEUR. ( Art mèch. ) Batteur de plâtre, de foude ,
d’étain, d’or. Batteur en grange. II. 154. b.
Batteur en grange, tems où l’on doit battre le bled : opérations
qui doivent fuivre. VII. 336.b. Voye^ les planches
-d’Agriculture, vol. I.
Batteur d'or: moulin de cet ouvrier. X. 815. a. Chaude-
rets. III. 253. b. Baudruche. H. 163. a. Liqueur appellée
fond. VU. 54. a. Fourreau. 253. b. Voye{ B a t t r e l’o r -, &
les planches qui fe rapportent à cet art, vol. II.
B a t t e u r s d’efirade, cavaliers envoyés pour reconnoître
•les environs du camp. Précautions oc foins qu’ils doivent
prendre. II. 154. a.
BATTEUX, {M. l'abbé) fa nouvelle opinion furl’inver-
fion grammaticale, examinée & réfutée. vIH. 852. b. 85-5.
a , b. 8f8.\z,b.8iç. a. Réflexions empruntées de cet auteur
dans plufieurs articles de littérature.
B A T T I , ( Bot an. ) nom malabare d’une plante oui a
l’apparence d’une ortie. Suppl. I. 830. b. Différentes déno-
• minations qu’elle a reçues. Sa defeription. Erreur de quelques
botaniftes fur cette plante. Ibid. 831. a. Deuxième efpece,
fais., fes différens noms. Defeription, culture, qualités &
ufages de cette tlpece de batti. Efpece de fcarifications &
de triCtions que les Indiens fe font avec cette plante. Ibid. b.
Leur utilité. Maniéré de conferver & de tranfporter fur mer
‘ les feuilles de la fala liées en fàifceaux. Troifieme efpece,
camadu, autre efpece de fala. Sa defeription & fes ufages.
Ibid. 83 2. a. Matti, ou ortie blanche. Ses autres noms. Del’
cription, culture, qualûés & ufages de cette plante. Erreur
de Linnæus. Ibid. b.
BATTOLOGIÉ, voyez B a t .
BATTORI, Etienne, \Hift. de Pologn.) événemens qui
fuivirent l’évafibn de Henri de Valois. Comment Battori
monta fur le trône de Pologne. Tableau de fon regne. Suppl. I.
832. b.
Battori, ( Etienne) roi de Pologne. XII. 033. ¿.Police militaire
qu’il établir parmi les Cofaques. Suppl. il. 621. a.
B A T
BATTRE, frapper, (Synon.) différence entre ces mots:
^ B a t t r e . (Art milit. ) Battre en breche, par camarade, en
falve, en écharpe, de bricole, enfape ,'la chamade. II. 15 5.a.
Battre, ufages de ce mot dans l’art militaire. Suppl. I.
833. a. .
B a t t r e la mefure, ( Mufiq.) mefures à un, deux, trois
& quatre tems. Le tems frappé eft toujours fur la note qui
fuit la barre immédiatement. ‘D’ou dépend le degre de lenteur
ou de vîteffe qu’on donne à la mefure. Différence entre
les muficiens françois & les italiens, dans la maniéré de battre
la mefure. La mufique frariçoife auroit beaucoup plus befoin
que l’italienne d’une mefure bien marquée. Différence fpé-
cifique entre l’une & l’autre. II. 135. a. Comment les anciens
battoient la mefure. FonCtion du coryphée. Ibid. b.
B a t t r e , ( Manege) a plufieurs fens. Chevaux qui battent
à la main. Ce qu’on fait pour leur en ôter l’envie. Chevaux
qui battent la poudre ou la poufliere. Chevaux qui battent
du flanc. II. 135. b.
B a t t r e l’or, l'argeàt, le cuivre ; action de réduire ces
métaux en feuilles extrêmement minces. Opérations principales.
Qualité de l’or qu’on emploie. U y a trois fortes d’or
en feuille, le pâle, le fin ou verd & le commun. Maniéré
de fondre l’o r, de le forger, de le tirer au moulin. Defeription
du moulin. II. 136. a. Pourquoi on fe fert du tirage au
moulin. Le ruban forti du moulin eft roulé fur une petite
latte & forgé enfuite. Si l’on ne fe fert point du moulin, on
forge la matière jufqu’à une demi-ligne d’épaiffeur, enfuite
onla*coupe en cïnquante-fix quartiers d’un pouce &demi de
long fur un de large. Comment on forge ces quartiers, jufqu’à
ce qu’ils aient la dimenfion d’un quarré dont le côté
auroit deux pouces. Ibid. b. On prend enfuite des feuilles de
velin, on en place deux entre chaque quartier, Oc. cet
affemblage s’appelle le premier caucber. Difpofition & ordre de
ce premier cauché. Lorfqu’il eft ainfi arrangé, on le bat fur
un marbre. Ibid. 137. a. Au fortir du caucher, on partage
les quartiers en, quatre parties égales avec le cifeau, & ae
ces parties on forme le fécond caucher. On le bat comme le
premier, enfuite on défemplit le fécond caucher. Maniéré
dont on pofe & rangé les feuilles. Ibid. b. Après cela, on les
coupe en quatre parues égales, ce qui donne 896 feuilles.
Cette divifion faite, on arrange ces feuilles entre des feuillets
de baudruche ; cet affemblage s’appelle chaudret. Ce que
c’eft que la baudruche. On bat environ deux heures le chaudret.
On ertleve les feuilles d’or entre les feuillets de baudruche,
on les rogne & on les divife en quatre parties égales;
ce qui donne 3384 feuilles. On diftribue ce nombre en
quatre portions. De chaque portion l’on fait un affemblage
qu’on appelle une moule : ainfi l’on forme quatre moules. Ibid.
138. a. Battage de ces moules. Chacune ne contient qu’environ
800 feuilles, par la perte de quelques-unes qui arrive
néceffairement dans le travail. Comment on tire l’or d’entre
les feuillets de la moule pour le placer dans lès quarterons
ou livrets dans lefquels les feuilles fe vendent. Ibid. b. Quatre
onces moins dix-fept gros peuvent fournir trois mille deux
cens feuilles quarrées, chacune de trente-fix pouces de fur-
fàce. Comment on fe procure de bons cauchers. Comment
on prépare la baudruche. Prix que coûtent au batteur les
feuilles de baudruche. Préparation qu'il leur donne avant de
les employer. Les batteurs donnent le nom d'outil aux affem-
blages, foit de vélin, foit de baudruche. Manière dont Us les
humeâent lorfqu’ils font las , & dont ils les font fécher dans
un outil qu’ils appeUentplane, enfuite Us les bruniffent. Ibid.
139. a. Les Romains ont poffédé l’art d’étendre l’or, mais ils
ne l’ont pas pouffé au même point que nous. Première dorure
dans Rome : progrès du luxe à cet égard. Il n’a pas été nécefi
faire d’affujettir les batteurs d’or à la marque. Difficultés de
l’art de battre l’or. Ibid. b. Obfervation fur la découverte de
la baudruche. Ibid. 160. a.
Battre du papier, l’applatir, le rendre uni. Comment cette
opération fe fait. II. 160. a.
Battre les livres pour les relier : explication de cet ouvrage. •
II. 160: a.
Battre au tric-trac ; différens ufages de ce mot dans le jeu
du tric-trac. II. 160. b.
BATTU , vaincu , défait, ( Synon. ) IV. 731. a. Différence
entre armée battue, armée mife en déroute, & retraite d’une
armée. 870. b. Reffources qui reftent à une armée après avoir
• été battue. XIV. 213. a. Conduite à obferver à l’égard d’uiie
troupe qui a été battue. Suppl. Iï. 160. b.
BATUECAS, ( Géogr. ) peuples d’Efpagne, dans le royaume
de Léon. Situation de leur pays , prefque inacceffible. Ils
n’ont été découverts qu’au commencement du fiecle paffé.
Conjectures fur l’origine de ces peuples. Leur groffiéreté.
II.i6i.il. . ,
BATTURE, compofition qu’on met fur les ouvrages de
peinture à plat, ou de boffage, & fur laquelle on applique
de l’or ou du cuivre en feuilles. Comment elle fe fait &
s’emploie. II. 161. a. BAU ‘
BAU B A Y lit.
BAU baux oufiarrots, ( Marine ) folive deftinée à affermir
les bordages & à foutenir les tillacs. Defeription de cette
partie du vaiffeau. Différence entre bau & barrot. Épaiffeur
& largeur des baux du premier pont. II. 161. a. Difpofition de
cette charpente. Ibid.b.
Baux, faux. Comment on les pofe. C’eft fur eux qu’on
iàit fouvent un faux pont, où les foldats couchent. H. 161. b.
BAVAROIS , ( les ) peuples d’Efpagne , autrefois Boiens
ou Bdiares , premiers Germains qui ont paffé les Alpes. En
493 , ils 'occupèrent la haute & la moyenne Autriche. Leur
bravoure. II. 161. b.
B a v a r o i s , ( Géogr. ) faute à corriger dans cet article de
l ’Encyclopédie. Suppl. I. 833. b.
B a v a r o i s > h i des, IX. 633. b.
B A V A Y , ( Géogr* Antiq. ) vifte de France dans le Hainaut.
Différens noms fous lefqüels elle a été défignée. Recherches
fur fon origine. Les divers monumens qu’on y admire encore,
prouvent qu’elle étoit autrefois aufli etendue que floriffante,
& que fon origine remonte à la plus haute antiquité. Pierre
à fept coins , placée au milieu de la place. Chemins militaires
qui viennent y aboutir. Fameux aqueduc connu fous
le nom de murs des aidus. Suppl. I. 833. b. Veftiges de
bâtimens qui couvroient plufieurs bains, tant pour les hom-.
mes que pour les femmes. Ouverture d’un fouterrein, où
Quelques habitaris de Bayay trouvèrent une cave amplement
ournie & bien confejrvéè. Cirque que les colonies romaines
établirent dans cette ville. Ibid. 834. a. Superbe monument
érigé en l’honneur de Tibere, que l’on voyoit dans l’enceinte
des vieux murs. En |quel tems cet empereur fit fon entrée
dans Bavay. Monumens qui prouvent l’ancienne étendue & la
population de ce lieu. En quel tems cette ville fut rumée.
Ibid. b.
BAUCIS, Philemon O , ( Mythol. ) leur hiftoire , félon les
xoëtes. La Fontaine , Prior & Swift ont mis en vers cette
fable. Différens carafteres de leur petit poëme. Inftruétions
renfermées dans cette fable., Voyc[ P h il em o n .
BAUDELOT de Dairval. Sa critique dé l’art diplomatique
du P. Mabillon. IV. 1020. b..
BAUDIUS, ( Dominique ) obfervations fur ce poëte latin
& fur feç ouvrages.IX. 333. a.
BAUDOIN ', ( Jean ) obfervations fur ce favant & fur fes
ouvrages. XIII. 237. a. •
BAUDRIER, ( Hift. anc.) coutume d’ôter autrefois fon
baudrier à la table de l’empereur. Baudriers dorés &.conf-
tellés que le fils de Gallien , enleva à des officiers qui étoient
à table avec l’empereur. Talifmans qu’on a cru gravés fur
. ces baudriers. Ce qui peut avoir donné lieu à cette fuperf-
tition des gens de guerre. Ce qu’on peut entendre d’une
maniéré fimple & naturelle par ces baudriers dorés & conf-
tellés. H. 102. b.
BAUDROIE, ( Ichthy. ) poiffon de mer, dont la bouche
eft fi grande , qu’on l’a comparée à un baudrier. Defeription
de ce-poiffon. Mauvaife qualité de fa chair. Tranfparence de
fon coips, quand on en a tiré les entrailles. II. 162. b.
BAUDRUCHE, ( Batt. d'or) ufage de la baudruche.H.
138. a. 159. a. Comment on la prépare. 139. a. Obfervation
fur fa découverte. 160. a.
BUVEUSE, ( Hift. nat. ) poiffon de mer. Sa defeription. IL
163. a.
BAUGE, (Écon. ruftiq. ) terre franche, mêlée avec de la
paille & du foin hachés. Ufagè qu’on en fait au lieu de paître
& de pierre. Quand elle eft foutenue par de la charpente ,
( cet enfembie s’appelle torchis. Comment on bâtit en torchis.
H. 163. a.
BAUGIAS, ( Thomas) fa patrie, fes ouvrages.XI. 348.a.
BAVIERE, ( Géogr. ) état d’Allemagne. Ses bornes & fon
étendue. Sa divifion en haute & baffe. Cercle de Bavière.
Palatinat de Bavière. II. 163. b.
B a v i è r e , cercle de, IV. 70. a. Suppl. 1. 310. b. De l’élefteur.
IV. 66. a. Cet éle&eur archidapifer de l’empire. I. 613. a.
Vicariat de Bavière. XVII. 232. b. La fuccefiion féodale du
comté de Haag parvenue à la maifon éleftorale de Bavière.
Suppl. III. 283. a. Armes de l’éle&eur , planch. 16 du
blafon, vol. II.
BAULIEU ou B a u l o t , ( Jacques ) connu fous le nom de
frere Jacques l’hermite, chirurgien. Suppl. III. 777. b.
BAUMANN , ( caverne de ) proene de Goilar , dans le
comté deBlanckenburg.Ellecontientfixgrottes. Pierres qu’on
y trouve , figurées en os d’animaux. II. 163. b.
Baumann. Defeription de cette grotte. VII. 967. b.
BAUME, (.Hift. nat.) le baume de Giléad eft des plus eftimés.
Arbre d’Egypte & de l’Arabie d’où on le tire. II. 163. b. Quand
& comment fe fait l’incifion. Diverfes couleurs fuccefliyes
que prend le fuc. Son odeur & fon goût. Le fuc qui nous
«ft apporté , n’eft qu’une préparation du bÄs & des branches
vertes diftillécs. Liqueur extraite de ja femence qu’on
but paffer pour Je, véritable baume. Defeription du baumier.
bon fruit entre dans la thériaque de Venife. Ufage que nous
fon hois. ü . 164. al
Tome I.
Baume de la Mecque: il a toutes les vertus du baume de
Giléad. 11. 164. a.
Baume du Pérou , -trois cfpeccs : baume 'tfincifion fon
ufage ; baume fcc, fon ufage ; baume de lotiön I fon ufage.
II. 164. a.
. Baume de Copahu, de deux fortes. Ufage qu’en font les Juifs.
H .1 6 4 .^ ',
Baume de Tolu. Voyez T o l ü .
Baume d’ambre liquide. H. 164. b.
Baume de Giléad ou Galaad. XI. 311. b. Baume de Jéricho.'
VIII. 309. ai Baie ou fruit , de l’arbre qui produit le baume
de Judée. H. 698. b. Baume cofniétique de la Mecque* IV.
292. a. Baume appellé opobalfamum ; on en diftingue deux
éfpeces , Tune qui eft le véritable, l'autre ceiui de la Mecque
& de Conftantinople. XL 310. b. 311. m Différence entre le
baunie de Copahu & celui du Pérou. IV. 172. b. Baume de
Tolu. XVI. 396. -a. Baume de poix. XII. 899. b. En quoi les
baumes différent des réfiries. XIV. 172. b.
Baume de foufre térébenthifié. Comment on le fait. Dans quels
cas, & comment on s’en fert. II. 164. b. Cas où il foroit
dangereux. Baume de foufre anifé. Maladies où on l’emploie.
Avantages des baumes de foufre fur le baume blanc du
Canada, Propriétés du baume de foufre employé extérieurement.
Maniéré de le préparer pour ce dernier ufage. Ibid.
163. a.
Baume du Pérou artificiel. Maniéré de le préparer. H. 163.4.
, Baume d'Arceus. Sa préparation & fon ufage. ü. 163. a.
Baume du commandeur. Sa préparation. Son ufage. IL 163. a.
Baume , ou onguent de genievre. Commeiit on le fait. IL
163. b.
Baume de Lucatelli. Préparation & ufage. IL 165. b.
Baume odoriférant. Préparation & ulage. II. 163. b.
Baume pcéloral. Préparation. II. 163. b.
Baume préparé par la décoilion des bois réfineux balfamiquesl
Comment fe fait cette décoétion ; fon uiàge. II. 163. b.
Baume folidé 0 aftringeni. Sa préparation , fon ufage dans les
gonorrhées; II. 165. b.
Baume vert de Met[ , ou de madempifelle Feuillet. Maniéré de
le faire. II. 163. b. Sort ufage. Ibid. 166. b.
Baume vulnéraire. Préparation & ufage. Léméry compte
73 efpeces différentes de baumes artificiels. II. 166. a.
Baume facré, dont les chrétiens orientaux fe fervent dany
quelques cérémonies. X. 913. b.
^ B a u m e , ( Botan.) defeription de cette plante par Virgile»
B a u m e les Moines, ou les Mejfieurs, ( Géogr. ) abbaye de
France en Franche-Comté. Son ancienneté. Tombeaux qu’on
voit dans fonéglife. Epitaphe de Jean de Wate ville, enterré
dans ce lieu. Obfervations fur cet abbé. Moines de l’abbaye de
Baume. Ouvrage à confulter. Suppl. I. 833.0.
B a u m e les Dames, ou les Nonnains , ( Géogr. ) petite ville
de Franche-Comté. Son origine. Abbaye! dé chanoineffes dans
ce lieu.Suppl. 1.83 •¡.a.
Baumes failices. Celui de fatume. A quoi il eft propre. II.
164. b.
Baumes de foufre. VIU. 3 3 3* b. XV. 400. b.
BAUMGARTEN. Son ouvrage fur la fcience efthetique.'
Suppl. IL 873. a.
BAUMIER, bois de cette plante. XVII. 638. a.
B A VOLET, coëffures à bavolet. III. 390. b. Origine du
mot bavolet. XVII. 430. a.
BAXANA, ( Botan. ) arbre à fruit vénéneux & à racine,
anti-vénérienne , qu’on trouve proche Ormùz. Particularités
fur cet arbre , fur fon fruit &fur fon ombre. II. 166. a.
BAXTER, ( Richard & Guillaume ) XV. 143. a.
B A YA , ( Botan.) efpece déplanté. Suppl.1. 786. b.
BAYADERES , femmes galantes , entretenues dans les
pagodes des Indiens. XVII. 73.7. a, b.
BAYANISME , ( Hift. ceci.) erreur de Baîus & de'fès
difoiples. Abrégé de la vie deBaïus, né en 1313 , dans le
Hainaut. Sa doarine, i°. fur l’état d’innocence. II. 166. â.
20. Sur l’état de nature tombée.
30. Sur l’état de nature réparée par le Rédempteur. II.
167. a.
Ce fyftême eft un/compofé bizarre & monftrueux de péla-
gianifme , de luthéranifme & de calvinifme. Quant à l’état de .
nature réparée, tous les fontimens font directement contraires
à la doCtrine dti concile de Trente.
Ouvrages qui l’ont réfuté. II. 167. b., Soumiflion de Baïus
à la bulle du pape Pie V. Seconde bulle de Grégoire XIII,
acceptée par Baius , & après laquelle cependant les contefta-
tions fe réveillèrent. Les opinions de Baïus renouvellées par
.Cornelius Janfenius, dans fon ouvrage intitulé : Auguftinus.
II. 168. a. .
BAYARD , {le Chevalier ) fa mort. Suppl. IV. 380. b.
BAYER, ( Théophile Sigeffoi) ouvrage.de ce favant, intitulé
: Fil du labyrinthe. X. 742. b. Analyfe d’un ouvrage «de
cet auteur , intitulé : fundamenta interpretationi* 6? adminiftra-
tionis generalia, ex mundo, mente & feripturis jaéla. 744. a. Son
Rc