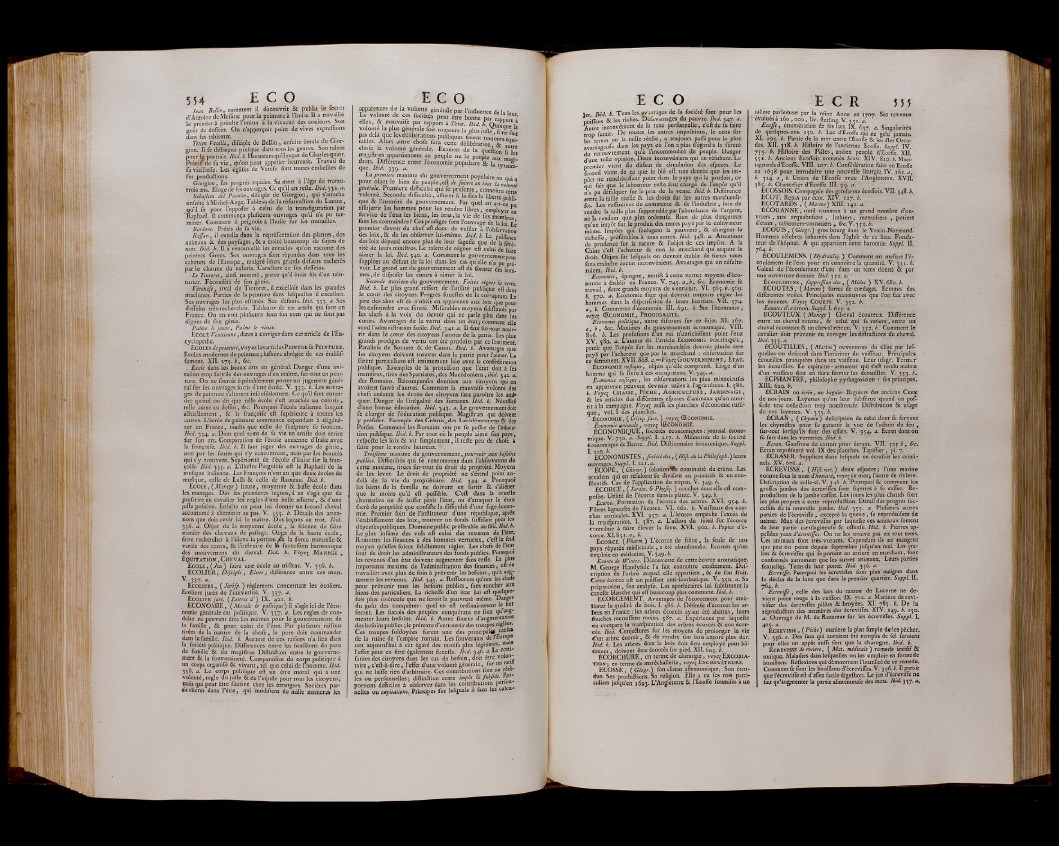
5 5 4 E C O
Jean Bellin, comment il découvrît 8c publia le fecret
d’Antoine deMeffine pour la peinture à l’huile. Il a travaillé
le premier à joindre 1 union à la vivacité des couleurs. Son
gour de deffein. On n’apperçoit point de vives expreffions
dans fes tableaux. .
Titien Vecelli, difciple de Bellin, enfuite émule du Gior-
gion. Il fe diftingua prefque dans tous les genres. Son talent
pour le portrait. Ibid. b. Honneurs qu’il reçut de Charles-quinr.
Précirdc fa vie, qu’on peut appeller lieureufe. Travail de
fa vieilleffe. Lcs'églifes de Venife font toutes embellies de
fes produirions.
Giorgion y fes progrès rapides. Sa mort à 1 âge de trente-
trois ans. Eloge de fes ouvrages. Ce qu il en refte. Ibid. 332.(1.
Sébajlien dcl Piombo, difciple de Giorgion, qui s’attacha
enfuite àMichel-Ange. Tableau de la réfurreérion du Lazare,
qu’il fit pour l’oppofer à celui de la transfiguration par
Ttaphaël. Il commença plufieurs ouvrages qu’d n’a pu terminer.
Comment il peignoit à l’huile fur les murailles.
Bordone. Précis de fa vie.
Bajfan, il excella dans la repréfentadon des plantes, des
animaux & des payfages, & a traité beaucoup de fujets de
nuit. Ibid. b. 11 a renouvellé les miracles qu’on raconte des
peintres Grecs. Ses ouvrages font répandus dans tous les
cabinets de l’Europe, malgré lêurs grands défauts rachetés
par le charme du coloris. Caraétere de fes defieins.
Le Tmtoret, ainfi nommé, parce qu’il étoit fils d’un teinturier.
Fécondité de fon génie.
Véroncfe, rival de Tintoret, il excelloit dans les grandes
machines. Parties de la peinture dans lefquelles il excelloit.
Ses ouvrages les plus ellimés. Ses défauts. Ibid. 333. a. Ses
defieins très-recherchés. Tableaux de cet ardfie qui font en
France. On en voit plufieurs fous fon nom qui ne font pas
dignes de fon génie.
Palme le jeune, Palme le vieux.
Ecole Vénitienne, dates à corriger dans cet article de l’Encyclopédie.
Ecoles dipeinmr^voyezlesarticlesPEiNTRE&PÉiNTURE.
Ecoles -modernes de peinture ; hiftoire abrégée de ces établif-
femens. XII. 275. b, &c.
Ecole dans les beaux arts en général. Danger d’une imitation
trop fervile des ouvrages d’un maître, fur-tout en peinture.
On ne fauroit équitablement porter un jugement général
fur les ouvrages fortis d’une école. V. 333. b. Les ouvrages
de peinture s’alterent infenfiblement. Ce qu’il faut entendre
quand on dit que telle école s’efi attachée au coloris,
telle autre au defiin, &c. Pourquoi l’école italienne languit
actuellement , & la françoife eft fupérieure à toutes les
autres. L’école de peinture commence cependant à dégénérer
en France, tandis que celle de fculpture fc foutient.
Ibid. 334. a. Dans quel tems de fa vie un'artifte doit écrire
- iur fon art. Comparaifon de l’école ancienne d’Italie avec
la françoife. Ibid. b. Il faut juger des ouvrages de génie,
non par les fautes qui s’y rencontrent, mais par les beautés
qui s’y trouvent. Supériorité de l’école d’Italie fur la françoife.
Ibid. 33 j. a. L’illufire Pergoléfe efi le Raphaël de la
mufique italienne. Les François n’ont eu que deux écoles de
mufique, celle de Lulli & celle de Rameau. Ibid. b.
Ecole, (Manège) haute, moyenne & baffe école dans
les maneges. Dés les premières leçons, il ne s’agit que de
preferireau cavalier les réglés d’une belle afiiette, & d’une
jùfté pofition. Enfuite on peut lui donner un fécond cheval
accoutumé à cheminer au pas. V. 335. b. Détails des attentions
que doit avoir ici le maître. Des leçons au trot. Ibid.
33 6. a. Objet de la moyenne école , la fcience de faire
manier des chevaux de paffage. Objet de la haute ccole,
faire rechercher à l’élevc la pordon Èe la force mutuelle 8c
variée des renes, & HnAruire de Ë fucccfiion harmonique
des mouvemens du cheval. Ibid. b. Voye{ Manege ,
É quitation , C h e v al .
Eco le, (/ew) faire une école au triélrac. V. 336. b.
ECOLIER, Difciple, Elevé ; différence entre ces mots.
V .J 3 7 . a.
Ecoliers , ( Jurifp. ) réglemens concernant les écoliers.
Ecoliers jurés de l’univerfité. V. 337. a.
Ecolier juré. (Lettres d’ ) IX. 421. b.
ECONOMIE, (Morale b politique') il s’agit ici de l’économie
générale ou politique. V. 337. a. Les réglés de conduite
ne peuvent être les mêmes pour le gouvernement de
la famille , & pour celui de l’état. Par plufieurs raifons
tirées de la nature de la chofo, le pere doit commander
dans la famille. Ibid. b. Aucune de ces raifons n’a lieu dans
la fociété politique. Différences entre les fonélions du pere
de famille & du magiftrat. Diftinétion ’ entre le gouvernement
& la fouveraineté. Comparaifon du corps politique à
un corps organifé & vivant, tel que celui de lhomme. Ibid.
338. a. Le corps^ politique eft un être moral qui a une
volonté,réglé du jufte & de l’injufte pour tous les citoyens,
mais qui peut être fautive chez les étrangers. Sociétés particulières
dans l’état, qui modifient de mille maniérés les
E C O
p p g p ï l S i a a s p « *
f 5 ’ ? . ma1uva,5i P ï "PPort à l’état. Ibid. I q £ ,
volott é la plus générale fott toujours la plus jufte, ¡1X *
ptu delà que les délibérations publiques foient toujiurëéuui
tables. Alors autre choie fera cette délibération & § 3 8
cliofe la volonté générale. Examen de la quefliou
magiftrats appartiennent au peuple ou le peiinlê au, „
S/éW nCC Cmre ^ conom*e P°Pula*re & la tyunm"
La première maxime du gouvernement populaire ou oui.
pour objet le bien du peuple,eft de fuivre en tout la volonté
générale. Première difficulté-qui fe préfente, connoître cet»
volonté. Seconde difficulté, afTurer à la fois la liberté publi
que 8c l’autorité du gouvernement. Par quel art a-t-on où
afiujetrir les hommes pour les rendre libres, employer au
fervice de l’état les biens, les bras,la vie de fes membres
fans les contraindre ? Ces prodiges font l’ouvrage de la loi Le
premier devoir du chef eft donc de veiller a l’obfervation
des loix, 8c de les obferver lui-même. Ibid. b. La puiflance
des loix dépend encore plus de leur fogeffe que de la fëvé-
rité de leurs miniftres. Le talent de régner eft celui de faire
aimer la loi. Ibid. 340. a. Comment le gouvernement peut
fuppléer au défaut de la loi dans les cas qu’elle n’a pu prévoir.
Le grand art du gouvernement eft de former des hommes
, dé difjpôfor lés coeurs à aimer la loi.
Seconde maxime du gouvernement. Faites régner la vertu
Ibid. b. Le plus grand reflort de l’utilité publique eft dans
le coeur des citoyens. Progrès funeftes de la corruption. Le
pire des abus eft de n’obéir en apparence aux loix que pour
les enfreindre avec fureté. Miférables moyens fubftitués par
les chefs à la voix du devoir qui ne parle plus dans les
coeurs. Avantages de la vertu dans un état;-comment elle
rend l’adminiftration facile. Ibid. 341. a. 11 faut fur-tout nourrir
dans lé coeur des citoyens l’amour de la patrie. Les plus
grands prodiges de vertu ont été produits par ce fentiment.
Parallèle de Socrate 8c de Caton. Ibid. b. Avantages que
les citoyens doivent trouver dans la patrie pour l’aimer. La
fureté particulière eft intimement liée avec la confédération
publique. Exemples de la prote&on que l’état' doit a fes
membres, tirés des Spartiates, des Macédoniens, ibid. 342 .a.
des Romains. Récompenfes données aux citoyens qui en
avoient fauvé d’autres. Comment la mauvaife volonté des
chefs anéantit les droits des citoyens fans paroître les att$*
quer. Danger de l'inégalité dés fortunes. Ibid. b. Nécefliré
d’une bonne éducation. Ibid. 343. a. Le gouvernement doit
fe charger de l’éducation publique. Magiftrats qui doivent
r préfider. Exemple des Crétois,des Lacédémoniens 8c des
’erfes. Comment les Romains ont pu fe paffâr de l’éducation
publique. Ibid. b. Par tout où le peuple'aime fon pays,
l
refpcéte les loix 8c vit Amplement, il refte peu de chofe à
faire pour le rendre heureux. .
Troifieme maxime du gouvernement, pourvoir aux lefoins
publics. Difficultés qui fe rencontrent dans l’obfervation de
cette maxime, tirées fur-tout du droit de propriété. Moyens
de les lever. Le droit de propriété ne s’étend point au-
delà de la vie du propriétaire. Ibid. 344. a. Pourquoi
les biens de la famille ne doivent en fordr 8c s’aliéner
que le moins qu’il eft poflible. C’eft dans la cruelle
alternative ou de laifier périr l’état, ou d’attaquer le droit
facré de propriété que confifte la difficulté d’une fage économie.
Premier foin de l’inftituteur d’une république, après
l’établifiement des loix, trouver un fonds fuffifanr pour les
dépenfes publiques. Domaine public préférable au fife. Ib'td. b.
Le plus infâme des vols eft celui des revenus de l’état;
Remettre les finances à des hommes vertueux, c’eft le feul
moyen qu’elles foient fidellement régies. Les chefs de l’état
font de droit les adminiftrateurs des fonds publics. Pourquoi
les revenus d’un état doivent augmenter fans cefle. La plus
importante maxime de l’adminiftration des finances, eft de
travailler avec plus de foin à prévenir les befoins, qu’à augmenter
les revenus. Ibid. 345. a. Reftources qu’ont les chefs
pour prévenir tous les befoins publics, fans toucher aux
biens des particuliers. La richefie d’un état lui eft quelquefois
plus onéreufe que ne feroit la pauvreté même. Danger
du goût des conquêtes : quel en eft ordinairement le but
fecret. Les fuccés des peuples conquérans ne font qu augmenter
leurs befoins. Ibid. b. Autre fource d’augmentanon
des befoins publics; le prétexte d’entretenir des troupes réglées.
Ces troupes foldoyées furent une des principal# caules
de la ruine de l’empire romain. Les fouverains de l’Europe
ont aujourd’hui à cet égard des motifs plus légitimes, ma»
l’effet peut en être également funefte. Ibid. 240. a. La cotti-
fàtiôn des citoyens dans les cas de befoin, doit être volontaire
, c ’eft-à-dire, l’effet d’une volonté générale, fur un tari
qui ne laifle rien d’arbitraire. Ces contributions fontou r e
les ou perfonnelles ; diftinélion entre impôt 8c fubjide. f
portions difficiles à obferver dans les contributions
nclles ou capitations. Principes fur lcfquels il faut les c
E C O
1er Ibid. b. Tous les. ¡avantages de la fociété font pour les
«uifliins 8c les richès. Défovantages du pauvre. Ibid. 347. a.
Autre inconvénient de la taxe perfonoelle, c’eft de fe foire
trop fentir. De toutes , les autres impofitions, le cens fur
les terres ou la taille réelle , a toujours paffépour la plus
avantageufe dans les pays où l’on a.plus d’égard à la fureté
du recouvrement qu’à l’incommodité du peuple. Danger
d’une telle opinion. Deux inconvéniens qui en réfultent. Le
premier vient du défout de circulation des efpeces. Le
fécond vient-de ce que le blé eft une denrée que les impôts
ne renchériffent point dans le pays qui la produit, ce
qui fait que le laboureur refte feul chargé de l’impôt qu’il
n’a pu défalquer fur le prix de la vente. Ibid. b. Différence
entre la taille réelle 8c les droits fur les autres marchandi-
fes. Les reffources du commerce 8c de l’induftrie, loin de
rendre la taille plus fupportable par l’abondance de l’argent,
ne la rendent que plus onéreufe. Rien de plus dangereux
qu’un impôr fur le produit des terres payé par le cultivateur
même. Impôts oui foulagent la pauvreté, 8c chargent la
richefie, préférables à tous autres. Ibid. 348. a. Attentions
de prudence fur la nature 8c l’objet de ces impôts. A la
Chine c’eft l’acheteur 8c non le marchand qui acquite le
droit. Objets fur lefquels on devroit établir de fortes taxes
fans craindre aucun inconvénient. Avantages qui en réfulte*
voient. Ibid. b.
Economie y épargne, motifs à cette vertu: moyens d économie
à établir en France. V. 745. a,b, &c. Economie 8c
travail, deux grands moyens de s’enrichir. VI. 565. b. 569.
b. 570. a. Economie fage qui devroit toujours régler les
hommes dans la difpenfotion de leurs bienfaits. VII. 374.
a b. Commerce d’économie. III. 691. b. Sur l’économie ,
voye[ (Economie, Prodigalité.
Economie politique, autre difeours fur ce fujer. XI. 367.
a b , 8cc. Maximes du gouvernement économique. VIII.
826. b. Les profufions aun roi n’enrichiflent point l’état
XV. 380. a. L’auteur de l’article Economie politique ,
penfe que l’impôt fur les marchandifcs devroit plutôt être
payé par l’acheteur que par le marchand : obfervation fur
ce fentiment.XVII.868. tf.—Voyc^Gouvernement, Eta t .
Économie rujlique', objets qu’elle comprend. Eloge d’un
homme qui fe livre à ces occupations. V . 349.a.
Economie rujlique, les obfervarions les plus minucieufes
en apparence peuvent devenir utiles à l’agriculture. I. 386.
b. Voye[ C hasse , Pèch e , A g ricultur e , Ja rd inage-,
8c les articles des différentes efpeces d’animaux qu’on nourrît
à la campagne. Voye[ aufii les planches d’économie rulli-
que., vol. 1 des planches.
Économie , ( Critiq. fier. ) voye1 (Economie.
Economie animale, voyez (ECONOMIE.
ÉCONOMIQUE, fociétés économiques : journal économique.
V. 730. a. Suppl. L 217. b. Mémoires de la fociété
économique de Berne. Ibid. Diitionnaire économique. Suppl.
I. 220. b.
ECONOMISTES , fociété des, (Hijl. de la Philofoph. ) leurs
ouvrages. Suppl. 1. 221. a.
ECOPÉ, ( Chirur. ) folutionfle continuité du crâne. Les
accidens qui en réfultent fe divifent en primitifs 8c en con-
fécurifs. Cas de l’application du trépan. V. 349. b.
ECORCE, ( Jardin. bPhyftq. ) couches dont elle eft com-
pofée. Utilité de l’écorce dans la planté. V. 349. b. -
Ecorce. . Formation de l’écorce des arbres. XVI. 934. b.
Fibres ligneufes de l’écorce. VI. 661. b. Vaiffeaux des couches
corticales. XVI. 937. a. L’écorce empêche l’excès de
la tranfpiration. I. 587. a. L’aâion du foleil fur l’écorce
contribue à foire élever la feve. XVI.',960.1 b. Papier d’é-
corce.XI.831.tf, é»
Écorce. ( Pharm.) L’écorce de frêne, la feule de nos
pays réputée médicinale, a été abandonnée. Ecorces qu’on
emploie en médecine. V. 349. é.
Ecorce de JVinter. Découverte’de cette écorce aromatique.
M. George Handyfide l’a foit connoître exa&ement. Def-
cription de l’arbre auquel elle appartient, & de fon fruit.
Cette écorce eft un puiffant anti-feorbutique. V. 330. a. Sa
préparation, fon anaWfe. Les apothicaires lui fubllituent la
canclle blanche qui eft beaucoup plus commune. Ibid. b.
ECORCEMENT. Avantages de l’écorcement pour améliorer
la qualité du bois. I. 386. b. Défenfe d’écorcer les arbre
s en France : les arbres écorcés. ayant été abattus , leurs
fouches recroiffent moins. 587. a. Expérience par laquelle
on compare la tranfpiration des arbres écorcés 8c non écor-
cés. Ibid. Conjectures fur les moyens de prolonger la vie
d’un arbre écorcé, 8c de rendre fon bois encore plus dur.
Ibid. b. Les arbres dont le bois doit être employé pour bâtiment
, doivent être écorcés fur pied. XII. 603. b.
ÉCORCHURE, en terme de chirurgie, voyc{Ex co ria tion
; en terme de maréchallerie, voye[ Enchevêtrure.
ECOSSE, ( Géogr.) fon climat altronomique. Son étendue.
Ses produirions. Sa religion. Elle a eu fes rois particuliers
juiqu’cu 1603. L’Angleterre 8c l’Écoffe foumifes à un
E C R 555
même parlement par la reine Anne en 1707. Ses revenus
'évaluésà 160,000, llv. fterline. V . j t i a
Ecoffè, énumération de r e s te s .« . 657. à. Singularités
de quelques-uns. 150. b. Lac d’Écoffe qui ne gele jamais-,
XI. 103. b. Partie de la mer entre l’Écoffe 8c les ifles Orca-
des. XÏI. 318. b. Hiftoire de l’ancienne Ecoffe. Suppl. IV.
733. b. Hiftoire des Piétés, ancien peuple d’Écoffe. XII.
331. b. Anciens Ecoffois nommés Scots. XIV. 810.¿.Montagnards
d’Ecofle. VIII. 207. b. Confédération faite en Ecoffe
en 1638 pour introduire une nouvelle liturgie. IV. 161.a,
b. 324. a , b. Union de l’Écofle avec l’Angleterre. XVIL-
383. b. Chancelier d’Écofle. III. 99. a.
ÈCOSSOIS. Compagnie des eendarme écoffois. VII. 348. b.
ECOT. Repas par écot. XIV. 127. b.
ECOTARDS , ( Marine) XIII. 141. a.
ÉCOUANNE, outil commun à un grand nombre d’ou-,
vriers, aux arquebufters , luthiers, menuifiers , potiers
d’étain , tâbletriers-cornetiers , &c. V. 351. b.
ECOUIS, (Géogr.) gros bourg dans le Vexin.Normand.
Hommes célébrés inhumés dans l’égliic de ce lieu. Fondateur
de l’hôpital. A qui appartient cette baronnie. Suppl. H.
764*iÈCOULEMENS.
( Hydrauliq. ) Comment on mefure l’é-
i coulement de l’eau pour en connoître la quantité. V. 331. b '.
Calcul de l’écoulement d’eau dans un tems donné 8c par
une ouverture donnée. Ibid. 3 3 2. a.
ÈCOULEMENS , fupprcjjîon •des, ( Mcdec ) XV. 680. b.
ÉCOUTES, (Marine) fortes de cordages. Ecoutes des
différentes voiles. Principales manoeuvres que l’on fait avec
les écoutes. Voye^ Courrs. V. 332. é.
Ecoutes d’artimon. Suppl. 1. 62 3. a.
ECOUTEUX. ( Manege) Cheval écouteux. Différence
entre un cheval retenu, oc celui qui fe retient., entre un
cheval écouteux 8c un cheval rerenu. V.' 3 32. b. Comment le
cavalier doit prévenir ou corriger les diftraéUons du chevaL
Ibid. 333. a.
ÉCOUTILLES, (Marine) ouvertures du tillac par lesquelles
on defeend dans l’intérieur du vaiffeau. Principales
écoutilles pratiquées dans un vaiffeau. Leur ufage. Fermer
les écoutilles. Le capitaine - armateur qui s’eft rendu maître
d’im vaiffeau doit en foire fermer les écoutilles. V. 333. b.
ECPHANTÉE, philofophe pythagoricien fes principes.
XIII. 620. b.
ÉCRAIN ou ¿crin y ou baguier. Baguiers des anciens Ceux
de nos jours. Layettes qu’on leur fubftitue quand on pof-
fede une colleéfion trop nombreufel Diftribution 8c ufage
de ces layettes. V. 333.b.
ÉCRAN , ( Chymie ) defeription de celui dont fe fervent
les chymiftes pour fe garantir la vue de l’aéhon du feu ,
fur-tout loriqu’ils font des effais. V. 3 34. a. Ecran dont on
fe fert dans les verreries. Ibid. b.
Ecran. Gaufrure de "carton pôur écrans. VII. 323 b , &c.
Ecran représenté vol. IX des planches. Tapiftier, pl. 7. '
ÉCRASER. Supplices dans lefquels on écrafoit les criminels.
XV. 676. tf.
ÉCREVISSE, (Hijl.nat.) deux efpeces; l’une marine
connue fous le nom à'homard, voyeçce mot; l’autre de riviere.
Defeription de celle-ci. V. 3 46. b. Pourquoi 8c comment les
groffes jambes des écrevifies font Sujettes à fe cafter. Re-
produélion de la jambe caffée. Les jours les plus chauds font
lesplus propres à cette réproduérion. Détail des progrès fuc-
cefufs delà nouvelle jambe. Ibid. 333. a. Plufieurs autres
parties de l’écreviffe , excepté la queue, fe reproduifent de
même. Mue des écrevifies par laquelle ces animaux Sortent
de leur partie cartilagineufe 8c offeufe. Ibid. b. Pierres ap-
pellées yeux d'écreviffes. On ne les trouve pas en tout tems.
Ces animaux font très-voraces. Cependant ils ne mangent
que peu ou point depuis Septembre jufqu’en mai. Les crabes
8c écrevifies qui fe portent en arriéré en marchant, font
conformés autrement que les autres animaux. Leurs parties
Sexuelles. Tems de leur ponte. Ibid. 3 36. tf;
Ecreviffe. Pourquoi les écrevifies font plus maigres dans
le déclin de la lune que dans le premier quartier. Suppl. II.
764. b.
Ecreviffe, celle des focs du canton de Lucerne ne devient
point rouge à la cuiffon. IX. 712. a. Maniéré de revivifier
des écrevifies jiilées 8c broyées. XI. 783. b. De la
réproduâion des membres des écrevifies. XIV. 149. b. 130.
a. Ouvrage de M. de Reaumur fur les écrevifies. Suppl. L
403. a. I
Ecrevisse, (Pêche) maniéré la plus fimple delespêcher;
V. 3 36- tf- Des focs qui auroient été remplis de fel feroient
pour elles un appât auffi fort que la charogne. Ibid. b.
Écrevisse de riviere y ( Mat. médicale ) remede incifif 8c
tonique. Maladies dans lefquelles on les emploie en forme de
bouillons. Réflexions qui démontrent l’inutilité de ce remede.
Comment fe font les bouillons d’écreviffes. V. 356. ¿. Il paroîr
que l’écreviffe eft d’affez facile digeftion. Le jus a’écreviffe ne
foit qu’augmenter la partie alimenteufe des mets. Ibid, 337. a.