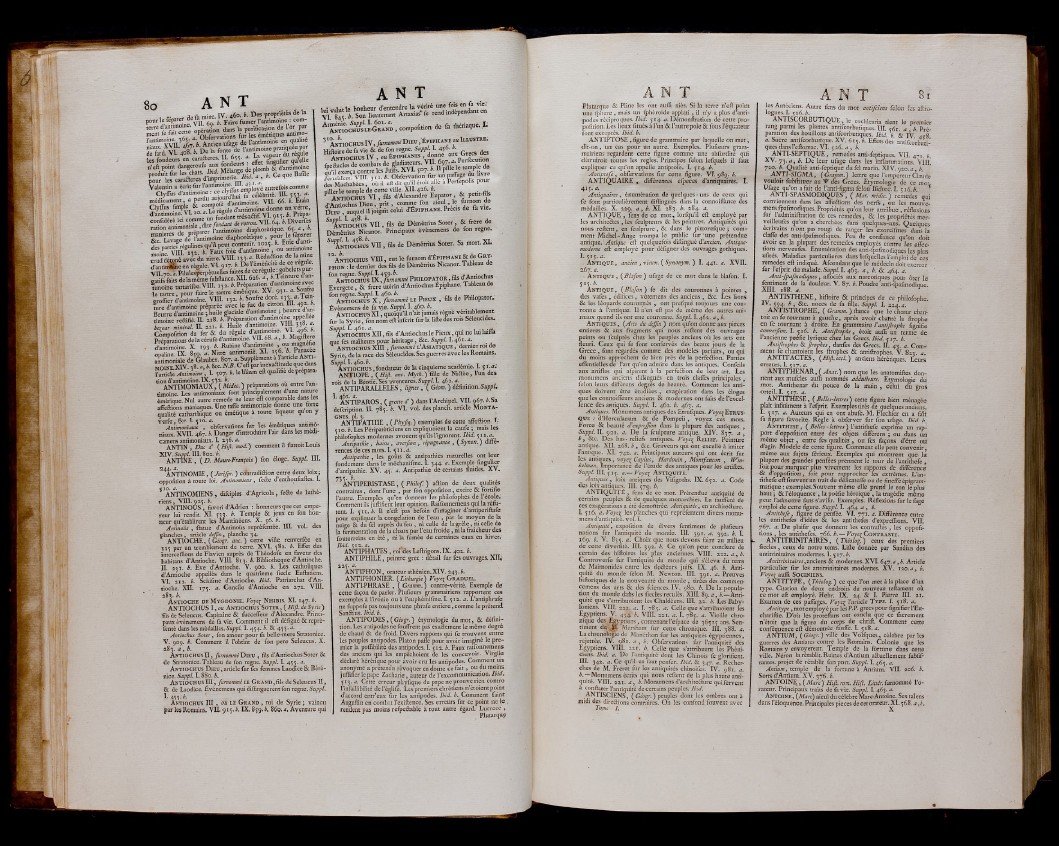
8o A N T
A N T
. as « mine IV. 460. i. Des -propriétés Se la
P Í Çmdne VIL 69. b. Faire fomer l’annmoine : com-
«rre f e g g g ” ¿ra| on dans la purification de l’or par
ment fe fint cette P w ;ons fur k s émèdqnes antuno-
£ggtacien ufage de ïantimoine en qualité
fon A ^ n m o m W e p a r
les fondeurs en caraôeres. IL 655. ¿m lie r qu elle
pour les caraâeres d’unpmnerie. ftid. e ■ ^ 8
Valentín a écriffur l’antimome. ^43 ■ ¿ autrefo¡s comme
Clyffus d’anUome : ce clyffus empmy a
médicament ; a perdu « f f i i t e P J g g S ¿ff i. Èain
Clyffus t o P^T f 0 ¡ ¡ ¡ l régule d’antimoine donne unvé rre,
d antimoine. V L io.<*.L.er g ¿ A y r Q1* b. prépaconftdéré
k U o ^ e un f o n ^ & v n . | 4. ¿.Diverfes
V r S T e nTép’amr l’antimoine dtaphoréûtpe. «5.
diaphorèdqne , P || g g g
B B a H a * g B « a t t B g
V l î^ ^ F Pilulesferpétuelíes faites de ce régule tgobelets pur-
yadftftÆdelamême fubffance.XII. 626. a , i.liinmre dan-
timoine tartarí fée. VIII. 13a. iVrèparaMn dannmomeavec
le tartre, pour faire le tartre émènque. XV 9 3 1 . a. loutre
grofíier d’antimoine. VIII. ,3a. 4: Soufre dorè m - T e m .
ture d’antimoine préparée avec le fue de citron. 1IL 49a•
Beurre d’antimoine stade glaciale danamtame; beurre d an-
timoine reffifiê.IL ai8. b.Fréparauon dantunome appellée
beroar minéral. IL aat. b. Huile dannmotne. VIII. 338- |
Compofttion du fer & du régule dtanmotne. VL ■,?££
Préparations de la cérufe d’antimoine. VII. 68. a, b. Magutere
. WmmmÊÊËÊÊOssss^
M O IN E .X IV . '18 . a, b. O Cv .i’f .d . v> c i l p a i i i
S A , I- 307. b. lelilium eft qualifié de prépara.
tion d’antimoine. IX. 3 3 ^ , s .
ANTIMONIAUX, ( Médec. ) préparations ou entre lantimoine.
Les antimoniaux font principalement d’une nature
émétique. Nul autre remede ne leur eft comparable dans les
affeétions maniaques. Une taffe antunomale donne une forte
qualité catharthique ou émédque à toute liqueur quon y
verfe, &c.I. <510. a. . . .
Antimoniaux , obfervations fur les émétiques anumo-
niaux. XVII. 467. b. Danger d’introduire lair dans les mèdi-
camens antimoniaux. I. 236. a.
ANTIN, Duc d‘ (Hifi. mod.) comment il flattoitLouis
XIV. Suppl. m. 802. A !
ANTlNE , (D . Maure-Françots) fon eloge. Suppl. 111.
ANTINOMIE, ( Jurifpr. ) extradition entre deux loix;
oppofition à toute loi. Antinomiens, iè te d enthoufiaftes. I.
^ANTINOMIENS, difciples d’Agricola, fe te de luthériens
, v in . 925. b.
ANTINOUS, favori d’Adrien : honneurs que cet empereur
lui rendit. XI. 533* b. Temple & jeux en fon honneur
qu’établirent les Mantinéens. X. 56. b. __
Antinous , ftatue d’Antinoüs repréfentée. u l. vol. des
planches, article dejfm, planche 34.
ANT1 0CHE, ( Géogr. anc.) cette ville renverfée en
115 par un tremblement de terre. XVI. 58a. b. Effet des
intercédions de Flavien auprès de Théodofe en faveur des
habitans d’Antioche. VIII. 813. b. Bibliothèque d’Antioche.
II. 231. b. Eve d’Antioche. V. 900. b. Les catholiques
d’Antioche appellés dans le quatrième fiecle Euftatiens.
VI. 212. b. Scliifine d’Antioche. Ibid. Patriarchat d’An-
tioche. XII. 175. a. Concile d’Antioche en 272. VIII.
283. b.
A nt io che de Myg d o n ie. Voyez N isibis. XI. 147. b.
ANTIOCHUS I , ou A ntiochus So t e r , (Hift. de Syrie)
fils de Seleucus. Capitaine & fucceffeur d’Alexandre. Principaux
évènemens de fa vie. Comment il eft défignè & repré
fenté dans les médailles. Suppl. 1. 454. b. 8c 45 5. a.
Antiochus Soter, fon amour pour fa belle-mere Stratonice.
V. 909. b. Comment il l’obtint de fon pere Seleucus. X.
283. a y b. - .
A ntiochus I I , fumommé D ieu , fils d’Antiochus Soter &
de Stratonice. Tableau de fon regne. Suppl. I. 455. a.
A nt iochus D ieu , article fur fes femmes Laodice & Bérénice.
Suppl. 1. 880. b.
A nt io ch u s III, fumommé le G r a n d , fils de Seleucus II,
& de Laodice. Évènemens qui diitinguerent fon regne. Suppl.
I- 435-é. « .
A ntiochus I I I , ou le G rand , roi de Syrie ; vaincu
par les Romains. VII. 913. b. IX. 859. b, 860. a. Aventure qui
compofition de fa thériaque. V
31 A o tio ch u s IV , fumommé Dieu .Épiphane m I llu s t r e .
k g S B S M W W 8
piller le temple de cette ville. Xll. 426. b.
A ntiochus V I , fils d’Alexandre Eupator, &
d’Antiochus Dieu, prit, comme fon aïeul, le fumom de
Dieu , auquel il joignit celui d’ÉplPHANE. Précis de fa v ie.
a’ntiochusVII , fils de Démétrius Soter, & frere de
Dèmétrius Nicanor. Principaux événemens de fon regne.
S“?XntÎochÙs v n , fils de Démétrius Soter. Sa mort. XL
1 ’ antiochus V i n , eut le fumomd’ÉpiPHANE&deG'.J-
phon : le dernier des fils de Démétnus Nicanor. Tableau de
f°YmoCHUs IX *}um°mmé P h ilo p a to r fils
Evergete, & frere utérin d’Antiochus Épiphane. Tableau de
^ANTiocmis^X ,Afimommé ee Pieux , fils de Philopator;
É A otiochus X l t q u o ÿ i ln ’ah jamais régné véritablement
fur la Syrie, fon nom eft inferit fur la lifte des rois Séleucides.
S“^Tl0CHUs 'xn, fils d’Antiochus le Pieux, qui ne lui laiffa
que fes malheurs pour héritage, &c. Suppl. 1. 461 .a.
Antiochu s X lH , fumommé l ’A siatiq ue , dernier roi de
Syrie, de la race des Séleucides. Ses guerres avec les Romains.
Suppl. 1. 460. b. . . . ,, . T •
Antiochus , fondateur de la cinquième académie, l. 51;<r*
ANTLOPE , Ûfift- anc- Mytk.) fille de Niftée, l’un des
rois de la BéouëV5 es~aventures.Sapp/.L 462. a.
ANTIPARALLELES, lignes, ( Géom. ) définition. Suppl.
M T O A R O S , ( grotte d' ) dans l’Archipel. VII. 967. b. Sa
defeription. H. 785. b. VI. vol. des planch. article Monta-
GNES.pl. 3. , _ T
ANTIPATHIE , ( Phyfiq.) exemples de cette affethon. I.
510. b. Les Péripatéticiens en expliquoient là caufe ; mais les
philofophes modernes avouent qu’ils l’ignorent. Ibid. 51 i.a.
Antipathie, haine , avcrjion , répugnance , ( Synon. ) différences
de ces mots. I. 511. a.
Antipathie , les goûts & antipathies naturelles ont leur
fondement dans le méchanifme. 1. 344- a- Exemple fingiÿer
d’antipathie. XV. 45. a. Antipathie de certains fluides. XV.
73c. b. . •
ANTIPERISTASE, ( Philof. ) aétion de deux qualités
contraires, dont l’une , par fon oppofition, excite & fortifie
l’autre. Exemples qu’en donnent les philofophes de l’école.'
Comment ils juftifient leur opinion. Raifonnemens qui la réfutent.
I. 511. b. Il n’eft pas befoin d’iriîaginer d’antiperiftafe
pour expliquer la congélation de l’eau , par le moyen de la
neige & du fel auprès du feu, ni celle de la grêle, ni celle de
la fermentation de la chaux par l’eau froide, ni la fraîcheur des
fouterreins en été, ni la fumée de certaines eaux en hiver.
Jbid. 512.a.
ANTIPHATES , roi des Leftrigons. IX. 402. b.
ANTIPHILE, peintre grec : détail fur fes ouvrages. XIL
225. a.
ANTIPHON, orateur athénien. XIV. 243. b.
ANT1PH0 NIER. ( Lithurgie) Voye^ G radu el.
ANTI-PHRASE , (Gramm.) contre-vérité. Exemple de
cette façon de parler. Plufieurs grammairiens rapportent ces
exemples à l’ironie ou à l’euphémifme.I. 512. a. L’antiphrafe
ne fuppofe pas toujours une phrafe entiere, comme le prétend
Sanétius. Ibid. b.
ANTIPODES, ( Géogr. ) étymologie du mot, & définition.
Les antipodes ne fouftrent pas exaaement le même degré
de chaud & de froid. Divers rapports qui fe trouvent entre
les peuples antipodes. Platon pane pour avoir imaginé le premier
la poflibilité des antipodes. I. 512. ¿. Faux raifonnemens
des anciens qui les empêchoient de les concevoir. Virgile
déclaré hérétique pour avoir cru les antipodes. Comment un
anonyme a prétendu révoquer en doute ce fait, ou du moins
juftifier le pape Zacharie, auteur de l’excommunication. Ibid.
ç 13 .a. Cette erreur phyfique du pape ne prouve rien contre
l’infaillibilité del’églife. Les premiers chrétiens n’étoient point
d’accord entr’eux fur les antipodes. Ibid. b. Comment faint
Auguftiii en combat l’exiftence. Ses erreurs fur ce point ne l e ,
rendent pas moins refpettablè à tout autre égard. Lucrèce ,
Plutarquy
A N T
Plutarque & Pline les ont aufli niés. Si la terre n’eft point
une fphere , mais un fphéroïde applati, il n’y a plus d’antipodes
réciproques. Ibid. 514. a. Démonftration de cette pro-
pofition. Les lieux fitués à l’un & l’autre pôle & fous l’équateur
font exceptés. Ibid. b.
ANTIPTOSE, figure de grammaire par laquelle on met,
dit-on, ' un cas pour un autre. Exemples. Plufieurs grammairiens
regardent cette figure comme une abfurdite qui
détruirait toutes les réglés. Principes félon lefquels il faut
expliquer ce qu’on appelle antiptofe. I. 514. b.
Antiptoje, obfervations fur cette figure. VI. 989. b.
ANTIQUAIRE différentes efpeces d’antiquaires. I.
415. a. § ■ ' "
Antiquaires, énumération de quelques-uns de ceux qui
fe font particulièrement diftingues dans la connoiftance aes
médailles. X. 229..a , b. XI. 283. b. 284. a.
ANTIQUE , fens de ce mot, lorfqu’il eft employé par
les architeâes, les fculpteurs & les peintres. Antiquités qui
nous reftent, en fculpture, & dans le pittorefque ; comment
Michel-Ange trompa le public fu r ’ une prétendue
antique.1 Antique eft quelquefois diftingué Hancien. Antique-
moderne eft employé pour défigner des ouvrages gothiques.
Lçi f . a.
A n t iq u e , ancien , vieux. ( Synonym. ) I. 441. a. XVII.
267. a.
■ A n t iq u e , ( Blafon ) ufage de ce mot dans le blafon. I.
S1?-*-
A n t iq ue , ( Blafon ) fe dit des couronnes à pointes ,
des vafes , édifices, vêtemens des anciens, &c. Les lions
& les léopards couronnés , ont prefquè toujours une couronne
à l’antique. Il n’en eft pas de même des autres animaux
quand ils ont une couronne. Suppl. I.462. a,b.
A ntiques , ( Arts du dejjîn ) nom qu’on donne aux pièces
entières & aux fragmens qui nous reftent dés ouvrages
peints ou fculptés chez les peuples anciens où les arts ont
fleuri. Ceux qui fe font confervés des beaux jours de la
Grece , font regardés comme des modèles parfaits, ou qui
du moins approchent de bien près de la perfection. Parties
eflentielles ae l’art qu’on admire dans les antiques. Confeils
aux artiftes qui afpirent à la perfection de leur art. Les
monùmens anciens difttngués en trois claffes principales ,
félon leurs différens degres de beauté. Comment les antiques
doivent être étudiées , exagération dans les éloges
que les connoiffeurs anciens & modernes ont faits de l’excellence
des antiques. Suppl. I. 462. b. 463. a.
Antiques. Monumens antiques des Etrufques. Voye[ Etrusq
u e : d’Herculanum & de Pompeii , voyez ces mots.
Force & beauté d’exprcjfîon dans la plupart des antiques. ,
Suppl. II. 921. a. De la fculpture antique. XIV. 837. a ,
6 y 8cc. Des bas - reliefs antiques. Voye[ Relief. Peinture
antique. XII. 268. b , &c. Graveurs qui ont excellé à imiter
l ’antique. XI. 742. a. Principaux auteurs qui ont écrit fur
les antiques, voyiCaylus, Hardouin, Montfaucon , Win-
kelman. Importance de l’étude des antiques pour les artiftes.
Suppl. III. p p a.— Voyez A n t iq u it é .
Antiques y loix antiques des Vifigoths. IX. 652. a. Code
des loix antiques. III. 579. b.
ANTIQUITÉ, fens de ce mot. Prétendue antiquité de
çertains peuples & de quelques monarchies. La fauffeté de
ces exagérations a été démontrée. Antiquités, en architedure.
I. 516. a. Voyez les planches qui repréfentent divers monumens
d’antiquité, vol. I.
Antiquité, expofition de divers fentimens de plufieurs
nations fur l’antiquité du monde. III. 391. a. 392. b. I.
169. b. V. 835. a. Choix que nous devons faire au milieu
de cette diveriitè. III. 392. b. Ce qu’on peut conclure de
certain des hiftoires les plus anciennes. VIII. 222. a , b.
Controverfe fur l’antiquité du monde qui s’éleva du tems
de Maimonidés entre les doCteurs juifs. IX. 46. b. Antiquité
du monde félon M. Newton. III. 391. a. Preuves
hiftoriques de la nouveauté du monde , tirées des commen-
cemens des arts & des fciences. IV. 980. b. De la population
du monde dafis les fiecles reculés. XIII. 89. a , b.— Antiquité
que s’attribuoient les Chaldéens. III. 22. b. Les Babyloniens.
V in . 221. a. I. 785. a. Celle que s’attribuôient ies
Egyptiens. V. 434. ¿. VIII. 221. a. I. 78«. a. Vieille chronique
des ^Egyptiens, contenant l’efpace de 3 6 « y ans. Sentiment
de-^jjd. Marsham fur cette chronique. III. 388. a.
La chronologie de Manéthon fur les antiquités égyptiennes,
rejettée. IV. 981. a , b. Obfervations fur l’antiquité des
Egyptiens. VIII. 221. b. Celle que s’attribuent les Phéniciens.
Ibid. a. De 1 antiquité* dont les Chinois fe glorifient.
III. 342. a. Ce qu’il en fautpenfer. Ibid. & 347. a. Recherches
de M. Freret fur les antiquités chinoifes. IV. 981. a.
¿.— Monumens écrits qui nous reftent de la plus haute antiquité.
VIII. 221. a , b. Monumens d’archite&ure qui fervent
à conftater l’antiquité de certains peuples. Ibid.
ANTISCIENS, | Géogr. ) peuples dont les ombres ont à
midi des directions contraires. On les confond fouvent avec
Tojne I.
A N T S i
les Anteciens. Autre fens du mot antifeiens felon les aftro-
logues.I. 516. b.
ANTISCORBUTIQUE, le cochlearia rient le premier
rang parmi les plantes antifeorbutiques. III. ¡¡¡f! a b. Préparation
des bouillons antifeorbutiques. Ibid. b. & IV 4?8
a. Sucre antifeorbutiaue. XV. 615.¿. Effets des antifeorbutiques
dansl’eftomac. VI. 326. a , b.
ANTI-SEPTIQUE, remedes anti-feptiques. VII. 471. ¿.
XV. 73 .a, b. De leur ufage dans les inflammations, v i l l .
720. b. Qualité anti-feprique du fel marin. XIV. 020. a b
A M T I C1/—KÆ X / A \ I r i . 1. ' X . *
vouloir f
Ufage qu’o _______
ANTI-SPASMODIQÜES0, ( Mau médic. )' remedes qui
conviennent dans les affeétions des nerfs, ou les mouve-
memipafmodiques. Propriétés qu’on leur attribue, réflexions
fur l’adminiftration de ces remedes, & les propriétés mer-
veilleufes qu’on a cherchées dans quelques-uns. Quelques
écrryains n ont pas rougi de ranger les exorcifmes dans la
claffe des anti-fpafmodiques. Peu de confiance qu’on doit
avoir en la plupart des remedes employés contre les affections
nerveufes. Enumération des anti-fpafmodiques les plus
ufités. Maladies particulières dans lefquelles l’emploi de ces
remedes eft indiqué. Afcendant que le médecin doit exercer
fur l’efjprit du malade.Suppl. I. 463. a , b. 8c 464. a.
Anti-fpafmodiques, affociés aux narcotiques pour ôter lé
fentiment de la douleur. V. 87. b. Poudre anri-fpafmodique.
XIII. 188. a.
ANTISTHENE, hiftoire & principes de ce philoiophe.
IV. Ç04. b , 8cc. noces de fa fille. Suppl. I. 224. a.
ANTISTROPHE, ( Gramm. ) ftance que le choeur chan-
toit en fe tournant à gauche, après avoir chatité la ftrophe
en fe rnnmum à Amitp Fn nnmmil.n r. m_
uiLicnnc poene lyrique cnez les virées. Ibid. <jy.
AntiJIrophes & flrovhes, danfes des Grecs. II. 43. a. Comment
fe chantoient les ftrophes & antiftrophes. V. 822. a.
ANTITACTES, (Hift.cccl. ) anciens hérétiques. Leurs
erreurs. I. 517. a.
ANTITHENAR, ( Anat. ) nom que les anatomiftes donnent
aux mufcles auffi nommés adduileurs. Etymologie du
mot. Antithenar du pouce de la main , celui du gros
■orteil. I. «17. a.
ANTITHESE, ( Belles-lettres) cette figure bien ménagée
Elaît infiniment à Peijprif. Exemples tirés de quelques anciens.
517. a. Auteurs qui en ont abufé. M. Flechier en a fait
fa figure favorite. Réglé à obferver fur fon ufage. Ibid. b.
A n tith è s e , ( Belles - lettres ) l’antithefe exprime un rapport
d’oppofition entre des objets différens ; ou .dans un
même objet, entre fes qualités, ou fes façons d’être ou
d’agin Modèle de cette figure. Comment elle peut convenir,
même aux fujets férieux. Exemples qui montrent que- la
plupart des grandes penfées prennent le tour de l’antithefe,
foit pour marquer plus vivement les rapports de différence
& d’oppofttion, foit pour rapprocher les extrêmes. L’antithefe
eft fouvent un trait de déucatefte ou de fineflè épigram*
matique : exemples. Souvent même elle prend le ton le plus
haut ; 8c l’éloquence , la poéfie héroïque, la tragédie même
peut l’admettre fans s’aviur. Exemples: Réflexions fur le fage
emploi de cette figure. Suppl. I. 464. a , b.
Antithefe, figure depenfée. VI. 771. a. Différence entre
les antithefes d’idées 8c les antithefes * d’expreffions. VIL
767. a. Du plaifir que donnent les contraftes, les oppofi-
tions , les. antithefes. 766. b. — Voyez C o ntr aste .
ANTITRINITAIRES, ( Théolog. ) ceux des premiers
fiecles, ceux de notre tems. Lifte donnée par Sandius des
antitrinitaires modernes. I. 317. b.
Antitriniçaires, anciens & modernes. XVL 647. a ,b. Article
particulier fur les antitrinitaires modernes. XV. 12o.a, b.
Voyez auffi SOCINIENS.
ANTITYPE, ( Théolog.) ce que l’on met à la place d’urt
type. Citation de deux endroits du nouveau teftament où
ce mot eft employé. Hebr. IX. 24. 8c I. Pierre III. 21.
Examen de ces paflages. Voyez f article T ype. I. 318. a.
Antitype, motemployépar les P.P. grecs pour fignifier l’Eu-
chariitie. D’où les proteftans ont conclu que ce facrement
n’étoit que la figure du corps de chrift. Comment cette
conféquence eft démontrée fauffe. I. 518. a.
ANtIUM, ( Géogr. ) ville des Volfques, célebre parles
guerres des Antiates contre les Romains. Colonie que les
Romains y envoyèrent. Temple de la fortune dans cette
ville. Néron la rétablit Ruines d’Antium aâuellement fubfif-
tantes. projet de rétablir fon port. Suppl. 1. 465. a.
Antium, temple de la fortune à Antium. VII. 206. b.
Sorts d’Antium. XV. 376. b.
ANTOINE, (Marc) Hïfl. rom. Hifl. Littér. fumommé l’orateur.
Principaux traits de fa vie. Suppl. I. 463. a.
A n to in e , (Marc) aïeul du célebreMarc-Antoine. Ses talens '
dans l’éloquence. Principales pièces de cet orateur. XI. 3 68. a, b.