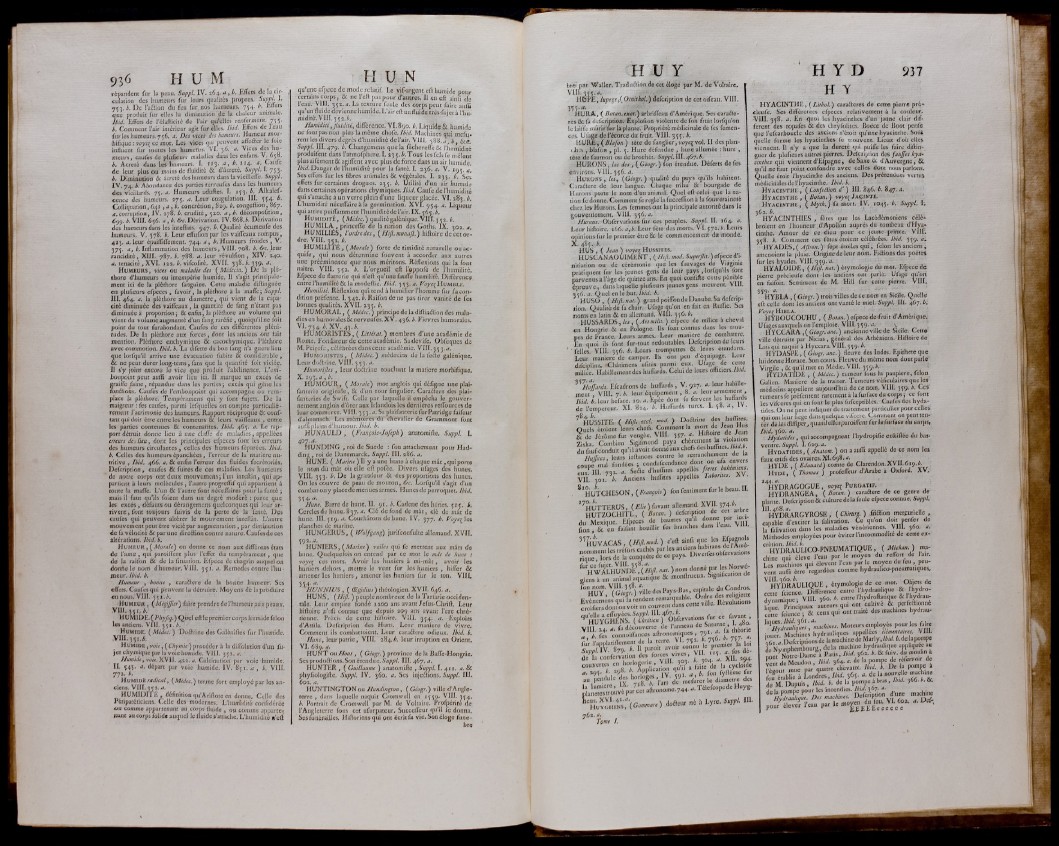
g l f H U M
répandent fur la peau, Suppl. IV . a64. a , b. Effets de la circulation
des humeurs fur leurs qualités propres. Suppl- L
753. b. D e l’aéfion du feu fur, nos humeurs. 754. b. tirets
que produit fur elles la diminution de la chaleur animale.
W d . Effets de l’élafticité de l’air qu’elles renferment. 7 5 3 .
b. Comment l’air intérieur agit fur elles. Ibid. Effets de 1 eau
lùr les humeurs, 756, 4. D e s vices des humeurs, Humeur mor-
bifique ; voyc{ ce mot. Les vices qui peuvent affecter le rote
influent fur toutes les humenrs. VI. 36. a. Vices des humeurs,
caufes de plufieurs maladies dans les enfans. V . 650.
b. Acreté dans les humeurs. I. 113. a , b. 1 1 4 . a. Caufe
de leur plus ou moins de fluidité & d’âcreté. Suppl. L 753•
b. Diminution & écreté des humeurs dans la vieilleffe. Suppl.
IV . 74 . b. Abondance des parties terreufes dans les humeurs
des vieillards, 7$, a. Humeurs adultes, I. 133. b. Alkalef-
cence des humeurs. »73. a. Leur coagulation. III. 334. b.
Colliquation, 641 , a , b . concrétion,8 29 . b. congeftion,8 6 7 .
4 . corruption, I v . ¿78, b. crudité, 320. 4 , b. décompofltlon,
¿>99. é. VIII. 6 3 6 .4 , b. b c . Dérivation. IV . 868, é. Dérivation
des humeurs dans les inteflins. 947, b. Qualité écumeufe des
humeurs, V . 378. b. Leur effuuon par les vaiffeaux rompus,
413. a. leur énaifliffement, 744. a , b, Humeurs froides, V .
373- u» b. Inflammation des humeurs, VIII. 708. b. Grc, leur
rancidité, XIII. 787. b, 788. a. leur révulfion, X IV . »40.
a . ténacité, X V I . 122, b. vifeoflté. X V I I . 338, b .339. a.
H u m e u r s , vices ou maladie des (M é d e c in .) D e la plétliore
d'humeurs ou intempérie humide. Il s'agit principalement
ici de la plétliore fanguine. Cette maladie diflinguée
en plufieurs efpeces , la vo ir , la pléthore à la maffe; Suppl.
III. 464, a. la plétliore au diametre, qui vient de la capacité
diminuée des vaiffeaux, la quantité de fang n'étant pas
diminuée à proportion; & enfin, la pléthore au volume qui
vient du volumc.auginenté d'un fang raréfié, quoiqu’il ne loir
point du tout furabondant. Caufes de ces différentes plénitudes.
D e la plétliore aux forces, dont les anciens ont lait
mention. Plétliore enchymique & cacocliymique. Plétliore
a vec commotion. Ibid. b. La difette du bon fang n'a guere lieu
que iorfqu'il arrive une évacuation fubite oc conlidérable,
o c ne peut durer long-tems, fans que la quantité foit viciée.
Il s’y joint encore le v ice que produit Vabflinence. L’em-
b on p o in t peut aulfi avoir lieu ici. Il marque un excès de
graiffe faine, répandue dans les parties; excès qui gène les
tonéiiohs. Caufes d e l’embonjioint qui accompagne ou remplace
{a plétliore. Tempéramens qui y font iujets. D e la
maigreur ; fes caufes, parmi lèfquelles on compte particulièrement
l'acrimonie des humeurs. Rapport réciproque 6c conf-
tant qui doit être entre les humeurs oc leurs vaiffeaux , entre
les parties contenues 6c contenantes, Ibid. 463, a. Le rapport
détruit donne lieu à u n e c h f f e d e maladies, appellées
erreurs de. lie u , dont les principales efpéces font les erreurs
des humeurs circulantes, celles des humeurs féparées, Ibid.
b. Celles des humeurs épanchées, l'erreur de la matière nutritive
, ibid. 46 6 . a. 6c enfin l'erreur des fluides fecrétoriés,
Defcription, caufes 6c fuites de ces maladies. Les humeurs
de notre corps ont deux mouvemens ; l’un inteflin, qui appartient
¡1 leurs molécu le s, l'autre progreflif qui appartient â
toute la maffe. L’un 6c l’autre font néceffaires pour la famé ;
mais il faut qu’ils foient dans 1111 degré modéré ; parce que
les e x c è s , défauts ou dérangemens quelconques qui leur arr
iv en t , font toujours fuivis de la perte de la famé. Des
caufes qui peuvent altérer le mouvement inteflin. L ’autre
mouvement peut être vicié par augmentation, par diminution
d e là vélocité 6c par une direétion contre nature. C aufesde ces
altérations. Ibid. b.
H u m e u r , (M o r a le ) on donne c e nom auxdifférensétats
de l’a m e , qui paroiffent plus l’effet du tempérament, que
de la raifon 6c d e la fituation, Efpece de chagrin auquel on
donfie le nom d'humeur. VIII, 331 . a. Remettes contre l’hu -
jrneur. Ibid. b.
Humeur , bonne , caraélere de la bonne humeur. Ses
effets, Caufes qui peuvent la détruire. Moyens de la produire
en nous, V I I I , 331 ,b .
H u m e u r , \MigiJfler) fa ire p rend re d e l'h um eu r^ u x pe au x.
VIII. 3 3 1, b.
H UMIDE.( P h y fu j.) Q u e l eft fepremier corps humide félon
les anciens, VIII, 3 3 1 . b.
H u m id e , ( Midec. ) Do&rine dés Galéniftcs fur l'humide.
V I I I . 331 .b.
H u m id e , v o ie , ( Chymie ) p ro c éd e r à la diffolution d’ un fit-
j e t ch ym iq u e par la v o ie humide. VIII. 33a. a.
H umide, voie. X VII. 42a, a. Calcination par voie humide.
' IL 343. a. départ par voie humide. IV . 831, a , b. VIII.
7 7 a . b.
Humi dE rad ica l, ( Midec. ) te rm e fo r t employé par les anciens.
VIII, 33a. u.
H UM ID IT E , définition qu’A riftote en donne. C e lle des
Péripatéticiens. C e lle des modernes. L ’hunfldité confidérée
o u comme apjiarrenanr au corps fluide , ou comme appartenant
au corps folide auquel le fluide s’attaclic. L’humidité n’efl
H U N
qu’une efpece de mode relatif. Le vif-argent cil humide pour
certain» corps , 6c ne l’cft pas pour d’autres. Il en eft ainfi de
l’eaù. VIII. 332.4. La texture feule des corps peut faire auflâ
qu’un fluide devienne humide* L ’air eft un fluide trèvfuiet à lliu .
nudité. VIII, 3 3 a, b.
Humidité f flu id ité, différence. V I . 890. b. Liquide fie humide
ne font pas non plus la même chofe, Ibid. Machines qui mefq.
rent les divers degrés d’humidité de l'air, V UI. 388, a b 6cc.
Su ppl A U . 479. b. Changemeus que la fécherefle 6c l’humidité
produîfcnt dans l’atmofphere. 1 . 2 33.¿ .T o u s le s fe ls fe mêlent
plus aifémeiu& agiffent avec plus de force dans un air humide.
Ibid. D anger de l’humidité pour lafanté. I. 236. a, V . 193. a.
Ses effets fur les fibres animales 6c végétales. I. 233. b. Ses
effets fur certaines drogues. 233. b. Utilité d’un air humide
dans certaines opérations chymiques. Ibid. Caufe de l'humidité
qui s'attache à un ve r re plein d'une liqueur glacée, V I . 283, b.
L'humidité néceffaire à la germination. X V i. 934, a. Liqueur
qui attire puiffamment l'humiditéde l’air, IX. 363. b.
H u m id i t é , (M i d e c . ) qualitégalénique. V I I I ,3 32. é.
H U M IL A , princeffe de la nation des Goths. IX. 302, a.
H UM ILIÉS , l'ordre d e s , (H i f l.m o n a f l.) luftoire de cet o rdre,
V I I I . 3 «a, b.
H U M IL IT É , ( Mo ra le) forte de timidité naturelle o u a c -
q u ife , qui nous détermine fouvent à accorder aux autres
une prééminence que nous méritons. Réflexions qui la font
naître. V I I I , 332, b. L ’o rgueil eft l’ojjpofé de l'humilité.
Efpece de flatterie qui n'eft qu’une fauffe humilité. Différence
entre l’humilité 6c la inodeftie. Ibid. 333.4. Foyc^ IIum/jee.
Humilité. Réflexion qui tend à humilier l'homme fur f à condition
préfente. 1. 342. b. Raifon de ne pas cirer vanité de fes
bonnes qualités. X V I I . 233. b.
H U M O R A L , ( Mid ec. ) principe de la difliuélion des mala-
diesen hum o ra lc s& n e rveu les .X V , 436. b. F ièvres humorales.
V I , 734, b. X V . 43. b.
H U M O R IS T E S , (L i t t é r a l .) membres d'une académie de
Rome. Fondateur de cette académie. Sa devife, Obfcques de
M, P e ifc fc , célébrées dans cette académie. V III.3 33,4.
H um o r is t e s , ( Mid ec. ) médecins de la fcéte galénique.
Leur doélrine, V I I I . 3 33, a.
I lum o r ifles , leur d o a rin c touchant la matière morbifique.
X , 1 9 3 .4 , b.
H U M O U R , (M o r a le ) mot anglois quidéfiene uneplai-
fanterie origina le, 6c d’un tour fingulier. Caraétere des plaî-
fanteries de Swift, C e lle par laquelle il empêcha le gou v er nement
anglois d’ô ter aux Irlandois les dernieres reffources de
leur commerce. V I I I ,333.4. SaplaifantcriefurPatridge faifeur
d’almanach. Les mémoires dû chevalier de Grainmont font
aufli pleins d ’h um ou r . Ibid. b.
H U N A U LD , (F ra n ço is -J o fep h ) anatomifte, Suppl. L
407.4.
H U N D IN G , roi de Suede : fou attachement pour Had-
dinz , roi de Danemarck. Suppl. III. 286.4.
HUNE, ( Marine ) I 1 y a une hune à chaque mât * qui porte
le nom dû mât où elle eft pofée. Divers ufages des hunes.
V I I I . 333. b. D e la grandeur 6c des,proportions dès hunes.
On les cou vre de peau de mouton, Grc, Lorfqu’il s'agit d'un
combat ou y place de menues armes. Hunes de perroquet. Ibid.
354. <2. . .
Hune. Rarre de hune. II, 9 1 . b. Cadene des hûnes. 3x3. b.
Cercles de hune, 8 3 7.4. C lé de fond de mât, clé de mât de
hune. III, 319. 4, (Jourbâtons de hune. IV . 377, b. Foy er les
planches de marine.
H U N G E RU S , ( IFolfgang) jurifconfulte allemand. X V I I .
392, a.
HU N IER S , (M a r in e ) voiles qui fe mettent aux mâts de
hune. Quelquefois on entend par c e m o t le nuit de hune :
v o y t\ ces mots. A v o ir les huniers â mi-mât, avoir les
huniers dehors, mettre le vent fur les huniers , biffer 6c
amener les huniers, amener les huniers fur le ton. V I IL
3 34. 4.
H U N H I U S , ( OEgidius ) théologien. X V I I . Safi. a. .
H U N S , ( H ijl. ) peuple nombreux de la Tarfarie occidentale,
Leur empire ronué X200 ans avant Jefus-Chrift, Leur
biftoire n'eft connue que depuis 209 ans avant l’ere chrétienne.
Précis de cette biftoire, VIII. 334; 4. Exploits
d’Attila. Defcription des Huns, Leur maniéré de vivre.
Comment ils combattoient. Leur caraûerc odieux. Ibid. b.
Hu n s , leur pa trie, VIII. 284. b. leur irruption en Orient.
V I , ¿89, a.
H U N T o u H a u t , ( Géogr. ) province d e là Baffe,-Hongrie.
Ses p roduirons. Son étendue. Suppl. III. 467. a.
H U N T E R , ( Guillaume ) anatomifte , Suppl. I. 4 1 1 . 4 .8c
phyftologifte. Suppl. IV . 360. a . Scs injeéttons. Suppl. III.
do 2.4.
H U N T IN G T O N o u Hundington, f Géogr.) ville d'Angleterre
, dans laquelle naquit Cromwell en 1339- VIII, 334.
b. Portrait de Cromwell par M, de Voltaire. Proljiérire de
l'Angleterre fous cet ufurpateur, Succeffcur qu'il te donna.
Ses funérailles. Hiftoriens qui ont écrit fa vie. Son éloge funèbre
H U Y
bre- par Walle r. T r a d i t io n de cet éloge par M. de Voltaire.
V I IL 333.4.
H U P E , lupcge,( Qrnitkol.) defcription de cet oifeau. V I IL
353. a.
H U R A , ( Ilo ta n .cxo t .) arbriffeau d’Amcriquc. Ses caraéte-
res 6 c fa defcription. Explofion violente de fon fruit lorfqu’on
le lâtffe mûrir tur 1a plante. Propriété médicinale de fes fernen-
ces. Ulage de Técorcc du fruit. V I I I . 333. b.
H U R E , ( Blafon ) tête de fanglier, voyc{ vol. II des plan-
t J t ; s , blafon , pl. 3. Hure défendue , hure allumée : hure ,
tête de faumon ou de brochet, Suppl. III. 467. b.
H U R O N S , lac d e s , ( Giogr. ) ion étendue. Déferts de fes
environs, VIII. 356. a.
H u r o n s , le s , (Géogr. ) qualité du t» y s qu’ils habitent.
Caraétere de leur langue. Chaque tribu 6c bourgade de
Hurons porte le nom d’un animal. Q u e l eft celui que la nation
fe donne. Comment fe rcglc'laTucccffion â la fouveraineté
chez le» Hurons, Les femmes ont la principale autorité dans le
gouvernement. VIII. 336.4.
Hurons. Obfervations fur ces peuples. Suppl. II. 164. a.
Leur biftoire. 166. 4,é . Leur fête des morts. V 1,3 72 ¡b. Leurs
opinions fur le premier être 6c le commencement du monde.
X . 483. b. ■
HUS , ( J e a n ) voyez H u s s ite s .
H U SC A N A O U IM .EN T , ( U tjl. mod. Superflit. ) efpece d’initiation
ou de cérémonie que les fauvages de Virginie
pratiquent fur les jeunes gens de leur pays ,-lorfqu’ils font
parvenus à l’âge de quinze ans. En quoi confine cette pénible
ép re u v e , dans laquelle plufieurs jeunes gens meurent. VIII.
336. 4. Q u e l en le but. Ibid. b. ,
B U S O , (H t f l .n a t . ) grand poiffondu Danube.Sa defcrip-
xion. Qualité de fa chair. Ufaee qu’on en fait en Ruffte. Ses
noms en latin 6c en allemand. V I IL 336. b. . . . . . ,
H U S SA R D S , l e s , ( A n m i l i t . ) el'pcce de milice a cheval
en Hongrie 6c en Pologne. Ils font connus dans les troupes
de France. Leurs armes. Leur maniéré de combattre.
En quoi ils font fur-tout redoutables. Defcription de leurs
1 'fe ile s . VIII. 336. b. Leurs trompettes 6c leurs étendarts.
Leur manière de camper. Ils ont peu d’équipage. Leur
difcipline. '•Cbâtimcns ufités jxarmi eux. Ufage de cette
milice. Habillement des huflards. Celui de leurs officiers. Ibid.
3 i i H Efcadrons de h iifa rd s, V , 927, a. leur habillement
, V I IL 7 . b. leur équipement, 8, a. leur armement,
O U . b. leur beface. 10. a. Epée dont fe fervent les huffards
d e l’empereur. X I. 824. b. Huffards turcs. 1. <8. a , IV .
^H U S S IT Ë . ( HM . tccl. mod. ) Doilrine des huffnes.
Q u e ls étoient leurs chefs. Comment la mort de Jean Hus
£ de Jérâme fut vengée. VIII. «7■ i f e l I f i l
Ziska. Combien Sigifmond paya tÿércmcnt b
du fauf eonduit q u i I avoir donné aux chefs des huffitcs. Ibid.b.
W m B M leurs luftances contre le retranchement de la
coune mal fondées ; condefcendance dont on ufa envers
eux III. 7 12 . a. Seélc d’Imffites appel és f r t r a boliimitiii.
V I I . 201. é. Anciens huffites appelles T a b om a . X V .
8 lH U T C H E SO N , fon fen tim en tfu r leb e au .il.
’ 7H U T T E R U S , avant allemand. X V II. 37+ b.
H U T Z O C H IT L , ( Hotan. ) defcription de cet arbre
d u M e x i q u e Efpeoes de baumes qu’il donne par m e -
b o n , ¿ en faifant bouillir fes branches dans l’eau. VIII.
35Î d U V A C A S , ( H i f t .m o l ) c’eft ainfi nue les Efpagnols
HO Y ' É S ville de. Pays-Bas, eaol.ale du Condros.
croifiers dont on volt un couvent dans cette vuie.
de la confcrvatlon de»_forco> v t v e . , y | x u ^
H i H Ä I au pendule des ‘ ^ meCurcr le diametre des
phnctcs^roiivé^iarcet aiironomc, 7 4 4 . a. T élcfcope de Huyg-
HuÎgHXNS »*'( Gommitrt ) dofleur né à L y re . Suppl. III.
7/IÎ2. a.
Tçme I .
H Y D 937
H Y
H Y A C IN T H E , ( L i ih o l . ) caraéfêrcs d e cette pierre pré*
cicufc. Scs différentes efpeces relativement â la couleur.
V I I I . 338. 4. En quoi les hyacinthes d’un jaune clair différent
des topafes 6c des chryfolitcs. Boéce d e Root penfe
que Tcfcarboucle des anciens n'étoit qu'une hyacinthe. Sous
quelle formé les hyacinthes fc trouvent. Lieux d’où elles
viennent. 11 n 'y a que la d u re té qui piaffe les faire diftin-
guer de plufieurs autres pierres. Deienpiion des fau jjes hyacinthes
qui viennent d’Elpagne, d e Saxe & d’A u ve rgn e, 6c
qu’il ne faut point confondre avec celles dont nous parlons.
Qu elle ¿toit l’hyacinthe des anciens. Des prétendues vertus
médicinales de l’hyaeiittlie. Ib id .b . : •
H y a c i n t h e , (ÇonfcHion d - ) III. 846. b. 847. a.
H y K C W ï i lv . , CHotan. ) v o y c i I k C iw i t .
H y a c i n t h e , (M y t h . ) f ï mort. IV . 1043. ^ WfÏÏm, %
362. b.
H Y A C IN TH IE S , fêtes que les Lacédémoniens c è lé -
broient en l’honneur . d’Apollon auprès du tombeau d’Hya-
cinthe. Amour de ce dieu pour ce jeune prince, VH f.
338. b. Comment ces fêtes étoient célébrées. Ibid. 339. 4 ;
H Y A D E S , (A f lrO n .) ' fept étoiles q u i, félon les anciens,
amenoicnrla pluie. Origine de leur nom. Fiéfions des poètes
fur les hyades. V I IL 339.4.
H Y A L O ID E , (H i f l . nat. ) étymologie du mot. Efpece de
pierre précieufc dont les anciens ont parlé. Ufage qu’on
en faifoit. Sentiment de M. Hill fur cette pierre. V I IL
339, 4. ‘ „
H Y R L A , ( Géogr. ) trois villes de ce nom en Sicile. Quelle
eft celle dont les anciens ont vanté le miel; Suppl. III. 467. b.
Foyer HlBLA.
H YU O U C O U H U , ( Botan. ) efpece de-fruit d Amérique.
Ufages auxquels on l’emploie. VIII, 3 59.4 , \
H Y C C A R A , (G éo g r .a n c .) ancienne ville de Sicile. Cette
ville détruite par Nicias, général des Athéniens. Hiftoirc de
Lais qui naquit â Hyccara. V III. 3 39. b.
H Y D A S F E , (Géogr. a n c .) fleu v e des Indes. Epithetc que
lui donne Horace. Son cours. Fleuve du même nom dont parle’
Virgile , 6c qu’il met en Médie. V IIL 359. b. •
H Y D A T ID E , (M id e c .) tumeur lous la paupière, félon
Galien. Manière de la traiter. Tumeurs véhculaires que les'
médecins appellent aujourd'hui de ce nom. V I IL 339. b. Ces
tumeurs fe préfentent rarement à la furface du corps ; ce font
les vifeeres qui en font le plus fufceptifelés, Caufes des hyda-
tides. O n ne peut indiquer de traitement particulier pour celles
qui ont leur liege dans quelque vifccrc. Comment on peut tenter
de les ditttper, quand ellesparoilTent fur I» furface du corps,
^ H y d a t id e s , qui accompagnent l’hydropific enkiftée du bas-
ventre. Suppl. I.6 29 .4 . ^
H y d a t i d e s , (A n a tom A o n aauffi appelle de ce nom les
faux oeufs des ovaires. XI. 698. a.
H YD E , ( Edouard) com te de Claren d on .X V lI.û iy .A
H y d e , ( Thomas ) profeffeur d’Arabe à Oxford. X V .
MH Y D R A G O G U E , vaye{ P u r g a t i f .
H Y D R A N G E A , ( B o t a n . ) caraflere de ce genre de
niante. Defcription & culture de la feule efpece connue. Suppl.
‘ h Y IJR A R G Y R O S E , ( Chirura. ) fiîa ion mcriuricHe.
capable d’exciter la falivation. C e qu’on doit; penfer de
la fallvation dans le» maladie» vénénenne». VIII. 360. a.
Méthodes employée» pour éviter l'incommodité de cette cx-
“ H Y D R A Ù Ù C O -PN E Ü M A T IQ U E I (M t c h a n . ) machine
qui éleve l’eau par le moyen du reffort de latr.
Les machines qui élevent l’eau par le moyen du feu , peuvent
auff» être regardées comme hydrauhco-pneumatiques,
^ w yU r A U L IO U E , étymologie de ce mot. Objets de
, „ n e f e ^ e ffifférence en t re> ydrtmlique & h y d r o dynamique
; VIII. 360. b. entre l’hydroflatique & I bydrau-
Itauc. Principaux auteurs qui ont cultive f c perfethonné
cette fcience; 6c ceux qui ontxraité des macliincs hydrau-
^ M a m , aM t m s Moteur» employé, pour le» faire
louer Machines hydraulique» appelléc» iUmm atrcs. VIIL
nCi a Defcription» de la machine de M arly, Ibid. b. delà pump®
i ’S Ï Ï S r . M i i > a C T e de réfctvoir de
muc par quatre chevaux. Ibid. b. D e Ja pompe a
f e u é t a b ïé à 2
de M. Dttpuls, Ibid. b. d e là pomneibra», Ibid. 3tsb .o .tx .
aola pompe pour l e » k e e n d i e . ^ H11?