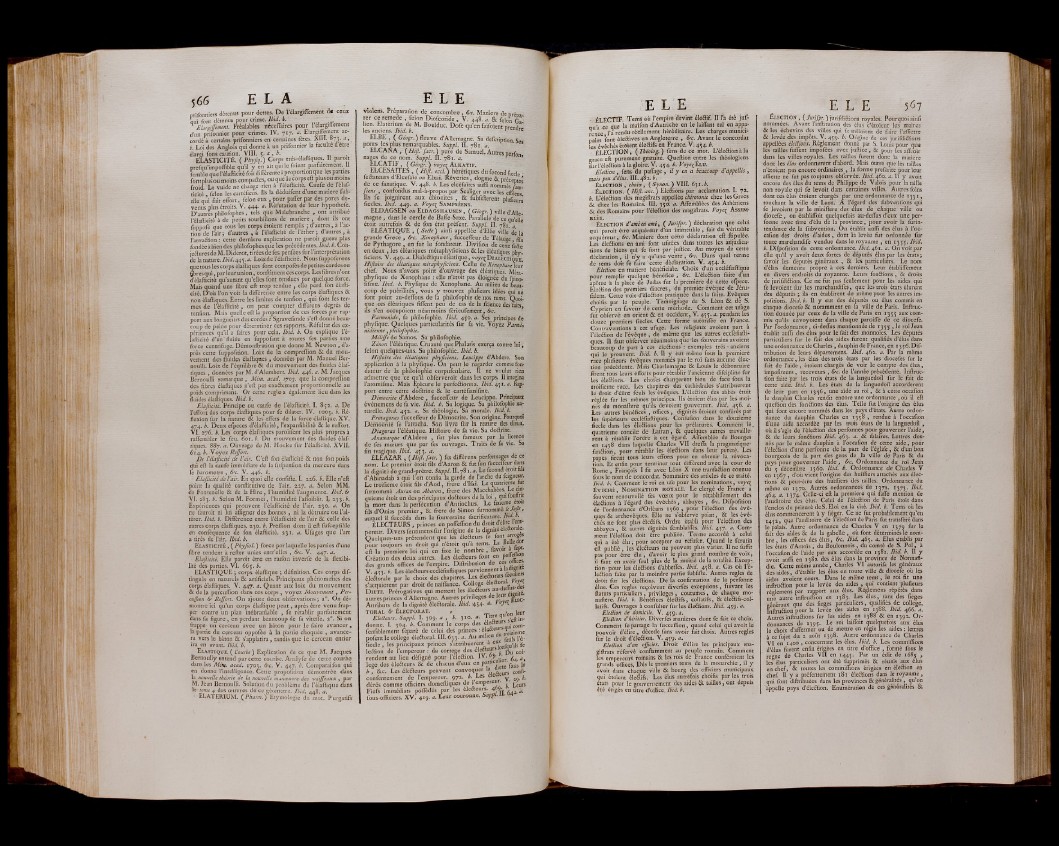
5 6 6 E L A
prifonniers dérem» pour dettes. De l'élargiffement de ceux
oui font détenus pour crime, lbii. i.
Elareiffement. Préalables néceffaires pour 1 élargillement
d’un prifonnier pour crimes. IV. 717. ai Elargiffemcnt accordé
£
à certains prifonniers en certaines têtes. Alli. »7 3 »
b. Loi des Anglois qui donne à un prifonnier la faculté d être
élargi fous caution. VIII. 5. a , b. .
ÉLASTICITÉ. ( Phyjiq. ) Corps tres-élaftiques. Il parait
prefqu’impoifible qu’il y en ait qui le foient parfaitement. 11
lemble que l’élafticité foit différente à proportion que les parties
fontplusou moins compares, ou 1que iccorpseftpiusourtoins
froid. Le vuide ne change rien a 1 élafticité. Caufe de 1 élasticité
félon les cartéfiens. Ils la déduifent d’une matière fub-
tile qui fait effort, félon eux , pour paffer par des pores devenus
plus étroits. V. 444. <*• Réfutation de leur hypothefe.
D’autres pliilofophes, tels que Malebranche , ont attribué
l’élafticité à de petits tourbillons de matière , dont ils ont
fuppofé que tous les corps étoient remplis ; d’autres, à l’action
de l’airj d’autres , à l’élafticité de l’éther; d’autres, à
l’atrraétion : cette derniere explication ne paroît guere plus
fondée à bien des philofophesque les précédentes. Ibid. b. Con-
jeàuresde M. Diderot, tirées de fes penfées fur l’interprétation
de la nature. Ibid.443.a. Loixde l’élafticité. Nous fuppoferons
qpetous les corps élaftiques font compofés de petites cordes ou
gbres qui, par leur union, conftituent ces corps. Les fibres n’ont
d’élafticité qu’autant qu’elles font tendues par quelque force.
Mais quand une fibre eft trop tendue , elle perd ion élafti-
cité. D ’où l’on voit la différence entre les corps élaftiques &
non élaftiques. Entre les limites de tenfion , qui font fes termes
de l’élafticité , on peut compter différens degrés de
tenfion. Mais quelle eft la proportion de ces forces par rapport
aux longueurs des cordes ? Sgravefande s’eft donné beaucoup
de peine pour déterminer ces rapports. Réfultat des expériences
qu’il a faites pour cela. Ibid. b. On explique l’é-
.afticité d’un fluide en fuppofant à toutes fes parties une
force centrifuge. Démonftration que donne M. Newton , d'après
cette fuppofition. Loix de la compreflion & du mouvement
des fluides élaftiques , données par M. Manuel Ber-
noulli. Loix de l’équilibre 8c du mouvement des fluides élaftiques
, données par M. d’Alembert. Ibid. 446. a. M. Jacques
Bcrnoulli remarque, Mém. acad. 1703. que la compreflion
des fibres élaftiques n’eft pas cxaâement proportionnelle au
poids comprimant. Or cette rcgle a également lieu dans les
fluides élaftiques. Ibid. b.
Elajlicité. Principe ou caufe de l’élafticité. I. 852. a. De
l’effort des corps élaftiques pour fe dilater. IV. 1005. b. Réflexion
fur la nature 8c les effets de la force élaftique. XV.
474. b. Deux efpeccs d’élailicité, l’expanfibilité 8c le reflort.
VI. 276. b. Les corps élaftiques paroitfent les plus propres à
raflembler le feu. 60r. b. Du mouvement des fluides élaftiques.
887. a. Ouvrage de M. Hooke fur l’élafticité. XVII.
¿'14. b. Voyez Rejfort.
De Nlajlicité de l ’air. C’cft fori élafticité 8c non fon poids
qui eft la caufe immédiate de la fufpenfion du mercure dans
le baromètre, bc. V. 446. b.
Elajlicité de l ’air. En quoi elle confifte. I. 226. b. Elle n’eft
point la qualité conftitutive de l’air. 227. a. Selon MM.
de Fontcnelle & de la Hire, l’humidité l’augmente. Ibid. b
VI. 283. b. Selon M. Formei, l’humidité l’aifoiblit. L 233. b.
Expériences qui prouvent l’élafticité de l’air. 230. a. On
ne faurolt ni lui afligner des bornes , ni la détruire ou l’altérer.
Ibid. b. Différence entre l’élafticité de l’air 8c celle des
autres corps élaftiques. 230. b. Preflion dont il eft fufceptible
en conféquencc ae fon élafticité. 23 t. a. Ufagcs que l’art
a tirés de l’air. Ibid. b.
Elasticité , ( Phyfiol. ) force par laquelle les parties d’une
fibre tendent à refter unies entr’elles, bc. V. 447. a.
Elajlicité. Elle paraît être en raifon inverfe de la flexibilité
des parties. VI. 66 ç. b.
ELASTIQUE ; corps élaftique ; définition. Ces corps dif-
tingués en naturels 8c artificiels. Principaux phénomènes des
corps élaftiques. V. 447. a. Quant aux loix du mouvement
8c de la pereuflion dans ces corps, voyez Mouvement, Per-
cujjion b ReJJort. On ajoute deux obfervations ; i°. On démontre
ici qu’un corps élaftique peut, après être venu frapper
contre un plan inébranlable , fe rétablir parfaitement
dans fa figure, en perdant beaucoup de fa vîteffe. 2°. Si on
frappe un cerceau avec un bâton pour le faire avancer,
la partie du cçrceau oppofée à la partie choquée , avancera
vers le bâton & s’applatira, tandis que le cerceau entier
ira en avant. Ibid. b.
Elastique. ( Courbe) Explication de ce que M. Jacques
Bemoully entend par cette courbe. Analyfe de cette courbe
dans les Mim. acad. 1703. bc. V. 447. b. Comparaifon qui
en donne l’intelligence. Cette propofition démontrée dans
la nouvelle théorie de la nouvelle manuuvre des vaiffeaux , par
M. Jean Bcrnoulli. Solution du problème de l’élaftique dans
p !tome 4 des oeuvres de ce géomètre. Ibid. 448. a.
ELATERIUM. ( Pharm.) Etymologie dii mot. Purgatifs
E L E
violens. Préparation de concombre, bc. Maniéré de nréiw
rer ce remede , félon Diofcoride , V. 448. a. 8c félon <V
lien. Elatérium de M. Boulduc. Dofe qu’en faifoient nremî™
les anciens. Ibid. b. v urc
ELBE , ( Géogr.) fleuve d’Allemagne. Sa defeription.
ponts les plus remarquables. Suppl. II. 781 .a.
ELCANA , ( Hijl. facr.) pere de Samuel. Autresperfon.
rages de ce nom. Suppl. II. 781. a.
ELCATIF, (Géogr.) voyer A lk a t if .
ELCESAITES , ( Hijl. eccl. ) hérétiques du fécond fiecle '
feélateurs dElcefaie ou Elxaï. Rêveries, dogme & préceptes
de ce fanatique. V. 448. b. Les eleéfaïtes auffi nommés fam-
féens , confondus mal-à-propos par Scaligcr avec les eflèens!
Ils fe joignirent aux ebionites , & fubfifterent plufieurs
fiecles. Ibid. 449. a. Voye[ Sampséens.
ELDAGSEN ou Eldagshausen , (Géogr. ) ville d’Allemagne
, dans le cercle de Baffe-Saxe. Parallèle de ce qu’ellë
étoit autrefois & de fon état préfent. Suppl. II. jSu a
ELÉATIQUE , ( Se fie ) ainfi appellée d’Elée ville* dé la
grande Grcce, bc. Xenophane, fucceffeur de Télauge, fils
de Pythagore , en fut le fondateur. Divifion de cette fefte
en deux , les éléatiques métaphyficiehs & les éléatiques phy.
ficiens. V. 449. a. Dialcétique éléatique, voye{ D ialectique.
Hijloire des éléatiques métaphyjtciens. Celle de Xenophane leur
chef. Nous n’avons point d’ouvrage des éléatiques. Mèta-
phyfique de Xenophane : elle n’étoit pas éloignée du ftjino-
fifme. Ibid. b. Phyfique de Xenophane. Au milieu de beaucoup
de puérilités, vous y trouvez plufieurs idées qui né
font point au-deffous de la philofophie de nos tems. Quoique
ces éléatiques fiffent peu de cas de la fcience des laits
ils s’en occupoicnt néanmoins férieufement, bc.
Parmenide, fa philofophie. Ibid. 450. a. Ses principes de
phyfique. Quelques particularités fur fa vie. Voyez Parmt-%
nidéenné, philofophie.
MéliJJ'e de Samos. Sa philofophie.
Zénon l’éléatique. Cfuauté que Phalaris exerça contre lui ,
félon quelques-uns. Sa philofophie. Ibid. b.
Hijloire des éléatiques phyficiens. Leucippe d’Abdere. Son
application à la phyfique. On peut le regarder comme fondateur
de la philoibpnie corpufculairc. Il ne voulut rien
admettre que ce qu’il obfervéroit dans les corps. Il imagina
l’atomifmc. Mais Êpicure le perfectionna. Ibid. 451. a. Rapport
entre cette doélrine & le cartéfianifmc.
Démocrite d’Abdere , fucceffeur de Leucippe. Principaux
événemens de fa vie. Ibid. b. Sa logique. Sa philofophie naturelle.
Ibid. 452. a. Sa théologie. Sa morale, lbid.b.
Protagoras fucceffeur de Démocrite. Son origine. Pourquoi
Démocrite fe l’attacha. Son livre fur la nature des dieux.
Diagoras l’éléatique. Hiftoire de fa vie. Sa doftrinc.
Anaxarque d’Abdere , fut plus fameux par la licence
de fes moeurs que par fes ouvrages. Traits de fa Vie. Sa
fin tragique. Ibid. 453. a.
ÉLEAZAR , (Hijl. facr. ) fix différens perfonnages dé ce
nom. Le premier étoit fils a’Aaron 8c fut ion fucceffeur dans
la dignité de grand-prêtre. Suppl. II. 781. a. Lé fécond étoit fils
d’Abinadab à qui 1 on confia la garde de l’arche du feigneur.
Le troifieme étoit fils d’Aod, frere d’Ifaï. Le quatrième fut
furnominé Auran ou Abaron, frere des Macchabées.^ Le cinquième
étoit un des principaux doéleurs de la lo i, qui founnt
la mort dans la perfécution d’Antiochus. Le fixieme étoit
fils d’Onias premier, 8c frere de Simon (urnommt le Jujte,
auquel il fuccéda dans la fouveraine facrificature.„. !•
ÉLECTEURS, princes en poffeflïondu droit dé ire 1 empereur.
Divers fentiinens fur l’origine de la dignité élcüoraie.
Quelques-uns prétendent que les électeurs le font: a j o g
pour toujours un droit qui n’étoit qu’à tems. La liuue
eft la première loi qui en fixe le nombre , favoir p •
Création des deux autres. Les éleéleurs font en p° •
des grands offices de l’empire. Diftribution de ces 0
V. 453. b. Les éleéleurseccléfiaftiques parviennent à la ai®
ùJLLLt- ik Ü É i Awc rhanitres. Les électorats lecuuer»
électorale par le choix des chapitres. Les éleJ°^atsj Vove.
s’acquierent par droit de naiffance.e. Collcge Collcge
éledora. /
D iete. Prérogatives qui mettent les éleéteurs électeurs aui-au-de
n
autres princes d’Allemagne. Autres privileges deleurpw
Attributs de la dignité électorale. Ibid. -454. et. roy {
to r a l b Éle cto ra t . R , Jcur
Eletleurs. Suppl. I. 309. a , b. 310. a. Titre quo _
donne. L 304. b. Comment le corps
fenfiblement féparé de celui des princes : f c , eme
pofent le college électoral. III. 623. a. Au milieu
fiecle, les principaux princes s attribuèrent a eiw * çe
leCtion de l’empereur : du cortege des l ¿u colrendent
au lieu défigné pour l’éleCtion. IV. 03» • 5, a%
lege des électeurs 8c de chacun d’eux en patu ■ jg
b , 8cc. Les électeurs d , <xc. e p ciwçHi» ppteuùvvteHnit convoquer laA ipfleurs^ ccoonnnfi--
confentcmcnt de iempereur. 972"Â p ^ SnJrcur. V. L
dérés comme officiers ^ domeftiques de 1 empereur. ¿^¡¡curs
Il
Fiefs immédiats poffédés :s par les éleâeurs. t- , . %
ï
fous-officiers. XV.' 4 *9-1 Uur couronnc- SuM1,1 4 *
E L E E L E 567
• ÉLECTIF. Tems où l’empire devint éleCtif. Il l’a été juf-
au’à ce que la maifon d’Autriche en le laiffant tel en apparence
l’a rendu réellement héréditaire. Les charges municipales
font électives en Angleterre , bc. Avant le concordat
les évêchés étoient éleCtifs en France. V. 454. b.
ÉLECTION, (■ Thêolog. ) fens de ce mot. L’éleCtion à la
grâce eft purement gratuite. Queftion entre les théologiens
fur l’élcCtion à la gloire. V . 454. b. Voyc{ Élu.
Eleélion , fens du paffage , il y en a beaucoup d’qppellés,
mais peu d’élus. III. 402. b.
Élection , choix, ( Synon.) VIII. 63 x. b.
Élection. (Hijl. me.) Elections par acclamation. I. 72.
b. L’éleCtion des magiftrars appellée chirotonie chez les Grecs
& chez les Romains. III. 3IÇ.0» <*> Affemblées des Athéniens
& des Romains pour l’éleCtion des magiftrats. Voye^ A ssemblée.
, .
Élection d’ami èrl ami, ( Jürifpr. ) déclaration que celui
qui paroît être acquéreur d’un immeuble, fait du véritable
acquéreur, bc. Manière dont cette déclaration eft ftipulée.
Les élections én ami font ufitêes dans toutes les adjudications
de biens qui fe font par juftice. Au moyen de cette
déclaration, il n’y a qu’une vente, bc. Dans quel terme
de tems doit fe faire cette déclaration. V. 454. b.
Eleilion en matière bénéficiale. Choix d’un eccléfiaftiquè
pour remplir quelque bénéfice, bc. L’éleCtion faite d un
apôtre à la place de Judas fut la première de cette efpece.
Election des premiers diacres, du premier évêque de Jéru-
falem. Cette voie d’éleCtion pratiquée dans la fuite. Evêques
choifis par le peuple. Témoignage de S. Léon & de S.
Cyprien en faveur de cette méthode. Comment cet ufage
fut obfervé en orient & en occident, V. 455. a. pendant les
douze premiers fiecles. Cette forme autorifée en France.
Contraventions à cet ufage. Les religieux avoient part à .
l’éleCtion de l’évêque, de même que les autres eccléfiafti-
ques. Il faut obferver néanmoins que les fouverains avoient
beaucoup de part à ces élections : exemples très - anciens
qui le prouvent. Ibid. b. Il y èüt même fous la première
race plufieurs évêques nommés par le roi fans aucune élection
précédente. Mais Charlemagne & Louis le débonnaire
firent tous leurs efforts poilr rétablir l’ancienne difeipline fui
les éleCtiorts. Les chöfes changèrent bien de face fous la
troificine race. Les Chapitres des cathédrales s’attribuèrent
le droit d’élire fculs les' évêques. L’éleCtion des abbés étoit
réglée fur les mêmes principes. Us étoient élus par les moines
du monaftere qu’ils dévoient gouverner. Ibid. 436. a.
Les autres bénéfices, offices, dignités étoient conférés pat-
les fupérieurs eccléfiaftiques. Confufiôn dans le douzième
fiecle dans tes élections pour les prélatures. Comment le.
quatrième concile de Lattan, & quelques autres travaillèrent
à rétablir l’ordre à cet égard. Affemblée de Bourges
en 1438 dans laquelle Charles VII dreffa la pragmatique-
fanâion, pour rétablir tes élections dans leur pureté. Les
papes firent tous leurs efforts pour- en obtenir la révocation.
Et enfin pour terminer tout différend avec la cour de
Rome , François I fit avec Léon X une tranfadion connue
fous 1e nom de concordat. Somrtiaire des articles de ce traité.
Ibid. b. Comment le roi en ufe pour les nominations, voye(
É v ê ch é , Nomin a tion r o y a l e . Le clergé de France a
fôuvcnt renouvellé fes voeux pour le rétabliffement des
élections à l’égard des évêchés, abbayes , bc. Difpofition
de l’ordonnance d’Orléans 1560, pour l’éleCtion des évêques
8c archevêques. Elle ne s’obierve point, 8c les évêchés
ne font plus éleCtifs. Ordre établi pour l’éleCtion des
abbayes, 8c autres dignités femblablés. Ibid. 457. a. Comment
l’éleCtion doit être publiée. Terme accordé à celui
qui a été élu j pour accepter ou rcfùfer. Quand le ferutin
eft publié, les électeurs ne peuvent plus varier. Il ne fuffit
pas pour être élu, d’avoir le plus grand nombre de voix,
il faut en avoir feul plus de la moitié de la totalité. Exception
pour tes élections d’abbeffcs. Ibid. 458. a. Cas Ou l’é-
leCtion faite par la moindre partie fubfifte. Autres réglés de
droit fur les élections. De la confirmation de la perfonne
élue. Ces réglés reçoivent diverfes exceptions, fuivant les
ftatuts particuliers, privilèges, coutumes, de chaque monaftere.
Ibid. b. Bénéfices éleCtifs, collatifs, 8c éleCtifs-col-
latifs. Ouvrages à confulter fur les élections. Ibid. 439. a.
Eleilion de domicile. V. 439. a.
EleRion d’héritier. Diverfes maniérés dont fe fait ce choix.
Comment fe partage la fucccflion, quand celui qui avoit le
pouvoir d’élire, décede fans avoir tait choix. Autres réglés
fur le droit d’éleCtion. V. 439. a.
Eleilion d’un officier. Droit d’élire tes principaux ma-
ê'ftr ats réfervé conftamment au peuple romain. Comment
fes empereurs romains 8c les rois de France conféraient tes
grands offices. Dès le premiers tems de la monarchie, il y
avoit dans chaque ville 8c bourg des officiers municipaux
qui étoient éleCtifs. Les élus autrefois choifis par les trois
états pour le gouvernement des aides 8t tailles, ont depuis
été érigés en titre d’office. Ibid. b.
É lection , ( Jurifpr.) jurifdiCtions royales. Pourquoi ainfi
nommées. Avant linftitution des élus c’étoient les maires
8c les échevins des villes qui fe mèloient de faire l’âfliè'tfe
8c levée des impôts. V. 439. b. Origine de ces jurifdiCtions
appeilées élefiions. ^Règlement donné par S. Louis pour que
tes tailles fuffent impofées avec juftice, 8c pour tes affeoir
dans les villes royales. Les tailles furent donc la matière
dont les élus ordonnèrent d’abord. Mais outre que tes tailles
n’étoient pas encore ordinaires , la forme preferite pour leur
affiette ne fut pas toujours obfcrvée. Ibid. 460. a. Il y avoit
encore des élus du tems de Philippe de Valois pour la taille
non royale qui fe levoit dans certaines villes. Autres foins
dont ces élus étoient chargés par une ordonnance de 1331,
touchant la ville dé Laon. A l’égard des fubventions qui
fe levoient par le minifiere des élus de chaque ville ou
diocefe, 011 établiffoit quelquefois au-deffus d’eux une perfonne
avec titre d’élu de la province, pour avoir la furin-
tendance de la fubvention. On établit auffi des élus à l’oc-
cafion des droits d’aides, dont la levée fut ordonnée fur
toute marchandife vendue dans le royaume , en 1333. Ibid.
b. Difpofition de cette ordonnance. Ibid. 461. a. On voit par
elle qu’il y avoit deux fortes de députés élus par les états ;
favoir les députés généraux , 8c les particuliers. Le nom
d’élus demeura propre à ces derniers. Leur établiffement
en divers endroits du royaume. Leurs fondions , 8c droits
de jurifdidion. Ce ne fut pas feulement pour les aides qui
fe levoient fur les marchaudifes, que les trois états élurent
des députés; ils en établirent de même pour tes autres im-
pofitions. Ibid. b. Il y eut des députés ou élus commis en
chaque diocefe 8c notamment en la ville de Paris. Inftruc-
tion donnée par ceux de la ville de Paris en 1353 aux commis
qu’ils envoyoient dans chaque paroiffe de ce diocefe.
Par l’ordonnance, ci-deffus mentionnée de 1333 , le roi Jean
établit auffi des élus pour le fait des monnoies. Les députés
particuliers fur le fait des aides furent qualifiés d’élus dans
une ordonnance de Charles, dauphin de France, en 1336. Diftribution
de leurs départemens. Ibid. 462. a. Par la même
ordonnance, tes élus des trois états par les dioccfes fur le
fait de l’aide, étoient chargés de voir le compte des élus,
impofiteurs, receveurs , bc. de l’année précédente. Infinie-
tion faite par les trois états de la languedoïl fur 1e fait de
cette aide. Ibid. b. Les états de la languedoïl accordèrent
de leur part en 1336, une aidé au roi, 8c à cette occafiOn
le dauphin Charles rendit encore une ordonnance , où il eft
queftion des fondions des élus. Telle fut l’origine des élus
qui font encore nommés dans les pays d’états. Autre ordonnance
du dauphin Charles en 1338 , rendue à l’occafion
d'une aide accordée par les trois états de la languedoïl ,
où il s’agit de l’éledion des perfonnes pour gouverner l’aide,
8c de leurs fondions Ibid. 463. a. 8c falaires. Lettres donnés
par le même dauphin à l’occafion de cette aide, pour
l’éledion d’une perfonne de la part de l’églife, 8c d’un bon
bourgeois de la part des gens de la ville de Paris 8c du
pays pour gouverner l’aide , bc. Ordonnaftce du roi Jean
du 3 décembre 1360. Ibid. b. Ordonnance dé Charles V
en 1367 , d’où trient l’origine des huiffiers attachés aiix élections
8c peut-être des huiffiers des tailles. Ordonnance dii
même en 1370. Autres ordonnances de 1372. 1373. Ibid.
464. a. 1374. Celle-ci eft la premierè qui faffe mention de
l’auditoire des élus. Celui de l’éleâion de Paris étoit dans
l’enclos du prieuré de S. Eloi en la cité. Ibid. b. Tems où les
élus commencèrent à y fiéger. Ce ne fut probablement qu’en
1432, que l’auditoire de 1 éleftion de Paris fut transféré dans
le palais. Autre ordonnance de Charles V en 1379 fur le
fait des aides 8c de la gabelle , où font déterminés le nombre
, tes offices des élus, bc. Ibid. 463. a. Elus établis par
les états d’Artois, du Boulonnois, du comté de S. Pol, à
l’occafion de l’aide par eux accordée en 1381. Ibid. b. Il y
avoit auffi en 1382 dès élus dans la province de Normandie.
Cette même année, Charles VI autorifa les généraux
des aides, d’établir tes élus en toute ville 8c diocefe où les
aides avoient cours. Dans le même tems, le roi fit une
inftruftion pour la levée des aides , qui contient plufieurs
réelemens par rapport aux élus. Réglemèns répétés dans
une autre inftruétion en 1383. Les élus, tant des fieges
généraux que des fieges particuliers, qualifiés de collège.
Inftruétion pour la levée des aides en 1388. Ibid. 466. a.
Autres inftruftions fur les aides en 1388 8c en 1392. Ordonnances
de 1393. Le roi laiffoit quelquefois aùx élus
lé choix d’affermer ou de mettre én régie les aides : lettres
à ce fujet du 2 août 1398. Autre ordonnance de Charles
VI en 1400 , concernant les élus. Ibid. b. Les cômmiffions
d’élus furent enfin érigées en titre d’office, formé fous lé
regne de Charles VU en 1443. Par un édit de 1685 ,
les élus particuliers ont été fupprimés 8c réunis aux élus
en chef, 8c toutes tes commiflions érigées en élection eh
chef. Il y a préfentement 181 élections dans leroyaumè,
qui font diftribuées dans les provinces 8c généralités , qu’on
^appelle pays d’éleétion. Enumération de ces généralités &