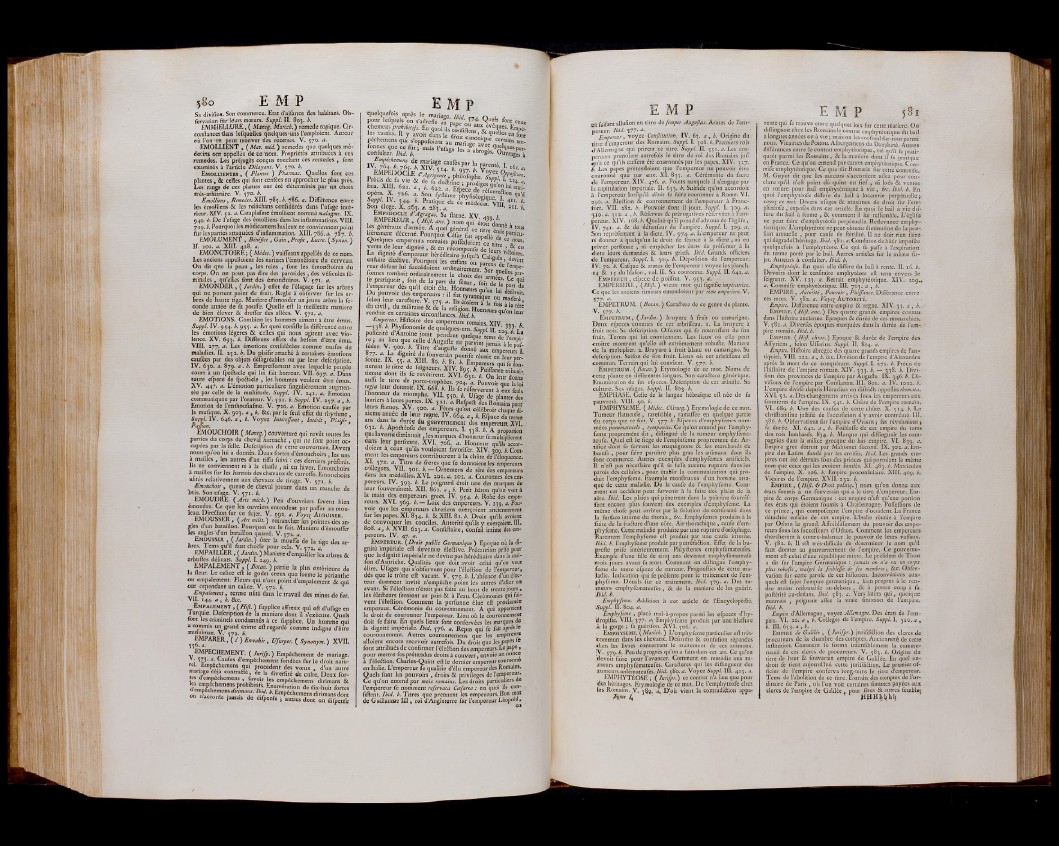
5$ o E M P
Sa divifioii. Son Commerce. Etat d'aifance des habitàns. Ob-
fervation forldurs moeurs. Suppl. II. 805. b.
¿MMIELLURE, ( Maneg. Maréch.) remede topique. Cir-
eonftances dans lefquelles qûelqaes-uns l’emploient. Auteur
où l’on 'en peut trouver des recettes. V . 57b. à.
EMOLLIENT , ( Mat. méd. ) remèdes que quelques médecins
ont appelles de ce 'nom. Propriétés attribuées à ces
rcmedes. Les préjugés conçus touchant ces rem'cdes , font
examinés à l’article Délayant. V. 570. b.
Emollientes , f Plantes ) Pharmac. Quelles font ces
plantes, & celles qui font cenfées en approcher le plus près.
Les rangs de ces plantes ont été déterminés par un choft
frès-arbitrairc. V . 570. b.
ËmolUtns, Remede s. XIII. 785. b. 78 6. a. Différence entré
les émbiltens & les relâchans confidérés dans l’ufage intérieur.
XIV. 52. a. Cataplafme émollient nommé malagme. IX.
940. b. De l’ufage des émolliens dans les inflammations. VIII.
719. b. Pourquoi les médicamens huileux ne conviennent point
fur les parties attaquées d’inflammation. XIII. 786. a, 787. b.
EMOLUMENT , Bénéfice , Gain, Profit, Lucre. ( Synon. )
ÏI. 20a. *. XIII. 428. a.
EMONCTOIRÉ; ( Midec. ) vaiffeaux appellés de ce nom.
Les anciens appelloient les narines l’émonétoirc du cerveau.
On dit que la peau , les feins , font les émonéloircs du
corps. On ne peut pas dire des parotides, des véftculés fé-
minalcs , qu’elles font des émonâoires. V. 571. a.
EMONDER, ( Jardin. ) effet de l’élagage fur les arbres
qui ne portent point de fruit. Réglé à' obferver fur les arbres
de haute tige. Maniéré d’émonder un jeune arbre la fe*
conde année de fa pouffe. Quelle cft la meilleure manière
de bien élever & drefler des allées. V. 571. a.
EMOTIONS. Combien les hommes aiment à être émus.
Suppl. IV. 954, b. 9Ç5. a. En quoi confifte la différence entre
les émotions légères & celles qui nous agitent avec Violence.
XV. 693. b. Différons effets du beloin d’être ému.
VIIL 277. a. Les émodons confidérées comme caufes de
maladies. II. 252. b. Du plaifir attaché à certaines émotions
caufées par des objets défagréables ou par leur deferiprion.
IV. 630. a. 879. a. b. Empreffemcnt avec lequel le peuple
court à un fpeâade qui lui fait horreur. VII. 697. a. Dans
toute efpece de fpeétade , les hommes veulent être émus.
XV. 447. a. L’émotion particulière fineuliérement augmentée
par celle de la mulutude. Suppl. IV. 241. a. Emotion
communiquée par l’orateur. V. 521. b. Suppl. IV. 257. a t b.
Emotion ae l’enthoufiafme. V. 720. a. Emotion caufée par
la mufique. X. 903. a , b. &c. par le feul effet du rhythme,
Suppl. IV. 646. a , b. y oyez Intérejfant, Intérêt, PLifir .
Pajfion.
EMOUCHOIR ( Maneg.} couverture qui revôt toutes les
parties du corps du cheval harnaché, qui ne font point occupées
par la iélle. Deicriptlon de cette couverture. Divers
noms qu’on lui a donnés. Deux fortes d’émouchoirs, les uns
à mailles , les autres d’un tilTu fuivi ; ces derniers préférés
Ils ne conviennent ni à la chaflc, ni en hiver. Emouchoirs
à mailles fur les harnois des chevaux de carroffe. Emouchoirs
ufitàs relativement aux chevaux de tirage. V. 571. b.
Emouchoir > queue de cheval jouant dans un manche de
obis. Son ufage. V. 571. b.
EMOUDKE. {Arts méch.) Peu d’ouvriers favent bien
émoudre. Ce que les ouvriers entendent par pafler au mouc
rkS^T?c°™fur,c<l ® f l Y* 59*- v °yel A ig u is e r .
EMUUSSER, ( Art milit. ) retrancher les pointes des angles
d un bataillon. Pourquoi on le fait. Manière d’émoulTcr
les angles d un bataillon quarré. V. 572. a.
Emousser t (Jardin.) ôter la moufle’ de la tige des arbres.
Tems quil faut choifir pour cela. V . 572. a.
EMPAILLER, ( Jardin.) Maniéré d’empailler les arbres 8c
arbufles délicats. Suppl. I. 249. b.
EMPALEMENT, ( Bot an. ) partie la plus extérieure de
la fleur. Le calice eft le godet creux que forme le périanthe
ou empalement. Fleurs qui n’ont point d’empalement 8c qui
ont cependant un calice. V. 572. b.
Empalement, terme ufné daus le travail des mines de fer.
VII. 144. a , b. 8cc.
Empalement , ( Hifi. ) fupplice affreux qui eft d’ufage en
l urquie. Deferiprion de la manière dont il s’exécute. Quels
font les criminels condamnés à ce fupplice. Un homme qui
a commis un grand crime eft regardé comme indigne d’être
mufulman. V. 572. b.
55f ^ PARER’ \ s' ) Envahîr* Ufurptr. ( Synonym.) XVII.
EMPECHEMENT. ( Jurifp. ) Empêchement de mariage,
j 573* a- Caufes d’empêchement fondées fur le droit natu-
.«■mpicheiiuai» qui procèdent des voeux , d’un autre
ruirnge d i,l contra t de la diverfité de culte. Deux for-
“ f “T l Î T \ Î VO r 1« utupUchcmens dirimans &
Enumération de dix-huit fortes
on nÇaccoer lC w 7 T ; fr ‘ v ^ 'on n accorde jaunis de dtfpenfe ; hauetmrese dnosn td iorinm adnifsp deonnfet
E M P
H ceux
chemcns prohibitifs. En quoi ils confié v iciu' s' Empfc
les caufes. Il y ' voit &
pcchemens qut s’onpofoient a u m ,.;.. q «nains cm.
fonnes que ce f i t ; mais i'üfigo lcs a abroeL‘In l , '1CSf cr‘
confulter. Ibid. b. abrogés. Ouvrages à
l H«n,é t. P j
p EMPEDOcIe ^„LÎphSfophe S 0JÎ"Mbua.
XI11/ 6™ 0 , b. '^aurî*
IV 7î6 ' t b" 1 Pl>yftologiqùeref i0" I X . $ 4 “ rm i l t
ÊMPEDOCLE d'Agragas. Sa ftàtué XV .«o »
1 E-'P>ER£Ü^ > §oeÊh/tc.) nom qui ¿ton donné i
es généraux darmée. A quel générai ce titre étôht,
héretnent décerné. Pourquoi Céfar fut appelsde ?
Quelques empereurs romains poltëdefeut ce due â ° in‘
vertu de leur dignité , & en récompeufe de leurs vifov
an ‘i'Sntcé cl empereur héréditaire jùfqu’S C a l S ï ' “ ’
cnfoite éleflive. Pourquoi les enfàns où paren, l ’ p lm
reur défont lui fuccédoient ordinairement Su? mÎll mpe‘
fonnes tomboir ordinairement le choix des aïmle. r ^
fe prattquoit, foit de la part du ftnat, foitTe U ï '
lempereur des qu’il ctoit élu. Honneuré qu’on lui K a J ?
Du poüvoir des embereilrs • il fut tvr,nnl oetéroifi
fclon leur cara flcre.T 57«.'" j S S É g G è ?“ * S » i i
du civil, du militaire Si de ia rclieion ? a,tite
rendoit en certaines circonftancesi] i °anam qu™
f l 7 Tp ù iÎ lftoire. de,s cmpcrcurs r'omains. XIV I
Mi. : Phyfionomte de quelques-uns. Suppl. II i 2o i l ô
pollénté d Antoine jouit pendant quelque tems ie i '. t
féde/'V ooo“ ! d> l'fen î * k t e
S r / ; ® ■'.T/,r? dau6uftq donné aux empeteurs I.
auflt le ntre de porte-trophées. 704. a. Pouvoir que la loi
m a leur donner. IX. 66$. b. Ils fe réferverent à eux fcuh
honneur du triomphe. VII. 550. b. Ufage de planter des
leurs" ftatue^lFv'’65" IX- * RQCP'a dos Romaïns poih
. i 5° ° ' "• ,,',cs qLl on oilébroit chaque diamnss
ddaan„sT l1a. dfu°r /ée'" dj u gouveIrVne’ m66e<n-t “d >e sh - eEmIPpÎeOrPeu dres. tXreVntIe.
632. b. Apothéofe des empereurs. I. 538. b. A proportion
que la vertu diminuent, les marques d’honneur fe multiplièrent
dans leur perfonne. XVI. 706. *. Honneur qu’ils accor-
doient g ceux qu’ils vouloient favorifer. XIV. 309. b. Comment
les empereurs contribuèrent à la chute de l’éloquence.
11 freres que fe donnoient les empereurs
collègues. VII. 301. b. — Ornemens de tête des empereurs
dans les médailles. XVI. 201. a. 202. a. Couronnes des empereurs.
IV. 393. b. Le poignard étoit une des marques de
leur fouveraineté. XII. 862. a , b. Petit bâton qu’on voit à
la main des empereurs grecs. IV. 954. b. Robe des empereurs.
XVI. 369. b. — Loix des empereurs. V. 139. a. Pouvoir
que les empereurs chrétiens exerçoient anciennement
fur les papes. XI. 834. b. & XIII. 81. b. Droit qu’ils avoient
de convoquer les conciles. Autorité qu’ils y exerçoient. III.
808. a j b. XVII. 623. a. Confiftoire, confeil intime des empereurs.
IV. 47. a.
Empereur. ( Droit public Genpanique) Epoque où la dignité
impériale eft devenue élc&ivc. Précaution prife pour
que la dignité impériale ne devînt pas héréditaire dans la inair
fon d’Autriche. Qualités que doit avoir celui qu’on veut
élire. Ufages qui s’obfervent pour l’éleélion de l’empereur,
dés que le trône eft vacant. V. 375. b. L’abfence d’un électeur
duement invité n’empêche point les autres d’aller en
avant. Si l’élcâion n’étoit pas faite au bout de trente jours ,
les électeurs feraient au pain & à l’eau. Cérémonies qui fui-
vent l’éleélion. Comment la perfonne élue eft proclamée
empereur. Cérémonie du couronnement. A qui appartient
le droit de couronner l’empereur. Lieu où le couronnement
doit fe faire. En quels lieux font confervées les marques de
la dignité impériale. Ibid. 576. a. Repas qui fe fait après le
couronnement. Autres couronncmens que les empereurs
alloicnt encore recevoir autrefois. Du droit que les papes fe
font attribués de confirmer l’éleétion des empereurs. Le pape,
pour mettre fes prétendus droits à couvert, envoie un nonce
a l’éleélion. Charles-Quint eft le dernier empereur couronne
en Italie. L’empereur ie qualifie d’élu empereur des Romains.
Quels font les pouvoirs , droits & privilèges de rempercur.
Ce qu’on entend par mois romains. Les droits particuliers de
l’empereur fe nomment refervata Cetfarea : en quoi ils con"
fiftent. Ibid. b. Titres que prennent les empereurs. Bon mot
de Guillaume I II, roi d’Angleterre fur l’empereur Léopold,
E M P
en faifant allufion au titre de femper Auguftus. Armes de l'empereur.
Ibid. 577- a"
Empereur, voyez Confiitution. IV. 63. a t b. Origine du>
titre d’empereur des Romains. Suppl. I. 308. b. Premiers rois
d’Allemagne qui prirent ce titre. Suppl. II. 551. a. Les empereurs
prenoient autrefois le titre de roi des Romains juf-
qu’à ce qu’ils euflent été couronnés par les papes. XIV. 327.
b. Lcs papes prétendaient que l’empereur ne pouvoir être
couronné que par eux. XI. 833. a. Cérémonie du iacre 1
de l’empereur. aIV. 476. a. Points auxquels il s’engage par
la capitulation impériale. II. 633. b. Subiidc qu’on accordoit
à l’empereur loriqu’il alloit fe faire couronner à Rome. VI.
290. a. Eleftion oc couronnement de l’empereur à Francfort.
VII. 282. b. Pouvoir dont il jouit. Suppl. I. 309. a.
310. a. 312. a , b. Réferves & prérogatives réiervées à l’empereur.
XIV. 168. b. Qualité qu’il prend d’advoué de l’églife,
IV. 741. a. 8c de détenfeur de t’empire. Suppl. I. 309. a.
Son repréfentant à la dicte. IV. 074. a. L'empereur ne peut
ni donner à quelqu’un le droit de féance à la dicte , ni eu
priver perfonne , ni empêcher les états de préfenter à la
diete leurs demandes & leurs griefs. Ibid. Grands officiers
de l’empereur. Suppl. I. 309. b. Dépoiirion de l’empereur.
IV. 72. b. Cafque 8c armes de l’empereur : voyez les planch.
14 8c 1 ç du blafon, vol. II. Sa couronne. Suppl. II. 642. a.
Emp ereu r, efpece de poiflon. V. 953. a.
EMPERIERE, ( Hifi. ) vieux mot qui fignifie impératrice.
Ce que les anciens rimeurs entendoient par rime emperïere. V.
^MPETRUM. ( Botan. ) Carafterc de ce genre de plante,
■v. 577. b. | :/ - ï
Empetrum , ( Jardin. ) bruyere h fruit ou camarigne.
Deux efpcces’connues de cet arbrifleau. 1. La bruyère à
fruit noir. Sa deferiprion. Oifcaux qui fe nourriflent de fon
fruit. Terres qui lui conviennent. Les lieux où elle peut
croître montrent qu’elle eft extrêmement robufte. Manière
de la multiplier. 2. Bruyere à fruit blanc ou camarigne. Sa
defeription. Saifon de ion fruit. Lieux où cet arbrifleau efl
commun. Terrein qui lui convient. V. 577. b.
Empetrum. {Botan.) Etymologie de ce mot. Noms de
cette plante en différentes langues. Son carafterc générique.
Enumération de fes cfpeces. Defeription de cet arbufte. Sa
culture. Ses ufages. Suppl. II. 803. b.
EMPHASE. Celle de la langue hébraïque eft née de fa
pauvreté. VIII. 90. b.
EMPHYSEME. {Médec. Chirurg.) Etymologie de ce mot.
Tumeur flatueufe, rarefcible, ramaffée en quelque partie
du corps que ce foit. V. 577. b. Efpeccs d’empliyfernes nommées
pneurnatoeele , tympanite. Ce qu’on entend par l’emphy-
feme proprement dit , diflingué de la tumeur emphyféma-
xeufe. Quel efl le ftege de l’emphifcme proprement dit. Artifice
dont fe fervent les maquignons oc les marchands de
Loeufs , pour faire paraître plus gras les animaux dont ils
font commerce. Autres exemples d’emphyfemes artificiels.
11 n’efl pas néccflairc qu’il fe fafle aucune rupture dans les
parois des cellules , pour établir la communication qui produit
l’cmphyfcme. Exemple monftrucux d’un homme attaqué
de cette maladie. De la~caufe de l’emphyfeine. Comment
cet accident peut furvenir à la fuite des plaies de la
¡tête. Ibid. Lcs plaies qui pénètrent dans la poitrine fournif-
fent encore plus fouvent des exemples d’emphyfeme. La
même chofe peut arriver par la folution de continuité dans
la furface interne du thorax, &c. Emphyfernes produits à la
fuite de la frafture d’une côte. Air thorachiquc, caufe d’emphyfeme.
Cette maladie produite par une rupture d’oefophage.
ilarcmcnt l’emphyfeme eft produit par une caufe interne.
Ibid. b. Emphy ferne produit par putréfaétion. Effet de la bu-
prefte prife intérieurement. Phlyétenes emphyfémateufes.
Exemple d’une fille de cinq ans devenue empnyfémateufe
trois jours avant fa mort. Comment on diftingue l’emphy-
feme de toute efpece de tumeur. Prognoftics de cette maladie.
Indication qui fe préfente pour le traitement de l’em-
phyferne. Détails fur ce traitement. Ibid. 579. a. Des tumeurs
emphyfémateufes, & de la manière de les guérir.
Ibid. b. ,
Emphyfeme. Addition à cet article de l’Encyclopédie.
'Suppl. 11. 804. a.
Emphyfeme , placé mal-à-propos parmi les efpeces d’hy-
Vlropiüe. VIII. 377. a. Emphyfeme produit par une blcflùre
à la gorge ; fa guérifon. AVI. 506. a.
Emphyseme. ( Maréch. ) L’emphyfeme particulier eft très-
commun dans les chevaux. Défordrc & confufion répandus
klans les livres concernant le traitement de ces animaux.
‘V . 579. b. Peu de progrès qu’on a faits dans cet art. Ce qu’on
!dcvoit faire pour l’avancer. Comment on remédie aux tumeurs
emphyfémateufes. Carailercs qui les diftinguent des
xumeurs oedémateufes. Ibid. 580. a. Voyez Suppl. lit. 413. a.
EMPHYTÉOSE ; ( Juri/pr.) ce contrat n a lieu que pour
des héritages. Etymologie de ce mot. De l’emphytéofe chez
les Romains, y . «Çq, u. D’où vient la coptradittion appa-
¡Bqpie ^
E M P 5 § 1
rr/?-tC ^U*- k , tr°'îve entre quelques loix fur cette foaficrc, On
dillinguoit chez les Romains le contrat emphytéotique, du bail
à longues années ou à vie ; mais on les confond fur-tout parmi
nous. Vicairics du Poitou. Albcrgcmcns du Dauphiné. Autres
différences entre le contrat emphytéotique, tel qu’il fe prati-.
quoit parmi les Romains , & la manière dont il fe pratique
en France. Ce qu’on entend par canon emphytéotique. Com-
inife emphytéotique. Ce que dit Boutaric fur cette commife.
M. Guyot dit que les auteurs s’accordent aflez pour conclure
qu’il n’eft point dû quint en fie f, ni lods & ventes
en roture pour bail emphytéotique à v ie , &c. Ibid. b. En
quoi l’emphytéofc différé du bail à locaterie perpétuelle;
voyc{ ce mot. Divers ufages & maximes de droit fur Pem-
phitéofe , expofés dans cet article. En quoi le bail à vie différé
du bail à ferme , & comment il lui reflemble. L’églife
ne peut faire d’emphytéofe perpétuelle. Redevance emphytéotique.
L’emphytéote ne peut obtenir diminution de la pen-
fion annuelle , pour caufe de flérilité. Il ne doit rien faire
qui dégrade l’héritage. Ibid. 581. a. Condition de bâtir impofée
quelquefois à l’emphytéote. Ce qui fc paffe à l’expiration
du terme porté par le bail. Autres, articles fur le même fu-
jct. Auteurs à confulter. Ibid. b.
Emphytéofe. En quoi elle différé du bail à rente. II. 16. b.
Devoirs dont le cenfitaire emphytéote eft tenu envers le
feigneur. XV. 123. a. Retrait emphytéotique. XIV. 209.»
a. Commife emphytéotique. III. 703. a , b.
EMPIRE , Autorité, Pouvoir, Pu/Jfance. Différence entre
ces mots. V. <82. a. Voye[ A u to r i t é .
Empire. Différence entre empire & regne. XIV. 33. a t b..
Empire. {Hifi. anc. ) Des quatre grands empires connus
dans l’hiftoirc ancienne. Epoques & durée de ces monarchies.
V. 582. a. Diverfes époques marquées dans la durée de l’em-v
pire romajn. Ibid. b.
Empire. {Hifi. chron.) Epoque & durée de l’empire des
Affyricns, félon Ufferius. Suppl. II. 804. a.
Empire. Hiftoire abrégée des quatre grands empires de l’antiquité.
VIII. 222. a , b. 8cc. Divifion de l’empire d’Alexandre
après la mort de ce conquérant. Suppl. I. 271. b. Précis de
l’hiftoire de l’empire romain. XIV. 333. b. — 338. b. Divifion
des provinces de l’empire par Àugufte. IX. 346. b. Divisons
de l’empire par Conftantin. III. 801. a. IV. 1012. b.
L’empire divifé depuis Héraclius en diftriéts appellés themata.
XVI. 52. a. Des changemens arrivés fous les empereurs aux
frontières de l’empire. IX. 541. b. Chute de l’empire romain.
VI. 689. b. Une des caufes de cette chute. X. 514. b. Le
chriftianifme juftifiè de l’accufation d’y avoir contribué. III.
386. b. Obfervations fur l’empire d’Orient ; fes révolutions ;
fa durée. XI. 641. a , b. Foiblcflc de cet empire du tems
des rois lombards. 834. b. Marque qui diftinguoit les compagnies
dans la milice grecque du bas empire. VI. 839. a.
Empire grec détruit par Mahomet fécond. IX. 302. a. Empire
des Latins fondé par les croifés. Ibid. Les grands empires
ont été détruits fous des princes qui portoient le méme
nom que ceux qui les avoient fondés. A l . 483. b. Matricules
de l’empire. X. 206. b: Empire proconfulairc. XIII. 409. b.
Vicaires de l’empire. XVII. 232. b.
Empire , ( Hifi. & Droit politiq. ) nom qu’on donne aux
états fournis à un fouverain qui a le titre d’empereur.. Empire
& corps Germanique : cet empire n’eft: qu’unejjortion
des états qui étoient fournis à Charlemagne. Poffeifions de
ce prince , qui compofervent l’empire d’occident. La France
détachée enluite de cet empire. L’Italie réunie à l’empire
par Othon le grand. Affoibliffement du pouvoir des empereurs
fous les fucceffeurs d’Othon. Comment les empereurs
cherchèrent à contre-balanccr le pouvoir de leurs vaffaux.
V. 582. b. Il cft très-difficile de déterminer le nom qu’il
faut donner au gouvernement de l’empire. Ce gouvernement
eft celui d’une république mixte. Le préfident de Thou
a dit fur l’empire Germanique : jamais on n a vu un corps
plus robufie , malgré la foibleffe de fies membres ; &c. Obfer-
vation fur cette parole de cet hiftorien. Inconvéniens auxquels
¿ft fujet l’empire germanique , bien propres à le rendre
moins redoutable nu-dehors , 8c à porter coup à fa
poftérité au-dedans. Ibid. 583. a. Vers latins qui, quoique
mauvais , peignent àffez la vraie fituation de l’empire.
Ibid. b.
Empire d’Allemagne, voyez Allemagne. Des états de l’empire.
vl. 20. a , b. Collèges de l’empire. Suppl. I. 310. a ,
b. III. 633. a , b. . . _
Empire de Galilée , { Jurifipr. ) jurifdiélion des clercs de
procureurs de la chambre des comptes. Ancienneté de cette
inftitution. Comment fe forma infenfiblement la communauté
de ces clercs de procureurs. V. 583. b. Origine du
titre de haut & fouverain empire de Galilée. En quel endroit
fe tient aujourd’hui cette jurifdiétion. Le premier officier
de l’empire confcrva long-tems le titre d’empereur.
Tems de l’abolition de ce titre. Extraits des comptes de l’ordinaire
de Paris, où l’on voit certaines fommes payées aux
clercs de l’empire de Galilée » pour fêtes & autres femblas