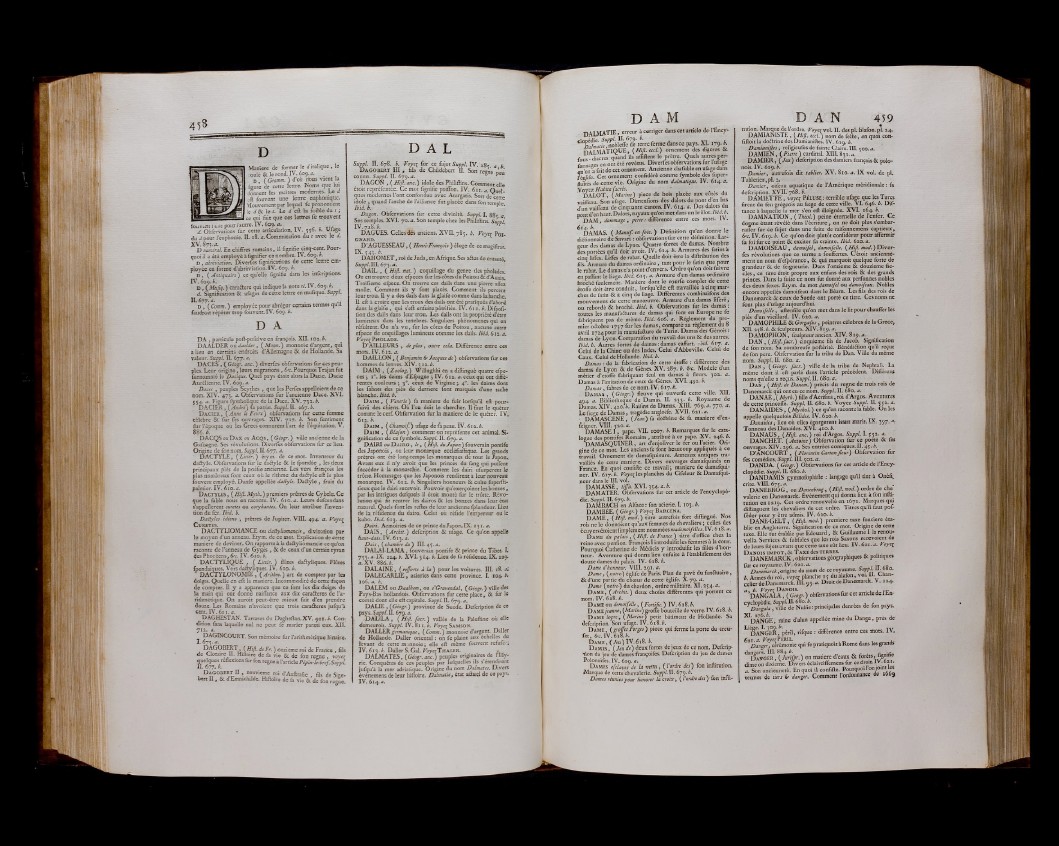
4 5 8
D
Maniéré de former le ¿italique , le
:oulé & le rond. IV. 609.4* .
D , ( Gramm. ) d’ou nous vient la
jigure de cette lettre. Noms que lui
donnent les maîtres modernes. Le d
,-ft fouvent une lettre euphonique.
Mouvement par lequel fe prononcent
le d 8c le t. Le d eft la foible du t j
ce qui fait que ces lettres fe trouvent
iouvtnr I une pour l'autre. IV. ¿09- a. ;
d Obfervations fur cette articulation. IV. 556. b. Ulage
du d pour l’euphonie. IL 18. a. Commutadon du t avec le d.
XV. 873.4.
D montrai. En chiffres romains, il fignifie cinq-cent. Pourquoi
il a été employé à fignifier ce nombre. IV. 609. b.
d , abréviation. Diverfes lignifications de cette lettre employée
en forme d’abréviation. IV. 609. b. . .
D, ( Antiquaire) ce qu’elle fignifie dans les infcripdons:
IV. 609. b.
D, (Mufiq.) caraâere qui indique la note re. IV. 609. b.
d. Signification & ufages de cette lettre en mufique. Suppl.
IL 677. a.
D , ( Comm. ) employée pour abréger certains termes qu il
faudroit répéter trop fouvent. IV. 609. b.
D A
DA , particule poft-pofitive en françois. XII. 102. b.
DAALDER o u daelder , ( Mo/m.) monnoie d’argent, qui
a lieu en certains endroits d’Allemagne & de Hollande. Sa
valeur. Suppl. IL 677. a.
DACES , ( Géogr. anc. ) diverfes obfervations fur ces peuples.
Leur origine , leurs migrations , &c. Pourquoi Trajan fut
fumommé le Dacique. Quel pays étoit alors la Dacie. Dacie
Aurélienne. IV. 609. a.
Daees , peuples Scythes , que les Perfes appelloient de ce
nom. XIV. 473. a. Obfervations fur l’ancienne Dace. XVL
ce4. a. Figure fymbolique de la Dace. XV. 732.b.
DACIER, (André) la patrie. SuppL IL 267. b.
D acier., (Anne le Fevre) obfervations fur cette femme
célébré 8c fur fes ouvrages. XIV. 717. b. Son fentiment
fur l’époque où les Grecs connurent l’art de l’équitation. V.
886. b.
DACQS ou D a x ou A c q s , ( Géogr. ) ville ancienne de la
Gafcegne. Ses révolutions. Diverfes obfervations fur ce lieu.
Origine de fon nom. Suppl. H. 677. a.
DACTYLE, ( liitér. ) ètym. de ce mot. Inventeur du
daâyle. Obfervations fur le daâyle 8c le fpondée , les deux
principaux piés de la poéfie ancienne. Les vers françois les
plus nombreux font ceux où le rithme du daâyle eft le plus
fouvent employé. Danfe àppellée daâyle. Daâyle , fouit du
palmier. IV. 610. a.
D a c t y l e s , (Hift. Myth. ) premiers prêtres de Cybele. Ce
que la fable nous en raconte. IV. 610. a. Leurs defcendans
s'appelleront cure te s ou corybontés. On leur attribue l’invention
du fer. Ibid. b.
DaByles idéens , prêtres de Jupiter. VIIL 494. a. Voyez
CURETES.
DACTYTJOMANCE ou daâyliomancie , divination par
le moyen d’un anneau. Etym. de ce mot. Explication de cette
maniéré de deviner. On rapporte à la daâyliomancie ce qu’on
raconte de l’anneau de Gygés , 8c de ceux d’un certain tyran
des Phocéens, &c. IV. 610. b.
DACTYLIQUE , ( littér. ) flûtes daâyliques. Flûtes
fpondaîques. Vers daâyliques. IY. 6x0. b.
DACIYLONOMÎE , ( Arhhm. ) art de compter par les
doigts. Quelle en eft la maniéré. Incommodité de cette façon
de compter. Il y a apparence que ce font les dix doigts de
la main qui ont donne n ai fiance aux dix caraâeres de l’arithmétique.
On auroit peut-être mieux fait d’en prendre
douze. Les Romains n’avoient que trois caraâeres jufqu’à
cent. IV. 611. a.
DAGHESTAN. Tartares du Dagheftan.XV. 921. b. Condition
(ans laquelle nul ne peut fe marier parmi eux. XII.
712. a.
DAGINCOURT. Son mémoire fur l’arithmétique binaire.
L675.*.
DAGOBERT, ( Hift. de Fr. ) onzième roi de France, fils
de Clotaire II. Hiftoire de fa vie 8c de fon regne , voyez
Î l 6 Ue ¿ 00S f°° r'E“ “ l’™ cle Pipin-ü-br'f.Suppï.
D a g o b e r t II , neuvième roi d’Auftrafie , fils de Sise-
bert I I , & d'Emnichilde. Hiftoire de b. vie & de fon regne.
D A L
Suppl. II. 678. b. Voyez fur ce fujet Suppl. IV. 28c. a b
D a g o b e r t I I I , fils de Childebert II. Son reene non
connu. Suppl. II. 679. a. . - >
DAGON , ( Hift. anc. ) idole des Philiftins. Comment elle
étoit repréfentée. Ce mot fignifie poiflon. IV. 611. a. Quelques
modernes l’ont confondue avec Atergatis. Sort de cette
idole , quand l’arche de l’alliance fut placée dans fon temnle
Ibid. b. g ,
Dagon. Obfervations fur cette divinité. Suppl. I. 883. a.
Ses temples. XVI. 70. a. Son temple chez les Philiftins. SuddÎ
IV. 7 iS.b. „ FP'
DAGUES. Celles des anciens. XVII.783. b. Voyez P o i g
n a r d .
D’AGUESSEAU, ( Henri-François ) éloge de ce magiftraf.
IX. 543-b.
D AH OMET, roi de Juda, en Afrique. Ses aâcs de cruauté.
Suppl.lîL 673. tf.
DAIL , ( Hift. nat. ) coquillage du genre des pholades.
On en trouve deux efpeces fur les côtes du Poitou 8c d’Aunis.
Troifiemc efpece. On trouve ces dails dans une pierre allez
molle. Comment ils y font placés. Comment ils percent
leur trou. Il y a des dails dans la glaife comme dans labanche.
Il eft à croire que les trous des dails ont étéprariqués d’abord
dans la glaife , qui s’eft enfuitepétrifiée. Iv. 611. b. Difpofi-
tion des dails dans leur trou. Les dails ont la propriété d’être
lumineux dans les tenebres. Singuliers phénomènes qui en
réfultent. On n’a vu, fur les côtes de Poitou , aucune autre
efpece de coquillages lumineux comme les dails. Ibid. 612. a.
Voyez P h o l a d e .
D’AILLEURS , de plus, outre cela. Différence entre ces
mots. IV. 6x2. a.
DAILLON, ( Benjamin &. Jacques de ) obfervations fur ces
hommes de lettres. XIV.312. b.
DAIM , ( Zoolog.) willughbi en a diftingué quatre efpeces
; x°. les daims d’Efpagne ; IV. 612. a. ceux qui ont différentes
couleurs ; 30. ceux de Virginie ; 40. les daims dont
les fabots des piés de derrière font marqués d’une tache
blanche. Ibid. b.
D a im , ( Vcncrie ) fa maniéré de fuir lorfqu’il eft pour-
fuivi des chiens. Où l’on doit le chercher. Il faut le quêter
comme le cerf. Obfervation fur. la maniéré de le quêter. IV,
612. b.
D a im , ( Chamoif.) ufage de fa peau. IV. 612. A
D a im , (Blafon ) comment on repréfente cet animal. Si-
irion de ce fymbole. Suppl. IL 079. a.
DAIRI ou D a i r o g le, (Hift. du Japon) fouverain pontife
des Japonois , ou leur monarque eccléfiaftique. Les grands
prêtres ont été long-temps les monarques de tout le Japon»
Avant eux il n’y avoir que les princes du fiuig qui pu u en t
{accéder à la monarchie. Comment les dairi ufurperent le
trône. Hommages que les Japonois rendirent à leur nouveau
monarque. IV. 612. b. Singuliers honneurs 8c culte fuperiti-
tieux que le dairi recevoit. Pouvoir qu’exerçoient les bonzes ,
par les intrigues defquels il étoit monté fur le trône. Révolution
qui fit rentrer les dairos 8c les bonzes dans leur état
naturel. Quels font les reftes de leur ancienne fplendeur. Lieu
de la réfidencc du dairo. Celui où réfide l’empereur ou le
kubo. Ibid. 6x3. a.
Dairi. Armoiries de ce prince du Japon, IX. 131. 4.
DAIS, ( Archit. ) defeription 8c ufage. Ce qu’on appelle
hatu-dais. IV. 613. a.
Dais, (chambredu) IIL 43. tf.
DALAI-LAMA, fouverain pontife 8c prince du Tibet. L
. a. IX. 224. b. XVI. 3 ¿4. b. Lieu de fa réfidence. IX 229,
:V. 886. b.
DALAINE, ( rejjbrts ¿ la ) pour les voitures. III. 18. tf»
DALECARLIE , aciéries dans cette province. L 104. b.
IO6. a. b.
DALEM ou Daalhem, ou s’Gravtndal, (Géogr.) ville des
Pays-Bas hollandois. Obfervations fur cette place, 8c fur le
comté dont elle eft capitale. Suppl. IL 679. a.
DALIE, (Géogr.) province de Suede. Defeription de ce
pays. Suppl. IL 679. a.
DALILA , ( Hift. facr. ) vallée de la Paleftine où elle
demeurait. Suppl. IV. 811. b. Voyez S a m s o n .
DALLER germanique, (Comm.) monnoie d’argent. Daller
de Hollande. Daller oriental : on fe plaint aux échelles du
levant de cette monnoie; elle eft même fouvent refid(c?i
IV. 613. b. Daller S. Gai. FbyrrTHALER.
DALMATES, (Géogr. anc.) peuples originaires de nlly-
rie. Conquêtes de ces peuples par lefquelles ils s étendirent
juiqu’à la mer adriatique. Origine du nom Dalmates. Divers
événemens de leur hiftoire. Dalmatie, état aâuel de ce pays»
IV. 614. a.
d a m
DALMATIE, erreur à corriger dans cet article de l’Ency-
Cl%ÎfmàtfeUfn o b E ffîd l terre ferme dans ce pays. XI. 179. g
D A L M A TIQUE, (Hift. ceci.) ornement des diferes 8c
fous - diacres quand ils affiftent le prêtre. Quels autres per-
fonnaees en ont été revêtus. Diverfes obfervations fur 1 ufage
au’on a fait de cet ornement. Ancienne chafuble en ufage dans
réelifc. Cet ornement conftdéré comme fymbole des fuper-
liùités de cette vie. Origine du nom dalmatique. IV. 614. a.
S oyez Habits facrés. - . , ,,
DALOT, (Marine) ptece de bois placée aux côtés du
vaiffeau. Son ufage. Dimenfions des dalots du pont d’en bas
<l’un vaiffeau de cinquante canons. IV. 614. a. Des dalots du
pont d’en haut. Dalots, tuyaux qu’on met dans un brûlot. Ibid.b.
DAM, dommage, perte : différence entre ces mots. IV.
é *DAMAS. (Manuf. en foie. ) Définition qu’en donne le
diâionnaire de Savari : obfervations fur cette définition. Largeur
des damas de Lyon. Quatre fortes de damas. Nombre
des portées qu’il doit avoir. IV. 614- b. Armures des fatins a
cinq liftes. Liffes de rabat. Quelle doit être la diftnbunon des
fils. Armure du damas ordinaire, tantnour le fatin que pour
le rabat. Le damas n’a point d’envers. Ordre qu’on doit futyre
en paffant le liage. Ibid. 613. a. Armure d’un damas ordinaire
broché feulement. Maniéré dont le courfe complet de cette
étoffe doit être conduit, lorfqu’elle eft travaillée à cinq marches
de fatin 8c à cinq de liage. Différentes combinaifons des
xnouvemens de cette manoeuvre. Armure d’un damas liferé;
ou rebordé 8c broché. Ibid. b. Obfervations fur les damas :
toutes les manufaâures de damas qui font en Europe ne fe
fabriquent pas de même. Ibid. 610. a. Règlement du premier
oâobre 1737 fur les damas, comparé au règlement du 8
avril x724pourla manufââure de Turin. Damas des Génois:
damas de Lyon. Comparaifon du travail des uns 8c des autres.
Ibid.b. Autres fortes de damas:damas caffart. zbid. 6x7. a.
Celui de la Chine ou des Indes. Celui d’Abbeville. Celui de
Caux. Celui de Hollande. Ibid. b.
Damas : de la fabrication de cette étoffe : différence des
damas de Lyon 8c de Gênes. XV. 287. b. &c. Modèle d’un
métier d’etoffe fabriquant feul un damas à fleurs. 302. a.
Damas à l’imitation de ceux de Gênes. XVL 492. b.
Damas, fabres de ce nom. IV. 617. b.
■ D a m a s , (Géogr.) fleuve qui traverfe cette ville. XII.
494. a. Bibliothèque de Damas. II. 233. b. Royaume de
Damas. XIV. 420.b. Raifins de Damas. XIII. 769.a. 770. a.
Le fiege de Damas, tragédie angloife. XVII. 621. a.
■ DAMASCENE, (Jean) fa doârine 8c fa maniéré d’en-
ièigner. VHI. 320. a.
DAMASEI, pape. VII. 1007. b. Remarques fur le catalogue
des pontifes Romains, attribué à ce pape. XV. 246. b.
DAMASQUINER, art d’enjoliver le fer ou l’acier. Origine
de ce mot. Les anciens fe font beaucoup appliqués à ce
travail. Ornement de damafquinure. Anneaux antiques travaillés
de cette maniéré. Divers ouvrages damafquinés eii
France. En quoi confifte ce travail ; maniéré de aamafqui-
ner. IV. 617. b. Voyez les planches du Cifeleur 8c Damafqui-
neur dans le III. vol..
DAMASSÉ, tiffu. XVI. 3 34- b.
DAMATER. Obfervations fur cet article de 1 encyclopédie.
Suppl. H. 679. b. .
DAMBACH. en Alface : fon aciérie. 1. 103. b.
DAMBÉE. (Géogr.) Voyez BARCENA.
DAME, ( Hift. mod. ) titre autrefois fort diftingué. Nos
rois ne le donnoient qu’aux femmes de chevaliers ; celles des
écuyersétoient Amplement nommées mademoïfelles. IV. 618 .a.
D a m e du palais, (Hift. de France") titre d’office chez la
reine avec penfion. François 1 introduifit les femmes à la cour.
Pourquoi Catherine de Médicis y introduifit les filles d’honneur.
Aventure qui donna lieu enfuite à l’établiffement des
douze dames du palais. IV. 618. b.
Dame d‘honneur. VIII. 291. a.
Dame, (notre-) églife de^Paris. Plan du pavé du fanâuaire,
& d’une partie du choeur de cette églife. A. 79. a.
Dame (notre-) du chardon, ordre militaire. XI. 234. a.
D a m e , (Archit.) deux chofes différentes qui portent ce
nom. IV. 6x8. b.
D a m e ou demoifelle, (Fortifie.) IV. 6x8.b.
D a m e jeanne, (Marine) grone bouteille de verre. IV. 618. b.
D a m e lopre, (Marine) petit bâtiment de Hollande. Sa
defeription. Son ufage. IV. 6x8. b.
D a m e , (groffesForges) piece qui ferme la porte du creu-
fet, &c. IV. 618. b.
D a m e , (Jeu) TV.618. b.
D a m e s , (Jeu de) deux fortes de jeux de ce nom. Defeription
du jeu de dames foançoifes. Defeription du jeu de dames
Polonoilcs.lv. 6x9. a. ■
D am e s efelayes de la vertu, ( l'ordre des) fon inftitution.
Marque de cette chevalerie. Suppl. II. 679. b.
Dames réunies pour honorer la croix, ( l’ordre des) fon ffifti-
D A N 45.9
tution. Marque de l’ordre. Voyez vol. II. des pl. blafon. pl. 24.
DAMIANISTE, (Hift. ccd.) nom de feâe, en quoi con-
fiftoit la doârine des Ûamianiftes. IV. 6x9. b.
Damumiftes, reügieufes de fainte Claire. III. 300. a.
DAMIÊN, (Pierre) cardinal. XIH.831.«.
DAMIER, ( Jeu ) defeription des damiers françois 8c polo-
nois.IV. éiçj.b.
Damier, autrefois dit tablier. XV. 810. a. IX voL de pl.
Tabletier ,pl. 2»
Damier, oifeau aquatique de l’Amérique méridionale : fa
defeription. XVII." 768. b.
DAMIETTE, voyez P é l u s e : terrible ufage que les Turcs
firent du feu grégeois au fiege de cette ville. Vl. 646. b. Dif-
tance à laquelle Ta mer s’en eft éloignée. XVI. 164. b.
DAMNATION, ( ThéoL ) peine éternelle de l’enfer. Ce
dogme étant révélé dans l’écriture, on ne doit plus s’embar-
| railer fur ce fujet dans une fuite de raifonnemens captieux,
&c. IV. 619. b. Ce qu’on doit plutôt confidérer pour affermir
fa foi fur ce point 8c exciter fa crainte. Ibid. 620. a.
DAMOISEAU, damoifel, damoifclle. (Hift. mod.) Diverfes
révolutions que ce terme a fouffertes. C’étoit anciennement
un nom d’efpérance, 8c qui marquoit quelque forte de
grandeur 8c de feigneurie. Dans l’onzieme & douzième fie-
cles, ce titre étoit propre aux enfans des rois 8c des grands
princes. Dans la fuite ce nom fut donné aux perfonnes nobles
des deux fexes. Étym. du mot 4amoifel ou damoifeau. Nobles
encore appellés damoifeau dans le Béarn. Les fils des rois de
Danemarck 8c ceux de Suede ont porté ce titre. Ces noms ne
font plus d’ufage aujourd’hui.
Demoifelle, uftenfile qu’on met dans le Ut pour chauffer les
piés d’un vieillard. IV. 620. a.
DAMOPHILE 8c Gorgafus, peintres célébrés de la Grece,
XII. 238. b. 8cfculpteurs. XIV. 819. a.
DAMOPHON, fculpteur ancien. XIV. 810. a.
DAN, (Hift.facr.) cinquième fils de Jacob. Signification
de fon nom. Sa nombreufe poftérité. Bénédiâion qu’il reçut
de fon pere. Obfervation fur la tribu de Dan. ViUe du même
nom. Suppl. II. 680. a.
D a n , ( Géogr. facr. ) ville de la tribu de Nephtali. La
même dont il eft parlé dans l’article précédent. Différen*
noms qu’elle a reçus. Suppl. II. 680. a.
D a n , ( Hift. de Danem.) précis du regne de trois rois de
Danemarck qui ont eu ce nom. Suppl. H. 680. a.
DANAÉ, ( Myth. ) fille d’Acrifius, roi d’Argos. Aventures
de cette princeffe. Suppl. II. 680. b. Voyez Suppl. II. 332. a.
DANAIDES, (Mythol.) ce qu’en raconte la fable. On les
appeUe quelquefois Bèlides. IV. 620. b.
Danaides, Ueu où eUes éeorgerent leurs maris. IX 397. a.
Tonneau des Danaides. XVI. 410. b.
DANAUS, (Hift. anc.) roi d’Argos. Suppl. I. 332. a.
DANCHET. (Antoine) Obfervation fur ce poète 8c fes
ouvrages. XIV. 296. a. Ses entrées comiques. II. 45*
D’ANCOURT, (Florentin Cartonfieur) Obfervation fur
fes comédies. Suppl. III. 302. a.
DANDA. ( Géogr. ) Obfervations fur cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. II. 680. b. '
DANDAMIS gymnofophifte : langage qutl tint à Onéfi.
crite. VIII. 673. a.
DANEBROG, ou Danenbrug, ( Hift. mod. ) ordre de ehe
valerie en Danemarck. Événement qui donna lieu à fon infor
tution en 1219. Cet ordre renouvellé en 1671. Marques qui
diftinguent les chevaliers de cet ordre. Titres qu’il faut poi-
féder pour y être admis. IV. 620. b. ■
DANE-GELT, (Hift. mod.) première taxe foncière établie
en Angleterre. Signification de ce mot. Origine de cette
taxe. Elle tut établie par Edouard, 8c Guillaume I la renouvela.
Services 8c fubfides que les rois Saxons recevoient de
de leurs fujets avant que cette taxe eût lieu. IV. 621. a. Voyez
D a n o i s im p ô t ,Sc T a x e des t e r r e s . . . .
DANEMARCK, obfervations géographiques 8c politiques
fur ce royaume. I,V. 621. a. TT /¡¡n
Danemarck,origine du nom de ce royaume. Suppl. IL 680.
b. Armes du roi, voyez planche 13 du blafon, vol. II. Chancelier
de Danemarck. llf.93.tf. Droit de Danemarck. V. 124.
a, b. Foyer D a n o i s . . ,
DANGALA, ( Géop. ) obfervanons fur cet article de 1 tnfvS
e d» Nubie : principales denrées de fon pays.
Æ j ruine d’alun appcllée mine du Dange, près de
L,i$ A N < S , péril, rifque : différence entre ces mots. IV,
6'2i.tf> FevqPtRiL. .
Danger, cérémonie qui fe pratiquoit àRome dans les grands
daîfANGER, (Jurifpr.) en matière d’eaux 8c fo rê ts , fignifie
dîme ou dixième. Divers éclairciffemens fur ce droit, l v • 021*
a. Son ancienneté. En quoi il confifte. Pourquoi 1on
termes de tiers 6* danger. Comment l’ordonnance de 16O9